Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Négociations de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
Évaluation environnementale stratégique initiale - Février 2012
Table des matières
- I. Résumé
- II. Aperçu du processus d’évaluation environnementale
- III. Commentaires du public
- IV. Commerce et environnement
- V. Aperçu de la relation économique entre le Canada et l’Union Européenne
- VI. Résultats de l’évaluation environnmentale initiale
- VII. Coopération environnementale
- VIII. Conclusion de l’évaluation environnementale initiale
I. Résumé
En mai 2009, les dirigeants du Canada et de l’Union européenne (UE) ont entamé des négociations en vue de conclure un accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE. La décision de lancer ces négociations reposait sur l’Étude conjointe Canada-UE d’octobre 2008, intitulée Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada.Footnote 1 (l’« Étude conjointe &187;) et leur portée a été définie dans le Rapport conjoint Canada-Union européenne de mars 2009 : Vers un accord économique approfondiFootnote 2(le « Rapport sur l’établissement de la portée &187;). Selon les conclusions de l’Étude conjointe, l’accroissement des échanges avec l’UE, le deuxième partenaire commercial du Canada, créerait d’importants débouchés économiques dans plusieurs secteurs, tandis que le Rapport sur l’établissement de la portée a abouti à la conclusion que le maximum d’avantages pour les deux parties découlerait du plus grand degré possible de libéralisation.
Le gouvernement du Canada s’engage à effectuer des évaluations environnementales de l’ensemble de ses négociations commerciales. Une évaluation environnementale des négociations commerciales vise deux objectifs : aider les négociateurs canadiens à intégrer la dimension environnementale dans le processus de négociation et montrer comment les facteurs environnementaux sont pris en compte dans les négociations. Grâce au processus d’évaluation environnementale, le Canada compte garantir que les accords commerciaux proposés contribuent au développement de l’économie canadienne de manière durable. Conformément au Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales de 2001 (le« Cadre &187;)Footnote 3, ce rapport constitue l’évaluation environnementale initiale d’Affaires étrangères et Commerce international Canada des négociations de l’AECG. Selon le Cadre, l’objectif principal d’une évaluation environnementale initiale consiste à examiner les principaux enjeux environnementaux susceptibles de se présenter au Canada par suite de l’accord proposé. Cette évaluation met l’accent sur les incidences économiques et environnementales potentielles au Canada découlant d’un AECG avec l’UE en étudiant les liens entre l’accès aux marchés, l’investissement et la réglementation environnementale au Canada. Autrement dit, cette évaluation tient compte des effets au Canada des nouveaux échanges et investissements qui pourraient découler directement des négociations de l’AECG. Ainsi, cette évaluation environnementale initiale n’a pas pour objet de prévoir avec certitude les résultats précis d’un AECG avec l’UE, comme de nouveaux projets ou investissements. L’évaluation environnementale initiale est plutôt une étude de délimitation de la portée, qui évalue les incidences environnementales possibles au Canada au moyen de jugements avisés sur les changements potentiels qui résulteraient de l’augmentation de l’activité économique découlant d’un AECG entre le Canada et l’UE.
Les changements technologiques, l’augmentation de la demande et la réallocation des ressources auront un effet permanent sur l’économie canadienne, qu’il y ait ou non un AECG avec l’UE. La croissance dans les secteurs des services, de l’agriculture et de l’industrie dépendra d’une interaction complexe des forces économiques, en plus de la libéralisation du commerce qui découlera de tout accord commercial. De surcroît, les gouvernements fédéral et provinciaux continueront d’adopter de nouvelles lois et de nouveaux règlements, et le Canada continuera de conclure des accords avec d’autres États. Par conséquent, isoler les effets économiques additionnels attribuables exclusivement à la libéralisation du commerce dans le cadre d’un accord entre le Canada et l’UE constitue un véritable défi. Quoi qu’il en soit, la présente évaluation vise à examiner les effets environnementaux des activités économiques et des changements à la politique commerciale résultant des négociations de l’AECG.
Aperçu des constatations de l’évaluation environnementale initiale
Dans le contexte des négociations de l’AECG, le Canada et l’Union européenne (UE) ont convenu de négocier des dispositions sur la protection de l’environnement en vertu desquelles les deux parties s’engageront à maintenir des niveaux élevés de protection de l’environnement et à s’assurer que les lois et règlements environnementaux atteignent leurs objectifs tout en ne faisant pas en même temps office d’obstacles au commerce.
Cette évaluation environnementale initiale des négociations de l’AECG avec l’UE se divise en deux parties principales :
- l’Analyse qualitative et
- l’Analyse quantitative.
Les incidences potentielles sur l’environnement et leur importance y sont analysées, de même que les possibilités d’atténuation et de renforcement.
Il ressort de l’analyse qualitative et de l’analyse quantitative que, au total, les effets directs que peuvent avoir les négociations de l’AECG sur l’environnement au Canada seront vraisemblablement mineurs. Cette conclusion est fondée sur les facteurs suivants : 1) l’analyse quantitative a montré que l’impact net de l’accroissement du commerce bilatéral avec l’UE sur l’environnement au Canada serait mineur si l’on tient compte des changements prévus en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’utilisation d’énergie et l’usage des eaux; 2) il existe déjà une législation environnementale en vigueur, ou une telle législation sera mise en place, pour atténuer les effets adverses; 3) bon nombre de domaines de négociation dans le cadre de l’AECG Canada-UE ont pour objet la facilitation du commerce (p. ex. dispositions visant à clarifier les procédures ou à établir un système de notification et d’enregistrement), et, par conséquent, on ne s’attend pas à ce qu’ils aient des effets directs sur l’environnement. Les quatre domaines où il existe une plus forte probabilité d’effets environnementaux ont fait l’objet d’un examen détaillé dans le cadre de l’analyse; ce sont : le commerce des biens, le commerce des services, les marchés publics et l’environnement.
En ce qui a trait au commerce des biens, un AECG avec l’UE devrait entraîner un accroissement des exportations canadiennes dans plusieurs secteurs faisant actuellement face à des obstacles tarifaires et non tarifaires. Les changements qui en résultent sur le plan de la production pourraient avoir des incidences environnementales en raison des émissions et des déchets causés par la production de biens, des incidences sur la consommation des ressources, et des effets de l’augmentation des activités liées au transport. On prévoit, toutefois, que la majorité de ces impacts seront contrebalancés par divers facteurs d’atténuation. Par exemple, les facteurs d’atténuation comme les efficiences accrues dans les processus de production découlant des effets techniques et de composition sur la production serviraient à réduire les incidences environnementales de telles augmentations de la production. En outre, toutes les activités de production sont assujetties aux lois et aux règlements environnementaux canadiens. Comme le Canada et l’UE ont des normes environnementales rigoureuses, les risques pour le Canada provenant des dangers environnementaux potentiels associés aux biens importés de l’UE devraient être pris en compte de manière adéquate. Des impacts positifs sont aussi possibles, en particulier dans les domaines où un AECG pourrait entraîner une coopération bilatérale accrue.
Un AECG devrait faciliter l’accroissement des échanges de services entre le Canada et l’UE. La coopération accrue dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, de la coopération en matière de réglementation et de la science et de la technologie devrait également contribuer à accroître les échanges de services. La plupart des services qui bénéficieront de cette libéralisation dans le cadre d’un AECG avec l’UE seraient vraisemblablement dans les secteurs virtuels (c.-à-d. ceux sans composante physique, comme la consultation juridique), avec moins de risque d’incidences environnementales négatives. Les incidences environnementales négatives comme l’utilisation accrue de l’énergie et les déchets électroniques (e-déchets) causées par l’accroissement du commerce des services devraient être atténuées par des augmentations au chapitre des pratiques environnementales durables dans le secteur des services.
L’accès accru de l’Europe aux marchés publics canadiens ne devrait pas avoir une incidence importante sur l’environnement. Bien qu’il puisse y avoir une augmentation marginale des répercussions négatives de la main-d’œuvre et des biens sur le transport par suite d’un accord, celles-ci pourraient être contrebalancées par une incidence légèrement positive étant donné que les gouvernements bénéficiant d’une concurrence accrue et d’options plus vastes se procurent les technologies les plus efficientes. En outre, les marchés publics tendent à être régis par des directives et des politiques strictes à l’égard de la gérance environnementale, et ces politiques resteront en vigueur avec ou sans un AECG. Cela comprend le maintien de la capacité des gouvernements canadiens de se procurer des produits respectueux de l’environnement.
En ce qui concerne l’investissement, le Canada négocie des dispositions relatives à la protection des investissements, qui énoncent clairement le droit des gouvernements à établir des politiques et des règlements dans l’intérêt de la population. Le Canada fera fond sur son expérience d’atténuation de telles incidences dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Néanmoins, un AECG Canada-UE ne devrait pas entraîner de modification sensible du régime d’investissement canadien, déjà largement ouvert, et il serait difficile de faire la distinction entre les effets d’une négociation de l’AECG et ceux découlant d’un intérêt étranger accru à l’égard de l’investissement au Canada. Par conséquent, toute incidence environnementale de l’investissement directement attribuable à l’AECG avec l’UE devrait être mineure. Des options d’atténuation existent dans les secteurs intensifs sur le plan environnemental comme l’exploitation minière et pétrolière / gazière, et sont décrites plus en détail dans l’évaluation. En outre, toutes les incidences environnementales potentielles seront atténuées par les lois contraignant les investisseurs étrangers à respecter les mêmes règlements environnementaux auxquels sont assujettis les investisseurs au pays.
Vu l’importance d’un AECG entre le Canada et l’UE pour l’économie canadienne, le gouvernement a effectué une modélisation quantitative supplémentaire dans le cadre de cette analyse pour compléter l’évaluation qualitative qui forme la base de l’évaluation environnementale initiale. Au moyen du modèle économique de l’Étude conjointe et des données environnementales de Statistique Canada et d’Environnement Canada, le Bureau de l’économiste en chef du MAECI a évalué trois indicateurs environnementaux : les gaz à effet de serre, l’utilisation de l’énergie et l’utilisation de l’eau. Les effets de trois catalyseurs (l’effet d’échelle, l’effet de composition et l’effet technique), par lesquels un changement aux politiques commerciales pourrait avoir une incidence sur le niveau de pollution et le rythme d’épuisement des ressources environnementales rares, ont aussi été évalués. La modélisation quantitative a indiqué que l’incidence nette de l’accroissement des échanges bilatéraux avec l’UE sur l’environnement au Canada serait caractérisée par des augmentations mineures des émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’énergie et de l’utilisation de l’eau. Toutefois, ces augmentations sont sensiblement plus petites que l’augmentation correspondante du PIB et de la production, ce qui signifie qu’un AECG avec l’UE entraînerait probablement une évolution vers une composition plus favorable de l’industrie canadienne en termes d’émissions. L’analyse quantitative conclut que l’incidence nette de l’accroissement des échanges bilatéraux avec l’UE sur l’environnement au Canada serait mineure compte tenu des changements prévus sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’énergie et de l’utilisation de l’eau.
En conclusion, l’analyse de l’évaluation environnementale initiale indique qu’un AECG avec l’UE ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur l’environnement.
Prochaines étapes :
À la lumière de cette conclusion et conformément au Cadre, le gouvernement procédera directement à la phase de l’évaluation environnementale finale.
L’évaluation environnementale finale sera rendue publique après la conclusion des négociations. Au besoin, elle comprendra un examen de toute analyse subséquente réalisée et documentera les commentaires reçus en réponse à l’évaluation environnementale initiale des effets environnementaux potentiels de l’Accord sur le Canada.
Suite à la conclusion du rapport d’évaluation environnementale finale, on pourrait assurer, au besoin, un suivi et une surveillance afin d’examiner toute mesure d’atténuation ou de renforcement qui serait recommandée ultimement par ce rapport. Les activités de surveillance et de suivi peuvent être entreprises à tout moment durant la mise en œuvre d’un accord commercial afin d’évaluer la performance de ses dispositions du point de vue environnemental.
II. Aperçu du processus d’évaluation environnementale
Le gouvernement du Canada est résolu à mener des évaluations environnementales sur toutes les négociations en rapport avec le commerce et les investissements à l’aide d’un processus qui fait appel à la fois à la collaboration interministérielle et à des consultations publiques. Le Cadre d’évaluation environnementale des négociations commerciales de 2001 expose ce processus en détail. Il a été mis au point pour donner suite à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.Footnote 4 Des directives détaillées sur l’application du Cadre se trouvent dans le Guide pour l’évaluation environnementale des négociations commercialesFootnote 5 (le « Guide &187;). Les lignes directrices révisées pour la mise en œuvre de la Directive du Cabinet exigent que les ministères décrivent, de façon détaillée, l’étendue et la nature des répercussions sur l’environnement qui pourraient découler de la mise en œuvre des propositions ainsi que l’incidence que celles-ci pourraient avoir sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable.
Le Cadre décrit le processus et la méthode à suivre pour mener l’évaluation environnementale des négociations commerciales. Il est souple à dessein, de façon à pouvoir être utilisé au cas par cas selon la nature de l’accord négocié. Les objectifs du processus d’évaluation environnementale des négociations commerciales, tels que décrits dans le Cadre, sont les suivants :
- aider les négociateurs canadiens à tenir compte des considérations environnementales dans le processus de négociation en leur fournissant des données sur les incidences environnementales d’un accord commercial et/ou d’investissement proposé.
- documenter comment les facteurs environnementaux sont pris en compte au cours des négociations commerciales.
Le Cadre prévoit trois étapes pour l’évaluation :
- Évaluation environnementale initiale : examen préliminaire visant à cerner les grands enjeux éventuels.
- Évaluation environnementale préliminaire : au besoin, s’appuie sur les constatations de l’évaluation environnementale initiale et comporte une analyse approfondie de ces enjeux.
- Évaluation environnementale finale : réalisée à l’issue des négociations.
À la conclusion de chaque phase, un rapport est rendu public, accompagné d’une invitation à soumettre des commentairesFootnote 6. Si, au terme de l’évaluation environnementale initiale, on constate qu’il est peu probable que l’accord ait des incidences importantes sur l’environnement, il ne sera pas nécessaire de rédiger une évaluation environnementale préliminaire. Dans de telles circonstances, on continue toutefois de tenir compte des considérations environnementales lors des discussions en cours et une évaluation environnementale finale devra toujours être rédigée.
Si les négociateurs l’exigent, on peut procéder à un suivi et à un contrôle au terme du processus d’évaluation environnementale afin d’examiner chacune des mesures d’atténuation ou de renforcement recommandées dans l’évaluation environnementale finale.
Méthode d’évaluation
Le Cadre prévoit une méthode analytique en quatre étapes pour la conduite des évaluations environnementales initiales, provisoires et finales. Les directives sur la façon d’effectuer chaque étape de l’analyse sont présentées dans le Guide.
- Détermination des effets économiques de l’accord à négocier. Cette étape a pour objet de déterminer l’activité de libéralisation du commerce visée par l’accord faisant l’objet de négociations. On y examine les secteurs que l’accord potentiel pourrrait inclure, les changements ou les nouvelles activités commerciales qui pourraient en résulter et la portée économique globale à l’échelle du Canada. On peut ainsi déterminer l’étendue de l’analyse à mener dans le cadre de l’évaluation environnementale et établir l’ordre de priorité des questions à évaluer.
- Détermination des incidences environnementales probables de tels changements. Une fois estimés les effets économiques de l’accord commercial proposé, on établit approximativement les incidences environnementales probables de tels changements. On tient compte des incidences positives et négatives potentielles. Footnote 7
- Évaluation de l’importance des incidences environnementales probables cernées. On évalue ensuite l’importance des incidences environnementales probables cernées. Dans le Cadre, on définit divers critères permettant de déterminer leur importance, dont la fréquence, la durée, la permanence, l’étendue géographique et l’ampleur, le degré de risque, l’irréversibilité des incidences et les synergies possibles entre les incidences. Pour qualifier l’importance, l’étude recourt à l’échelle suivante en rapport avec les critères susmentionnés : aucune, mineure, modérée, élevée et extrême.
- Détermination des options de renforcement/d’atténuation qui serviront à orienter les négociations. L’évaluation environnementale initiale a pour objet de déterminer, dans un premier temps, les options ou mesures stratégiques possibles qui pourraient s’imposer afin d’atténuer les incidences négatives potentielles et/ou de renforcer les incidences positives potentielles qui pourraient découler de l’accord proposé.
L’évaluation environnementale des négociations commerciales exige une collaboration interministérielle.Footnote 8 Un comité interministériel est créé pour examiner l’évaluation environnementale de chacune des négociations et réunit des responsables des ministères participant aux négociations, notamment Environnement Canada et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Cette approche facilite l’élaboration de politiques et la prise de décisions éclairées dans l’ensemble du processus de négociation.
Le processus d’évaluation environnementale comprend également des consultations auprès du public, des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux et du Groupe consultatif sur l’évaluation environnementale (GCEE) non-gouvernemental. Le GCEE se compose de personnes provenant du secteur des affaires, du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales qui fournissent des conseils en leur nom propre sur le processus d’évaluation du MAECI. Au terme de chaque étape d’évaluation (c.-à-d. évaluation initiale, évaluation provisoire et évaluation finale), les évaluations environnementales sont transmises aux représentants provinciaux et territoriaux ainsi qu’au GCEE pour solliciter leur rétroaction initiale avant d’être publiées afin de recueillir les commentaires du public.
L’évaluation environnementale initiale
L’évaluation environnementale initiale est un exercice de prévision qui permet de déterminer les effets environnementaux potentiels résultant d’une négociation commerciale et qui offre l’occasion de réfléchir aux enjeux environnementaux pendant le déroulement des négociations. La présente évaluation environnementale initiale se concentre sur les effets économiques et environnementaux potentiels au Canada découlant d’un AECG avec l’UE, en examinant les liens existants entre l’accès aux marchés, les investissements et les répercussions environnementales au Canada. En d’autres termes, cette évaluation considère les effets environnementaux de nouveaux flux de commerce et d’investissement au Canada qui peuvent résulter directement d’un AECG.
Alors que se déroulent encore les négociations de l’AECG, il existe un certain degré d’incertitude associé à la détermination de leurs résultats. Les changements réels à la politique commerciale que nécessite un éventuel accord ne seront peut-être connus qu’après la conclusion de l’AECG Canada-UE, son entrée en vigueur et la mise en œuvre intégrale des obligations qui en découlent.
Structure de l’évaluation environnementale initiale
L’évaluation environnementale initiale des négociations de l’AECG Canada-UE est divisée en deux parties :
Partie 1 – Analyse qualitative
L’analyse qualitative commence par donner un aperçu général des enjeux d’ordre qualitatif faisant l’objet des négociations, ainsi qu’un bref résumé de leurs effets environnementaux potentiels, positifs et négatifs. Suit une analyse plus détaillée des effets environnementaux potentiels dans quatre domaines clés où des effets environnementaux peuvent être enregistrés. Bien qu’on considère comme peu probables des impacts environnementaux majeurs, les quatre domaines où la possibilité de tels impacts est la plus élevée, compte tenu des changements anticipés dans le cadre de l’AECG Canada-UE, sont les suivants : le commerce des biens, le commerce des services, les marchés publics et l’investissement. Chaque domaine est évalué au moyen d’une méthodologie en quatre étapes, définie précédemment dans le rapport, qui vise à déterminer : a) les effets économiques potentiels et la manière dont ils peuvent se matérialiser, b) les effets environnementaux potentiels, suivis d’une analyse de ces derniers c) l’importance des effets environnementaux potentiels et, enfin d) des options d’atténuation des impacts potentiels/ de renforcement.
Partie 2 – Analyse quantitative
L’analyse économique et environnementale quantitative a été élaborée par le Bureau de l’économiste en chef du MAECI pour évaluer l’impact environnemental au Canada résultant de l’augmentation des échanges commerciaux et de la coopération économique entre le Canada et l’Union européenne en vertu de l’AECG Canada-UE. L’évaluation a été effectuée en fonction des incidences économiques estimées du modèle informatique d’équilibre général (IEG) de l’Étude conjointe. L’impact environnemental de l’AECG avec l’UE est exprimé par trois catégories d’indicateurs environnementaux : les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’utilisation de l’énergie et l’utilisation de l’eau. L’impact environnemental résultant d’une expansion des échanges commerciaux et du renforcement de la coopération économique au titre de l’AECG est subdivisé en trois composantes : l’effet d’échelle, l’effet de composition et l’effet technique. L’analyse quantitative vise à compléter et à renforcer l’analyse qualitative.
III. Commentaires du public
Comme l’exige le Cadre, un avis d’intention de procéder à une évaluation environnementale stratégique des négociations de l’AECG Canada-UE a été publié le 18 juillet 2009.Footnote 9 Cet avis invitait les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires à prendre en compte dans le cadre de la rédaction de l’évaluation environnementale initiale. Peu de commentaires publics ont été reçus au cours de l’étape de la consultation.
Le gouvernement sollicite les contributions et commentaires portant sur cette évaluation environnementale initiale. On invite également le public à faire part au gouvernement, à l’adresse suivante, de ses suggestions sur la façon d’améliorer les mesures d’atténuation relatives aux incidences environnementales négatives potentielles et de renforcer les incidences positives qui ont pu être décelées à cette étape-ci :
Secrétariat de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (TEU)
Évaluation environnementale – AECG Canada-UE
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0G2
Téléc. : 613-943-1102
Courriel : ceta_ea_consultations_aecg_ee@international.gc.ca
IV. Commerce et environnement
Le gouvernement du Canada est résolu à s’assurer que ses négociations commerciales tiennent compte de la durabilité de l’environnement afin d’encourager l’établissement d’objectifs commerciaux et environnementaux qui se renforcent mutuellement. L’importance des résultats commerciaux et environnementaux qui se renforcent mutuellement est soulignée par la forte corrélation entre les marchés ouverts, le développement économique et la protection de l’environnement. Un système commercial fondé sur des règles et des marchés encadrés par des règlements efficaces constituent des éléments de base clés de la croissance et du développement économiques. La réduction des obstacles au commerce joue un rôle important pour faciliter l’échange de technologies respectueuses de l’environnement et pour établir des règles d’investissement qui aident à créer les conditions nécessaires aux transferts de technologies. En outre, les dispositions en matière d’environnement des accords commerciaux peuvent comprendre d’autres engagements et obligations contribuant à la protection et à la conservation de l’environnement.
Parallèlement, une augmentation des investissements et une plus grande intégration économique à l’échelle mondiale pourraient avoir une incidence sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) du Canada. La SFDD constitue la stratégie de développement durable globale du gouvernement. L’évaluation environnementale de ces négociations commerciales tient compte des objectifs et des cibles de la SFDD.Footnote 10
La détermination des effets environnementaux probables et importants d’un accord commercial proposé permet aux négociateurs de déterminer si les mécanismes actuels, comme les cadres de règlementation et les évaluations environnementales des nouveaux projets de développement commercial sont suffisants pour atténuer toute incidence cernée découlant d’un accord proposé, et d’examiner la nécessité de mesures d’atténuation supplémentaires. L’objectif consiste à s’assurer que la mise en œuvre des accords commerciaux réduit au minimum les incidences négatives sur l’environnement tout en contribuant en même temps au bien-être économique des Canadiens.
Reconnaissant que l’accroissement de l’activité économique peut mener à des répercussions sur l’environnement tant positives que négatives, le Canada et l’Union européenne (UE) ont convenu de négocier des dispositions sur la protection de l’environnement dans un AECG afin de garantir que les deux parties maintiennent des niveaux élevés de protection de l’environnement et que les lois et règlements en matière d’environnement réalisent leurs objectifs tout en ne constituant pas d’obstacles au commerce.
Comme tous les accords de libre-échange du Canada, un AECG avec l’UE sera conforme aux obligations du Canada en vertu des accords multilatéraux sur l’environnement, comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.Footnote 11
V. Aperçu de la relation économique entre le Canada et l’Union Européenne
Composée de vingt-sept États membres et dotée d’une population totale de 502 millions d’habitants et d’un produit intérieur brut (PIB) de 16,7 billions $ (12,3 billions €) en 2010, l’Union européenne (UE) constitue le plus grand marché du monde et le plus important investisseur et négociant étranger. L’UE est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada tant pour les biens que pour les services. En 2010, les exportations de biens et services canadiens vers l’UE se sont élevées à 49,1 milliards $. Les importations de biens et services en provenance de l’UE se sont, quant à elles, chiffrées à 55,2 milliards $. L’UE compte 11 des 21 marchés prioritaires du Canada pour l’investissement. Elle représentait une part de 148,7 milliards $ des stocks d’investissements étrangers directs (IED) au Canada à la fin de 2010, ce qui constituait 26,5 % de ces stocks. En 2010, le stock d’investissements directs du Canada au sein de l’UE s’élevait à 145,7 milliards $, représentant 23,6 % de l’investissement direct canadien à l’étranger. Les principaux secteurs d’intérêt des entreprises canadiennes au sein de l’UE comprennent les technologies de l’information et des communications, l’aérospatiale et la défense, les sciences de la vie, l’agriculture et l’agroalimentaire ainsi que les produits, les services et les technologies de l’environnement.
Le Canada a déjà conclu plusieurs autres accords avec l’UE.Footnote 12 Par exemple, un accord vétérinaire bilatéral avec l’UE est en vigueur depuis 1998. La coopération en vertu de cet accord a permis de trouver des solutions constructives à la gestion des questions de santé animale, tout en assurant des normes élevées en matière de protection de la santé publique. En décembre 2009, le Canada et l’UE ont conclu un accord historique sur le transport aérien. L’Accord, négocié dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada, donne aux entreprises de transport aérien la souplesse nécessaire pour offrir des services aériens mieux adaptés et des tarifs réduits au profit des voyageurs, des expéditeurs ainsi que des secteurs du tourisme et des affaires.
Le Canada et l’UE s’engagent également dans la coopération scientifique et technologique à de nombreux niveaux et à travers les frontières des secteurs publics et privés. L’Accord de coopération scientifique et technologique de 1996 entre le Canada et l’UE permet aux ressortissants canadiens et de l’UE d’avoir accès aux programmes de chacune des parties sur la base de l’autofinancement. L’UE est un intervenant principal dans la coopération scientifique et technologique à l’échelle mondiale par des programmes comme le Septième programme-cadreFootnote 13, qui permettra d’investir environ 69,3 milliards $ (50,7 milliards €) en recherche et développement, avec une intention explicite de faciliter l’accroissement de la coopération internationale. La collaboration du Canada avec l’UE s’avère particulièrement dynamique dans les secteurs de la technologie de l’information et des communications et de l’agriculture. Des progrès sont également accomplis en recherche sur la santé; d’autres secteurs prometteurs comprennent les aliments fonctionnels, les technologies en matière d’efficacité énergétique, la bioénergie et la technologie de l’information et des communications.
En outre, le Canada a conclu un certain nombre d’accords économiques bilatéraux avec plusieurs pays de l’Union européenne, portant sur un éventail de questions économiques. Par exemple, les accords fiscaux protègent les consommateurs et les entreprises de la double imposition. Des accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) ont été conclus pour protéger les investisseurs canadiens qui font des affaires à l’étranger et encourager l’investissement et la croissance des entreprises canadiennes. Ces accords réduisent les obstacles qui nuisent aux affaires, permettent aux Canadiens de tirer avantage des possibilités offertes sur le marché européen et encouragent les Européens à investir sur le marché canadien.
Des liens économiques plus étroits avec l’UE par un AECG augmenteraient considérablement l’avantage concurrentiel du Canada dans le monde. Selon l’Étude conjointe, une plus grande libéralisation du commerce pourrait offrir d’importants avantages économiques tant au Canada qu’à l’UE. L’étude révèle qu’un accord, une fois mis entièrement en œuvre, pourrait se traduire par un apport de 12 milliards $ au PIB du Canada et entraîner un accroissement du commerce bilatéral d’au moins 20 % entre le Canada et l’UE.Footnote 14
VI. Résultats de l’évaluation environnementale initiale
L’évaluation environnementale initiale comporte deux niveaux d’analyse – l’Analyse qualitative (Partie 1) et l’Analyse quantitative (Partie 2).
Partie 1 : Analyse qualitative
Aperçu des résultats qualitatifs
L’analyse qualitative se subdivise ci-dessous en un aperçu général (tous les secteurs) et en une analyse approfondie (quatre secteurs d’intérêt clés).
L’Aperçu général de tous les secteurs d’intérêt qualitatifs ci-dessous offre un résumé de l’ensemble des secteurs faisant l’objet des négociations et leur incidence potentielle sur l’environnement. L’aperçu traite les vingt-trois domaines de négociation établis à l’origine entre le Canada et l’UE, notamment : le commerce des biens, la facilitation des échanges, les règles d’origine, les procédures d’origine, les obstacles techniques au commerce, la coopération en matière de règlementation, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les recours commerciaux, les subventions, le commerce des services, le séjour temporaire, l’investissement, les services financiers, les télécommunications, le commerce électronique, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, les monopoles et les entreprises d’État, la politique de concurrence, le travail, l’environnement, le règlement des différends et les dispositions institutionnelles.
Une analyse plus approfondie des incidences potentielles sur l’environnement dans quatre secteurs d’intérêt clés, de leur importance et des possibilités d’atténuation et de renforcement est présentée après l’aperçu général. Ces quatre secteurs, qui présentent le plus grand risque d’incidences environnementales, sont les suivants : commerce des biens, commerce des services, marchés publics et investissement.
Aperçu général de tous les secteurs d’intérêt qualitatifs
Secteur : Préambule
Résultat attendu
- Les dispositions du préambule feraient normalement référence à l’engagement continu des parties à l’égard du développement durable et de la coopération sur les questions environnementales.
- De telles dispositions offrent le contexte et les « énoncés d’aspirations &187; sur la manière dont un AECG devrait être interprété.
Incidences possibles sur l’environnement
- En soulignant l’engagement du Canada à l’égard de la gérance de l’environnement, ces dispositions pourraient avoir des effets positifs indirects.
Secteur : Objectifs
Résultat attendu
- Les objectifs comprennent normalement les éléments suivants : établissement d’une zone de libre-échange; rapport aux autres accords; rapport aux accords sur l’environnement et la conservation; portée des obligations.
Incidences possibles sur l’environnement
- Lorsque de telles dispositions font référence aux accords multilatéraux sur l’environnement et la conservation, elles pourraient servir à souligner les engagements des parties à l’égard de la gérance de l’environnement.
Secteur : Facilitation des échanges
Résultat attendu
- L’objectif des dispositions relatives à la facilitation des échanges consiste à simplifier les procédures douanières et à faciliter la circulation des biens.
Incidences possibles sur l’environnement
- La facilitation du mouvement des biens peut accroître les incidences environnementales, comme celles dans le secteur des transports, mais peut également avoir des effets positifs indirects grâce à la réduction des coûts de transaction.
Secteur : Règles d’origine
Résultat attendu
- L’objectif des règles d’origine consiste à s’assurer que les avantages d’un accord sont applicables aux biens originaires du territoire de l’une ou l’autre des parties.
- Les négociateurs cherchent à obtenir des règles claires et simples à comprendre.
Incidences possibles sur l’environnement
- Les changements sur les plans de la production et de la consommation découlant des règles d’origine se rapportant spécifiquement aux produits seraient compris dans la section consacrée au commerce des biens, de même que les incidences environnementales correspondantes.
Secteur : Procédures d’origine
Résultat attendu
- L’objectif de telles procédures consiste à s’assurer que les règles d’origine sont administrées de manière juste et transparente par l’administration douanière et à fournir à la communauté commerçante les moyens de tirer avantage du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’accord commercial.
Incidences possibles sur l’environnement
- Le renforcement de l’administration des règles d’origine peut offrir des avantages commerciaux et environnementaux en réduisant les coûts et les retards pour les négociants, tout en réduisant au minimum les incidences environnementales liées au mouvement des biens par des efficiences accrues au chapitre des transports, la promotion d’environnements sans support papier et d’autres facteurs d’atténuation.
Secteur : Obstacles techniques au commerce
Résultat attendu
- De telles dispositions affirmeraient les engagements pris en vertu de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce.Footnote 15
Incidences possibles sur l’environnement
- Dans la mesure où ces dispositions renforcent la gérance de l’environnement, celles-ci pourraient avoir des effets positifs indirects.
Secteur : Coopération en matière de réglementation
Résultat attendu
- De telles dispositions feraient la promotion d’une plus grande coopération dans le domaine des mesures relatives aux normes, aborderaient les questions de transparence horizontale, y compris les avis et la participation aux processus de consultation, et établiraient un mécanisme permettant de fournir des directives sur la détermination, la gestion et la résolution des questions portant sur les mesures relatives aux normes, afin d’éviter les différends.
Incidences possibles sur l’environnement
- De telles dispositions contribueraient à l’atteinte de niveaux élevés de sécurité afin de protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale ainsi que l’environnement et les consommateurs.
- Dans la mesure où de telles dispositions renforcent la gérance de l’environnement, celles-ci pourraient avoir des effets positifs indirects.
Secteur : Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
Résultat attendu
- De telles dispositions réaffirmeraient les engagements pris dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)Footnote 16 et confirmerait que les parties s’engagent à continuer de recourir aux procédures de règlement des différends de l’OMC pour régler les désaccords officiels sur les mesures SPS.
- En outre, on peut envisager la mise sur pied d’un mécanisme bilatéral servant à gérer les enjeux SPS de manière à éviter les différends.
Incidences possibles sur l’environnement
- Les mesures SPS ont pour but de protéger la vie humaine, animale et végétale ainsi que la santé sur le territoire de chaque partie.
- Des incidences positives pourraient découler d’une augmentation de la coopération bilatérale avec l’UE.
Secteur : Recours commerciaux
Résultat attendu
- Ces dispositions protégeraient les producteurs au pays des difficultés temporaires liées à la libéralisation bilatérale du commerce (p. ex. hausse soudaine des importations).
Incidences possibles sur l’environnement
- On ne sait pas si de telles mesures seraient prises, ni sur quels produits. Par conséquent, il n’est pas possible de prévoir les répercussions environnementales probables.
Secteur : Subventions
Résultat attendu
- De telles dispositions viseraient à délimiter les droits et obligations des parties en matière de subventions.
Incidences possibles sur l’environnement
- De telles dispositions ne devraient avoir aucun effet environnemental direct.
Secteur : Séjour temporaire
Résultat attendu
- De telles dispositions faciliteraient les déplacements temporaires des gens d’affaires.
- Elles favorisent les échanges de biens et de services ainsi que les investissements bilatéraux grâce à la négociation d’un accès plus libre au moyen de la dérogation aux prescriptions réglementaires, telles que les critères d’offre d’emploi.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il n’est pas possible en ce moment de prévoir les accroissements probables sur le plan des voyages d’affaires et des séjours temporaires découlant d’un accord.
- Il est peu probable que de telles dispositions aient des incidences directes sur l’environnement.
Secteur : Services financiers
Résultat attendu
- De telles dispositions serviraient à promouvoir des engagements de grande qualité tournés vers l’avenir en matière d’accès aux marchés et à améliorer la transparence réglementaire dans le secteur des services financiers.
Incidences possibles sur l’environnement
- Ainsi qu’expliqué en détail dans la section sur le commerce des services, les répercussions environnementales probables, s’il y en a, seraient minimes.
Secteur : Télécommunications
Résultat attendu
- De telles dispositions font en sorte que les règlements sur les réseaux et services publics de télécommunications et de transport ne nuisent pas aux engagements pris en matière d’accès aux marchés, et fournissent un marché ouvert et concurrentiel pour les services en télécommunications.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il serait improbable que de telles dispositions se traduisent par des répercussions directes sur l’environnement.
Secteur : Commerce électronique
Résultat attendu
- De telles dispositions garantissent un environnement prévisible pour la conduite du commerce électronique.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il est peu probable qu’il y ait des répercussions directes sur l’environnement.
Secteur : Droits de propriété intellectuelle
Résultat attendu
- De telles dispositions concernent l’extension potentielle des dispositions sur la propriété intellectuelle (PI) au-delà des niveaux minimums en vertu de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.Footnote 17
Incidences possibles sur l’environnement
- Il est peu probable que de telles dispositions aient un effet direct sur l’environnement, car elles ne mèneront sans doute pas directement à une augmentation de la production ou des échanges.
Secteur : Monopoles et entreprises d’État
Résultat attendu
- De telles dispositions garantissent que les pratiques d’affaires anticoncurrentielles ne compromettent pas les avantages de l’Accord.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il est peu probable que de telles dispositions aient un effet direct sur l’environnement, car elles ne mèneront sans doute pas directement à une augmentation de la production ou des échanges.
Secteur : Politique de concurrence
Résultat attendu
- De telles dispositions garantissent que les pratiques d’affaires anticoncurrentielles ne compromettent pas les avantages de l’Accord.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il est peu probable que de telles dispositions aient un effet direct sur l’environnement, car elles ne mèneront sans doute pas directement à une augmentation de la production ou des échanges.
Secteur : Travail
Résultat attendu
- De telles dispositions garantissent le respect des principes reconnus sur la scène internationale en matière de travail et l’application efficace des lois nationales sur le travail.
Incidences possibles sur l’environnement
- Il est peu probable que de telles dispositions aient un effet direct sur l’environnement, car elles ne mèneront sans doute pas directement à une augmentation de la production ou des échanges.
Secteur : Environnement
Résultat attendu
- De telles dispositions garantissent que le commerce ainsi que la conservation et la protection de l’environnement se renforcent mutuellement.
- De telles dispositions pourraient inclure des engagements à l’égard de niveaux élevés de protection de l’environnement, l’application efficace des lois environnementales nationales, la non dérogation aux lois environnementales nationales afin de faciliter le commerce ou l’investissement, la participation et l’engagement du public ainsi que le règlement des différends.
Incidences possibles sur l’environnement
- De telles dispositions visent à s’assurer que les parties conservent leur capacité à établir leurs propres priorités en matière d’environnement, afin d’établir leurs propres niveaux nationaux de protection de l’environnement et d’adopter ou de modifier les lois et politiques environnementales appropriées.
Secteur : Règlement des différends
Résultat attendu
- De telles dispositions permettent de mettre sur pied les mécanismes servant au règlement des différends résultant de l’Accord entre les parties.
Incidences possibles sur l’environnement
- Dans la mesure où de telles dispositions renforcent la gérance environnementale, celles-ci pourraient avoir des répercussions positives indirectes.
Secteur : Dispositions institutionnelles, générales et finales, transparence
Résultat attendu
- De telles dispositions fournissent un cadre pour la gestion d’ensemble d’un AECG, y compris les mécanismes de consultation pour le règlement efficace des différends à l’extérieur du cadre formel de règlement des différends. De telles dispositions pourraient comporter la mise sur pied de comités et/ou de groupes de travail particuliers.
Incidences possibles sur l’environnement
- De telles dispositions permettraient aux deux parties d’examiner et de commenter de manière transparente toute nouvelle loi ou réglementation susceptible d’avoir des répercussions sur l’environnement.
- De telles dispositions pourraient prévoir une exception générale permettant l’adoption et l’application de mesures visant à protéger la vie ou la santé animale ou végétale, et des mesures liées à la conservation des ressources naturelles épuisables.
- De telles dispositions permettraient aux parties de mettre en œuvre les accords environnementaux multilatéraux liés au commerce, auxquels elles sont parties.
Secteur : Commerce des biens
Résultat attendu
- De telles dispositions fourniraient aux importateurs et aux exportateurs canadiens et de l’UE un accès meilleur et plus sécuritaire aux marchés des biens.
Incidences possibles sur l’environnement
- Les changements dans la production pourraient avoir des incidences sur l’environnement en raison d’émissions et de déchets découlant de la production, de la consommation de ressources, de changements causés aux paysages terrestres et aux habitats naturels ainsi que de changements dans les activités liées aux transports. Les facteurs atténuant ces incidences comprennent l’innovation technologique, la composition de l’économie et le régime de règlementation du Canada.
- Les niveaux globaux de risque en matière d’environnement pour l’eau, le sol, l’air et la biodiversité ne devraient pas changer considérablement par conséquent de la libéralisation des échanges agricoles et non agricoles entre le Canada et l’UE.
- Les incidences éventuelles sur l’environnement découlant du commerce des biens sont étudiées davantage dans les parties suivantes de la présente évaluation.
Secteur : Commerce des services
Résultat attendu
- De telles dispositions amélioreraient l’accès au marché ainsi que la transparence et la prévisibilité pour les fournisseurs de services canadiens et de l’UE.
Incidences possibles sur l’environnement
- La plupart des services bénéficiant de la libéralisation des échanges dans le cadre d’un AECG Canada-UE se trouveraient sans doute dans des domaines virtuels; il est donc moins probable qu’ils aient des incidences néfastes sur l’environnement.
- Les incidences néfastes sur l’environnement (p. ex. la hausse de la consommation d’énergie et de déchets électroniques) causées par l’augmentation du commerce des services devraient être atténuées en partie par l’adoption accrue de pratiques durables sur le plan environnemental dans le secteur des services.
- Les incidences éventuelles sur l’environnement découlant du commerce des services sont étudiées davantage dans les parties suivantes de la présente évaluation.
Secteur : Marchés publics
Résultat attendu
- De telles dispositions offriraient aux fournisseurs canadiens et de l’UE un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux marchés publics de l’autre partie.
Incidences possibles sur l’environnement
- Les hausses dans le domaine du transport lié au travail et aux échanges de biens devraient être contrebalancées par la hausse de l’achat de technologies efficientes.
- Les marchés publics sont habituellement régis par des lignes directrices et des politiques rigoureuses en ce qui concerne la gérance environnementale. Cet aspect ne changera pas après la mise en œuvre de l’AECG avec l’UE.
- Les incidences éventuelles sur l’environnement découlant des marchés publics sont étudiées davantage dans les parties suivantes de la présente évaluation.
Secteur : Investissement
Résultat attendu
- De telles dispositions offriraient aux investisseurs canadiens et de l’UE une plus grande certitude et une meilleure prévisibilité, ainsi qu’une confiance accrue pour investir dans le territoire de l’autre partie.
- De telles dispositions reconnaissent l’importance de ne pas déroger aux lois sur l’environnement, la santé et la sécurité en vue d’encourager l’investissement.
Incidences possibles sur l’environnement
- Un équilibre entre le besoin de réglementer et le besoin de faciliter l’ouverture de l’investissement est important.
- Un AECG ne devrait pas changer de façon considérable le régime d’investissement déjà très ouvert du Canada.
- Les incidences éventuelles sur l’environnement seront attenuées par les lois qui lient les investisseurs étrangers aux mêmes règlements en matière d’environnement auxquels les investisseurs nationaux sont asujettis.
- Les incidences éventuelles sur l’environnement découlant de l’investissement sont étudiées davantage dans les parties suivantes de la présente évaluation.
Les quatre derniers secteurs présentés dans l’aperçu représentent les quatre secteurs d’intérêt clés qui ont été déterminés comme ceux ayant la plus grande probabilité d’incidences environnementales :
- commerce des biens;
- commerce des services;
- marchés publics;
- investissement.
Les quatre secteurs d’intérêt clés sont étudiés en détail après la description des limites de l’évaluation qualitative. Le reste de l’analyse qualitative porte principalement sur les incidences éventuelles sur l’environnement dans ces quatre domaines d’intérêt clés, leur importance et les possibilités d’atténuation et de renforcement.
Limites de l’évaluation qualitative
Comme mentionné plus haut, la présente évaluation environnementale initiale constitue un exercice de délimitation de la portée qui vise à déterminer la probabilité d’incidences importantes sur l’environnement par suite de la conclusion d’un AECG avec l’UE. L’évaluation qualitative des incidences environnementales éventuelles n’est pas un examen exhaustif des secteurs de l’économie ou des questions environnementales. Elle a plutôt pour but de fournir un aperçu des incidences éventuelles de l’accord commercial. Par conséquent, plusieurs mises en garde sont requises relativement à l’interprétation des incidences environnementales signalées.
- La présente évaluation n’a pas pour objectif d’évaluer les incidences environnementales de la croissance économique, mais plutôt des changements dans l’activité économique et la politique commerciale pouvant éventuellement découler de façon directe des négociations en vue de conclure un AECG Canada-UE. De nombreuses forces macroéconomiques et microéconomiques sont en jeu et ont une influence sur la composition et le flux des échanges. Les incidences économiques réelles des négociations en vue de conclure un AECG avec l’UE dépendent également de la réaction des divers acteurs économiques, producteurs et consommateurs en ce qui concerne le nouvel environnement de politique commerciale.
- La présente analyse porte principalement sur les incidences globales pour le Canada. Elle ne traite pas précisément des incidences distributives par province/territoire et/ou région. Bien que les incidences nettes puissent être positives, certaines régions peuvent être touchées différemment.
- Étant donné que les négociations en vue de conclure un AECG Canada-UE sont toujours en cours, il existe certaines incertitudes liées à la détermination des résultats des négociations. Les changements réels à la politique commerciale requis par un accord éventuel pourraient demeurer indéterminés jusqu’à ce qu’un AECG soit conclu et mis en vigueur, et que les dispositions qu’il contient soient complètement mises en œuvre.
- Les mesures adoptées en vue de protéger l’environnement pourraient causer d’autres incidences inattendues sur la société, lesquelles n’ont pas été prises en compte dans la présente évaluation en raison de la difficulté de les prévoir. À titre d’exemple, un changement de comportement pourrait neutraliser en partie les gains environnementaux, ce qu’on appelle l’effet rebond (p. ex. les gains d’efficacité énergétiques peuvent être subséquemment neutralisés par une augmentation des hausses de la consommation d’énergie).
A. Commerce des biens
A1. Aperçu
Dans cette section, nous analysons plus en profondeur les possibilités économiques, les incidences potentielles sur l’environnement ainsi que les mesures d’atténuation / de renforcement possibles dans cinq secteurs non-agricoles qui profiteraient de l’accroissement des exportations vers l’Union européenne (UE) en vertu d’un AECG : métaux, fabrication industrielle (équipement électronique, machinerie et équipement, véhicules motorisés et pièces), produits chimiques, produits forestiers et produits de poisson et de fruits de mer.
L’analyse est ensuite répétée pour les secteurs agricoles susceptibles de connaître des gains majeurs au chapitre des exportations : bœuf et porc, grains, huiles et oléagineux, légumineuses à grain et cultures spéciales, fruits et légumes et produits de l’érable.
Enfin, l’importance des incidences potentielles sur l’environnement découlant de ces changements possibles au commerce des marchandises du Canada en vertu d’un AECG avec l’UE est évaluée.
A2. Effets économiques et environnementaux prévus
Comme mentionné dans l’Étude conjointe, les niveaux tarifaires des échanges de marchandises entre l’UE et le Canada sont en moyenne faibles en raison surtout de la baisse progressive multilatérale des tarifs. De surcroît, à l’heure actuelle, une bonne part (70 %) des échanges sont exempts de droits de douane. En 2007, après pondération selon les échanges, les produits canadiens faisaient l’objet de droits de douane moyens de 2,2 % à l’accès au marché de l’UE, alors que les produits de l’UE faisaient face à des droits comparables, soit 3,5 %, dans le marché canadien.
Malgré ces niveaux tarifaires peu élevés, dans les deux cas un certain nombre de secteurs se heurtent toujours à des niveaux élevés de protection tarifaire, y compris certains secteurs de produits agricoles et alimentaires, de textiles et de vêtements et le secteur de l’automobile. À cet égard, les résultats de l’Étude conjointe indiquent que la libéralisation du commerce de biens et de services se traduirait par d’importants avantages pour l’UE et le Canada. La hausse annuelle du PIB d’ici l’année 2014 (année où, selon les estimations de l’Étude conjointe, l’accord aurait été pleinement mis en œuvre) serait de 16,3 trillions $ pour l’UE (0,08 % du PIB de l’UE), et de 11,5 milliards $ pour le Canada (0,77 % du PIB canadien). Le total des exportations de l’UE vers le Canada devrait augmenter de 24,3 % ou de 25,1 milliards $ d’ici 2014, tandis que les exportations du Canada à l’UE devraient augmenter de 20,6 % ou de 12,6 milliards $ pour la même période. Les gains réalisés à la suite de l’élimination de tous les droits de douane sur les biens échangés bilatéralement représentent 25 % du total des gains économiques pour l’UE et 33,3 % pour le Canada.
Les gains commerciaux les plus importants découlant d’un AECG Canada-UE devraient être réalisés dans les secteurs où les niveaux d’échanges actuels sont élevés et où d’importants obstacles tarifaires existent. Outre l’élimination tarifaire, les négociateurs canadiens cherchent à inclure des dispositions visant à faciliter une coopération accrue avec l’UE afin de rendre le commerce plus efficient, par exemple par l’adoption de mesures de facilitation du commerce et de procédures douanières conçues pour offrir de la certitude, de la transparence et des procédures efficaces de vérification de l’origine. Des règles d’origine transparentes, prévisibles et d’application systématique seront mises au point pour que les avantages négociés dans le cadre de l’accord commercial profitent à ses parties.
Produits non-agricoles
Exportations non-agricoles canadiennes à destination de l’Union européenne
Au cours de la période 2006-2008Footnote 18, les exportations non-agricoles canadiennes vers l’UE se sont élevées en moyenne à 31,4 milliards $. Les exportations de produits non-agricoles canadiens qui sont susceptibles de bénéficier de l’élimination des tarifs comprennent : les métaux, la machinerie et l’équipement, les produits chimiques, les véhicules motorisés et les pièces, l’équipement électronique de même que les produits forestiers et les produits de poisson et fruits de mer. Les augmentations résultantes sur les plans de la production et des échanges peuvent avoir des effets sur l’environnement par des augmentations de l’utilisation des ressources, des processus de production, des déchets ainsi que dans d’autres secteurs qui sont étudiés plus en détail ci-dessous. Les possibilités d’atténuation des incidences négatives sont également examinées, étant donné que des augmentations de la production se produiraient dans les installations fonctionnant en vertu de la législation et des règlements du Canada. Le cadre de réglementation solide du Canada garantit que les pratiques industrielles et commerciales sont élaborées conformément aux principes de développement durable et de gérance de l’environnement. Les politiques et la réglementation canadiennes axées sur le développement durable sont un élément essentiel du cadre de réglementation général du pays aux paliers des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Au plan horizontal, les échanges accrus de biens non agricoles peuvent avoir des effets plus généralisés liés à l’industrie du transport, qui joue un rôle de premier plan en acheminant la production locale vers les ports d’embarquement pour l’expédier sur les marchés étrangers, notamment dans un pays aussi dispersé sur le plan géographique que le Canada. La croissance dans un grand marché transatlantique comme l’UE peut se traduire par une augmentation des besoins en matière d’expédition, particulièrement dans les secteurs ferroviaire et des transports maritimes (cela est aussi abordé dans la section portant sur le commerce des services.)
Les hausses graduelles des revenus canadiens découlant d’un AECG avec l’UE peuvent finalement se traduire par des augmentations au chapitre de la consommation des biens, ce qui pourrait généralement entraîner des incidences sur l’environnement en raison d’une utilisation accrue des ressources et une plus grande production de déchets. Même s’il n’est pas possible de mesurer ni de quantifier ces incidences pour le moment, les augmentations potentielles de la consommation sont examinées indirectement ci-dessous.
Métaux
- Possibilités : Les exportations canadiennes de métaux vers l’UE se sont élevées en moyenne à 4,6 milliards $ chaque année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux métaux exportés vers l’UE pendant cette période et passibles de droits comprenaient : le nickel et ses produits (1,9 milliard $; tarif moyen de 6,3 %), les produits de fer et d’acier (1,5 milliard $; tarif moyen de 0,8 %), les produits d’aluminium (707 millions $; tarif moyen de 6,3 %) et les métaux non-ferreux tels que le zinc et le cobalt (470 millions $; tarif moyen de 6,3 %). Entre 2006 et 2008, l’UE était le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour le secteur des métaux, représentant 10,5 % des exportations mondiales.
- Incidences potentielles sur l’environnement : Une hausse de la demande et de la production de métaux canadiens pourrait avoir des incidences environnementales pouvant être réparties en deux catégories. D’abord, une augmentation de la production exigerait une plus grande quantité de matières premières non renouvelables et un apport accru de minéraux. Les activités d’extraction qui en découleraient auraient des conséquences directes sur le paysage environnemental à la suite des activités minières et d’excavation. De surcroît, les processus d’extraction exigent souvent de l’équipement industriel lourd et une grande consommation d’eau, lesquels, une fois combinés, produisent des eaux usées et des résidus miniers en plus des émissions liées à l’utilisation de l’équipement. La deuxième catégorie d’incidences potentielles sur l’environnement concerne les étapes de raffinage et de traitement de la production de métaux, laquelle exige souvent une grande quantité d’énergie et l’utilisation de produits chimiques et autres substances potentiellement dangereuses.
- Atténuation / Renforcement :
L’exploitation minière constitue une utilisation intensive des terres qui peut avoir des incidences environnementales sur une zone limitée. Cependant, à l’aide de mécanismes appropriés de planification et de protection de l’environnement, les incidences nocives sur l’environnement peuvent être réduites au minimum. Parmi les incidences négatives possibles sur l’environnement, notons le risque de perturbation d’écosystèmes fragiles, de pollution de plans d’eau locaux et de contamination des sols. Au Canada, la protection de l’environnement constitue un élément important d’une exploitation minière moderne et est axée vers le développement sûr et durable des ressources minérales.
Les gouvernements provinciaux sont principalement responsables de l’exploitation minière – l’exploration, le développement et l’extraction des ressources minérales, ainsi que la construction, la gestion, la remise en état et la fermeture des sites miniers – qui relèvent de leur compétence.
L’intervention directe fédérale comparable dans la réglementation des opérations minières est limitée et d’une nature précise. Outre la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE),Footnote 19 la Loi sur les pêchesFootnote 20 fédérale est l’une des principales lois régissant la gestion des ressources aquatiques au Canada et elle garantit la conservation et la protection de l’habitat du poisson dans les eaux des pêcheries canadiennes.Footnote 21De même, la plupart des principaux projets d’exploitation minière au Canada sont assujettis à un processus d’évaluation environnementale régi par le gouvernement fédéral, par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou en vertu d’une loi en vigueur au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.Footnote 22
La politique des minéraux et des métaux du gouvernement du Canada – Des partenariats pour un développement durableFootnote 23 intègre les politiques, les programmes et les dispositions législatives qui garantissent l’usage continu de la richesse que constituent les ressources naturelles canadiennes dans un cadre de développement durable. En outre, le Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada (de RNCan) a mis sur pied des activités et des partenariats qui démontrent l’expertise canadienne dans un large éventail de secteurs d’intérêt liés au développement durable. Ceux-ci comprennent l’utilisation sécuritaire des minéraux et des métaux, l’analyse du cycle de vie, la bonne gestion de produits, la prise de décision fondée sur la science et les progrès dans la science et la technologie liés à la technologie minière, l’atténuation des incidences de l’exploitation des minéraux et des métaux sur l’environnement ainsi que la fermeture de mines et la remise en état de sites.Footnote 24 Si une hausse des exportations se produit en raison d’un AECG avec l’UE, les lois et règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux portant tant sur l’exploitation des ressources minérales que l’évaluation environnementale contribueraient à faire en sorte que toute hausse de la production au Canada s’effectuerait de manière acceptable et responsable sur le plan environnemental.Footnote 25
Fabrication industrielle
- Possibilités :
- Équipement électronique : Les exportations canadiennes d’équipement électronique vers l’UE se sont élevées en moyenne à 2,9 milliards $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux équipements électroniques exportés vers l’UE pendant cette période et passibles de droits comprenaient : les postes téléphoniques, y compris les appareils pour réseaux cellulaires/sans fil (764 millions $; tarif moyen de 1,3 %), les appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision (263 millions $; tarif moyen de 4,3 %), les pièces électroniques (96 millions $; tarif moyen de 3,3 %), les transformateurs électriques, les convertisseurs statiques et les inducteurs (69 millions $; tarif moyen de 2,9 %) et les machines électriques (68 millions $; tarif moyen de 3,4 %). L’UE constituait le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour les produits électroniques, comptant pour 12,4 % des exportations totales canadiennes de ce secteur.
- Machinerie et équipement : Les exportations canadiennes de machines et d’équipement à destination de l’UE se sont chiffrées en moyenne à 1,9 milliard $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux éléments de machinerie et d’équipement exportés vers l’UE et passibles de droits comprenaient : la machinerie industrielle (1,2 milliard $; tarif moyen de 2,1 %), l’équipement de construction (352 millions $; tarif moyen de 0,7 %), la machinerie de production d’énergie (343 millions $; tarif moyen de 3,2 %) et l’équipement agricole (64 millions $; tarif moyen de 0,5 %). L’UE constituait le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour la machinerie, comptant pour 8,2 % des exportations canadiennes de ce secteur.
- Véhicules motorisés et pièces : Les exportations canadiennes de véhicules motorisés et des pièces vers l’UE se sont chiffrées en moyenne à 633 millions $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux produits automobiles exportés vers l’UE et passibles de droits comprenaient : les pièces automobiles (353 millions $; tarif moyen de 3,4 %), les véhicules légers (185 millions $; tarif moyen de 11,2 %), d’autres types de véhicules tels les véhicules récréatifs tout-terrain et les motocyclettes (56 millions $; tarif moyen de 5,3 %) et d’autres tels les tracteurs, les camions et les autobus (26 millions $; tarif moyen de 9,3 %). L’UE constituait le troisième marché d’exportation en importance du Canada pour les véhicules à moteur et les pièces, comptant pour 0,9 % des exportations canadiennes de ce secteur.
- Équipement électronique : Les exportations canadiennes d’équipement électronique vers l’UE se sont élevées en moyenne à 2,9 milliards $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux équipements électroniques exportés vers l’UE pendant cette période et passibles de droits comprenaient : les postes téléphoniques, y compris les appareils pour réseaux cellulaires/sans fil (764 millions $; tarif moyen de 1,3 %), les appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision (263 millions $; tarif moyen de 4,3 %), les pièces électroniques (96 millions $; tarif moyen de 3,3 %), les transformateurs électriques, les convertisseurs statiques et les inducteurs (69 millions $; tarif moyen de 2,9 %) et les machines électriques (68 millions $; tarif moyen de 3,4 %). L’UE constituait le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour les produits électroniques, comptant pour 12,4 % des exportations totales canadiennes de ce secteur.
- Incidences potentielles sur l’environnement : La fabrication industrielle représente un secteur où une hausse de la production pourrait avoir des incidences environnementales. Une demande accrue provoquée par la libéralisation du commerce accroîtrait probablement les exportations canadiennes vers l’UE et potentiellement la production au Canada. Une hausse de la production de machinerie électronique, de véhicules motorisés, de machinerie et d’équipement et de biens connexes intensifierait la demande d’intrants, notamment les principales matières premières telles que les métaux, les produits chimiques et les plastiques. Une telle augmentation de la demande pourrait entraîner des incidences environnementales dans les secteurs des déchets dangereux, de l’utilisation de l’eau et du ruissellement, des émissions et de l’épuisement des ressources non renouvelables. En outre, l’accroissement de la production et de la fabrication industrielles pourrait contribuer à une augmentation de la pollution atmosphérique, des déchets, des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation d’énergie. D’un autre côté, des incidences positives peuvent se produire en améliorant l’accès aux technologies et aux biens environnementaux qui font avancer les objectifs de développement durable dans certaines industries. La demande en biens environnementaux est forte au sein de l’UE. La libéralisation du commerce dans le secteur des biens environnementaux créera de solides incitatifs pour que les entreprises environnementales connexes mettent au point des technologies nouvelles et plus efficientes en matière de prévention de la pollution et de conservation.
- Atténuation/Renforcement : Le cadre de réglementation régissant les incidences environnementales découlant de la fabrication industrielle comprend la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) et ses règlements. Un aspect essentiel de la LCPE est la prévention et la gestion des risques posés par des substances toxiques et autres dangereuses, y compris celles qui découlent de la fabrication industrielle. En vertu de la LCPE, les installations de fabrication pourraient également devoir divulguer leurs émissions de certains polluants par l’intermédiaire de divers programmes comme l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)Footnote 26 et le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serreFootnote 27 d’Environnement Canada. Les émissions de polluants dans l’eau découlant de la fabrication industrielle sont également assujetties aux lois régissant la gestion de l’eau, notamment la Loi sur les ressources en eau du CanadaFootnote 28 (qui prévoit la gestion des ressources en eau au Canada) et la Loi sur les pêches (qui porte sur le maintien de la qualité de l’habitat du poisson).
Une augmentation de la fabrication industrielle d’équipement électronique aboutit généralement à un accroissement des déchets électroniques. En 2004, le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME), qui réunit les ministres de l’Environnement des gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux, a adopté 12 principes de bonne gestion des déchets électroniques. Ces principes sont centrés sur la gestion du cycle de vie, qui attribue aux producteurs la charge principale de la gestion des déchets électroniques (e-déchets), les coûts devant être assumés à la fois par les producteurs et les utilisateurs. La liste des produits à inclure dans le champ d’application de tout régime de réglementation comprend non seulement les appareils considérés comme relevant des technologies de l’information (TI) mais aussi toutes sortes d’appareils ménagers.
Les règlements régissant la gestion des déchets électroniques relèvent généralement des provinces et des territoires, et les déchets électroniques dangereux doivent être gérés en conformité avec les règlements provinciaux et territoriaux applicables concernant les déchets dangereux. Les municipalités peuvent aussi participer à la gestion ou à l’élimination des déchets électroniques domestiques. Plusieurs provinces appliquent des programmes de gestion des déchets électroniques. Ces programmes sont centrés sur la collecte, l’élimination, le recyclage, la reprise, le retraitement et le traitement.
Produits chimiques
- Possibilités : Les exportations canadiennes de produits chimiques vers l’UE se sont chiffrées, en moyenne, à 2,4 milliards $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux produits chimiques exportés vers l’UE et passibles de droits comprenaient : l’hydrogène, les gaz rares et autres éléments non métalliques (64 millions $; tarif moyen de 3,5 %), les initiateurs de réaction, les accélérateurs de réaction et les préparations catalytiques (29 millions $; tarif moyen de 4,3 %), les acides nucléiques et leurs sels (15,5 millions $; tarif moyen de 4,1 %) et les liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie (19,5 millions $; tarif moyen de 5,4 %). L’UE constituait le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour les produits chimiques, comptant pour 17 % des exportations canadiennes de ce secteur. À forte intensité de recherche et de développement (R et D), le secteur des produits chimiques du Canada est axé sur la technologie et l’innovation et est bien positionné pour tirer avantage d’un AECG avec l’UE, notamment dans les industries émergentes liées à la biotechnologie, aux nanomatériaux et à la chimie verte.
- Incidences potentielles sur l’environnement : L’accroissement du commerce des produits chimiques (ou des produits contenant des produits chimiques) avec une juridiction étrangère pourrait entraîner des pressions sur l’environnement par, notamment, des hausses de la consommation d’énergie, une plus forte demande en intrants primaires et autres intermédiaires nécessaires à la production des produits chimiques, et des niveaux plus élevés d’émissions atmosphériques et de déchets dangereux. En outre, un plus grand nombre de substances préoccupantes contenues dans les produits finis importés pourraient entrer au Canada. Néanmoins, le Canada dispose du cadre environnemental et réglementaire nécessaire pour atténuer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles sur l’environnement découlant de la fabrication de produits chimiques et de leur utilisation et élimination, qui sont liées à un accroissement des échanges entre le Canada et l’UE. Le commerce accru de produits chimiques résultant d’un plus grand accès au marché européen ne devrait pas provoquer de nouveaux enjeux environnementaux qui ne pourraient pas être relevés dans le cadre des structures réglementaires actuelles.
- Atténuation / Renforcement : Le gouvernement du Canada dispose d’un certain nombre de lois ainsi que d’un cadre de réglementation qui protègent la santé humaine et l’environnement des risques posés par les produits chimiques nocifs. La principale autorité juridique pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques nocives est la Loi canadienne sur la protection de l’environnementFootnote 29. D’autres lois pouvant être utilisées comprennent la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les produits antiparasitaires Footnote 30. Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) Footnote 31du gouvernement du Canada permet la mise en œuvre des processus de prise de décisions et la coordination dans le cadre de l’initiative de la « loi la plus indiquée &187;, pour faire en sorte que les autorités les plus appropriées et la série la plus indiquée d’outils législatifs, réglementaires et autres offerts dans le cadre de ces diverses lois sont utilisés pour protéger la santé humaine et l’environnement des produits chimiques dangereux. Le PGPC, lancé en 2006, est géré conjointement par Environnement Canada et Santé Canada afin de :
- prendre des mesures rapides sur les produits chimiques nouveaux et actuels;
- intégrer les activités de gestion des produits chimiques à l’échelle du gouvernement;
- assurer une prévisibilité pour les entreprises et contribuer au sentiment de confiance publique par des plans de travail transparents.
- Le PGPC prend des mesures pour réduire au minimum et/ou éliminer les risques posés par les substances chimiques nocives pour l’environnement et la santé humaine, et ce, au moyen d’une approche fondée sur le risque qui repose sur la science, l’évaluation et le contrôle efficace afin d’orienter les décisions en matière de gestion des risques concernant les produits chimiques préoccupants.
Environnement Canada et Santé Canada ont conclu un protocole d’entente (PE) avec l’Agence européenne des produits chimiques. Ce protocole décrit un certain nombre de secteurs de coopération technique. L’objectif général du PE consiste à mettre en commun des connaissances et des renseignements ainsi que d’échanger des expériences et des pratiques exemplaires sur les questions d’intérêt mutuel concernant la gestion des substances chimiques.
Produits forestiers
- Possibilités : Les exportations canadiennes de produits forestiers vers l’UE se sont chiffrées en moyenne à 2,2 milliards $ par année en 2006 et 2008. Au Canada, les principaux produits forestiers exportés vers l’UE et passibles de droits comprenaient : le bois scié ou en copeaux (382 millions $; tarif moyen de 1,0 %), les panneaux de fibres (14 millions $; tarif moyen de 7 %), les panneaux de particules, les panneaux OSB et autres panneaux semblables (13 millions $; tarif moyen de 7 %), le contreplaqué, le plaqué et autres éléments de bois lamellé similaires (11 millions $; tarif moyen de 8,1 %). L’UE constituait le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour les produits forestiers, comptant pour 6 % des exportations canadiennes de ce secteur.
- Incidences potentielles sur l’environnement : Au Canada, la détermination et la réglementation de la quantité de bois pouvant être récoltée sont essentielles aux stratégies de gestion durable des forêts. Les gouvernements provinciaux réglementent les niveaux de récolte sur les terres publiques provinciales en précisant une possibilité annuelle de coupe (PAC), qui est le niveau annuel de récolte permis dans un secteur particulier pendant un nombre précis d’années. Les niveaux de l’AAC se fondent sur le taux de croissance durable de la forêt. L’objectif consiste à maintenir la diversité biologique tout en examinant les facteurs économiques et sociaux.
L’approvisionnement total en bois du Canada, le volume estimé de bois d’œuvre pouvant être récolté d’un secteur tout en répondant aux critères d’admissibilité, a été relativement stable depuis 1990. Il a atteint 246 millions de mètres cubes en 2009, y compris 188 millions de mètres cubes pour les résineux et 58 millions de mètres cubes pour les feuillus. Toutefois, le niveau de récolte des résineux s’est chiffré en moyenne à 144 millions de mètres cubes de 2000 à 2009, soit plus de 20 % en dessous du niveau durable. En outre, les niveaux de récolte ont chuté rapidement depuis 2004, et le niveau actuel de récolte se situe à environ la moitié du niveau durable. Une situation similaire peut être décrite pour les récoltes de feuillus, qui se situent à l’heure actuelle légèrement au-dessus du tiers du niveau durable. Footnote 32
Le suivi des volumes de récoltes permet aux gestionnaires forestiers de déterminer si ces niveaux sont conformes aux quantités réglementées. Les provinces et territoires du Canada ont des programmes rigoureux consacrés aux inspections, à la conformité et à la mise en application de la législation forestière. Footnote 33
Un AECG Canada-UE ne se traduira pas par une augmentation des récoltes de bois d’œuvre au-dessus des niveaux de la PAC établis par les gouvernements, et il ne modifiera pas les paysages et les habitats naturels. En même temps, les exportations de produits forestiers vers l’UE devraient augmenter. À ce titre, un AECG devrait entraîner un changement dans la composition des marchés d’exportation, où une plus grande part des exportations de produits forestiers va à l’UE plutôt qu’aux autres marchés, ou mener à une augmentation des prix qui améliorerait les modalités du commerce de produits forestiers canadiens. Le potentiel d’exportation n’est pas un facteur dans la détermination des niveaux de récolte. Par conséquent, un AECG pourrait entraîner une augmentation des exportations de produits forestiers vers l’UE sans mettre de pression sur les niveaux de récolte canadiens.
Comme les produits de pâte et papier entrent actuellement sur le marché de l’UE en franchise de droits, un AECG ne devrait pas accroître les exportations canadiennes de ces produits ni les émissions atmosphériques et les rejets d’effluents associés, générées par l’industrie. Les produits faisant actuellement l’objet de tarifs plus élevés sont les produits du bois à valeur ajoutée (panneau de fibres, panneau de particules, panneau OSB, placage). L’élimination potentielle de ces tarifs par un AECG Canada-UE pourrait mener à une augmentation des exportations et de la production de ces produits. L’industrie des produits du bois dans son ensemble génère moins de pollution atmosphérique et des eaux que l’industrie des pâtes et papiers. En outre, la transformation secondaire des produits du bois ne génère pas de rejets d’effluents et contribue de façon négligeable aux émissions de GES. Toutefois, les processus de production de ces produits génèrent souvent certaines émissions de substances particulaires et de composés organiques volatils. Si un AECG avec l’UE accroît la production de produits du bois secondaires, l’incidence sur l’environnement serait négligeable. - Atténuation / Renforcement : Les politiques et programmes du gouvernement qui règlementent la production de produits ligneux et forestiers constituent une responsabilité partagée entre les gouvernements provinciaux, Environnement Canada (par la LCPE) et Ressources naturelles Canada et sont orientés par le concept de la gestion forestière durable. À tous les paliers de gouvernement, les politiques forestières régies par ce cadre garantissent une gestion des forêts respectant les principes du développement durable. Les ressources forestières commerciales du Canada sont gérées en grande partie par les provinces au moyen d’accords de tenure et de gestion des forêts qui réglementent rigoureusement l’exploitation forestière, la sylviculture et les pratiques forestières. Ces politiques prévoient également des mécanismes de réglementation et de vérification fondés sur les pratiques du développement durable, pour garantir que les quantités de bois d’œuvre récoltées ne dépassent pas la capacité de régénération de la forêt. La gestion durable des forêts fait en sorte que moins de 1 % des forêts gérées est récolté dans une année donnée au Canada.
Poissons et fruits de mer
- Possibilités : Les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer vers l’UE se sont chiffrées en moyenne à 541 millions $ par année entre 2006 et 2008. Au Canada, les principaux poissons et fruits de mer exportés vers l’UE et passibles de droits comprenaient : les crustacés, comme le homard et la crevette (243 millions $; tarif moyen de 11,1 %), les crustacés préparés ou en conserve comme le crabe, la crevette et le homard (80 millions $; tarif moyen de 17,6 %) et le poisson congelé, tel que le saumon (56 millions $; tarif moyen de 8,5 %). L’UE était le deuxième marché d’exportation en importance du Canada pour les poissons et fruits de mer, comptant pour 13,8 % des exportations canadiennes de ce secteur.
- Incidences potentielles sur l’environnement : La hausse de la production et des exportations découlant d’un AECG Canada-UE pourrait entraîner des pressions sur l’environnement. Les activités de pêche sauvage peuvent affecter les écosystèmes océaniques et d’eau douce, tandis que l’aquaculture peut apporter des changements sur le plan environnemental dans les secteurs où elle a lieu.
Les exportations de poissons et de fruits de mer vers l’UE comprennent les crevettes, le homard, le saumon et les pétoncles, les exportations canadiennes étant actuellement réparties sur certain nombre d’espèces et de produits. Un AECG avec l’UE ne devrait pas modifier considérablement cette composition des exportations, mais il importe de mentionner que les incidences pourraient toucher des stocks de poissons précis si elles ne sont pas gérées convenablement. Même si les espèces exportées vers l’UE ne sont pas, à l’heure actuelle, considérées comme étant à risque, il sera important de continuer à surveiller ces stocks concernant les incidences négatives, notamment dans les secteurs où des augmentations au chapitre des exportations pourraient être prévues.
L’accroissement des exportations de produits du poisson et des fruits de mer vers l’Union européenne pourrait avoir une incidence sur un certain nombre de composantes dans l’écosystème, y compris le stock de poisson ciblé, les espèces de poissons prises accidentellement, les sources de nourriture pour les autres espèces (c.-à-d. les espèces-fourrage), l’habitat des poissons et les habitats et écosystèmes vulnérables ou uniques des fonds marins, comme les monts sous-marins, les cheminées hydrothermale, les coraux et les éponges.
L’augmentation des exportations vers l’UE de produits d’aquaculture pourrait aussi entraîner des incidences négatives par l’augmentation des volumes de déchets d’aquaculture (p. ex. nutriments et matières organique), l’utilisation accrue de produits chimiques (p. ex. pesticides, drogues, agents antisalissure) et l’augmentation des chances d’interactions entre les espèces d’élevage et sauvages (avec le potentiel de transfert de maladies et d’effets génétiques et écologiques).
Les incidences positives découlant d’un AECG Canada-UE sont également possibles grâce à une collaboration accrue sur des questions précises. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) contribue fortement au déclin des stocks de poisson et à la destruction des habitats marins. À l’échelle mondiale, la pêche INN revêt de nombreuses formes, tant dans les eaux nationales qu’en haute mer. On ne sait pas vraiment avec précision dans quelle mesure la pêche INN est pratiquée, mais on estime qu’elle compte pour environ 30 % de l’ensemble des activités de pêche menées dans le monde entier. La majeure partie de la coopération actuelle entre le Canada et l’UE pour les questions de pêche (y compris l’INN) se déroule dans le contexte des organisations régionales de gestion des pêches, notamment l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). Malgré les approches modernes à l’égard de la gestion des pêches, les stocks de bon nombre d’espèces de poissons traditionnelles de l’OPANO continuent d’être bas, ce qui indique que le processus de reconstruction prendra du temps. Un AECG pourrait avoir une incidence positive grâce à une collaboration bilatérale accrue entre le Canada et l’UE dans ce secteur.
Dans l’ensemble, la gestion et la réglementation conformes aux principes du développement durable sont nécessaires pour atténuer les incidences potentielles sur l’environnement qui pourraient être prévues avec des exportations accrues vers l’UE de poissons et fruits de mer. La pêche, l’aquaculture et les activités de traitement connexes sont réglementées au Canada pour garantir que les ressources sont exploitées à un niveau durable, y compris par l’utilisation de contingents ou de contrôles des intrants pour les méthodes traditionnelles de capture et le choix d’emplacement, la gestion et la réglementation appropriés pour l’aquaculture. Les mesures, comme celles-ci, qui peuvent être utilisées pour atténuer les incidences négatives potentielles, sont discutées plus en détail ci-dessous. - Atténuation / Renforcement : Bien que plusieurs lois et règlements définissent les règles et les règlements régissant la récolte du poisson et le développement de l’aquaculture au Canada, le Cadre pour la pêche durable Footnote 34 de Pêches et Océans Canada (POC) sert de base à l’élaboration de politiques sur la conservation et la durabilité environnementale des pêches canadiennes. Les stocks de poissons sont gérés par des contrôles des quantités capturées, au moyen d’un total autorisé des captures et la limitation de l’effort de pêche comme mécanismes de contrôle prédominants, auxquels s’ajoutent fréquemment des restrictions visant les efforts (p. ex. entrée limitée, restrictions visant les navires et les engins de pêche) et/ou la composition des prises (p. ex. taille et âge des poissons). POC élabore et met en œuvre des plans de gestion intégrée des pêches pour de nombreuses pêches, qui intègrent des objectifs scientifiques, de conservation et de gestion pour le(s) stock(s) et exposent en détail les mesures requises pour conserver et gérer la pêche. Les contrôles sont réglementés et appliqués. La plupart des sites d’aquaculture nouveaux et élargis au Canada sont tenus de faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Cette loi vise les effets environnementaux, sociaux et économiques, toutes les phases d’exploitation ainsi que les effets cumulatifs. La Loi exige la détermination des stratégies d’atténuation et de contrôle pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’effets négatifs résiduels d’importance.
Les méthodes traditionnelles de capture et l’aquaculture sont deux secteurs où les incidences environnementales sont étroitement gérées par des initiatives fédérales, provinciales et territoriales. Celles-ci sont analysées plus en détail ci-dessous.- Les méthodes traditionnelles de capture
Les contrôles et les règlements élaborés et utilisés par POC garantissent qu’une hausse de la demande en poisson et en produits du poisson sur les marchés étrangers ne se traduit pas automatiquement en de plus grands contingents de capture, et que la durabilité des stocks est prise en compte dans toutes les décisions. En outre, les lois et règlements des provinces et des territoires servent à atténuer certains effets environnementaux qui pourraient autrement découler d’un accès accru aux marchés.
Le Canada adhère à des instruments internationaux comme l’Accord des Nations Unies sur la pêche (ANUP) Footnote 35 et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), Footnote 36 est membre d’organisations régionales de gestion des pêches, et est partie à plusieurs accords qui, collectivement, servent à gérer, à conserver et à protéger les stocks de poissons, ainsi qu’à atténuer les incidences négatives potentielles sur l’environnement.
L’objectif primordial de la gestion des pêches au Canada consiste à protéger les stocks de poissons en garantissant une utilisation durable à long terme reposant sur des avis scientifiques sérieux. Cet objectif est atteint pour la plupart des pêches au Canada en établissant des niveaux cibles prudents de mortalité par pêche (c.-à-d. un pourcentage des stocks totaux qui peuvent être pris), limitant la capture des poissons en dessous d’une taille cible minimale, et/ou en s’assurant qu’un nombre minimal de poissons s’échappent pour frayer. Ces cibles reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sont atteintes par la réglementation et l’application du total autorisé des captures et les contrôles de l’effort (c.-à-d. limites sur le nombre d’opérations de pêche et de jours de pêche et restrictions s’appliquant aux navires et aux engins de pêche), ainsi que la composition de la capture (c.-à-d. taille et âge du poisson) par divers règlements s’appliquant à la taille des mailles et des hameçons, la longueur du poisson, les zones fermées et les saisons. Dans le cas du saumon du Pacifique, les règlements se concentrent sur les objectifs fixés quant aux échappées pour le frai et, pour les homards, les contrôles se concentrent principalement sur la taille minimale des carapaces, et s’accompagnent d’une entrée limitée (c.-à-d. le nombre d’opérations de piégeage de homards).
En ce qui touche la pêche en haute mer, il existe actuellement une dynamique internationale importante en faveur du renforcement des organisations régionales de gestion des pêches et de l’élargissement de leurs mandats afin d’inclure un plus vaste éventail de considérations liées aux espèces et aux écosystèmes. Cela comprend, le cas échéant, la création de nouvelles organisations pour viser les zones ou espèces auparavant non réglementées, et par le soutien aux pays en développement dans leurs efforts visant à améliorer la gestion des pêches à l’échelle nationale et pour leur permettre de participer davantage aux questions de gouvernance internationale des pêches. Le Canada a assumé un rôle de premier plan dans le cadre de cet effort mondial visant à réformer la gouvernance internationale des océans, notamment par une conférence internationale sur la gouvernance en haute mer en mai 2005 organisée par le Canada. - Aquaculture
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent les compétences relatives à l’aquaculture canadienne et ont appliqué en coopération des mesures pour garantir l’intégrité environnementale des exploitations d’aquaculture
L’aquaculture peut servir à atténuer certaines pressions sur les stocks naturels, et ainsi prévenir les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient autrement se produire. Par exemple, le secteur de la salmoniculture de la Colombie-Britannique a produit environ 78 700 tonnes de saumon en 2010. Au cours de la même année, les pêches commerciales de la province représentaient environ 23 100 tonnes. Si le saumon d’élevage n’avait pas été disponible, il y aurait eu une pression encore plus grande sur les ressources en saumon sauvage du Canada. L’aquaculture présente des similitudes avec les fonctions de production agricole traditionnelles et, par conséquent, son succès et sa croissance dépendent des politiques qui assurent la durabilité et atténuent les incidences négatives sur l’environnement. Plus de 80 lois et règlements fédéraux et provinciaux régissent la performance environnementale de cette industrie, assurant que l’accroissement de la production ne serait pas permise sauf s’il a été jugé qu’elle est durable sur le plan environnemental. En général, la Loi sur les pêches prévoit un cadre de réglementation national dans lequel les provinces exercent leurs activités pour fournir des baux et des permis aux différents exploitants. Ces mesures réglementaires serviraient à prévenir ou à atténuer la majorité des incidences négatives sur l’environnement qui pourraient autrement se produire si les réductions des tarifs imposés sur le poisson se traduisaient par une pression accrue pour fournir davantage de poissons et de produits du poisson d’aquaculture à l’UE.
Ces systèmes de gestion des pêches et les mesures prises par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont été mis en place pour garantir la durabilité des pêcheries canadiennes, quels que soient les demandes et les niveaux tarifaires des marchés exportateurs; ils sont donc indépendants de toute incidence découlant des accords commerciaux. Ces systèmes garantissent également l’intégrité environnementale des exploitations d’aquaculture au Canada, si bien que les augmentations du commerce résultant d’un accord commercial n’aura qu’une incidence mineure sur l’environnement. Étant donné que les exportations de poisson et de fruits de mer sont réparties sur un certain nombre d’espèces et de produits, on s’attend à ce que toute augmentation subséquente des exportations soit également diversifiée. Par conséquent, une augmentation des exportations vers l’UE en raison d’un AECG et d’une libéralisation tarifaire pour les produits du poisson ne devraient pas donner lieu à une modification importante de la durabilité des différents stocks de poissons ni de l’environnement marin ou d’eau douce du Canada.
- Les méthodes traditionnelles de capture
Produits agricoles
Exportations agricoles canadiennes à destination de l’Union européenne
Au cours de la période 2006-2008, les exportations agricoles canadiennes vers l’UE se sont chiffrées en moyenne à 2 milliards $ par année. Les secteurs agricoles canadiens qui pourraient profiter d’une libéralisation commerciale en vertu d’un AECG comprennent : bœuf, porc, grains, huiles et oléagineux, légumineuses à grain, fruits et légumes et produits de l’érable. Pour les produits agricoles canadiens, l’amélioration de l’accès au marché de l’UE est subordonnée à l’élimination des tarifs de douane et à la résolution d’un certain nombre d’obstacles non tarifaires, y compris les mesures SPS, la biotechnologie et des règles d’origine appropriées.
- Possibilités :
- Bœuf et porc : À l’heure actuelle, les petits volumes de contingents tarifaires (CT) jumelés à des obstacles tarifaires et non tarifaires élevées empêchent largement le bœuf et le porc canadiens d’avoir accès au marché de l’UE. Ainsi, les exportations canadiennes vers l’UE sont faibles à l’heure actuelle. De 2006 à 2008, le Canada a exporté en moyenne pour 11 millions $ de bœuf et de bison vers l’UE selon un droit contingentaire de 20 %. Au cours de la même période, les exportations de porc du Canada vers l’UE se sont chiffrées en moyenne à 31 millions $. Toutefois, ces chiffres comprenaient les exportations vers la Bulgarie et la Roumanie avant leur accession à l’UE en 2007; dans les faits, les exportations de porc vers l’UE étaient en moyenne de seulement 3,6 millions $ entre 2006 et 2008. Si les questions tarifaires et non tarifaires seront réglées adéquatement dans le cadre d’un AECG, les industries canadiennes du porc et du bœuf pourraient augmenter leurs exportations vers le marché de l’UE.
- Grains : Au cours de la période 2006-2008, le Canada a exporté en moyenne pour 535 millions $ de grains et de produits céréaliers vers l’UE (8 % des exportations canadiennes de grains). Près de 95 % de ces exportations étaient constituées de blé (266 millions $) et de blé dur (235 millions $) dont la plus grande partie était exemptée de droits de douanes selon le calcul des droits de l’UE pour le blé et le blé dur.
- Huiles et oléagineux : Au cours de la même période, la valeur moyenne des exportations canadiennes d’huiles et d’oléagineux vers l’UE s’est élevée à 534 millions $ (10 % des exportations canadiennes d’huiles et d’oléagineux). Les principales exportations du Canada vers l’UE comprenaient : le soja (230 millions $), le lin (211 millions $) et l’huile de canola (84 millions $).
- Légumineuses à grain et cultures spéciales : De 2006 à 2008, le Canada a exporté en moyenne pour 328 millions $ de légumineuses à grain et de cultures spéciales vers l’UE (19 % des exportations canadiennes de légumineuses à grain et de cultures spéciales). Les plus importantes exportations canadiennes de légumineuses à grain du Canada vers l’UE comprenaient : les lentilles sèches, décortiquées (75 millions $), les haricots secs, décortiqués (71 millions $) et les pois (58 millions $). Près de l’ensemble des importations canadiennes de légumineuses à grain et de cultures spéciales entrent en franchise de droit sur le marché de l’UE.
- Fruits et légumes : Le Canada a exporté en moyenne pour 123 millions $ de fruits et légumes vers l’UE (4 % des exportations canadiennes de fruits et légumes). Les principales exportations vers l’UE comprenaient les baies congelées (63 millions $), les fruits préparés ou conservés (8,9 millions $), les cerises fraîches (7 millions $), les pommes fraîches (3,4 millions $), le maïs sucré (8,8 millions $), les flocons de pomme de terre (4,0 millions $) et les pommes de terre cuites, congelées et les frites (2,8 millions $). Presque toutes ces exportations sont entrées sur le marché de l’UE au titre de lignes tarifaires passibles de droits, auxquelles on a appliqué des tarifs ad valorem, composites et saisonniers variés, bien que les droits de douane sur les baies congelées aient été suspendus temporairement jusqu’au 31 décembre 2013.
- Produits de l’érable : Le Canada a exporté en moyenne pour 33 millions $ de sirop d’érable et de sucre d’érable vers l’UE (15 % des exportations canadiennes de sirop d’érable et de sucre d’érable). Les importations de sirop d’érable et de sucre d’érable sont assujetties à un tarif douanier de l’UE de 8 %.
- Incidences potentielles sur l’environnement : L’agriculture primaire a une incidence sur l’environnement car il s’agit d’un important utilisateur de ressources naturelles comme la terre et l’eau. Le gouvernement du Canada continue de déployer des efforts considérables pour comprendre l’incidence de l’agriculture sur l’environnement, de chercher des façons de réduire les incidences négatives et de promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Par exemple, en vertu du Programme national d’analyse et de rapport en matière de santé agro-environnementale (PNARSA) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), des indicateurs agroenvironnementaux (IAE) ont été élaborés pour fournir l’information requise pour évaluer l’incidence du secteur et la performance environnementale au fil du temps. On s’attend à ce que de meilleures décisions soient prises quant à l’opportunité et la façon d’améliorer ce rendement. Footnote 37
L’Étude conjointe prévoit que les exportations canadiennes de produits agricoles primaires et transformés vers l’UE pourraient connaître une augmentation de 42 % et de 142 %, respectivement. Quant aux produits qui pourraient bénéficier de la réduction ou de l’élimination des tarifs douaniers prohibitivement élevés, comme le bœuf et le porc, toute hausse prévisible des exportations canadiennes vers l’UE n’aura pas l’ampleur suffisante pour affecter les niveaux des prix mondiaux, ce qui serait le facteur clé dans la fourniture d’un incitatif pour modifier les niveaux d’utilisation des ressources et de la production. Étant donné que l’utilisation des ressources dans ces secteurs devrait très peu changer dans le cadre d’un AECG Canada-UE, les incidences environnementales résultantes seraient très faibles.Avec des importations accrues en provenance de l’UE, le Canada doit maintenir sa vigilance à l’égard de la prévention des espèces exotiques envahissantes et des maladies qui pourraient menacer les secteurs qui interagissent étroitement avec l’environnement, comme le secteur agricole. Footnote 38
Il est important de noter qu’il pourrait y avoir certaines incidences environnementales localisées de petite envergure. Toutefois, étant donné les petits changements prévus en matière d’utilisation des ressources, il est probable que ces incidences seraient isolées et non généralisées. Atténuation / Renforcement : L’agriculture durable sur le plan environnemental est une composante clé de Cultivons l’avenirFootnote 39, une initiative de cadre stratégique agricole des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. L’initiative environnementale de Cultivons l’avenir, dotée d’un financement de près de 200 millions $, met l’accent sur le développement de nouvelles connaissances, de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives dans le secteur agroenvironnementaFootnote 40.
Le programme environnemental Cultivons l’avenirFootnote 41> est constitué de quatre initiatives principales chapeautant un ensemble de six programmes visant à développer des connaissances, des informations et des technologies et à promouvoir par la suite l’adoption de systèmes agricoles contribuant à la durabilité économique et environnementale de l’agriculture pour le bénéfice des producteurs et des Canadiens. Ces quatre initiatives principales sont :- Science agroenvironnementale (32 millions $);
- Outils de connaissance et d’information (63 millions $);
- Soutien des pratiques agricoles durables à la ferme (91 millions $);
- Mesure du rendement et présentation de rapports (13 millions $).
- Des exemples de projets, d’activités et de programmes contribuant aux efforts d’atténuation dans chacune des principales initiatives de Cultivons l’avenir sont décrits en détail ci-dessous.
- Science agroenvironnementaleFootnote 42
Cible – Cible est une initiative de recherche et de développement axée sur l’étude des mécanismes par lesquels les pratiques agricoles et les variations de l’eau et du climat interagissent et elle vise à trouver des pratiques nouvelles ou améliorées que les producteurs pourront utiliser pour maximiser l’impact positif de l’agriculture sur l’environnement. Cette initiative mettra l’accent sur l’utilisation des connaissances concernant les effets des pratiques actuelles en vue de mettre en place des pratiques de gestion bénéfiques nouvelles ou améliorées.Synergie – Synergie est une initiative de recherche et de développement qui veut étudier dans un contexte plus vaste les variations de l’eau et des climats. Son objet est semblable à Cible mais tire parti des ressources externes et des technologies émergentes pour comprendre les liens entre l’agriculture et l’écosystème plus large. Parmi les enjeux qui sont étudiés, figurent par exemple les suivants : comment la variabilité du climat influe sur l’utilisation des terres et comprendre, évaluer et gérer l’incidence de l’agriculture sur la qualité de l’eau.
Outils de connaissance et d’informationFootnote 43
Évaluation des pratiques de gestion bénéfiques à l’échelle des bassins hydrographiques (EPBH) – un projet visant à mesurer l’incidence économique de certaines pratiques de gestion agricoles bénéfiques (PGB) et leurs répercussions sur la qualité de l’eau dans sept bassins hydrographiques canadiens. L’EPBH continue de soutenir la prise de décision quant à l’utilisation des terres autant au niveau de la ferme que du paysage; elle fait partie du volet Environnement de Cultivons l’avenir : le cadre stratégique pour l’agriculture.
Agrogéomatique – un programme qui fournit de l’information et des connaissances en ligne basées sur la géographie pour améliorer la prise de décisions et la gestion des risques pour l’agriculture et l’environnement.Pratiques agricoles durablesFootnote 44
Initiative des approches novatrices – les projets financés par cette initiative répondent aux besoins d’assistance technique en matière de planification environnementale et examinent de nouveaux modèles de prestation des programmes.
Quatre projets sont à la base des approches novatrices :- Assistance technique – pour accélérer l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) en développant et en fournissant des renseignements fondés sur la science et une expérience pertinente dans le cadre de projets réalisés en partenariat (p. ex. études portant sur les pénuries d’eau à usage agricole et l’adaptation aux changements climatiques, systèmes de culture de rechange, projets d’approvisionnement en eau).
- Planification axée sur les paysages – par l’appui de l’industrie, des responsables des bassins hydrographiques et d’autres groupes, ce projet fournit aux producteurs des outils, des renseignements et des ressources pour les aider à trouver des solutions aux problèmes prioritaires de la gestion de l’eau, de l’incidence des changements climatiques et des mesures d’atténuation et d’adaptation.
- Instruments axés sur les marchés – recension et mise à l’essai d’approches axées sur les marchés qui peuvent inciter les producteurs à mieux relever les défis agroenvironnementaux. Ces instruments servent à élaborer un certain nombre de recommandations et/ou de plans de programmes incitatifs, accordant la priorité aux nouveaux défis du secteur ainsi qu’aux contributions des producteurs et de l’industrie.
- Programmes pilotes étagés – étude d’une approche canadienne de programmes étagés axés sur la nécessité d’adopter à la ferme des PGB apportant de nombreux avantages publics.
- Assistance technique – pour accélérer l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) en développant et en fournissant des renseignements fondés sur la science et une expérience pertinente dans le cadre de projets réalisés en partenariat (p. ex. études portant sur les pénuries d’eau à usage agricole et l’adaptation aux changements climatiques, systèmes de culture de rechange, projets d’approvisionnement en eau).
- Mesure du rendement et présentation de rapportsFootnote 45
Programme national d’analyse et de rapport en matière de santé agroenvironnementale (PNARSA) – un système d’indicateurs de rendement agroenvironnemental quantifiables.
Système national de comptabilisation et de vérification des quantités de carbone et des émissions de gaz à effet de serre (SNCVCG) – un système pour améliorer les bases scientifiques de mesure des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’agriculture.
- Science agroenvironnementaleFootnote 42
A3. Importance des incidences potentielles sur l’environnement
Produits non-agricoles
Les discussions précédentes portant sur les biens non-agricoles ont cerné les incidences potentielles sur l’environnement qui pourraient découler d’une libéralisation du commerce en vertu d’un AECG Canada-UE dans les secteurs des métaux, de la fabrication industrielle, des produits chimiques, des produits forestiers et des produits de poisson et de fruits de mer. La croissance dans chacun de ces secteurs pourrait entraîner une demande accrue en matières premières. Les augmentations au chapitre de la production des biens non agricoles pourraient également entraîner une plus grande consommation énergétique et davantage d’émissions dans l’environnement. Ces incidences devraient être gérables pour plusieurs raisons. D’abord, les augmentations de la production se produiraient en vertu du cadre réglementaire du Canada avec des régimes de surveillance environnementale fédéraux, provinciaux et territoriaux bien établis qui traiteraient les incidences négatives résultantes sur l’environnement. En particulier, les cadres juridiques nécessitant des évaluations des incidences environnementales des nouveaux développements contribueront à atténuer les incidences des projets dans plusieurs secteurs. Deuxièmement, une plus grande libéralisation des échanges appuie les objectifs environnementaux en améliorant l’accès aux technologies, aux biens et aux services qui font avancer les objectifs de développement durable. Le Canada est bien placé comme chef de file mondial en technologies environnementales et a les bonnes conditions, des compétences variées de classe mondiale, l’équipement et la technologie nécessaires ainsi qu’un nombre croissant d’entreprises à la fine pointe qui sont prêtes à tirer profit des marchés mondiaux en expansion. Troisièmement, la coopération entre le Canada et l’UE sur les questions de réglementation, dans les secteurs des ressources et ailleurs pourrait conduire à une mise en œuvre et à une surveillance améliorées des mesures environnementales dans les deux pays.
Produits agricoles
Dans l’ensemble, les niveaux de risques environnementaux pour l’eau, le sol, l’air et la biodiversité ne devraient pas changer considérablement en raison de la libéralisation du commerce des produits agricoles entre le Canada et l’UE. Tout changement qui pourrait en découler serait moins important que la fluctuation normale des niveaux de production causée par un changement des conditions du marché. Comme il a été discuté préalablement, on ne s’attend pas à un changement majeur dans l’utilisation des ressources, et les tendances commerciales changeantes ne devraient pas entraîner des incidences importantes sur les niveaux de production. En examinant la menace potentielle posée par les maladies et les parasites envahissants découlant des échanges accrus avec l’UE, il sera important pour le Canada de maintenir sa vigilance dans ce secteur. En outre, il existe plusieurs mesures et programmes d’atténuation actuellement en place gérés par plusieurs ministères du gouvernement fédéral qui permettraient de traiter les incidences potentielles négatives sur l’environnement dans les secteurs discutés ci-dessus, tout en renforçant les incidences positives sur l’environnement.
Étant donné les considérations énoncées ci-dessus, les incidences environnementales découlant d’un accroissement des échanges de biens avec l’UE devraient être mineures.
B. Commerce des services
B1. Aperçu
L’Union européenne (UE) est le plus important exportateur de services au monde, représentant 42,5 % de la part totale mondiale des exportations de services commerciauxFootnote 46 en 2010. Le commerce des services de l’UE se concentre sur d’autres économies industrialisées. Les États-Unis sont le principal partenaire de l’UE tant pour la fourniture que pour l’achat de services, suivis de la Suisse, la Chine, la Russie, le Japon et le Canada. L’UE est le deuxième partenaire en importance du Canada pour le commerce des services : le commerce bilatéral s’élevait à 27,5 milliards $ en 2010.
Les services représentent le plus important secteur économique au Canada et au sein de l’UE, et les deux parties ont pris des engagements de fond en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce dans pratiquement tous les principaux secteurs de services.Footnote 47 De même, les deux ont également pris des engagements sur les protocoles pour les secteurs des télécommunications et des services financiers. Un nombre limité d’exemptions nation la plus favorisée (NPF) est maintenu dans un petit nombre de secteurs.
Le commerce des services entre le Canada et l’UE est régi principalement par les règles et les engagements en matière d’accès aux marchés de l’AGCS de l’OMC. Le Canada et l’UE participent activement aux négociations de l’AGCS.
Il existe suffisamment de latitude pour promouvoir les intérêts canadiens bilatéralement dans le cadre d’un AECG avec l’UE et une approche de type Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) bonifié serait probablement plus avantageuse pour les deux parties que l’AGCS.Footnote 48 Une approche ambitieuse, fondée sur des listes négatives, où tous les secteurs sont censés être libéralisés sauf indication contraire, offrira aux deux parties une meilleure transparence en matière de réglementation et un accès accru aux marchés que ce qui existe actuellement en vertu de leurs engagements respectifs dans le cadre de l’AGCS.
B2. Effets économiques prévus
Bien que des études démontrent que la libéralisation des services procure des avantages considérables, il demeure difficile d’évaluer l’incidence économique de l’élimination des obstacles au commerce des services. De plus, la définition de commerce des services déborde des flux transfrontaliers pour inclure trois modes additionnels d’offres : la consommation à l’étranger, la présence commerciale et les mouvements des personnes physiques.
Les services constituent un élément essentiel des chaînes de valeur mondiales étant donné qu’ils favorisent les activités à valeur ajoutée dans différents marchés. Les restrictions visant les activités de services se trouvent rarement à la frontière. Les obstacles proviennent souvent de la réglementation nationale de la prestation de services, comme les obstacles aux établissements commerciaux, les restrictions visant certains types de présence commerciale et le nombre/le type de services qui peuvent être fournis et le traitement discriminatoire qui avantage les entreprises nationales par rapport aux entreprises étrangères.
L’Étude conjointe prévoyait que la libéralisation du commerce des services contribuerait considérablement aux gains du PIB (50 % des gains totaux pour l’UE et 45,5 % des gains pour le Canada). Le total des exportations de biens et de services de l’UE vers le Canada devrait augmenter de 24,3 %, tandis que les exportations canadiennes vers l’UE devraient connaître une hausse de 20,6 %. Pour le commerce des services, les exportations de l’UE au Canada devraient croître de 13,1 % et les exportations du Canada vers l’UE devraient augmenter de 14,2 %. En outre, l’étude fait état de la possibilité d’améliorer un large éventail d’aspects, allant de la mobilité de la main-d’œuvre (y compris le séjour temporaire des gens d’affaires), à l’environnement, à la coopération en matière de réglementation et aux sciences et technologies. On peut s’attendre à ce que le Canada tire profit d’un meilleur accès aux innovations, aux technologies de pointe et aux pratiques exemplaires qui contribueront à améliorer la productivité, et qui pourraient également accroître la performance environnementale.
B3. Incidences potentielles sur l’environnement
Du fait que les services deviennent de plus en plus intégrés pour la production de biens complexes, les incidences environnementales pouvant découler d’un commerce accru des services seraient probablement indirectes. De surcroît, on s’attend à ce qu’un renforcement de la coopération dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, du séjour temporaire, de la coopération en matière de réglementation et des sciences et technologies, contribue également à une augmentation des activités dans le secteur du commerce des services. Toutefois, il est difficile de quantifier ou de prévoir les effets d’une augmentation du commerce transfrontalier des services sur l’environnement, puisque les services commerciaux ne sont pas tous enregistrés lorsqu’ils franchissent la frontière. Les mouvements des personnes liés au commerce des services, par exemple, est pris en considération dans les statistiques sur les voyages d’affaires, mais ces données ne sont pas propres aux industries; il s’avère donc difficile de les attribuer à des hausses ou à des baisses dans des secteurs de services précis.
Cela étant dit, la plupart des services profitant d’une libéralisation en vertu d’un AECG Canada-UE seraient probablement dans les secteurs virtuels (c.-à-d. ceux sans composante physique, comme la consultation juridique), avec moins de risque d’incidences négatives sur l’environnement. L’effet net sur l’environnement sera difficile à évaluer de façon qualitative ou quantitative, mais il devrait être faible, étant donné le développement et l’utilisation des technologies vertes et les innovations connexes dans ces secteurs de services.
Dans des secteurs comme les services environnementaux et les services de télécommunications, on peut prévoir des incidences positives sur l’environnement vu l’adoption de biens et services plus durables sur le plan environnemental. Les services environnementaux, par exemple, comprennent les services respectueux de l’environnement tels que l’élimination des déchets, l’assainissement et les services connexes, la réduction du bruit, la protection de la nature et du paysage ainsi que d’autres services de protection de l’environnement. Les télécommunications pourraient faciliter les transactions virtuelles de services.
Cela pourrait également être le cas dans les domaines des services professionnels, scientifiques et technologiques, pour lesquels on peut s’attendre à ce que le Canada tire profit de l’accès aux innovations, aux technologies de pointe et écologiques et aux pratiques exemplaires qui contribueront à améliorer la productivité au pays.
B4. Importance des incidences potentielles sur l’environnement
Bien qu’on s’attende à ce qu’un accord avec l’UE élargisse l’accès au marché, le Canada est déjà très ouvert à l’égard de la plupart des secteurs de services. De manière générale, alors qu’on ne s’attend pas à d’importantes incidences – positives ou négatives – sur l’environnement, il serait utile d’examiner les synergies entre les biens et services environnementaux, qui pourraient influer sur l’ampleur des incidences. Les incidences négatives potentielles sur l’environnement peuvent être contrebalancées par l’adoption de mesures d’atténuation et des possibilités connexes visant à favoriser une croissance durable sur le plan environnemental, entre autres par la voie de l’innovation technologique et des pratiques industrielles exemplaires, comme mentionné ci-dessus.
B5. Atténuation / Renforcement
Les secteurs des services ont tendance à être fortement réglementés. Les divers ordres de gouvernement, de même que les associations professionnelles qui ont obtenu des pouvoirs d’autoréglementation, ont mis en œuvre et maintenu des règlements régissant la prestation de services. Généralement, ces règlements établissent et maintiennent un cadre légal répondant à divers objectifs de politique publique, dont celui de la protection de l’environnement.
En ce qui touche certains secteurs de services, les changements et améliorations apportés aux procédures, à l’équipement et à la technologie atténuent les incidences possibles, comme le font les lois environnementales et la sensibilisation de l’industrie aux enjeux environnementaux. Par exemple, dans le secteur pétrolier et gazier, les changements apportés aux procédures et à la technologie comprennent : un forage de puits directionnel et horizontal qui réduit le nombre de routes, de lignes de transport d’énergie et de pipelines nécessaires pour un site, et l’utilisation de technologies sismiques à faible impact sur un terrain sensible sur le plan environnemental. De nouvelles procédures et technologies peuvent également aider à prévenir les accidents qui pourraient avoir des conséquences graves sur l’environnement.
Dans le secteur du tourisme, les dommages environnementaux peut être limités en contrôlant l’accès aux sites sensibles sur le plan écologique et en limitant le nombre de visiteurs dans certains secteurs en fonction de la capacité d’accueil, sans pollution, perte de l’habitat faunique ou d’autres dommages. En ce qui touche les services de transports, il existe une large gamme de directives environnementales, de codes de pratique et de normes internationales en place pour réduire les incidences environnementales. Il existe, dans le secteur de la construction, un large éventail de directives, outils et techniques en matière de protection de l’environnement applicables aux travaux d’ingénierie. Ceux-ci comprennent la conception des installations et les mesures de sélection des sites, les mesures de conservation de l’énergie et les mesures sur le site servant à contrôler l’érosion du sol, à gérer les déchets et à contrôler les polluants. L’initiative stratégique Super E®, par exemple, est une nouvelle norme d’habitation qui repose sur des techniques de construction de pointe favorisant la conservation de l’énergie, la construction respectueuse de l’environnement et les maisons saines.Footnote 49
Les options du secteur privé en matière d’atténuation comprennent la conservation du papier au sein du bureau, une utilisation accrue des moyens de facilitation des échanges transfrontaliers (c.-à-d. Internet/courriel, télécopieur, téléconférence et vidéoconférence), le recyclage de divers matériaux et les politiques organisationnelles sur l’« approvisionnement durable &187;. Bien que ces activités relèvent du champ d’application du secteur privé, les politiques gouvernementales peuvent donner le ton quant à l’adoption de telles pratiques, précisément par l’écologisation des stratégies en matière de marchés publics.
C. Marchés publics
C1. Aperçu
Les règles régissant l’accès de l’étranger aux marchés publics sont régies sont établies en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Footnote 50 L’AMP étend la portée des principes de non-discrimination, de traitement national et de transparence aux engagements pris par les parties à l’Accord. Bien que le Canada et l’Union européenne (UE) soient tous deux signataires de l’AMP, leurs engagements pourraient être améliorés dans le cadre d’un AECG, tout particulièrement dans le domaine de l’accès aux marchés. Pour le Canada, cela pourrait comprendre des engagements élargis concernant les entités sous-centrales (provinces, territoires et municipalités) et d’autres entités comme les sociétés d’État. Actuellement, bien que l’UE offre des engagements dans ces secteurs à d’autres parties à l’AMP, y compris dans le secteur des « services d’utilité publique &187;, elle n’étend pas au Canada – sur une base de réciprocité – l’accès aux marchés publics de ces entités.
L’Étude conjointe a conclu que la libéralisation des marchés publics à tous les niveaux offrirait de grandes perspectives d’affaires tant aux exportateurs et investisseurs canadiens qu’européens.Footnote 51 Les accords sur les marchés publics offrent aux fournisseurs canadiens de nouvelles possibilités de soumissionner sur des marchés lancés par des gouvernements étrangers. Ces accords contribuent également à assurer un traitement équitable, ouvert, transparent, concurrentiel et non-discriminatoire à l’égard des fournisseurs canadiens lorsqu’ils soumissionnent sur ces marchés. Il en sera de même pour les fournisseurs européens cherchant à soumissionner sur les marchés publics accordés au Canada.
Les dispositions sur les marchés publics de l’AECG Canada-UE reposera sur les règles et obligations énoncées dans le texte révisé (novembre 2007) de l’AMP de l’OMC et mettra l’accent sur l’élargissement de l’accès aux marchés.
C2. Effets économiques prévus
Les marchés publics constituent une part importante des revenus nationaux. Même s’il existe une certaine incertitude quant à la valeur des marchés publics de biens et de services au Canada comme dans l’UE, la Commission européenne estime que le marché public européen est le plus grand au monde. Les achats publics effectués par les 27 États membres de l’UE et par ses principales institutions, la Commission européenne et le Conseil de l’UE, ont été estimés à 17 % du PIB (ou 2,94 billions $ / 2,15 billons €) en 2008.Footnote 52 Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) du Canada, la valeur annuelle estimée des contrats accordés par les ministères et organismes du gouvernement fédéral était de 16 milliards $CAN en 2008.Footnote 53 Cette estimation ne tient pas compte des marchés infra-fédéraux ni de ceux des autres entités fédérales (les sociétés de la Couronne), dont la valeur est généralement estimée à un montant dépassant largement celui des marchés fédéraux.
Les effets économiques majeurs de tout accord concernant les marchés publics entre l’UE et le Canada découleraient d’une extension des engagements actuels aux entités sous-centrales et autres entités acheteuses (« services d’utilité publique &187; dans l’UE, sociétés d’État au Canada). Une telle extension donnerait lieu à une ouverture formelle et obligatoire des marchés pertinents dans l’UE et au Canada. Les fournisseurs canadiens bénéficieraient d’un meilleur accès aux contrats gouvernementaux dans des secteurs de croissance clés de l’UE, comme ceux des technologies de l’information et des communications, des télécommunications, des technologies de l’énergie et des produits et services environnementaux. Le Canada aurait également un meilleur accès aux marchés publics de l’UE dans les secteurs d’expertise canadienne comme les infrastructures, les travaux de génie civil, les transports, l’énergie, la production, la distribution et la transmission de l’électricité et les services d’eau.
C3. Incidences potentielles sur l’environnement
Dans l’ensemble, la libéralisation accrue des marchés publics ne devrait pas avoir une incidence considérable sur l’environnement. Même si les incidences négatives de la main-d’œuvre et des biens sur le transport pourraient s’accroître marginalement en raison d’un accord, celles-ci pourraient être contrebalancées par une incidence légèrement favorable étant donné que les gouvernements bénéficiant d’une concurrence accrue et d’options plus vastes se procurent les technologies les plus efficientes. En outre, les marchés publics tendent à suivre des directives et des politiques strictes à l’égard de la gérance environnementale, et ces politiques resteront en vigueur avec ou sans un AECG avec l’UE.
C4. Atténuation / Renforcement
Les incidences environnementales découlant de marchés publics accrus dans le cadre d’un AECG Canada-UE devraient être atténuées en grande partie par des pratiques d’approvisionnement écologiques tant au Canada qu’au sein de l’UE. Dans les matières relatives aux marchés publics, comme pour les autres matières relatives au commerce, les provinces et les territoires s’engagent à tenir compte de la nécessité de rétablir, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement.Footnote 54 Le Canada conservera sa capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques d’achats écologiques, et le Canada et l’UE pourraient profiter d’une collaboration accrue dans le domaine de l’étiquetage des produits écologiques et des achats écologiques. À cet égard, le thème de l’écologisation des opérations gouvernementales (EOG) de la SDDF contribuera à faire en sorte que les marchés publics fédéraux respectent les normes environnementales.
Le gouvernement fédéral est un acheteur important au Canada. À ce titre, ses activités ont des répercussions sur l’économie nationale et peuvent influer tant sur le prix que sur la disponibilité des biens et services sur le marché, y compris les services de construction. En faisant davantage la promotion de l’environnement durable et en intégrant l’application des considérations de performance environnementale à son processus d’achats, le gouvernement fédéral est en position d’influer sur la demande de biens et services à privilégier du point de vue environnemental et sur la capacité de l’industrie de répondre à l’utilisation grandissante des normes environnementales sur les marchés mondiaux.
En 2006, le gouvernement fédéral a établi la Politique d’achats écologiques.Footnote 55 Dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement en vue d’améliorer l’environnement et la qualité de vie des Canadiens, la Politique d’achats écologiques du gouvernement cherche vise à réduire les répercussions des activités du gouvernement sur l’environnement et à promouvoir la gérance de l’environnement en intégrant des facteurs de performance environnementale au processus d’achats.
La politique vient également appuyer le gouvernement fédéral pour cibler des résultats environnementaux précis relativement auxquels la politique d’achats peut servir à atténuer les incidences environnementales.
D. Investissements
D1. Aperçu
Comme le souligne l’Étude conjointe, les investissements représentent un volet important des relations économiques entre le Canada et l’Union européenne (UE). L’UE représente la deuxième source d’investissement étranger direct du Canada, lequel se classe au quatrième rang des sources d’investissement étranger direct de l’UE. Les deux économies ont d’importantes entrées et sorties d’investissement étranger direct.
Les économies canadienne et européenne sont de manière générale ouvertes à l’investissement étranger direct. Les investissements sont régis par un cadre de règles établi par les régimes de réglementation respectifs de chaque partie ainsi que par les engagements internationaux en matière d’établissement d’une présence commerciale au Canada ou dans l’UE. Les ventes des sociétés étrangères affiliées constituent l’élément le plus important de la relation d’investissement Canada-UE. Le volume de ces ventes rivalise actuellement avec celui du commerce transfrontalier au chapitre des marchandises et il dépasse largement celui des échanges transfrontaliers de services.
Un nombre de facteurs peut entraver les flux d’investissement. Ces facteurs vont des restrictions réglementaires précises et officielles limitant la participation étrangère dans certains secteurs par des limitations des capitaux propres étrangers, aux exigences de citoyenneté et de résidence pour les directeurs et aux régimes de réglementation accablants qui compliquent l’obtention de visas, de permis de travail et de résidence pour les travailleurs étrangers. Il existe donc un potentiel suffisant de promotion de l’investissement canadien grâce à l’élimination ou à la limitation de ces obstacles.
D2. Effets économiques prévus
La quantification des incidences économiques de la libéralisation des investissements dans le contexte d’un AECG sur les investissements européens au Canada soulève deux questions sur les données :
- la quantification de la portée des obstacles actuels à l’investissement étranger direct découlant des cadres nationaux de réglementation économique
- la détermination de la mesure dans laquelle de tels obstacles peuvent être réduits grâce à une libéralisation plus importante.
Malgré les difficultés que pose la quantification des effets économiques de l’augmentation des investissements de l’UE au Canada, l’Étude conjointe a démontré l’importance des avantages que les deux parties tireraient d’un partenariat économique plus étroit. Il existe actuellement des investissements importants de l’UE au Canada et un AECG aurait le potentiel de faciliter davantage de tels investissements. Toutefois, bien que la présence de telles dispositions relatives à l’investissement constitue un facteur positif pour ce qui est des décisions d’investir dans le territoire de l’autre partie, il ne s’agira là que d’un facteur parmi tant d’autres.
Le marché canadien offre aux investisseurs de l’UE un accès au marché de l’ALENA de 448 millions de consommateurs, des procédures simples et explicites et un climat commercial attirant. Malgré l’absence de statistiques permettant de mesurer l’augmentation des investissements européens à la suite d’un AECG, les niveaux d’investissement européen actuels au Canada et leur croissance au cours de la dernière décennie laissent présager que l’Europe investira dans les secteurs clés qui l’intéresse particulièrement comme celui des services financiers, de la fabrication, de l’immobilier, des services aux entreprises et de l’énergie. D’autres dispositions d’un AECG pourraient aussi favoriser une augmentation des investissements des pays de l’UE par des moyens moins directs, puisqu’une entrée temporaire améliorée, une libéralisation des services et d’autres mesures pourraient attirer les investisseurs.
D3. Incidences potentielles sur l’environnement
La probabilité et l’importance des incidences environnementales pouvant découler des effets économiques prévus d’un AECG avec l’UE dépendront de l’ampleur de l’accroissement des investissements, des secteurs dans lesquels sont réalisés les investissements et des mesures en place pour protéger l’environnement.
L’investissement joue un rôle important dans l’établissement de chaînes de valeur mondiales qui facilitent l’économie mondiale moderne. Ainsi, le commerce international porte très souvent sur d’importants échanges intra-sociétés de biens et de services dans les entreprises multinationales. Ceci s’ajoute aux approvisionnements en composantes et en services sur les marchés mondiaux, aux mouvements internationaux des cadres d’entreprises et des experts techniques, ainsi que des capitaux. Les types d’incidences environnementales susceptibles de découler d’une intégration de plus en plus grande de l’économie mondiale peuvent comprendre des effets sur la pollution de l’air et de l’eau et sur la conservation des terres et de la biodiversité.
L’augmentation des investissements entre le Canada et l’UE pourrait favoriser les incidences positives du fait de l’échange de technologies plus écologiques et plus efficaces et de pratiques commerciales exemplaires.
D4. Importance des incidences potentielles sur l’environnement
L’UE représente 26,5 % de l’ensemble des investissements étrangers directs au Canada. Par conséquent, des modifications relativement modestes sur le plan des investissements de l’Europe découlant d’un AECG pourraient être importantes compte tenu du niveau global de l’investissement au Canada. Bien qu’il soit difficile de distinguer les effets d’un accord ultérieur de ceux découlant d’une croissance générale des intérêts étrangers à l’égard de l’investissement au Canada, un AECG avec l’UE ne devrait pas modifier considérablement le régime d’investissement du Canada déjà largement ouvert. Par conséquent, toute incidence environnementale des investissements accrus directement attribuables à un AECG Canada-UE devrait être mineure.
D5. Atténuation / Renforcement
Comme dans le cas de tous les accords antérieurs sur l’investissement, le Canada entend fermement maintenir le droit de réglementer dans l’intérêt public dans des secteurs comme la santé, l’éducation, les services sociaux et la culture, ainsi que le droit de protéger l’environnement du Canada. Dans le cas où un AECG entraîne une augmentation des investissements de l’UE au Canada, les incidences potentielles sur l’environnement seront atténuées par les lois et règlements existants qui régissent les investisseurs tant nationaux qu’étrangers.
Le Canada poursuivra les négociations en adoptant une position qui offre une solide protection aux investisseurs, d’une manière qui ne compromet pas le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt public, y compris en ce qui a trait à la protection de l’environnement. L’approche du Canada consiste à négocier la latitude nécessaire pour protéger ses objectifs légitimes en matière de politiques publiques dans les clauses de fond d’un chapitre sur l’investissement, y compris en fournissant des indications adéquates aux arbitres dans le cas d’un recours.
Même si le régime d’investissement du Canada déjà ouvert en grande partie signifie que l’augmentation des investissements directement attribuables à un AECG Canada-UE devrait être mineure, il est utile d’examiner comment les incidences environnementales découlant d’un accroissement potentiel des investissements pourraient être atténuées, notamment dans les secteurs les plus intensifs sur le plan environnemental que sont l’exploitation minière et pétrolière/gazière.
Les différents processus réglementaires provinciaux, territoriaux et fédéraux garantissent que les incidences potentielles sur l’environnement découlant des investissements dans des projets d’exploitation minière et pétrolière et gazière sont atténuées. De même, les modifications et améliorations apportées aux procédures, à l’équipement et aux technologies réduisent les effets négatifs possibles tout comme le font la législation environnementale et la sensibilisation de l’industrie aux enjeux environnementaux. Voici quelques exemples de modifications des procédures et des technologies :
- les provinces et les territoires disposent d’un processus réglementaire d’évaluation environnementale pour les projets d’exploitation minière, pétrolière et gazière;
- au niveau fédéral, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) fixe les conditions pour lesquelles un projet exigerait une évaluation environnementale fédérale;
- la prise de précautions particulières lors du forage de puits de gaz acide très importants;
- l’utilisation d’équipement comme celui permettant de récupérer les vapeurs pour réduire les incidences;
- le recours au forage directionnel et horizontal de puits pour réduire le nombre de routes, de lignes de transport d’énergie et de pipelines nécessaires sur un site;
- le recyclage de l’eau utilisée lors du forage et du traitement des sables bitumineux et des minéraux;
- l’utilisation de technologies sismiques à faible impact sur les terrains fragiles sur le plan environnemental afin de réduire les émissions de GES découlant de la consommation d’énergie pendant l’exploration;
- l’emploi des pratiques exemplaires pour réduire les émissions de benzène et les incidences sur la qualité de l’air dans l’industrie des services d’affinage moyennant redevance;
- la prestation de services sur les champs pétroliers et gaziers pour réduire les odeurs, extraire le soufre élémentaire (et ainsi réduire les émissions de dioxyde de soufre), tout en utilisant de l’équipement permettant de récupérer les vapeurs à une échelle commerciale;
- la mise en œuvre du triage du minéral, de la ségrégation et des pratiques avancées de traitement des minéraux afin de réduire au minimum le volume des résidus des opérations minières à gérer;
- l’utilisation d’une approche holistique à l’égard de l’exploitation des ressources minérales comme les modèles de gisements de minerai environnementaux;
- la mise en œuvre de techniques de prévision afin de réduire au minimum la production d’acide découlant des résidus des opérations minières
- la promotion du contrôle des incidences environnementales comme outil d’évaluation et de prise de décisions afin de protéger les écosystèmes aquatiques;
- la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie dans les opérations de l’exploitation des ressources minérales;
- la mise en œuvre de technologies et pratiques de l’exploitation minière écologique.
Il y a de nombreux autres exemples de réactions aux préoccupations environnementales. L’industrie canadienne du pétrole et du gaz est consciente qu’elle partage la terre et l’eau (dans le cas de l’exploration au large des côtes) avec de nombreux intervenants (p. ex. foresterie, pêche et utilisateurs récréatifs) et investit donc largement dans des programmes et des technologies qui aident à réduire son empreinte environnementale. De nombreuses associations nationales ont conclu des protocoles d’entente avec RNCan concernant les changements climatiques. De plus, des initiatives dirigées par le gouvernement visent le développement durable des ressources, et les incidences potentielles sur l’environnement seront atténuées par des lois qui contraignent les investisseurs étrangers aux mêmes règlements en matière d’environnement que ceux auxquels les investisseurs au pays sont assujettis.
D6. Conclusion de l’analyse qualitative
Dans cette analyse, le gouvernement a donné un aperçu qualitatif des secteurs d’intérêt pertinents dans le cadre des négociations de l’AECG Canada-UE et de leurs incidences potentielles sur l’environnement. Cet aperçu a été suivi d’une analyse plus approfondie portant sur quatre secteurs d’intérêt clés où un plus grand risque d’incidences environnementales est prévu : commerce des biens, commerce des services, marchés publics et investissement. Dans ces secteurs, les effets économiques prévus découlant d’un AECG avec l’UE ont été examinés, et les incidences potentielles sur l’environnement et leur importance ont été explorées plus avant. Les cadres stratégiques, les règlements et les autres options visant l’atténuation des incidences potentiellement négatives et le renforcement des incidences positives ont finalement été analysés, et ont été pris en compte dans la prévision des incidences environnementales globales d’un AECG.
En conclusion, l’analyse qualitative de cette évaluation environnementale initiale indique qu’un AECG avec l’UE ne devrait pas avoir d’importantes incidences environnementales au Canada.
Partie 2 : Analyse quantitative
Modélisation économique et environnementale
Aperçu des résultats quantitatifs
Cette analyse économique et environnementale quantitative a été élaborée par le Bureau de l’économiste en chef du MAECI pour évaluer l’incidence environnementale au Canada d’une coopération commerciale et économique croissante entre le Canada et l’UE en vertu d’un AECG Canada-UE. L’évaluation a été effectuée en fonction des incidences économiques estimées provenant de la modélisation de l’équilibre général calculable (EGC) dans l’Étude conjointe. En particulier, les modifications estimées touchant la production de l’analyse économique fondée sur l’EGC dans l’Étude conjointe sont liées au Système des comptes de l’environnement et des ressources du CanadaFootnote 56 de Statistique Canada et l’inventaire national des GESFootnote 57 d’Environnement Canada pour suivre les changements environnementaux au Canada découlant d’une coopération commerciale et économique croissante dans le cadre de l’AECG Canada-UE pour la période comprise entre 2007 et 2014. Cette période a été choisie dans l’Étude conjointe pour refléter l’espace de temps nécessaire pour intégrer pleinement tous les ajustements à long terme dans l’économie découlant de la future mise en œuvre de l’AECG.
L’incidence environnementale d’un AECG avec l’UE est exprimée en trois catégories d’indicateurs environnementaux : les émissions de gaz à effet de serre (GES), l’utilisation de l’énergie et l’utilisation de l’eau. L’incidence environnementale découlant d’une coopération commerciale et économique croissante dans le cadre d’un AECG se répartit en trois composantes : l’effet d’échelle, l’effet de composition et l’effet technique. Les effets d’échelle et de composition découlent directement des changements apportés aux activités commerciales et économiques croissantes dans le cadre de l’AECG Canada-UE : l’effet d’échelle établit un lien entre la croissance des activités économiques et l’accroissement des incidences environnementales, et l’effet de composition permet de cerner les rapports entre les changements structurels et les incidences environnementales. L’effet technique produit par l’AECG n’est pas étudié dans le présent document en raison de l’échelle relativement petite de l’effet mentionné ci-dessous; l’analyse sera plutôt axée sur l’effet technique général qui explique les améliorations en matière d’efficacité énergétique, de réduction des gaz à effet de serre et d’utilisation de l’eau, indépendamment d’un AECG, qui sont prévues au cours de la période examinée.
Selon l’Étude conjointe, le PIB du Canada (valeur nette ajoutée) devrait s’accroître de 0,77 %, tandis que la production totale (y compris tant la valeur nette ajoutée que les intrants intermédiaires) augmenterait de 0,6 % en raison d’une coopération commerciale et économique croissante dans le cadre d’un AECG Canada-UE. Cette croissance des activités économiques devrait générer une nouvelle demande en capital naturel du Canada, ce qui entraînerait des répercussions sur l’environnement au Canada. Il est important de comprendre la portée d’une telle incidence environnementale au Canada et de déterminer si des mesures appropriées pour atténuer une telle incidence devraient être envisagées.
Compte tenu des mesures estimées de l’effet d’échelle, de l’effet de composition et de l’effet technique, la mise en œuvre d’un AECG avec l’UE accroîtrait marginalement les émissions de GES, l’utilisation de l’énergie et l’utilisation de l’eau du Canada. Dans l’ensemble, les émissions de GES augmenteraient de 2 306 kilotonnes par l’intermédiaire des effets d’échelle et de composition. Comparativement aux émissions de gaz à effet de serre annuelles du Canada de 616 580 kilotonnes d’équivalent CO2 en 2007Footnote 58, l’augmentation nette des émissions en raison d’un AECG Canada-UE représente seulement 0,38 % du total des émissions de gaz à effet de serre au cours de cette année. En outre, au cours de la période de mise en œuvre de l’AECG, les progrès réalisés en matière d’adoption de nouvelles techniques environnementales et d’application des règlements environnementaux saisis par l’effet technique devraient réduire davantage les émissions de GES de 393 kilotonnes. Ainsi, l’augmentation nette conséquente des émissions de GES serait seulement de 1 913 kilotonnes.
La consommation totale d’énergie devrait s’accroître de 30 985 térajoules par l’intermédiaire des effets d’échelle et de composition, ce qui représente 0,36 % de l’utilisation d’énergie du Canada de 8 679 177 térajoules en 2007. La consommation totale d’énergie dans le cadre d’un AECG Canada-UE diminuera de 677 térajoules par l’intermédiaire de l’effet technique. Ainsi, l’augmentation nette de la consommation d’énergie serait de 30 308 térajoules. L’estimation fondée sur les renseignements sectoriels choisis (en raison du manque de données) indique que l’utilisation de l’eau devrait augmenter de 387,2 millions m3 grâce à une entente commerciale, ce qui représente 1,1 % de l’utilisation de l’eau du Canada, laquelle totalise 35 574,4 millions m3. Le manque de données de prévision pour les années ultérieures ne permet pas d’estimer l’effet technique pour l’utilisation de l’eau.
Par conséquent, l’incidence négative potentielle sur l’environnement général du Canada découlant de la mise en œuvre de l’AECG Canada-UE devrait être mineure. En outre, un AECG avec l’UE pourrait mener à un changement favorisant une meilleure composition de l’industrie canadienne pour ce qui est des émissions et de la consommation d’énergie, puisque les augmentations nettes prévues des émissions et de la consommation d’énergie sont plus faibles que l’augmentation correspondante du PIB et de la production.
| Effet d’échelle | Effet de composition | AECG - Effet induit total | Effet technique | Effet total, 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de GES (en kilotonnes d’équivalent CO2)> | 3 681 | -1 375 | 2 306 | 0,38% | -393 | 1 913 |
| Utilisation d’énergie (en térajoules) | 51 820 | -20 835 | 30 985 | 0,36% | -677 | 30 308 |
| Utilisation d’eau (en milliers de m3) | 212 401 | 174 817 | 387 218 | 1,1 % | N/A | 387 218 |
La méthodologie employée et les résultats détaillés sont décrits ci-dessous.
A. Cadre de l’évaluation quantitative
L’évaluation est effectuée au moyen de l’estimation de l’incidence économique provenant du modèle EGC dans l’Étude conjointe. L’estimation de l’incidence économique de l’Étude conjointe est liée aux données figurant dans le Système des comptes de l’environnement et des ressources du Canada de Statistique Canada et l’inventaire national des GES d’Environnement Canada pour suivre les incidences environnementales du développement de la coopération commerciale et économique en vertu de l’AECG Canada-UE au Canada.
A1. Le modèle EGC
Le modèle EGC utilisé dans l’Étude conjointe est un modèle mondial dynamique à régions et à secteurs multiples qui a été mis au point par la firme Copenhagen Economics.Footnote 59 Le modèle quantifie les gains économiques potentiels de la libéralisation du commerce entre l’UE et le Canada en vertu d’un AECG Canada-UE en comparant les résultats économiques au Canada et au sein de l’UE avant et après la mise en œuvre de l’AECG. Le modèle isole l’effet du changement de politiques commerciales en n’assumant « aucun changement &187; pour tous les autres facteurs économiques qui affectent l’économie comme les fluctuations macroéconomiques et les variations du taux de change. Les résultats de l’estimation présentés comprennent les améliorations globales du bien-être économique ainsi que les changements à l’égard de la production et des courants d’échanges commerciaux par secteur découlant de la mise en œuvre d’un AECG avec l’UE.
La base de données utilisée pour la simulation est fondée sur la base de données du Projet d’analyse du commerce mondial (GTAP), version 7 édition 5, référencée à 2004. Les données ont été mises à jour au niveau 2007 et comprennent des révisions à divers tableaux nationaux afin de refléter les récentes tendances dans les prix des secteurs de l’agriculture et de l’énergie, et des révisions aux données de protection en fonction du récent texte provisoire de Doha.
L’Étude conjointe élabore un scénario de base et un scénario de libéralisation pour lesquels les changements dans les flux des échanges commerciaux, le PIB et la production sont évalués.
- Scénario de base – Présente les circonstances économiques probables en l’absence d’un AECG Canada-UE.
- Scénario de libéralisation – Assume l’élimination totale de la protection des échanges de biens pour tous les secteurs industriels et agricoles, y compris tous les tarifs douaniers et les contingents tarifaires; une réduction des coûts des échanges générés par les mesures non tarifaires d’un montant équivalant à 2 % de la valeur des échanges dans les secteurs des biens autres que des produits de base; une réduction du coût des échanges pour le commerce des services d’un montant équivalant à celui qu’on estime avoir atteint à l’égard des échanges entre les États membres de l’UE.
Pour les besoins de la présente étude, la base de données du PACM ont été recueillies dans 35 régions, dont l’UE (27), le Canada, les États-Unis, le Mexique, la Chine, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le Japon, l’Inde, certains pays moins avancés (PMA), de même que des pays d’Europe et de la Méditerranée qui ont des accords préférentiels avec des pays de l’UE, de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour lesquels des données du GTAP peuvent être obtenues. La base de données a été regroupée en 33 secteurs canadiens, desquels 23 sont des secteurs producteurs de biens et 10 sont des secteurs de services.
A2. Les indicateurs environnementaux
Les indicateurs environnementaux utilisés pour l’analyse comprennent les émissions de GES, la consommation d’énergie provenant de combustibles fossiles et l’utilisation de l’eau. L’analyse examine l’incidence du commerce libéralisé et de la coopération économique élargie entre le Canada et l’UE en vertu de l’AECG sur la consommation d’énergie et d’eau ainsi que sur la production d’émissions de GES au Canada en fonction des coefficients d’intensité directs pour les émissions de GES et la consommation d’énergie en 2007 et l’utilisation de l’eau en 2007 provenant de Statistique Canada et d’Environnement Canada. Tous ces coefficients d’intensité ont été convertis de façon à correspondre aux catégories de secteur du GTAP utilisées dans l’Étude conjointe.
Quant aux émissions de GES, l’analyse examine tant le niveau de 2007 que l’intensité directe de 3 principaux GES associés à la production d’un groupe de produits : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Le niveau d’émissions mesuré est exprimé en kilotonnes d’équivalent dioxyde de carbone (kt éq. CO2) et leur intensité est mesurée en kilotonnes d’équivalent dioxyde de carbone par million de dollars (Kt éq. CO2/1 000 000 $). Les sources d’émissions se composent de 10 différents types de combustible : le charbon, le gaz naturel (à l’exclusion du liquéfié), l’essence automobile, le carburant aviation, le carburant diesel, le mazout léger, le mazout lourd, les gaz de pétrole liquéfiés (y compris le gaz naturel), la puissance électrique et le coke.
En ce qui concerne la consommation d’énergie, l’analyse se fonde sur le niveau de 2007 et l’intensité directe de la consommation d’énergie associés à la production d’un groupe de produits comprenant le charbon, le gaz naturel (à l’exclusion du liquéfié), l’essence automobile, le carburant aviation, le carburant diesel, le mazout léger, le mazout lourd, les gaz de pétrole liquéfiés (y compris le gaz naturel), la puissance électrique et le coke. L’énergie a été mesurée en térajoules (TJ), et les intensités sont mesurées en térajoules par millions de dollars (TJ/1 000 000 $).
Pour l’utilisation de l’eau, la base est le volume de l’utilisation en 2007 qui représente les derniers renseignements disponibles actuellement. Le niveau mesuré de l’utilisation de l’eau est exprimé en milliers de mètres cubes, l’intensité en mètres cubes par dollar.
A3. Méthodes d’évaluation
La présente analyse distingue trois mécanismes par lesquels un changement dans les politiques commerciales peut influer sur le niveau d’émissions de GES et le rythme d’épuisement des ressources naturelles (énergie, eau) : l’effet d’échelle, l’effet de composition et l’effet technique. Footnote 60
Lorsqu’il y a expansion de l’activité économique, et si la nature de cette activité demeure inchangée, le niveau total d’émissions de GES et d’épuisement des ressources en eau et en énergie ne peut qu’augmenter. On appelle cela l’effet d’échelle.
Un effet de composition englobe les changements dans les émissions et l’épuisement découlant de l’évolution de la structure industrielle de l’économie par la suite des modifications apportées aux politiques commerciales. Lorsque le commerce est libéralisé, les pays concentrent encore plus leurs activités dans les secteurs dans lesquels ils profitent d’avantages comparatifs et d’une spécialisation. L’effet net de l’ajustement structurel sur les niveaux d’émissions de GES et d’épuisement des ressources en eau et en énergie pour chaque économie dépend de l’augmentation ou de la réduction des activités très polluantes et des activités qui utilisent beaucoup d’eau et d’énergie. Ainsi, l’effet de composition net sur l’environnement découlant de changements aux politiques commerciales peut seulement être évalué de manière empirique.
Enfin, un effet technique est mesuré. À la suite d’une libéralisation des marchés, les méthodes de production économique pourraient ne pas être les mêmes qu’avant un AECG avec l’UE. Afin d’être entièrement évaluée, l’incidence environnementale d’un AECG Canada-UE doit être examinée non seulement en fonction des technologies et des règlements en matière d’environnement qui existent au moment du changement des politiques, mais aussi compte tenu de l’évolution technologique qui se sera produite lors de la mise en œuvre de l’accord. Par exemple, les émissions par unité de production économique peuvent diminuer pour les raisons suivantes :
- L’augmentation des prix de l’énergie facilite l’adoption de mesures éconergétiques et de conservation;
- La nouvelle formation de capital au cours de la période de mise en œuvre de l’AECG entraînerait un niveau d’émission moins élevé que le stock de capital existant étant donné que le nouveau capital est généralement plus propre et plus efficient que le stock de capital existant;
- L’accroissement des échanges facilitera également le transfert des technologies modernes et propres entre les partenaires commerciaux, ce qui réduira le coût de telles technologies et accroîtra leur disponibilité. L’utilisation accrue de technologies plus propres et efficientes contribuerait également à la réduction des émissions nocives et à l’amélioration de la conservation de l’énergie et de l’eau;
- L’élaboration de normes plus strictes en matière de pollution et d’une application plus rigoureuse des lois et des règlements actuels de lutte contre la pollution pourraient également mener à de meilleurs résultats environnementaux.
Toutefois, l’effet technique produit par un AECG n’est pas étudié dans la présente évaluation; l’analyse est plutôt axée sur l’effet technique qui représente l’amélioration continue de la qualité de l’environnement au Canada, indépendamment d’un AECG Canada-UE. Dans l’ensemble, l’incidence nette d’un AECG avec l’UE sur l’environnement est déterminée par ces trois forces concurrentes, chacune ayant une valeur relative unique : l’effet d’échelle (incidence négative), l’effet de composition (incidence ambigué) et l’effet technique (incidence positive). L’effet d’échelle et l’effet technique tendent à prendre des directions opposées, tandis que l’effet de composition dépend de l’augmentation et de la réduction des secteurs à forte production d’émissions. L’incidence d’ensemble du commerce dépendra de l’ampleur ou de la force de chacun de ces trois effets.
A4. Limites de la modélisation économique et environnementale
Les résultats de la modélisation devraient être examinés dans le contexte des avantages et des limites du modèle. Quelques mises en garde sont requises à propos de l’interprétation des incidences environnementales mentionnées.
L’évaluation quantitative de l’incidence environnementale d’un AECG Canada-UE est effectuée en fonction de l’estimation de l’incidence économique déclarée dans l’Étude conjointe. Par conséquent, l’évaluation environnementale effectuée dans ce rapport hérite de certaines limites relatives à la modélisation économique dans l’Étude conjointe. Celles-ci sont présentées ci-dessous.
D’abord, bien que la modélisation économique soit un outil prévisionnel utile, tous les modèles économiques, par définition, représentent une simplification de la réalité et s’appuient sur de nombreuses hypothèses. Par conséquent, les résultats présentés devraient être considérés comme complémentaires à l’analyse qualitative des avantages découlant d’un AECG avec l’UE qui sont présentés ailleurs dans l’Étude conjointe et plus haut dans la présente évaluation environnementale.
Deuxièmement, l’évaluation économique présentée dans l’Étude conjointe devrait être considérée comme des estimations des incidences économiques potentielles d’un AECG avec l’UE, et non comme des prévisions des résultats réels. Elle isole l’incidence des politiques commerciales en dégageant toutes les autres influences macroéconomiques comme la croissance économique et les fluctuations des taux de change.
Troisièmement, la modélisation économique assume l’élimination entière des obstacles tarifaires pour tous les produits industriels et agricoles; notamment, aucune exception n’est faite pour les « secteurs sensibles &187; même si les accords de libre-échange (ALE) comprennent généralement des dispositions visant leurs incidences dans les secteurs sensibles. Les gains commerciaux du Canada dans les secteurs de sensibilité de l’UE et les gains commerciaux de l’UE dans les secteurs de sensibilité canadienne pourraient être limités dans le temps ou l’étendue par des dispositions particulières qui ne sont pas connues avant la conclusion de l’accord. Ces dispositions ne pouvaient être prises en compte dans la modélisation économique.
Quatrièmement, la modélisation économique utilisée dans l’Étude conjointe comprend seulement l’expansion du commerce des produits déjà échangés dans le cadre de la relation bilatérale, et ne peut prévoir la création d’échanges dans les nouveaux secteurs de produits, ce qui est particulièrement important pour le nouvel accord commercial étant donné que l’entente commerciale abaisse le seuil d’entrée pour les pays partenaires de l’ALE.
Cinquièmement, la modélisation économique ne permet d’analyser que les gains tirés de la libéralisation des échanges de biens et services, mais pas ceux tirés de la libéralisation et du renforcement de la coopération économique dans d’autres domaines (notamment celui de l’investissement en raison de la limite des données).
Sur le plan des résultats de la modélisation environnementale décrits dans le présent rapport, il y a certaines mises en garde concernant l’interprétation des résultats d’estimation.
Premièrement, le rapport fournit une évaluation de l’incidence environnementale due à la croissance des activités de production en vertu d’un AECG avec l’UE, mais ne permet pas de rendre compte des émissions directes, de la consommation d’énergie et de l’utilisation de l’eau des ménages découlant des changements dans les tendances de consommation en raison d’un AECG étant donné que la modélisation économique dans l’Étude conjointe fait seulement état des changements dans les tendances de production.
Deuxièmement, cette étude fait une distinction entre la modélisation économique et la modélisation environnementale. L’insuffisance de cette approche est qu’elle ne rend pas compte des changements dans l’intensité des émissions, la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau qui pourraient découler de la mise en œuvre de l’AECG. L’intensité des émissions avant et après l’entrée en vigueur d’un AECG Canada-UE pourrait ne pas être la même. La levée des obstacles pourrait influer sur les choix des entreprises quant aux intrants de production (au pays par rapport à l’étranger ou moins économiques en combustible par rapport à plus économiques en combustible), entraînant une différente intensité des émissions.
Troisièmement, l’effet technique indiqué dans cette étude représente les progrès continus de la qualité environnementale au Canada indépendamment d’un AECG avec l’UE. Cet effet technique est différent d’un effet technique produit par un AECG dans le sens que l’amélioration des revenus en raison d’un AECG Canada-UE pourrait se traduire par une plus grande demande en qualité de l’environnement, aboutissant à une plus faible intensité d’émissions. Il n’existe toutefois aucune raison convaincante de croire qu’un tel effet technique serait considérable étant donné les gains limités de revenus dans le cadre d’un AECG Canada-UE relativement à la taille de l’économie canadienne.
Quatrièmement, en raison de la disponibilité des données, les résultats de la modélisation environnementale reflètent les incidences en fonction des trois indicateurs utilisés dans l’analyse, et ils ne rendent pas compte de l’envergure des problèmes environnementaux qui pourraient survenir en raison d’un AECG avec l’UE. Ces incidences potentielles non quantifiés sont analysées dans la Section D.
B. Les résultats de simulation de l’Étude conjointe de 2008
B1. Incidences sur le PIB
Les résultats de simulation de l’Étude conjointe de 2008 indiquent que les gains du PIB en raison de l’AECG se chiffreraient à 12,1 milliards $, Footnote 61 soit une hausse de 0,77 % du PIB, tandis que les gains du PIB de l’UE s’élèveraient à 17 milliards $, soit une augmentation du PIB de 0,08 %. Bien que les gains du Canada soient, en termes absolus, plus faibles que ceux de l’UE, les répercussions sur l’économie canadienne sont proportionnellement plus grandes, en raison de la différence dans la taille des économies.
La libéralisation du commerce des biens contribue considérablement aux gains du PIB du Canada. Environ 55 % des gains du PIB du Canada découlent de la libéralisation des échanges de biens : 33 % des gains proviennent de l’élimination des obstacles tarifaires et 22 % des gains découlent d’une réduction des obstacles non tarifaires. La libéralisation du commerce des services représente 45 % de gains restants.
B2. Incidences sur le commerce
Le modèle économique prévoit que le commerce bilatéral mesuré en fonction des exportations de biens et de services connaîtrait une croissance de 37,8 milliards $, ou de 22,9 %. Les exportations totales de biens et de services du Canada vers l’UE devraient croître de 20,6 % ou de 12,5 milliards $.
Le Tableau 1 (Appendice A) expose en détail l’incidence des secteurs sur les exportations de biens et de services du Canada vers l’UE à la suite d’un AECG. Dans l’ensemble, les secteurs qui profitent le plus de la libéralisation du commerce avec l’UE sont les aliments transformés, les métaux, les services de transport, l’agriculture primaire, les produits du pétrole et du charbon et l’équipement de transport. La machinerie et l’équipement, les produits chimiques, l’équipement électronique et les services aux entreprises enregistrent également des gains considérables à l’exportation.
Le Tableau 2 (Appendice A) présente l’incidence des secteurs sur les importations du Canada en provenance de l’UE en raison d’un AECG. Les secteurs canadiens qui connaissent la plus forte hausse de la valeur des importations sont les aliments transformés, les produits chimiques, la machinerie et l’équipement, les services de transport et les services aux entreprises.
Comme prévu, les gains de chaque partenaire sont les plus importants dans leurs propres secteurs d’avantages comparatifs majeurs. Le secteur primaire représente 8,6 % des gains à l’exportation du Canada, comparativement à des gains de seulement 0,3 % pour l’UE – ce qui indique un avantage comparatif pour le Canada dans les industries primaires. Par ailleurs, l’Étude conjointe prévoit des gains considérables dans la même industrie (principalement dans les secteurs de la fabrication et des services aux entreprises) tant pour le Canada que l’UE – principalement pour les aliments transformés, les produits chimiques, la machinerie et l’équipement, reflétant les gains réalisés dans le commerce intrasectoriel qui se produit souvent entre pays aux niveaux de revenu similaires.
B3. Incidences sur la production
L’évolution de la structure des échanges ainsi que des changements connexes en matière de tendances de consommation et d’investissement en vertu d’un AECG Canada-UE semble indiquer qu’une réaffectation des ressources dans les secteurs se produirait dans chaque économie selon les avantages comparatifs et l’expertise de chaque partenaire. Ce sont ces changements au niveau de production sectoriel qui servent de base à l’analyse des incidences environnementales présentée ci-dessous.
Au moyen des données sur le niveau de production de 2007 provenant de la base de données (version 8) du GTAP, nous avons appliqué les changements de pourcentage dans la production indiqués dans l’Étude conjointe afin d’obtenir la production suite à la libéralisation pour chaque secteur au Canada. Certains secteurs comme les aliments transformés et les produits du cuir font l’objet d’importants changements négatifs dans la production, reculant de -6,0 % et -4,9 %, respectivement, tandis que l’équipement de transport, les métaux et l’équipement électronique connaissent des gains positifs considérables, variant de 5,2 % à 7,7 %. La production de la plupart des autres secteurs est seulement marginalement affectée par la libéralisation dans le cadre d’un AECG avec l’UE. Dans l’ensemble, la production ou les extrants totaux au Canada devraient croître de 0,6 % ou de 15 milliards $ en prix de 2007.
C. Résultats de l’évaluation environnementale
Cette section présente les résultats de l’évaluation environnementale au moyen des trois indicateurs correspondant aux émissions de GES, à la consommation d’énergie provenant de combustibles fossiles et à l’utilisation de l’eau. Suit une brève conclusion de l’analyse quantitative.
C1. Émissions de gaz à effet de serre par secteur (GES)
Pour déterminer les émissions de GES qui découleraient d’un AECG avec l’UE, l’intensité directe réelle d’équivalent dioxyde de carbone (CO2) de 2007 a été appliquée aux changements dans la production canadienne entre les périodes antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de l’AECG pour 33 produits et services canadiens. Sur le plan de l’intensité en émission de GES, le secteur des services d’utilité publique a la plus forte production d’émissions par million de dollars, suivi par l’agriculture primaire, l’extraction pétrolière et gazière, les produits minéraux et les services de transport.
L’incidence globale sur l’environnement d’un AECG entre le Canada et l’UE dépend de l’envergure de l’expansion économique (l’effet d’échelle) et de la question de savoir si le développement de secteurs de pollution intensive domine l’ajustement structurel (l’effet de composition) dans le cadre d’un AECG. Le Tableau 4 (Appendice A) montre que l’effet d’échelle domine les émissions de GES globales. Ici, l’effet d’échelle est calculé en comparant les différences dans les émissions de GES entre les périodes antérieures et postérieures à l’AECG en maintenant la structure de l’économie au niveau antérieur à l’AECG. En maintenant la structure de l’économie canadienne au niveau antérieur à l’AECG, le développement des activités économiques au Canada dans le cadre d’un AECG avec l’UE donne lieu à une augmentation nette de 3 681 kilotonnes d’émissions d’équivalent CO2. Les secteurs les plus touchés par l’échelle augmentée des activités économiques dans le cadre d’un AECG Canada-UE sont les services d’utilité publique, les services de transport, l’agriculture primaire, les produits chimiques, la construction et l’extraction pétrolière et gazière qui, ensemble, représentent près de 70 % de l’augmentation nette des émissions par l’effet d’échelle dans le cadre d’un AECG avec l’UE.
L’effet de composition est calculé en comparant les différences en émissions de GES au niveau des secteurs entre les périodes antérieure et postérieure à l’AECG en maintenant le niveau des activités économiques au niveau antérieur à l’AECG. L’effet de composition net sur le total des émissions dépend de la question à savoir si les secteurs intensifs en pollution dominent la croissance de la production. L’effet de composition aboutira à moins d’émissions de GES si les secteurs en développement dans le cadre d’un AECG Canada-UE produisent moins d’émissions.
Tel qu’indiqué au Tableau 3 (Appendice A) portant sur les changements sur le plan de la production dans le cadre d’un AECG avec l’UE, les secteurs qui ont une croissance supérieure à la moyenne dans le cadre d’un AECG sont principalement les métaux, l’équipement de transport et l’équipement électronique. Selon les coefficients d’intensité indiqués au Tableau 4 (Appendice A), aucun de ces secteurs n’est considéré comme étant à forte intensité en émissions. D’autre part, les secteurs qui ont une intensité en GES supérieure à la normale comme les services d’utilité publique, l’agriculture primaire et les produits chimiques et les produits du pétrole auraient une croissance inférieure à la moyenne. Par conséquent, l’effet de composition contribue de façon négative au total des émissions de GES au Canada, équivalant à une réduction de 1 375 kilotonnes d’émissions de GES. Cela réduit le total d’émissions de GES de 3 681 tonnes, en fonction du calcul de l’effet d’échelle, à 2 306 tonnes. Comparativement aux émissions de GES annuelles canadiennes de 616 580 kilotonnes d’équivalent CO2 en 2007, l’augmentation nette des émissions en raison de la mise en œuvre de l’AEGC Canada-UE représente seulement 0,38 % de l’ensemble des émissions de GES cette même année. Par conséquent, l’incidence négative potentielle découlant de la mise en œuvre de l’AECG Canada-UE à l’environnement général du Canada serait mineure.
Au niveau des secteurs, l’environnement en général au Canada profite le plus des contractions dans deux secteurs : aliments transformés et services de transport. La hausse des importations de l’UE en aliments transformés réduisent la production du secteur de 6,0 %, ce qui entraîne un recul de 397 kilotonnes d’émissions de GES. Une réduction de la production des services de transport de 0,4 % conduit à une baisse de 314 kilotonnes d’émissions de GES.
Plusieurs secteurs contribuent de façon importante à l’augmentation des émissions au Canada. Une augmentation de 0,97 % de la production des services d’utilité publique conduit à une augmentation de 948 kilotonnes d’émissions d’équivalent CO2. La hausse des exportations de métal du Canada vers l’UE augmente la production du secteur de 7,7 %, ce qui, en retour, donne lieu à une augmentation de 292 kilotonnes d’émissions d’équivalent CO2. Enfin, il est important d’examiner l’effet technique, qui représente l’amélioration continue de la qualité de l’environnement au Canada indépendamment d’un AECG avec l’UE. Dans le cas présent, l’effet technique découle de l’adoption de meilleures technologies environnementales, d’une meilleure application des règlements sur l’environnement, des changements apportés à la structure de l’économie canadienne ainsi que de hausses du commerce de biens, de services et de technologies respectueux de l’environnement au cours de la période de mise en œuvre de l’AECG. On s’attend à ce que l’intensité des émissions mesurée par le volume de pollution générée par unité de production diminuerait en raison de cet effet technique général. Le fait de ne pas tenir compte de l’effet technique aurait pour effet de surévaluer l’incidence environnementale d’un AECG entre le Canada et l’UE. Comme l’illustre la figure 1 ci-dessous, les émissions de GES par milliard de dollars de PIB ont graduellement diminué au cours de la période, passant de 0,72 en 1990 à 0,54 en 2009.
Figure 1 : Intensité en GES (Mt/$milliard PIB)
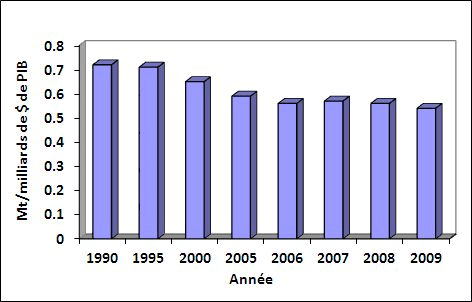
Source : Statistique Canada, Système des comptes de l’environnement et des ressources du Canada
La présente analyse repose sur les prévisions de l’intensité en GES fournies par Environnement Canada de 2007 à 2014 pour évaluer comment l’effet technique pourrait atténuer l’incidence négative potentielle sur l’environnement au Canada au cours de la mise en œuvre de l’AECG. Footnote 62 Ainsi, lorsqu’un AECG avec l’UE sera entièrement mis en œuvre, l’incidence négative réelle sur l’environnement du Canada pourrait ne pas être aussi importante que dans le cas où l’on ne tient pas compte de l’effet technique.
Les intensités des émissions prévues en 2007-2014 proviennent du Modèle 3E d’Environnement Canada. Footnote 63 En appliquant l’intensité prévue des émissions aux changements estimés de la production, on peut constater que l’effet technique a une incidence positive sur l’environnement au Canada en réduisant les émissions de GES de 393 kilotonnes. Les améliorations les plus importantes devraient provenir des secteurs des services d’utilité publique (-178), des produits chimiques (-46) et des aliments transformés (-63).
Dans l’ensemble, l’AECG Canada-UE devrait très légèrement accroître les émissions de GES globales du Canada principalement en raison d’un solide effet d’échelle. Les trois effets ont l’incidence suivante sur les émissions de GES au Canada : un effet d’échelle de 0,6 %, un effet de composition de -0,22 % et un effet technique de -0,06 %, entraînant une augmentation nette des émissions de 0,32 %.
C2. Utilisation de l’énergie par secteur
Sur le plan de l’utilisation de l’énergie, la présente analyse a pris en considération les niveaux de 2007 ainsi que les intensités directes des utilisations de l’énergie relativement à la production de 33 produits canadiens. La hausse des activités économiques découlant d’un éventuel AECG avec l’UE augmenterait l’utilisation totale de l’énergie du Canada comparativement au scénario de base, comme le montre le Tableau 5 (Appendice A)
L’utilisation d’énergie totale pour l’économie canadienne dans son ensemble au cours de la période postérieure à l’AECG augmenterait de 51 820 térajoules par l’intermédiaire de l’effet d’échelle. Les secteurs dans lesquels la plus grande incidence est observée sont les services d’utilité publique, les services publics, les services de transport, la construction, les produits chimiques et les produits de papier, qui ensemble représentent plus de 62 % de l’augmentation totale de l’utilisation d’énergie. Ces secteurs ont des variations positives sur le plan de la production (de 0,2 % à 7,2 %) en raison de la mise en œuvre de l’AECG entre le Canada et l’UE et affichent certains des taux les plus élevés d’intensité en énergie au sein de l’économie canadienne (dans une plage de 2,15 à 37,74 térajoules par million de dollars).
Des échanges plus libres avec l’UE dans le cadre d’un AECG modifieraient la composition de la production canadienne et, ainsi, l’utilisation d’énergie totale de la production nationale. Deux secteurs en contraction sont la source des économies d’énergie supplémentaires : les aliments transformés et les services de transport. Un éventuel AECG avec l’UE permet de réduire la production du secteur canadien des aliments transformés de 6,0 %, ce qui entraîne donc une réduction de l’utilisation d’énergie de 11 467 térajoules. Une réduction de la production des services de transport de 0,4 % mène également à un recul de l’utilisation d’énergie de 10 478 térajoules. Les secteurs qui représentent la grande partie des hausses de l’utilisation d’énergie en raison d’un éventuel AECG entre le Canada et l’UE sont les métaux et les services d’utilité publique.
Ces deux secteurs se développent grâce à un AECG. La hausse des exportations canadiennes de métaux vers l’UE augmente la production du secteur de 7,2 %, ce qui stimule l’utilisation de l’énergie de 6 733 térajoules. Une hausse de la production du secteur des services d’utilité publique de 0,97 % conduit à une augmentation de l’utilisation d’énergie de 5 054 térajoules. Dans l’ensemble, l’évolution de la composition de l’industrie entraîne une diminution de 20 835 térajoules d’utilisation de l’énergie au Canada.
La présente analyse utilise les données relatives aux projections de l’intensité énergétique pour entre 2007 et 2014 Footnote 64 fournies par Environnement Canada pour évaluer l’effet technique qui découlerait du développement des activités économiques résultant d’échanges plus libres avec l’UE dans le cadre d’un AECG. L’utilisation prévue d’énergie se fonde sur les estimations du modèle Énergie-économie-environnement du Canada (Modèle 3E). L’application des changements de l’intensité énergétique aux variations de la production dans le cadre d’un AECG avec l’UE permettrait au Canada d’afficher une réduction marginale de 677 térajoules dans sa consommation énergétique. La majeure partie de l’économie d’énergie devrait provenir des services d’utilité publique (-2 849) et des produits chimiques (-807), tandis que les secteurs des métaux et des aliments transformés devraient accroître leur utilisation d’énergie de 1 800 et de 995 térajoules respectivement.
Dans l’ensemble, les trois effets, considérés séparément, entraînent les incidences suivantes sur l’utilisation de l’énergie pour l’économie canadienne : un effet d’échelle de 0,6 %, un effet de composition de -0,24 % et un effet technique de -0,008 %. Par conséquent, l’AECG Canada-UE devrait accroître l’utilisation d’énergie du Canada par l’intermédiaire d’un important effet d’échelle. Néanmoins, l’incidence totale d’un AECG avec l’UE sur la consommation d’énergie au Canada est relativement faible, ne représentant que 0,35 % de l’utilisation totale d’énergie du Canada.
C3. Utilisation de l’eau selon les secteurs
Pour les données sur l’utilisation de l’eau, la présente analyse utilise les tableaux de Statistique Canada Utilisation de l’eau selon le secteur 2007 pour évaluer les répercussions éventuelles d’un AECG entre l’UE et le Canada sur l’utilisation de l’eau au Canada. Les données sur l’utilisation de l’eau servant à la présente analyse font référence à l’utilisation de l’eau à des fins agricoles, industrielles et municipales, y compris l’irrigation agricole et la génération d’énergie hydroélectrique (vecteur 3). Footnote 65
La hausse des activités économiques découlant de l’AECG Canada-UE augmente de 387,2 millions m3 l’utilisation totale annuelle d’eau. Cela représente une hausse de 1,1 % de l’utilisation de l’eau par rapport à l’utilisation annuelle de l’eau industrielle du Canada de 35 574,4 millions m3. Les secteurs reconnus comme étant les plus intensifs en eau, comme le montre le Tableau 6 (Appendice A) sont les services d’utilité publique, les métaux et les produits du papier. Par contre, les secteurs reconnus comme étant les moins intensifs en eau sont les aliments transformés ainsi que les boissons et le tabac. L’utilisation d’eau totale pour l’économie canadienne augmenterait de 212,4 millions m3 selon l’effet d’échelle en raison d’un AECG. Les secteurs les plus touchés par les hausses de l’utilisation de l’eau sont les services d’utilité publique, l’agriculture primaire, les produits du papier et l’édition, qui ensemble représentent plus de 87 % de l’augmentation totale de l’utilisation de l’eau dans le cadre d’un AECG entre l’UE et le Canada.
Toutefois, l’effet de composition signale qu’un éventuel AECG entre le Canada et l’UE entraînerait une augmentation supplémentaire de l’utilisation de l’eau au Canada de l’ordre de 174,8 millions m3. Les plus importantes augmentations de l’utilisation de l’eau en raison d’un éventuel AECG, par l’effet de composition, se produiraient dans les secteurs des métaux et des services d’utilité publique. Un AECG avec l’UE renforce le commerce du Canada dans le secteur des métaux, en entraînant une hausse de 7,7 % de la production du secteur, ce qui se traduit par une augmentation de 150,9 millions m3 d’utilisation de l’eau. De même, une hausse de 1,0 % de la production des services d’utilité publique canadiens, en raison d’un commerce plus libre avec l’UE, entraînera une utilisation de 85,5 millions m3 d’eau. Les plus importantes réductions de l’utilisation de l’eau correspondent aux trois industries à forte consommation d’eau faisant face à d’importantes diminutions de production en raison d’un AECG entre le Canada et l’UE : aliments transformés, produits du papier et agriculture primaire.
L’effet technique pour l’utilisation de l’eau ne pouvait être calculé en raison de l’absence des données prévisionnelles. L’utilisation de l’eau pour l’économie dans son ensemble est ainsi caractérisée par un effet d’échelle de 0,6 % et d’un effet de composition de 0,5 %. Par conséquent, un AECG entre le Canada et l’UE conduirait à des niveaux marginalement plus élevés d’utilisation de l’eau au Canada.
C4. Conclusion de l’analyse quantitative
Dans la présente analyse, nous avons utilisé les données de Statistique Canada et d’Environnement Canada sur l’intensité des émissions pour les GES, l’utilisation d’énergie et l’utilisation de l’eau pour évaluer les éventuelles incidences sur l’environnement d’un AECG avec l’UE au Canada. L’analyse établit une relation entre les données sur l’intensité et les changements dans la production prévus dans l’Étude conjointe pour estimer les effets de trois catalyseurs (l’effet d’échelle, l’effet de composition et l’effet technique), par lesquels un changement dans les politiques commerciales pourrait influer sur le niveau de pollution et le rythme d’épuisement des ressources environnementales. D’après l’analyse, l’impact net d’un accroissement du commerce bilatéral avec l’UE sur l’environnement du Canada serait caractérisé par des augmentations mineures des émissions de GES, de l’utilisation de l’énergie et de l’utilisation de l’eau. De plus, ces augmentations sont considérablement plus faibles que la hausse correspondante du PIB et de la production, ce qui laisse entrevoir un virage vers une composition plus favorable de l’industrie canadienne en termes d’émissions et d’utilisation de l’énergie dans le cadre d’un AECG entre le Canada et l’UE. Par conséquent, cette évaluation quantitative débouche sur la conclusion qu’il est peu probable qu’un accord ait des incidences importantes sur l’environnement au Canada
D. Autres indicateurs en matière d’environnement et de durabilité
Les modèles environnementaux et économiques dont s’est servi le Bureau de l’économiste en chef fournissent trois indicateurs quantitatifs nationaux : les émissions de GES, l’utilisation d’énergie et l’utilisation de l’eau. Ces indicateurs ont été choisis parce qu’ils représentent des effets quantifiables adaptés à la méthodologie du modèle EGC utilisé par le Bureau de l’économiste en chef du MAECI. Il existe plusieurs autres indicateurs environnementaux, d’envergure nationale, qui sont actuellement disponibles pour contrôler les incidences environnementales et qui méritent de faire l’objet d’une brève discussion. Footnote 66
En raison des difficultés à faire concorder les données environnementales avec le cadre de données dans la modélisation économique, il n’a pas été possible pour le Bureau de l’économiste en chef d’intégrer ces indicateurs à l’évaluation quantitative de l’AECG entre le Canada et l’UE à ce stade. Néanmoins, les indicateurs offrent des données et des informations utiles pour suivre la performance du Canada sur des questions clés de durabilité environnementale. Ils font en sorte que les tendances internationales, nationales, régionales et locales soient facilement accessibles et présentées de manière transparente à l’ensemble des Canadiens. Ces indicateurs continueront d’être utilisés pour suivre la durabilité lorsque l’AECG entre le Canada est l’UE sera mis en œuvre.
D1. Biodiversité
La biodiversité est le terme utilisé pour décrire la diversité ou la variété de la vie sur terre. Elle fait référence aux millions d’espèces qui ont évolué depuis des milliards d’années. La biodiversité est essentielle à la santé des écosystèmes et offre des biens et services qui sont essentiels à la survie de l’espèce humaine, y compris la production d’aliments, de combustible et de médicaments; la réglementation du contrôle climatique, de la défense contre les inondations et de la lutte contre la maladie; la purification de l’air et de l’eau; la pollinisation des plantes et le cycle des éléments nutritifs. La conservation de la biodiversité et l’utilisation des ressources biologiques de manière durable sont des composantes essentielles de l’effort du Canada en vue de réaliser le développement durable. L’Étude conjointe indique que la production agricole augmentera suite à la mise en œuvre d’un AECG entre le Canada et l’UE. L’agriculture dépend fortement de la biodiversité pour les cultures agricoles et l’industrie des productions animales, les sources d’avancement génétique et les services écosystémiques. En même temps, l’agriculture peut avoir une incidence considérable sur l’environnement local et les niveaux de biodiversité. Toutefois, la durabilité économique n’est pas incompatible avec la conservation de la biodiversité dans les systèmes de production agricole.
La Stratégie canadienne de la biodiversité Footnote 67 réaffirme que les gouvernements au Canada doivent créer les conditions en matière de politiques et de recherche qui conduiront à la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources biologiques. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en collaboration avec les parties intéressées et les membres du public, poursuivront la mise en œuvre des directions stratégiques contenues dans la Stratégie canadienne de la biodiversité conformément avec leurs politiques, plans, priorités et capacités fiscales. La Stratégie canadienne de la biodiversité établit un cadre d’action à tous les niveaux qui renforcera la capacité d’assurer la productivité, la diversité et l’intégrité des systèmes naturels et, par conséquent, la capacité comme nation de se développer de manière durable
D2. Contaminants atmosphériques
La pollution de l’air est un terme général s’appliquant à tout agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l’atmosphère. On peut donner comme exemples les particules matières particulaires et l’ozone troposphérique. Les polluants atmosphériques appartiennent à quatre catégories principales : les principaux contaminants atmosphériques (p. ex. SO2, NOx, composés organiques volatiles), les polluants organiques persistants (p. ex. dioxines et furanes), les métaux lourds (p. ex. mercure) et les substances toxiques (p. ex. benzène). Ces contaminants sont indésirables en raison de leurs effets sur la santé humaine et l’environnement, et figurent dans la liste des substances toxiques dans l’Annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les gaz à effet de serre sont inclus dans l’Annexe I, et sont examinés dans la modélisation quantitative de cette analyse.
Les sources de pollution atmosphérique comprennent les tendances actuelles de production et de consommation d’énergie, les industries manufacturières et la production et l’utilisation de produits. L’Étude conjointe indique que certains secteurs manufacturiers (p. ex. véhicules motorisés et pièces, équipement de transport) devraient connaître des augmentations à long terme de leur production en raison d’un AECG entre le Canada et l’UE.
Le gouvernement fédéral, ainsi que les autres paliers de gouvernement, l’industrie, les organisations non gouvernementales et des particuliers ont pris des mesures visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs issus de sources humaines.
Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) sert de forum principal pour que les parties élaborent des stratégies, des normes et des directives nationales que chaque ministère de l’environnement au pays peut utiliser, y compris pour la pollution atmosphérique. Le CCME se compose des ministres de l’environnement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui discutent des priorités nationales en matière d’environnement et qui déterminent le travail à effectuer sous l’égide du CCME. Le Conseil cherche à réaliser des résultats environnementaux positifs, mettant l’accent sur les enjeux de portée nationale et qui exigent l’attention collective de plusieurs gouvernements. Pour la pollution atmosphérique, en particulier, les gouvernements ont mené diverses activités visant des enjeux précis, comme les pluies acides, les substances appauvrissant la couche d’ozone et les normes régissant les substances toxiques.
Fruit d’une étroite collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les parties concernées, le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) Footnote 68 du CCME offre une approche exhaustive de la réduction de la pollution atmosphérique au Canada. Lors de sa mise en œuvre en 2013, le SGQA comprendra de nouvelles normes canadiennes de qualité de l’air ambiant, une gestion de la qualité de l’air local par province dans les zones atmosphériques, et des exigences de base relatives aux émissions industrielles pour les secteurs clés et les groupes d’équipement. Quant aux gaz à effet de serre, le gouvernement fédéral adopte une approche secteur par secteur pour l’élaboration de règlements. Les règlements récemment proposés en matière d’électricité réduiront tant les émissions de gaz à effet de serre que les polluants atmosphériques causés par la production d’électricité à partir du charbon, et des règlements strictes concernant les véhicules amélioreront le rendement du carburant et réduiront les émissions de gaz à effet de serre issues des véhicules utilitaires légers et des camions.
D3. Déchets
Le volume de déchets solides générés au Canada comprend autant les ordures enfouies dans les décharges et éliminées dans les incinérateurs que les déchets récupérés en vue de leur recyclage et de leur réutilisation. La production et la gestion des déchets solides soulèvent d’importants enjeux environnementaux, économiques et sociaux pour les Canadiens. En effet, non seulement les déchets solides peuvent polluer la terre, l’air et l’eau, mais leur collecte et leur élimination coûtent des milliards de dollars par année aux Canadiens. Le détournement des déchets (recyclage, compostage, réutilisation) réduit le volume des matières envoyées dans les décharges, diminue la nécessité d’extraire, de transformer et de produire des matériaux et des produits, et réduit les émissions de gaz à effet de serre et de substances toxiques. La façon la plus efficace de freiner le flux des déchets consiste à réduire le volume des déchets produits par les Canadiens. Les augmentations de la production découlant d’un AECG avec l’UE, comme le prévoit l’Étude conjointe, pourraient entraîner des augmentations des déchets issus des processus industriels, de l’extraction des ressources et de l’emballage.
Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets solides est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales. Les administrations municipales sont chargées de la collecte et de la gestion des déchets résidentiels pour le recyclage, le compostage et l’élimination, tandis que les autorités provinciales et territoriales sont chargées de l’approbation, de l’octroi de licences et du suivi des activités de gestion des déchets. Le gouvernement fédéral, par l’entremise d’Environnement Canada, assume des responsabilités relatives aux mouvements internationaux et interprovinciaux des déchets dangereux, aux rejets de substances toxiques dans l’air, le sol et l’eau ainsi qu’aux activités réalisées sur les terrains fédéraux. Le CCME s’emploie à élaborer des outils et à développer des ressources qui favorisent une gestion des déchets respectueuse de l’environnement au Canada, la promotion de l’utilisation durable des matériaux et des ressources visant à réduire les incidences négatives sur l’environnement et à faciliter la réduction des déchets au minimum. Par exemple, le CCME a approuvé les principes relatifs à l’intendance des produits électroniques, a élaboré des directives régissant les décharges pour déchets dangereux, et met actuellement au point une approche pancanadienne visant à optimiser les réductions en matière d’emballage. Footnote 69
D4. Produits chimiques
L’Étude conjointe prévoit une augmentation à long terme de 0,6 % de la production du secteur des produits chimiques en raison d’un AECG Canada-UE, ainsi que d’autres secteurs qui utilisent les produits chimiques dans le cadre de leurs processus.
Les substances chimiques sont présentes partout où nous nous trouvons : dans l’environnement, les aliments, les vêtements et même dans notre organisme. Beaucoup sont utilisées pour améliorer notre qualité de vie. La plupart ne présentent aucun danger pour l’environnement ou la santé humaine.
Tel que discuté dans la section Commerce des biens de l’analyse qualitative, le gouvernement du Canada gère les substances chimiques qui préoccupent afin de protéger la santé humaine et l’environnement par le Plan de gestion des produits chimiques. Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada a été lancé en 2006, et est géré conjointement par Environnement Canada et Santé Canada. Les substances chimiques préoccupantes font l’objet d’analyses, et des mesures sont mises en place pour éliminer ou réduire les risques de celles qui sont toxiques. Les activités de contrôle et de surveillance dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada sont de portée nationale et sont donc décrits plus en détail ci-dessous.
D5. Programmes nationaux de contrôle et de suivi
Outre les cadres de gestion des risques présentés dans certains secteurs ci-dessus, le Canada a mis sur pied plusieurs programmes nationaux de contrôle en cours pour l’environnement. Ceux-ci comprennent, mais sans s’y limiter :
Les activités de contrôle et de surveillance dans le cadre du plan de gestion des produits chimiques du Canada – Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est le contrôle et la surveillance des niveaux de produits chimiques nocifs dans les Canadiens et leur environnement. La surveillance et le contrôle biologique environnementaux et humains sont essentiels pour cerner et suivre l’exposition aux dangers dans l’environnement et les répercussions connexes sur la santé.
Inventaire national des rejets de polluants – Inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés (dans l’atmosphère, dans l’eau et dans le sol), éliminés et transférés afin d’être recyclés.
Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnementFootnote 70 – Établies par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) afin de fournir des objectifs pour la qualité des écosystèmes atmosphériques, aquatiques et terrestres, qui reposent sur des données scientifiques et qui sont reconnus à l’échelle nationale.
Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE)Footnote 71 – Ce programme fournit des données et des renseignements qui permettent d’effectuer un suivi du rendement du Canada à l’égard d’enjeux clés en matière de durabilité de l’environnement comme les changements climatiques et la qualité de l’air, la qualité de l’eau et sa disponibilité, et la protection de la nature. Les indicateurs environnementaux sont établis à partir d’un ensemble complet de renseignements objectifs, lesquels permettent de dégager des tendances environnementales de façon directe et transparente. Les indicateurs sont ajoutés et mis à jour tout au long de l’année à mesure que de nouvelles données sont disponibles.
VII. Coopération environnementale
Le Canada et l’Union européenne (UE) s’emploient depuis 1975 à accroître leur coopération environnementale bilatérale. Le Dialogue de haut niveau Canada-UE sur l’environnement donne l’occasion aux deux parties de se rencontrer et d’échanger leurs vues sur des politiques de façon régulière. Il est coprésidé par des hauts fonctionnaires d’Environnement Canada et la Direction générale Environnement de l’UE. Des travaux portent également sur la coopération en matière de réglementation afin d’échanger des renseignements sur les approches de gestion du cycle de vie des produits et des déchets électriques et électroniques, sur la réglementation des substances chimiques et sur l’application des régimes de réglementation.Footnote 72
Le Canada et l’UE ont également pris plusieurs autres engagements bilatéraux en matière de coopération environnementale. Ces cadres établis de dialogue constituent les piliers de la coopération actuelle et future en matière d’environnement pour renforcer les incidences positives d’un AECG entre le Canada et l’UE et en atténuer tout effet négatif.
- L’Accord de coopération scientifique et technique entre le Canada et la Communauté Européenne de 1995 vise à encourager la coopération en recherche et en développement dans des secteurs d’intérêt mutuel. L’un de ces secteurs est l’environnement. L’accord porte sur l’échange de renseignements, les chercheurs, les lois et règlements ainsi que le partage d’établissements de recherche.Footnote 73
- La Déclaration conjointeFootnote 74 du Sommet Canada-UE de 2002 engage les deux partenaires à travailler ensemble sur les questions de développement durable et à rechercher des pistes de coopération dans les secteurs suivants : l’environnement, comprenant les changements climatiques, la surveillance de l’environnement, le développement durable et la gestion des ressources. De plus, une coopération accrue était prévue pour les régions septentrionales où le Canada et l’UE ont des défis communs à relever : les menaces environnementales représentées par les changements climatiques, la pollution de l’Arctique, comprenant les polluants organiques persistants et les difficultés causées par l’éloignement géographique.
- Le Programme de partenariat Canada-Union européenne de 2004 souligne l’importance du dialogue et de la coopération sur les enjeux environnementaux, dont ceux relatifs aux changements climatiques, aux pêches, à la foresterie et au Nord.Footnote 75
Les chercheurs canadiens ont également participé activement aux projets de recherche sur l’environnement financés par le Septième programme-cadre. Leurs études ont porté sur une gamme de problèmes environnementaux d’actualité, dont les changements climatiques, les forêts, l’Arctique et la vérification des technologies environnementales. Ces recherches permettent de travailler sur des problèmes d’intérêt mutuel de manière à ce que les résultats et les constatations puissent être diffusés et utilisés pour améliorer les procédés technologiques et la qualité de vie.
Conscients que les problèmes environnementaux actuels constituent un défi trop vaste pour être réglés bilatéralement et que les questions d’environnement transcendent les frontières géographiques, le Canada et l’UE ont été des partenaires actifs de la coopération internationale avec d’autres pays. Ces accords internationaux contribuent à renforcer les normes internationales sur l’environnement et à protéger les ressources pour les générations à venir.
Le Canada a ratifié de nombreux accords environnementaux multilatéraux comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
(Note : Une liste non-exhaustive des traités conclus entre le Canada et des organisations européennes est présentée dans l’Appendice C.)
VIII. Conclusion de l’évaluation environnementale initiale
Des liens économiques plus étroits avec l’UE grâce à un AECG augmenteraient sensiblement l’avantage concurrentiel du Canada dans le monde. Selon l’Étude conjointe, une libéralisation accrue du commerce a le potentiel d’offrir des avantages économiques importants pour le Canada, ainsi que pour l’UE. L’étude révèle qu’un accord, une fois entièrement mis en œuvre, pourrait se traduire par un apport de 12 milliards $ au PIB du Canada et entraîner un accroissement du commerce bilatéral d’au moins 20 % entre le Canada et l’UE.
Un système commercial fondé sur des règles et des marchés encadrés par des règlements efficaces constituent des éléments de base clés de la croissance et du développement économiques. La réduction des obstacles au commerce joue un rôle important pour faciliter l’échange de technologies respectueuses de l’environnement et pour établir des règles d’investissement qui aident à créer les conditions nécessaires aux transferts de technologies. Le recensement des effets environnementaux probables et importants d’un accord commercial proposé permet aux négociateurs de déterminer si les mécanismes existants, comme les cadres de réglementation fédéraux, provinciaux, territoriaux ainsi que les évaluations environnementales des nouveaux projets de développement suffisent à atténuer toute incidence cernée découlant d’un accord proposé et d’examiner la nécessité de mesures d’atténuation supplémentaires.
La présente évaluation environnementale initiale fait partie du processus visant à assurer que les négociations des accords commerciaux prévoient la prise en compte appropriée des incidences environnementales.
L’évaluation environnementale initiale a pour but de déterminer les principaux enjeux environnementaux susceptibles de survenir en raison des négociations. À cette fin, ce rapport a évalué les incidences environnementales en effectuant une analyse qualitative et une analyse quantitative afin d’aider les négociateurs et le public canadien à mieux comprendre les incidences économiques et environnementales potentielles d’un accord.
L’analyse qualitative a fourni un bref aperçu des incidences éventuelles dans tous les domaines de négociations et traite plus en détail les quatre domaines clés où les incidences sont plus susceptibles de se produire. Les incidences potentielles sur l’environnement ont été cernées ainsi que les possibilités connexes d’atténuation des effets négatifs et de renforcement des incidences positives par l’analyse qualitative à l’égard du commerce de marchandises, des services, des marchés publics et de l’investissement. Les possibilités d’atténuation des effets négatifs et de renforcement des incidences positives ont fait l’objet de discussions. L’évaluation qualitative a souligné que le Canada est doté d’un vaste cadre de réglementation en matière d’environnement qui devrait contribuer à atténuer les incidences potentielles et à garantir que l’accroissement des activités économiques découlant de l’accord ne compromettrait pas son engagement à l’égard du développement durable.
L’analyse quantitative préparée par le Bureau de l’économiste en chef d’Affaires étrangères et Commerce international Canada a utilisé une modélisation économique et des données environnementales pour déterminer les effets potentiels d’un AECG entre le Canada et l’UE dans l’ensemble de l’économie canadienne en fonction de trois indicateurs environnementaux : émissions de gaz à effet de serre, utilisation de l’énergie et utilisation de l’eau. L’analyse quantitative a déterminé que les augmentations marginales des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation de l’eau et de l’énergie découleraient vraisemblablement d’un AECG avec l’UE. L’analyse indique également qu’un tel accord favoriserait un virage vers une composition plus favorable de l’industrie canadienne en termes d’émissions étant donné que les augmentations nettes des émissions ainsi que de l’utilisation de l’énergie et de l’eau en raison d’un éventuel AECG entre le Canada et l’UE sont moins importantes que l’augmentation correspondante du PIB et de la production.
L’analyse quantitative indique que l’impact net d’un accroissement du commerce bilatéral avec l’UE pour l’environnement au Canada serait marginal d’après les projections relatives aux changements des émissions de GES, à l’utilisation de l’énergie et à l’utilisation de l’eau.
Tant l’analyse qualitative que l’analyse quantitative des changements économiques et environnementaux potentiels ont indiqué que des incidences environnementales importantes sont peu probables en raison d’un Accord économique et commercial global avec l’Union européenne.
Conformément au cadre, la prochaine phase du processus d’évaluation environnementale consistera à effectuer une évaluation environnementale finale. L’évaluation environnementale finale comprendra une discussion de toute analyse subséquente entreprise et documentera les commentaires reçus en réponse à l’évaluation environnementale initiale concernant les incidences environnementales prévues de l’accord sur le Canada. L’évaluation environnementale finale sera publiée à l’issue des négociations.
Suite à la conclusion du rapport de l’évaluation environnementale finale, les activités de suivi et de contrôle pourraient, au besoin, être entreprises afin d’examiner toute mesure d’atténuation ou de renforcement finalement recommandée par le rapport de l’évaluation environnementale finale. Des activités de contrôle et de suivi pourront être réalisées en tout temps durant la mise en œuvre d’un accord commercial conclu, de façon à mesurer l’exécution de ses dispositions d’un point de vue environnemental.
Appendice A – Tableaux de l’analyse économique et environnementale
| Exportations antérieures à l’AECG (millions $) | Exportations postérieures à l’AECG (millions $) | Variations des exportations (millions $) | Variations en pourcentage des exportations (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 2780 | 3942 | 1162 | 41,8 |
| Aliments transformés | 1415 | 3420 | 2005 | 141,7 |
| Foresterie | 88 | 91 | 3 | 3,7 |
| Pêche | 214 | 248 | 34 | 16,1 |
| Charbon | 1189 | 1187 | -1 | -0,1 |
| Extraction pétrolière et gazière | 4294 | 4282 | -12 | -0,3 |
| Minéraux | 5392 | 5278 | -113 | -2,1 |
| Boissons et tabac | 97 | 115 | 18 | 17,8 |
| Textiles | 229 | 400 | 170 | 73,6 |
| Vêtements | 232 | 372 | 140 | 60,0 |
| Produits du cuir | 24 | 31 | 7 | 33,3 |
| Produits du bois | 636 | 742 | 106 | 16,7 |
| Produits du papier et édition | 2431 | 2669 | 238 | 9,7 |
| Pétrole et produits du charbon | 1476 | 2365 | 889 | 60,2 |
| Produits chimiques | 2365 | 3179 | 814 | 34,5 |
| Produits minéraux | 175 | 210 | 35 | 19,7 |
| Métaux ferreux | 356 | 420 | 65 | 18,1 |
| Métaux | 4312 | 5575 | 1263 | 29,3 |
| Produits métalliques | 335 | 425 | 90 | 26,7 |
| Véhicules motorisés et pièces | 1300 | 1675 | 375 | 28,8 |
| Équipement de transport | 3765 | 4635 | 870 | 23,1 |
| Équipement électronique | 1368 | 1681 | 313 | 22,9 |
| Machinerie et équipement | 3758 | 4610 | 852 | 22,7 |
| Autres produits manufacturés | 376 | 439 | 63 | 16,9 |
| Services d’utilité publique | 495 | 594 | 98 | 19,8 |
| Construction | 97 | 141 | 44 | 45,7 |
| Commerce intérieur | 1538 | 1844 | 306 | 19,9 |
| Services de transport | 5123 | 6330 | 1208 | 23,6 |
| Services de communication et d’information | 1667 | 1841 | 173 | 10,3 |
| Services financiers | 978 | 1125 | 147 | 14,9 |
| Services d’assurance | 1714 | 2023 | 309 | 18,1 |
| Autres services aux entreprises | 7860 | 8317 | 457 | 5,8 |
| Services aux consommateurs | 1783 | 2091 | 307 | 17,2 |
| Services publics | 1447 | 1622 | 175 | 12,1 |
| Total | 61310 | 73918 | 12608 | 20,6 |
| Importations antérieures à l’AECG (millions $) | Importations postérieures à l’AECG (millions $) | Variations des importations (millions $) | Variations en pourcentage des importations (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 536 | 570 | 34 | 6,3 |
| Aliments transformés | 2 509 | 10 694 | 8 184 | 326,2 |
| Foresterie | 6 | 7 | 1 | 1,5 |
| Pêche | 100 | 91 | -9 | -9,2 |
| Charbon | 19 | 19 | 0 | 0,0 |
| Extraction pétrolière et gazière | 2 734 | 2 772 | 38 | 1,4 |
| Minéraux | 198 | 212 | 13 | 6,7 |
| Boissons et tabac | 1 609 | 1 845 | 237 | 14,7 |
| Textiles | 782 | 1 330 | 548 | 70,2 |
| Vêtements | 632 | 1 027 | 395 | 62,5 |
| Produits du cuir | 682 | 905 | 223 | 32,8 |
| Produits du bois | 1 122 | 1 468 | 345 | 30,7 |
| Produits du papier et édition | 1 306 | 1 422 | 116 | 8,9 |
| Pétrole et produits du charbon | 715 | 1 243 | 527 | 73,8 |
| Produits chimiques | 10 171 | 13 032 | 2 862 | 28,1 |
| Produits minéraux | 918 | 1 121 | 203 | 22,2 |
| Métaux ferreux | 1 343 | 1 548 | 206 | 15,3 |
| Métaux | 423 | 505 | 82 | 19,4 |
| Produits métalliques | 1 258 | 1 656 | 398 | 31,6 |
| Véhicules motorisés et pièces | 5 073 | 6 000 | 927 | 18,3 |
| Équipement de transport | 3 426 | 3 695 | 269 | 7,9 |
| Équipement électronique | 927 | 1 071 | 144 | 15,5 |
| Machinerie et équipement | 11 456 | 13 394 | 1 938 | 16,9 |
| Autres produits manufacturés | 1 219 | 1 518 | 298 | 24,4 |
| Services d’utilité publique | 460 | 539 | 79 | 17,3 |
| Construction | 378 | 539 | 162 | 42,9 |
| Commerce intérieur | 4 657 | 5 634 | 977 | 21,0 |
| Services de transport | 8 214 | 9 862 | 1 648 | 20,1 |
| Services de communication et d’information | 2 237 | 2 452 | 214 | 9,6 |
| Services financiers | 4 240 | 4 882 | 642 | 15,1 |
| Services d’assurance | 4 991 | 5 919 | 928 | 18,6 |
| Autres services aux entreprises | 20 954 | 22 280 | 1 327 | 6,3 |
| Services aux consommateurs | 5 888 | 6 724 | 836 | 14,2 |
| Services publics | 2 010 | 2 292 | 282 | 14,0 |
| Total | 103 191 | 128 267 | 25 076 | 24,3 |
| Production antérieure à l’AECG (millions $) | Production postérieure à l’AECG (millions $) | Variations de la production (millions $) | Variations de la production en pourcentage (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 43 867,4 | 43 946,4 | 79,0 | 0,2 |
| Aliments transformés | 15 041,4 | 15 012,8 | -28,6 | -6,0 |
| Foresterie | 3 600,5 | 3 594,4 | -6,1 | -0,2 |
| Pêche | 1 806,9 | 1 806,7 | -0,2 | -0,2 |
| Charbon | 53 378,5 | 53 389,2 | 10,7 | -0,0 |
| Extraction pétrolière et gazière | 20 152,5 | 20 406,4 | 253,9 | 0,0 |
| Minéraux | 93 854,5 | 88 182,9 | -5 671,6 | 1,3 |
| Boissons et tabac | 17 036,0 | 16 906,6 | -129,5 | -0,8 |
| Textiles | 8 786,4 | 8 915,6 | 129,2 | 1,5 |
| Vêtements | 6 431,8 | 6 631,8 | 200,0 | 3,1 |
| Produits du cuir | 981,6 | 933,8 | -47,8 | -4,9 |
| Produits du bois | 39 747,8 | 39 564,9 | -182,8 | -0,5 |
| Produits du papier et édition | 69 414,0 | 69 518,1 | 104,1 | 0,2 |
| Pétrole et produits du charbon | 38 640,6 | 38 961,4 | 320,7 | 0,8 |
| Produits chimiques | 101 368,7 | 101 977,0 | 608,2 | 0,6 |
| Produits minéraux | 22 186,8 | 22 175,7 | -11,1 | -0,1 |
| Métaux | 76 169,7 | 82 012,0 | 5 842,2 | 7,7 |
| Produits métalliques | 42 508,6 | 42 823,1 | 314,6 | 0,7 |
| Véhicules motorisés et pièces | 111 935,7 | 117 745,1 | 5 809,5 | 5,2 |
| Équipement de transport | 22 145,8 | 23 769,0 | 1 623,3 | 7,3 |
| Équipement électronique | 22 547,6 | 23 803,5 | 1 255,9 | 5,6 |
| Machinerie et équipement | 66 063,4 | 67 239,3 | 1 175,9 | 1,8 |
| Autres produits manufacturés | 17 097,5 | 17 065,0 | -32,5 | -0,2 |
| Services d’utilité publique | 35 912,1 | 36 260,4 | 348,3 | 1,0 |
| Construction | 230 372,5 | 231 892,9 | 1 520,5 | 0,7 |
| Commerce intérieur | 325 607,2 | 326 584,1 | 976,8 | 0,3 |
| Services de transport | 96 150,5 | 95 737,0 | -413,4 | -0,4 |
| Services de communication et d’information | 66 573,7 | 66 660,2 | 86,5 | 0,1 |
| Services financiers | 114 970,2 | 114 763,3 | -206,9 | -0,2 |
| Services d’assurance | 33 087,1 | 32 620,6 | -466,5 | -1,4 |
| Autres services aux entreprises | 287 830,3 | 288 031,8 | 201,5 | 0,1 |
| Services aux consommateurs | 48 314,1 | 48 140,2 | -173,9 | -0,4 |
| Services publics | 448 813,8 | 450 743,7 | 1 929,9 | 0,4 |
| Total | 2 582 395,4 | 2 597 815,1 | 15 419,7 | 0,6 |
| Intensité directe en GES (kt/million $) | Émissions de GES antérieures à l’AECG (kilotonnes) | Émissions de GES postérieures à l’AECG (kilotonnes) | Effet d’échelle (kilotonnes) | Effet de composition (kilotonnes) | Variations dans les émissions de GES (kilotonnes) | Effet technique (kilotonnes) | Effet technique (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 1,60 | 70 187,9 | 70 314,3 | 419,1 | -292,7 | 126,4 | -7,5 | -5,9 |
| Aliments transformés | 0,07 | 6 569,8 | 6 172,8 | 39,2 | -436,2 | -397,0 | -63,1 | 15,9 |
| Foresterie | 0,28 | 4 211,6 | 4 203,6 | 25,1 | -33,1 | -8,0 | -0,5 | 6,6 |
| Pêche | 0,42 | 1 512,2 | 1 509,7 | 9,0 | -11,6 | -2,6 | -0,2 | 6,6 |
| Charbon | 0,68 | 1 228,7 | 1 228,6 | 7,3 | -7,5 | -0,1 | 0,0 | -7,6 |
| Extraction pétrolière et gazière | 0,95 | 50 709,5 | 50 719,7 | 302,8 | -292,6 | 10,1 | 0,7 | 6,8 |
| Minéraux | 0,29 | 5 844,2 | 5 917,9 | 34,9 | 38,7 | 73,6 | -0,5 | -0,7 |
| Boissons et tabac | 0,07 | 1 192,5 | 1 183,5 | 7,1 | -16,2 | -9,1 | -1,4 | 15,9 |
| Textiles | 0,07 | 615,1 | 624,1 | 3,7 | 5,4 | 9,0 | -2,9 | -31,9 |
| Vêtements | 0,01 | 64,3 | 66,3 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | -0,1 | -5,4 |
| Produits du cuir | 0,02 | 19,6 | 18,7 | 0,1 | -1,1 | -1,0 | -0,1 | 9,6 |
| Produits du bois | 0,08 | 3 179,8 | 3 165,2 | 19,0 | -33,6 | -14,6 | 4,4 | -29,7 |
| Produits du papier et édition | 0,28 | 19 435,9 | 19 465,1 | 116,0 | -86,9 | 29,2 | -10,9 | -37,3 |
| Produits du pétrole et du charbon | 0,38 | 14 683,4 | 14 805,3 | 87,7 | 34,2 | 121,9 | -17,6 | -14,4 |
| Produits chimiques | 0,68 | 68 930,7 | 69 344,3 | 411,6 | 2,0 | 413,6 | -45,9 | -11,1 |
| Produits minéraux | 0,79 | 17 527,6 | 17 518,8 | 104,7 | -113,4 | -8,8 | 1,2 | -13,6 |
| Métaux | 0,05 | 3 808,5 | 4 100,5 | 22,7 | 269,3 | 292,0 | 1,8 | 0,6 |
| Produits métalliques | 0,39 | 16 578,4 | 16 701,0 | 99,0 | 23,7 | 122,7 | -3,9 | -3,2 |
| Véhicules motorisés et pièces | 0,03 | 3 358,1 | 3 532,4 | 20,0 | 154,2 | 174,3 | -12,6 | -7,2 |
| Équipement de transport | 0,02 | 442,9 | 475,4 | 2,6 | 29,8 | 32,5 | -2,4 | -7,2 |
| Équipement électronique | 0,01 | 225,5 | 238,0 | 1,3 | 11,2 | 12,6 | 0,1 | 0,6 |
| Machinerie et équipement | 0,03 | 1 981,9 | 2 017,2 | 11,8 | 23,4 | 35,3 | -0,9 | -2,4 |
| Autres produits manufacturés | 0,03 | 512,9 | 512,0 | 3,1 | -4,0 | -1,0 | -0,0 | 1,0 |
| Services d’utilité publique | 2,72 | 97 680,8 | 98 628,3 | 583,2 | 364,3 | 947,5 | -177,9 | -18,8 |
| Construction | 0,27 | 62 200,6 | 62 611,1 | 371,4 | 39,1 | 410,5 | -34,6 | -8,4 |
| Commerce intérieur | 0,10 | 32 560,7 | 32 658,4 | 194,4 | -96,7 | 97,7 | -7,0 | -7,1 |
| Services de transport | 0,76 | 73 074,4 | 72 760,2 | 436,3 | -750,5 | -314,2 | -0,8 | 0,3 |
| Services de communication et d’information | 0,11 | 7 323,1 | 7 332,6 | 43,7 | -34,2 | 9,5 | -0,7 | -7,1 |
| Services financiers | 0,04 | 4 598,9 | 4 590,5 | 27,5 | -35,7 | -8,3 | 0,6 | -7,1 |
| Services d’assurance | 0,01 | 330,9 | 326,2 | 2 | -6,6 | -4,7 | 0,3 | -7,1 |
| Autres services aux entreprises | 0,03 | 8 634,9 | 8 641,0 | 51,6 | -45,5 | 6,0 | -0,4 | -7,1 |
| Services aux consommateurs | 0,03 | 1 449,4 | 1 444,2 | 8,7 | -13,9 | -5,2 | 0,4 | -7,1 |
| Services publics | 0,08 | 35 905,1 | 36 059,5 | 214,4 | -60,0 | 154,4 | -11,0 | -7,1 |
| Total | 616 579,8 | 618 886,2 | 3 681,4 | -1 375,0 | 2 306,4 | -393,2 |
Note : Les effets d’échelle et de composition sont mesurés au moyen des données sur les intensités directes en GES de 2007 provenant de Statistique Canada, L’effet technique est mesuré au moyen des données sur les intensités directes en GES de 2007 et de 2014 fournies par Environnement Canada.
| Intensité directe en énergie (térajoules/million $) | Utilisation de l’énergie selon le scénario de base (térajoules) | Utilisation de l’énergie postérieure à la simulation (térajoules) | Effet d’échelle (térajoules) | Effet de composition (térajoules) | Variations à partir du scénario de base (térajoules) | Effet technique (térajoules) | Effet technique (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 4,05 | 177 663,0 | 177 983,0 | 1 060,8 | -740,8 | 319,9 | -27,7 | -8,7 |
| Aliments transformés | 1,84 | 172 692,3 | 162 256,9 | 1 031,1 | -11 466,6 | -10 435,5 | 1 800,2 | -17,3 |
| Foresterie | 2,65 | 39 859,7 | 39 784,0 | 238,0 | -313,7 | -75,7 | -4,3 | 5,7 |
| Pêche | 5,68 | 20 451,1 | 20 416,3 | 122,1 | -156,9 | -34,8 | -2,0 | 5,7 |
| Charbon | 5,98 | 10 805,7 | 10 804,6 | 64,5 | -65,6 | -1,1 | 0,1 | -9,2 |
| Extraction pétrolière et gazière | 9,48 | 503 359,0 | 503 459,7 | 3 005,4 | -2 904,7 | 100,7 | 23,8 | 23,6 |
| Minéraux | 6,30 | 126 960,7 | 128 560,4 | 758,0 | 841,7 | 1 599,7 | 35,2 | 2,2 |
| Boissons et tabac | 4,30 | 73 254,7 | 72 698,0 | 437,4 | -994,1 | -556,7 | 96,1 | -17,3 |
| Textiles | 2,17 | 19 066,6 | 19 346,9 | 113,8 | 166,4 | 280,3 | -62,0 | -22,0 |
| Vêtements | 0,42 | 2 701,4 | 2 785,4 | 16,1 | 67,9 | 84,0 | -2,2 | -2,6 |
| Produits du cuir | 0,68 | 667,5 | 634,9 | 4,0 | -36,5 | -32,5 | -3,0 | 9,2 |
| Produits du bois | 2,45 | 97 382,0 | 96 934,0 | 581,4 | -1 029,4 | -448,0 | -126,4 | 28,2 |
| Produits du papier et édition | 13,00 | 902 382,2 | 903 735,8 | 5 387,8 | -4 034,2 | 1 353,6 | -8,3 | -0,6 |
| Produits du pétrole et du charbon | 5,96 | 230 298,2 | 232 209,7 | 1 375,0 | 536,5 | 1 911,5 | -210,4 | -11,0 |
| Produits chimiques | 8,13 | 824 127,7 | 829 072,4 | 4 920,5 | 24,2 | 4 944,8 | -806,6 | -16,3 |
| Produits minéraux | 9,55 | 211 884,3 | 211 778,3 | 1 265,1 | -1 371,0 | -105,9 | 21,5 | -20,3 |
| Métaux | 1,25 | 95 212,2 | 102 513,2 | 568,5 | 6 732,5 | 7 301,0 | 995,0 | 13,6 |
| Produits métalliques | 8,43 | 358 347,7 | 360 999,5 | 2 139,5 | 512,2 | 2 651,8 | 207,2 | 7,8 |
| Véhicules motorisés et pièces | 0,69 | 77 235,6 | 81 244,1 | 461,1 | 3 547,4 | 4 008,5 | 288,0 | 7,2 |
| Équipement de transport | 1,03 | 22 810,2 | 24 482,2 | 136,2 | 1 535,8 | 1 672,0 | 120,1 | 7,2 |
| Équipement électronique | 0,36 | 8 117,1 | 8 569,3 | 48,5 | 403,7 | 452,1 | 115,0 | 25,4 |
| Machinerie et équipement | 0,67 | 44 262,5 | 45 050,3 | 264,3 | 523,6 | 787,9 | -31,9 | -4,0 |
| Autres produits manufacturés | 0,71 | 12 139,3 | 12 116,2 | 72,5 | -95,5 | -23,0 | 0,4 | -1,8 |
| Services d’utilité publique | 37,74 | 1 355 248,6 | 1 368 394,5 | 8 091,6 | 5 054,3 | 13 145,9 | -2 849,0 | -21,7 |
| Construction | 0,58 | 133 616,0 | 134 497,9 | 797,8 | 84,1 | 881,9 | -80,7 | -9,1 |
| Commerce intérieur | 1,79 | 582 836,9 | 584 585,4 | 3 479,9 | -1 731,4 | 1 748,5 | -27,1 | -1,6 |
| Services de transport | 10,61 | 1 020 156,7 | 1 015 770,1 | 6 090,9 | -10 477,6 | -4 386,7 | -79,4 | 1,8 |
| Services de communication et d’information | 1,81 | 120 498,4 | 120 655,0 | 719,4 | -562,8 | 156,6 | -2,4 | -1,6 |
| Services financiers | 0,94 | 108 072,0 | 107 877,4 | 645,3 | -839,8 | -194,5 | 3,0 | -1,6 |
| Services d’assurancee | 0,09 | 2 977,8 | 2 935,9 | 17,8 | -59,8 | -42,0 | 0,7 | -1,6 |
| Autres services aux entreprises | 0,86 | 247 534,0 | 247 707,3 | 1 477,9 | -1 304,7 | 173,3 | -2,7 | -1,6 |
| Services aux consommateurs | 2,31 | 111 605,6 | 111 203,9 | 666,4 | -1 068,1 | -401,8 | 6,2 | -1,6 |
| Services publics | 2,15 | 964 949,8 | 969 099,1 | 5 761,3 | -1 612,0 | 4 149,3 | -64,4 | -1,6 |
| Total | 8 679 176,6 | 8 710 161,5 | 51 819,9 | -20 834,9 | 30 984,9 | -677,2 |
Note : L’effet technique est mesuré au moyen des données sur les intensités directes en énergie de 2007 et de 2014 provenant d’Environnement Canada alors que les effets d’échelle et de composition sont mesurés au moyen des données sur l’énergie de 2007 provenant de Statistique Canada
| Intensité directe de l’utilisation de l’eau (m3/$) | Utilisation de l’eau selon le scénario de base (milliers de m3) | Utilisation de l’eau après la simulation (milliers de m3) | Effet d’échelle (milliers de m3) | Effet de composition (milliers de m3) | Variations du scénario de base (milliers de m3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture primaire | 0,0842 | 3 692 802,6 | 3 699 452,8 | 22 048,2 | -15 398,1 | 6 650,2 |
| Aliments transformés | 0,0040 | 376 450,5 | 353 702,3 | 2 247,6 | -24 995,8 | -22 748,2 |
| Foresterie | ||||||
| Pêche | ||||||
| Charbon | ||||||
| Extraction pétrolière et gazière | 0,0018 | 97 042,1 | 97 061,5 | 579,4 | -560,0 | 19,4 |
| Minéraux | 0,0161 | 324 394,7 | 328 482,1 | 1 936,8 | 2 150,5 | 4 087,4 |
| Boissons et tabac | 0,0050 | 84 600,7 | 83 957,7 | 505,2 | -1 148,1 | -643,0 |
| Textiles | 0,0016 | 14 480,1 | 14 692,9 | 86,5 | 126,4 | 212,9 |
| Vêtements | ||||||
| Produits du cuir | ||||||
| Produits du bois | 0,0031 | 124 609,2 | 124 035,9 | 743,9 | -1 317,2 | -573,2 |
| Produits du papier et édition | 0,0630 | 4 372 111,3 | 4 378 669,5 | 26 104,1 | -19 546,0 | 6 558,2 |
| Produits du pétrole et du charbon | 0,0061 | 234 200,9 | 236 144,8 | 1 398,3 | 545,6 | 1 943,9 |
| Produits chimiques | 0,0092 | 935 126,4 | 940 737,2 | 5 583,3 | 27,5 | 5 610,8 |
| Produits minéraux | 0,0026 | 57 219,8 | 57 191,2 | 341,6 | -370,2 | -28,6 |
| Métaux | 0,0280 | 2 134 201,4 | 2 297 854,4 | 12 742,5 | 150 910,5 | 163 653,0 |
| Produits métalliques | 0,0007 | 30 478,7 | 30 704,2 | 182,0 | 43,6 | 225,5 |
| Véhicules motorisés et pièces | ||||||
| Équipement de transport | 0,0002 | 4 340,6 | 4 658,7 | 25,9 | 292,3 | 318,2 |
| Équipement électronique | ||||||
| Machinerie et équipement | 0,0001 | 9 711,3 | 9 884,2 | 57,9 | 114,9 | 172,9 |
| Autres produits manufacturés | 0,0005 | 9 164,3 | 9 146,9 | 54,7 | -72,1 | -17,4 |
| Services d’utilité publique | 0,6366 | 22 861 737,9 | 23 083 496,8 | 136 498,2 | 85 260,6 | 221 758,9 |
| Construction | ||||||
| Commerce intérieur | ||||||
| Services de transport | ||||||
| Services de communication et d’information | ||||||
| Services financiers | ||||||
| Services d’assurance | ||||||
| Autres services aux entreprises | 0,0006 | 181 333,1 | 181 460,0 | 1 082,7 | -955,7 | 126,9 |
| Services aux consommateurs | 0,0006 | 30 437,9 | 30 328,3 | 181,7 | -291,3 | -109,6 |
| Services publics | ||||||
| Total | 35 574 443,4 | 35 961 661,5 | 212 400,7 | 174 817,3 | 387 218,0 |
Note: Les données n’étaient pas disponibles pour certains secteurs en raison du détail de l’information de source. L’effet technique ne pouvait être calculé car il n’existe aucune donnée sur les prévisions de l’utilisation de l’eau pour l’année 2014, Tant l’effet d’échelle que l’effet de composition sont mesurés au moyen des données de 2007 sur l’utilisation de l’eau provenant de Statistique Canada.
Appendice B – Glossaire et acronymes
- 7 PC – Septième programme-cadre
- AAC – Agriculture et Agroalimentaire Canada
- AECG – Accord économique et commercial global Canada-UE
- AGCS – Accord général sur le commerce des services
- AGTC Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
- ALE – Accord de libre-échange
- ALENA – Accord de libre-échange nord-américain
- AMP – Accord sur les marchés publics
- AMPNA –Accès aux marchés pour les produits non agricoles
- ANASE – Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
- ANUP – Accord des Nations Unies sur la pêche
- APIE – Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers
- BMP – Pratiques de gestion bénéfiques
- CCME – Conseil canadien des ministres de l’Environnement
- CE – Commission européenne
- CGE – Modèle d’équilibre général calculable
- CH4 – Méthane
- CITES – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
- CO2 – Dioxyde de carbone
- CT – Contingent tarifaire
- DG Environnement – Direction générale Environnement
- E-déchets – Déchets électroniques
- EE – Évaluation environnementale
- EPB – Évaluation des pratiques de gestion bénéfiques à l’échelle des bassins hydrographiques
- GCEE – Groupe consultatif sur l’évaluation environnementale
- GES – Gaz à effet de serre
- GTAP – Projet d’analyse du commerce mondial
- ICDE – Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement
- IDCE – Investissement direct canadien à l’étranger
- IED – Investissement étranger direct
- kt – Kilotonne
- LCPE – Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999
- LDC – Pays les moins avancés
- MAECI – Affaires étrangères et Commerce international Canada
- Modèle 3E – Le Modèle Énergie-économie-environnement du Canada, qui est le modèle de prévisions d’émissions d’Environnement Canada, Essentiellement, il regroupe Énergie 2020 et le modèle TIM,
- MP – Matières particulaires
- N2O – Oxyde nitreux
- NPF – Nation la plus favorisée
- NPRI – Inventaire national des rejets de polluants
- OMC – Organisation mondiale du commerce
- PGPC – Plan de gestion des produits chimiques du Canada
- PI – Propriété intellectuelle
- PIB – Produit intérieur brut
- PNARSA – Programme national d’analyse et de rapport en matière de santé agroenvironnementale
- R-D – Recherche-développement
- RNCan – Ressources naturelles Canada
- SCT – Secrétariat du Conseil du Trésor
- SFDD – Stratégie fédérale de développement durable
- SGQA – Système de gestion de la qualité de l’air
- SNCVG – Système national de comptabilisation et de vérification des quantités de carbone et des émissions de gaz à effet de serre
- SOx – Dioxyde de soufre
- SPS – Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
- S-T – Science et technologie
- TAC – Total autorisé des captures
- TI – Technologie de l’information
- TIC – Technologie de l’information et des communications
- TJ – Térajoule
- TRS – Soufre réduit total
- UE – Union européenne
Appendice C – Liste illustrative de traités signés par le Canada et des organisations européennes
Communauté Européenne
- Échange de lettres concernant la modification de l’Annexe V de l’Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Signé les 22 mars et 16 avril 2010 - Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres
Signé les 17 et 18 décembre 2009 - Accord sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et la Communauté européenne
Date d’entrée en vigueur : 26 juillet 2011 - Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT
Date d’entrée en vigueur : 25 juin 2007 - Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne établissant un cadre de coopération en matière d’enseignement supérieur, de formation et de jeunesse
Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2007 - Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne sur le traitement des données relatives aux informations préalables sur les voyageurs et aux dossiers passagers
Date d’entrée en vigueur : 22 mars 2006 - Échange de lettres constituant un accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne afin de modifier l’annexe V et l’annexe VIII de l’Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait le 17 décembre 1998 à Ottawa
Date d’entrée en vigueur : 15 mars 2005 - Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses
Entrée en vigueur : 1er juin 2004 - Accord sous la forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne les céréales, prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994
Date d’entrée en vigueur : 11 juillet 2005 - Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation
Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2001
État : résilié - Accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Date d’entrée en vigueur : 17 décembre 1998 - Accord modifiant l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada et la Communauté européenne
Date d’entrée en vigueur : 30 avril 1999 - Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada
Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 1998 - Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 1998 - Accord concernant la conclusion des négociations entre le Canada et la Communauté européenne dans le cadre de l’article XXIV:6
Date d’entrée en vigueur : 25 juillet 1996 - Échange de lettres constituant un accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l’article XXIV:6
Date d’entrée en vigueur : 25 juillet 1996 - Accord de coopération scientifique et technologique entre le Canada et la Communauté européenne
Date d’entrée en vigueur : 27 février 1996
EURATOM
- Accord de coopération entre le Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la recherche nucléaire
Date d’entrée en vigueur : 29 janvier 1999 - Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) modifiant l’accord de coopération concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique du 6 octobre 1959
Date d’entrée en vigueur : 15 juillet 1991 - Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) constituant un Accord de coopération dans les utilisations pacifiques de l’énergie atomique
Date d’entrée en vigueur : 21 juin 1985 - Accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique exécutant l’exigence du paragraphe 5 de l’échange de lettres parafé le 20 novembre 1984
Date d’entrée en vigueur : 20 juin 1985 - Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) et le gouvernement du Canada destiné à remplacer l’ « Arrangement intérimaire sur l’enrichissement, le retraitement et le stockage ultérieur des matières nucléaires dans la Communauté et le Canada &187; constituant l’Annexe C de l’Accord sous forme d’échanges de lettres du 16 janvier 1978 entre EURATOM et le gouvernement du Canada
Date d’entrée en vigueur : 18 décembre 1981 - Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) pour modifier l’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique du 6 octobre 1959, en particulier au sujet des garanties
Date d’entrée en vigueur : 16 janvier 1978 - Échange de notes entre le Canada et l’EURATOM mettant en vigueur l’Accord de coopération signé à Bruxelles le 6 octobre 1959 concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique
Date d’entrée en vigueur : 18 novembre 1959 - Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique
Date d’entrée en vigueur : 18 novembre 1959
Communauté Européenne du charbon et de l’acier
- Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre le Canada et la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
Date d’entrée en vigueur : 1er février 1982
Communautés Européennes
- Accord entre le gouvernement du Canada et les Communautés européennes concernant l’application de leur droit de la concurrence
Date d’entrée en vigueur : 17 juin 1999 - Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et les Communautés européennes constituant un Accord comportant les termes du règlement du différend en instance devant l’Organisation mondiale du commerce (CE – Dénomination de vente des pectinidés) (WT/DS7)
Date d’entrée en vigueur : 25 juin 1996 - Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre le Canada et les Communautés européennes
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 1976
Communauté économique Européenne
- Accord entre le Canada et la Communauté économique européenne concernant le commerce des boissons alcooliques
Date d’entrée en vigueur : 28 février 1989 - Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant leurs relations en matière de pêche
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 1984 - Accord en matière de pêche entre le gouvernement du Canada et la Communauté économique européenne
Date d’entrée en vigueur : 30 décembre 1981 - Accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Canada et la Communauté économique européenne concernant leurs relations en matière de pêche
Date d’entrée en vigueur : 30 décembre 1981 - Accord sous forme d’échange de lettres portant application provisoire de deux accords de pêche sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada
Date d’entrée en vigueur : 14 avril 1980 - Accord pour le blé de qualité
Date d’entrée en vigueur : 29 mars 1962 - Accord pour le blé ordinaire
Date d’entrée en vigueur : 29 mars 1962
Office Européen de police
- Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Office européen de police
Date d’entrée en vigueur : 21 novembre 2005
Agence spatiale Européenne
- Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne
Signé le 15 décembre 2010 - Arrangement entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du gouvernement du Canada aux activités de développement et de validation du programme GalileoSat
Date d’entrée en vigueur : 6 octobre 2003 - Arrangement entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne relatif à la participation du gouvernement du Canada à l’élément InfoTerra/TerraSAR du Programme européen de surveillance de la Terre
Date d’entrée en vigueur : 22 septembre 2003 - Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne
Date d’entrée en vigueur : 21 juin 2000 - Échange de notes constituant un Accord entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne pour prolonger jusqu’au 31 décembre 1999 l’Accord de coopération signé à Montréal le 31 mai 1989
Date d’entrée en vigueur : 22 octobre 1998 - Accord entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du Canada aux phases de développement et d’exploitation du programme ERS-1
Date d’entrée en vigueur : 8 janvier 1985
Union Européenne
- Accord entre le Canada et l’Union européenne établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
Entrée en vigueur : 1er décembre 2005
Appendice D – Liste illustrative d’instruments juridiquement non contraignants signés par le Canada et des organisations européennes
Communauté Européenne de l’énergie atomique
- Mémorandum d’entente concernant la coopération entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
25 juillet 1995 - Accord de mise en œuvre entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et l’Énergie atomique du Canada limitée, désignée comme agent de mise en œuvre par le gouvernement du Canada, concernant la participation du Canada à la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux activités ayant trait au projet détaillé (EDA) du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) 25 juillet 1995
- Mémorandum d’entente entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Canada concernant la participation du Canada à la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux activités ayant trait à la définition du concept du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) 3 octobre 1988
- Mémorandum d’accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, concernant une coopération dans la recherche et le développement dans le domaine de la fusion 6 mars 1986
- Accord de coopération entre l’Énergie atomique du Canada limitée et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la recherche en gestion des déchets nucléaires
En anglais seulement 3 novembre 1980
Commission Européenne
- Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l’importation de bœuf provenant d’animaux non traités au moyen de certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l’Union européenne 17 mars 2011
- Protocole d’entente entre le ministère de la Santé du Canada et la Direction générale Santé Consommateurs de la Commission européenne dans le domaine de la lutte contre le tabagisme
16 juin 2009
Communautés Européennes
- Procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de l’Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté15 décembre 1997
- Convention entre la Communauté européenne et les conseillers d’entreprises et/ou intermédiaires membres du BC-NET au Canada2 juillet 1993
- Protocole d’entente entre la Commission des Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant la coopération dans le domaine de la recherche sur les eaux usées16 mars 1983
- Procès-verbal agréé (en date du 31 mars 1981) et échange de lettres pour étendre la sauvegarde à un certain type de chaussure,5 et 8 mai 1981
- Protocole d’entente entre le Canada et la Commission des Communautés européennes concernant la coopération dans le domaine des systèmes d’autobus de l’énergie 17 décembre 1979
Communautés économiques Européennes(CEE)
- Échanges de lettres concernant les écarts de majoration appliqués à la bière et aux vins 28 novembre 1989
- Accord sous la forme d’un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant la demande d’indemnisation présentée par la CEE découlant du prolongement des contingents sur les importations au Canada des chaussures de femmes et de filles pour la période comprise entre le 1er décembre 1985 et le 30 novembre 1988 10 avril 1986
- Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant les exportations de bœuf désossé de transformation de la Communauté vers le Canada 26 février 1986
- Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant les importations de bœuf et de veau de la Communauté au Canada en 1985 6 juin 1985
- Arrangement sous la forme d’un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Canada concernant l’établissement d’un programme d’observation scientifique dans la zone de réglementation de la convention de l’OPANO, Cet arrangement entre en vigueur à la date d’un échange de notifications 14 novembre 1984
- Arrangement entre le Canada et la CEE concernant le fromage, Cet arrangement a préséance sur les négociations réalisées entre le Canada et la CEE du 28 février 1975 en vertu de l’Article XXIV 6 du GATT 22 mai 1979
- Déclaration d’intention provinciale en matière de vente de boissons alcoolisées par les agences provinciales de commercialisation au Canada 12 avril 1979
- Échange de lettres entre le Canada et la Mission du Canada auprès des Communautés européennes concernant un arrangement de coopération environnementale 6 novembre 1975
- Arrangement entre le Canada et la CEE concernant les négociations au titre de l’Article XVIII, paragraphe 4 du GATT 30 septembre 1968
Agence spatiale Européenne
- Arrangement entre le gouvernement du Canada (représenté par l’Agence spatiale canadienne) et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du gouvernement du Canada au Programme-enveloppe d’observation de la Terre 21 juin 2000
- Arrangement entre le gouvernement du Canada (représenté par l’Agence spatiale canadienne) et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du gouvernement du Canada aux activités de définition du programme Galileosat 21 juin 2000
- Arrangement concernant la participation du Canada au Programme de mission technologique et de relais par satellite 21 mars 1991
- Arrangement concernant la participation du Canada au programme préparatoire de la première mission d’observation de l’orbite polaire au moyen de la plate-forme polaire 21 mars 1991
- Arrangement entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne sur la participation du Canada au programme de développement HERMES de l’Agence 21 mars 1991
- Arrangement concernant la participation du Canada au programme concernant les systèmes et techniques de pointe (Phase 4) 21 mars 1991
- Arrangement considérant la participation du Canada à l’élaboration et à l’exploitation des phases du programme ERS-2 21 mars 1991
- Arrangement entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du gouvernement du Canada au programme préparatoire HERMES de l’Agence 23 novembre 1987
- Arrangement entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne concernant la participation du gouvernement du Canada au programme préparatoire d’observation de la Terre de l’Agence spatiale européenne 15 mai 1987
Organisation Européenne de recherces spatiales (OERS)
- Arrangement concernant la participation du gouvernement du Canada au programme préparatoire européen de satellite de télédétection 31 mars 1980
Union Européenne
- Déclaration concernant un accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Union européenne 6 mai 2009
- Déclaration commune concernant l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres 6 mai 2009
- Déclaration politique commune sur les relations entre le Canada et l’Union européenne 17 décembre 1996
Footnotes
- Footnote 1
- Footnote 2
Rapport conjoint Canada-Union européenne : Vers un accord économique approfondi
- Footnote 3
Cadre pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales 2001
- Footnote 4
- Footnote 5
Guide pour l’évaluation environnementale des négociations commerciales
- Footnote 6
Rapports se trouvent sur le site Web de Consultations du MAECI
- Footnote 7
Aux fins de la présente évaluation environnementale, « environnement &187; s’entend des éléments de la Terre, notamment le sol, l’eau et l’air (toutes les couches de l’atmosphère), toute matière organique et inorganique, les organismes vivants ainsi que les systèmes naturels en interaction qui englobent les composantes des éléments susmentionnés.
- Footnote 8
Cette évaluation environnementale initiale a été rédigée par Affaires étrangères et Commerce international Canada et a fait l’objet de consultations avec des ministères et organismes du gouvernement fédéral, notamment : Environnement Canada, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, l’Agence des services frontaliers du Canada, Industrie Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Citoyenneté et Immigration Canada, le Bureau de la concurrence, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Transports Canada, Pêches et Océans Canada et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada..
- Footnote 9
- Footnote 10
Planifier un avenir durable – Stratégie fédérale de développement durable SFDD) pour le Canada, 2010
- Footnote 11
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1979; Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 2000 (PDF, 142 ko); Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 2005; Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, 2005 (PDF, 248 ko); Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2009
- Footnote 12
Une liste illustrative des accords en vigueur entre le Canada et l’UE se trouve aux Appendices C et D.
- Footnote 13
- Footnote 14
Un AECG avec l’UE pourrait profiter à de nombreux secteurs de l’économie canadienne, dont l’aérospatiale, les produits chimiques, les plastiques, l’aluminium, les produits du bois, le poisson et les fruits de mer, l’automobile et les pièces, les produits agricoles, les transports, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et des communications, les services d’ingénierie et les services informatiques.
- Footnote 15
Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (PDF, 59.2 ko)
- Footnote 16
Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
- Footnote 17
Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (PDF, 89.7 ko)
- Footnote 18
L’analyse qualitative sectorielle utilise les statistiques commerciales moyennes de 2006-2008. La période 2006-2008 chevauche l’année repère 2007 utilisée pour la simulation de la modélisation dans l’analyse quantitative.
- Footnote 19
Les exemples de la portée de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement concernant l’exploitation minière comprennent le Règlement sur les urgences environnementales, le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et le Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux, entre autres.
- Footnote 20
Les exemples de la portée de la Loi sur les pêches concernant l’exploitation minière comprennent : a. 36(3) interdit le dépôt d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons sauf si le dépôt est spécifiquement permis par le Règlement, et le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) a été promulgué en vertu de l’a.36(5) et permet le dépôt de substances nocives de métaux dans des eaux où vivent des poissons conformément aux conditions établies dans le Règlement, entre autres.
- Footnote 21
Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, ch. 33; Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14
- Footnote 22
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C., 1992, ch. 37)
- Footnote 23
- Footnote 24
Ressources naturelles Canada, Secteur des minéraux et des métaux – Développement durable, 2009
- Footnote 25
De plus amples renseignements sur le système réglementaire pour les grands projets de ressources au Canada
- Footnote 26
- Footnote 27
Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada
- Footnote 28
Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C., 1985, ch. C-11)
- Footnote 29
Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, L.C. 1999, ch. 33
- Footnote 30
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21; Loi sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27; Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28
- Footnote 31
- Footnote 32
Protocole d’entente entre l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC) et Environnement Canada / Santé Canada, 2010
- Footnote 33
- Footnote 34
Conseil canadien des ministres des forêts consulté le 7 février 2012 (PDF, 2.13 mo)
- Footnote 35
- Footnote 36
Accord des Nations Unies sur la pêche, 2003
- Footnote 37
- Footnote 38
Programme national d’analyse et de rapport en matière de santé agro-environnementale
- Footnote 39
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont cette menace est gérée, veuillez consulter le document Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes &187; du Canada, 2004
- Footnote 40
Cultivons l’avenir : Accord-cadre fédéral-provincial-territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels
- Footnote 41
Cultivons l’avenir : Une agriculture respectueuse de l’environnement
- Footnote 42
Cultivons l’avenir : Systèmes environnementaux pour une agriculture durable
- Footnote 43
Cultivons l’avenir : Outils de connaissance et d’information
Return to first footnote 43span class="wb-invisible"> referrer
- Footnote 44
Cultivons l’avenir : Une agriculture respectueuse de l’environnement
- Footnote 45
Cultivons l’avenir : Mesure du rendement et présentation de rapports
- Footnote 46
Services commerciaux : définis comme équivalant aux services moins les services gouvernementaux, non inclus ailleurs.
- Footnote 47
de l’Organisation mondiale du commerce, 1995 (PDF, 89.1 ko)
- Footnote 48
Accord de libre-échange nord-américain, 32 I.L.M. 289 et 605 (1993), 1994
- Footnote 49
Super E® est une nouvelle norme d’habitation établie par Ressources naturelles Canada (RNCan)
- Footnote 50
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce, 1996(PDF, 72.8 ko)
- Footnote 51
- Footnote 52
Indicateurs des marchés publics de la Commission européenne, 2008 (PDF, 74.2ko)
- Footnote 53
ARCHIVÉ Rapport sur les acquisitions du Secrétariat du Conseil du Trésor, 2008
- Footnote 54
Cet énoncé est tiré de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 15 : Protection de l’environnement, Article 1505 : Droits et obligations fondamentaux, qui affirme que « Dans les matières relatives au commerce, les Parties prennent en considération la nécessité de rétablir, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement. &187; Pour le texte intégral de l’accord, veuillez consulter : Accord sur le commerce intérieur – Codification administrative, 2011 (PDF, 916 ko)
- Footnote 55
Politique d’achats écologiques du gouvernement fédéral du Canada, 2006
- Footnote 56
Système des comptes de l’environnement et des ressources du Canada
- Footnote 57
- Footnote 58
Comme l’a indiqué Statistique Canada, en 2007, les émissions annuelles de GES du Canada se sont chiffrées à 724 949 kilotonnes de CO2, la consommation d’énergie, à 10 841 682 térajoules, et l’utilisation de l’eau, à 41 867,2 millions de mètres cubes. Les différences entre les données de Statistique Canada et les données utilisées dans le présent document s’expliquent en grande partie par la consommation des ménages, qui est exclue de la modélisation économique et environnementale
- Footnote 59
J. Francois, H. van Meijl et F. van Tongeren, « The Doha Round and Developing Countries &187;, Economic Policy, 2005.
- Footnote 60
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lien entre le commerce et l’environnement, voirBrian R. Copeland et M. Scott Taylor, 1994. « North-South Trade and the Environment &187;, The Quarterly Journal of Economics, 109(3), 755-787; Brian R. Copeland et M. Scott Taylor, 1993. « Trade and Transboundary Pollution &187;, American Economic Review, 85(4), 716-737; Grossman, Gene M., et Alan B. Krueger, 1991, « Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement &187;, document de travail du NBER no 3914.
- Footnote 61
Ou 8,1 milliards € en prix de 2007. Les valeurs en dollars proviennent de l’Étude conjointe en euros et ont été converties en dollars canadiens aux prix de 2007.
- Footnote 62
La portée des mesures des émissions d’Environnement Canada est plus large que celle de Statistique Canada. Les indicateurs d’émissions d’Environnement Canada comprennent 6 GES : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les perfluorurocarbones (PFC) et les hydrurofluorurocarbones (HFC), alors que l’indicateur de GES de Statistique Canada comprend seulement les trois premiers. En outre, la définition des secteurs de Statistique Canada diffère de celle d’Environnement Canada. Les données de Statistique Canada tiennent compte des émissions liées aux transports dans chaque secteur pour les différents secteurs industriels particuliers, tandis que les données d’Environnement Canada les rassemblent toutes dans le secteur des transports.
- Footnote 63
Prévisions des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada
- Footnote 64
Prévisions en fonction des données historiques
- Footnote 65
Statistique Canada : « Utilisation de l’eau au Canada selon le secteur &187; 2005 et 2007:
- Footnote 66
D’autres indicateurs pourraient être tirés de la série des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement et pourraient comprendre, entre autres, les émissions atmosphériques, la qualité de l’air ambiant, l’indicateur air-santé, les émissions de toxiques atmosphériques, le rejet de substances contrôlées dans l’eau, l’indicateur de la qualité de l’eau douce et la durabilité de la récolte de bois d’œuvre.
- Footnote 67
- Footnote 68
- Footnote 69
Voir les initiatives du CCME en matière de gestion des déchets
- Footnote 70
Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement
- Footnote 71
- Footnote 72
Commission européenne, Coopération Canada-UE en matière d’environnement, 2010; Coopération en matière d’environnement entre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada et l’Union européenne, 2010
- Footnote 73
Accord de coopération scientifique et technique entre le Canada et la Communauté européenne, F102117 RTC 1996 No 24, 1996 (PDF, 43.7 ko)
- Footnote 74
Déclaration conjointe du Canada et de l’Union européenne, 2002
- Footnote 75
Programme de partenariat Canada-Union européenne
- Date de modification: