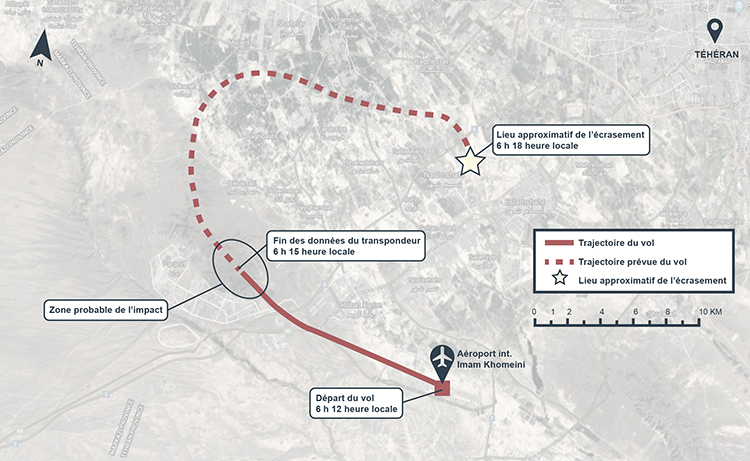Vol PS752
Le long chemin vers la transparence, la responsabilité et la justice
Rapport du conseiller spécial auprès du premier ministre
Décembre 2020
Préface
Ce sont les familles qui comptent le plus
J’ai éprouvé, tout comme de très nombreux Canadiens, des sentiments d’horreur, de chagrin et d’indignation à l’annonce, en janvier dernier, de l’horrible catastrophe aérienne survenue en Iran, au cours de laquelle un avion de ligne ukrainien (vol PS752) a été abattu par des missiles iraniens, faisant 176 victimes innocentes, dont 138 ayant des liens avec le Canada. J’ignorais alors que le premier ministre Trudeau me demanderait d’aider le gouvernement du Canada à réagir à cette tragédie bien canadienne. Cette mission s’est avérée être l’une des plus difficiles et des plus émouvantes que j’aie entreprises.
Les familles des victimes sont au cœur de cette tragédie. J’ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises différents groupes d’entre elles – virtuellement, pour la plupart, à cause de la pandémie de COVID-19. Cependant, chaque rencontre est profondément émotionnelle, car la souffrance et le chagrin des familles sont réels et indélébiles. Les familles racontent leur histoire personnelle. Elles décrivent leurs proches, aujourd’hui disparus. Elles pleurent le riche potentiel humain si cruellement ruiné. Elles posent des questions. Elles aspirent à connaître la vérité. Ce contexte constitue une puissante motivation pour les Canadiens à rechercher obstinément la transparence, la responsabilité et la justice dont ces familles ont besoin et qu’elles méritent.
Ce faisant, nous nous souvenons également avec respect et affection des familles des victimes d’autres catastrophes aériennes internationales, en particulier le vol 182 d’Air India. L’appareil a été détruit par un acte de terrorisme en 1985 qui a coûté la vie à 280 Canadiens, notre pire bilan à ce jour. Nous pensons aussi au vol 302 d’Ethiopian Airlines qui s’est écrasé en 2019 en raison des défaillances catastrophiques en matière de sécurité de l’appareil Max 8, qui a fait 18 victimes canadiennes, notre tragédie aérienne la plus récente avant celle du vol PS752. Je me suis entretenu avec certaines des familles de ceux qui ont péri dans ces autres catastrophes, et il est évident qu’elles sont encore en deuil. Leur douleur reste viscérale. Chaque vie était si précieuse. Chaque famille a été meurtrie à jamais. Notre pays doit admettre les lacunes de nos réponses à ces tragédies précédentes et s’assurer que les leçons essentielles sont prises à cœur, en particulier dans notre réponse aux besoins des familles des victimes.
Quant au vol PS752, les responsables iraniens ont d’abord nié tout méfait, mais une fois mis en présence de preuves irréfutables, ils ont tardivement admis leur responsabilité dans ce simulacre mortel et se sont engagés à mener une enquête en bonne et due forme en accord avec les normes internationales et à assurer une indemnisation sans égard à la nationalité des victimes. Il s’agit d’un bon point de départ. Cependant, compte tenu des événements des onze derniers mois et d’autres cas d’avions civils abattus ailleurs dans le monde (voir annexe A), nous devons nous armer d’une détermination et d’une persévérance à toute épreuve pour parvenir à un résultat convenable pour les familles. Le Canada ne doit jamais se laisser décourager.
Le dossier du vol PS752 est complexe et difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, le bilan des morts était accablant. En plus de l’Iran, les victimes provenaient de cinq autres pays : le Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni. Parmi les personnes ayant un lien avec le Canada figuraient des citoyens canadiens (dont certains étaient également citoyens iraniens), des résidents permanents, des étudiants et des visiteurs, tous en route vers le Canada. L’histoire de chaque victime est différente. Les circonstances de chaque famille sont uniques. Le fil conducteur dans tous les cas est le traumatisme et le chagrin d’avoir perdu des êtres chers d’une manière aussi insensée et tragique aux mains de l’armée iranienne.
Deuxièmement, les besoins humains des familles des victimes du vol PS752 ont nécessité des réponses diversifiées et complexes de la part du gouvernement du Canada et d’autres intervenants, faisant appel au savoir-faire et à l’autorité de plus d’une douzaine de ministères et d’organismes fédéraux, ainsi qu’à des éléments de coordination avec des provinces et municipalités dans tout le pays, des participants du secteur privé (comme des banques et des compagnies d’assurance), des universitaires et des organismes auxiliaires, comme la Croix-Rouge. La collaboration nécessaire était complexe et doit être constante.
Troisièmement, la nature internationale de cette catastrophe signifie que plusieurs pays aux intérêts, perspectives et systèmes juridiques différents s’intéressent à la manière dont le dossier sera finalement résolu, et donc une prise de décision multilatérale n’est jamais simple. Le cadre juridique applicable repose sur des conventions internationales de longue date (voir annexe B) dont tous les pays touchés sont signataires, ainsi que sur des principes généraux du droit international coutumier et le droit interne des pays touchés. Ce cadre complexe ne se prête pas aisément à des issues rapides. En particulier, des frustrations naissent lorsque la cause d’une catastrophe aérienne est une activité militaire du pays dans lequel cette catastrophe s’est produite. En raison de la souveraineté et de l’égalité des États, l’auteur finit par être chargé de l’enquête. Lorsque ce pays est dépourvu d’une autorité d’enquête de l’aviation civile indépendante et d’un système judiciaire transparent, il y aura inévitablement des doutes quant à l’impartialité, à l’objectivité et à la légitimité.
D’autres préoccupations découlent de la lenteur des démarches pour procéder à la lecture du contenu des enregistreurs de bord du vol PS752. Les procédures recommandées exigent que ce travail se fasse « sans tarder » et les neuf semaines écoulées auraient permis de le faire avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne limiter les déplacements. Au final, il a fallu plus de six mois, ce qui a exacerbé l’angoisse et a entaché la crédibilité. De surcroît, l’Iran a refusé au Canada de désigner un représentant accrédité pour l’enquête, ce qui nous aurait fourni une plus grande connaissance de première main. Au lieu de cela, bien que nous ayons subi le plus grand nombre de pertes de vie, notre rôle officiel dans l’enquête sur la sécurité s’est cantonné à celui d’observateur.
Quatrièmement, le Canada n’a plus d’ambassade ni d’ambassadeur en poste à Téhéran depuis 2012, alors les relations diplomatiques sont limitées. Notre démocratie occidentale fondée sur les droits de la personne, l’état de droit, l’indépendance des enquêtes et du pouvoir judiciaire, la régularité de la procédure, la transparence et la responsabilité est contraire aux valeurs du régime iranien. L’Iran est reconnu dans le droit canadien comme un État soutenant le terrorisme. La force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et plusieurs autres organes substituts sont répertoriés dans notre Code criminel comme des entités terroristes. Tout dialogue est donc empreint d’aléas.
Qu’à cela ne tienne, le premier ministre du Canada l’a dit sans équivoque : ce sont les familles qui comptent le plus. Et le Canada ne connaîtra de répit tant que nous n’aurons pas obtenu les réponses et les mesures dont ces familles ont besoin et qu’elles méritent.
À cette fin, ma mission de conseiller spécial a débuté le 31 mars, avec trois objectifs :
- aider le premier ministre, les différents ministres, les secrétaires parlementaires et la fonction publique à répondre aux besoins et aux attentes des familles endeuillées, notamment en matière de justice et d’indemnisation;
- déterminer les meilleures pratiques et le cadre opérationnel le plus efficace pour faire face aux catastrophes d’aviation civile internationale qui concernent le Canada, afin que les futurs gouvernements aient des orientations à suivre en cas de crise similaire;
- offrir des conseils sur la manière de prévenir de telles catastrophes – en promouvant la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada, annoncée par le premier ministre en février dernier, et en s’appuyant sur le travail effectué par les Pays-Bas à la suite de l’abattage en 2014 de l’avion qui effectuait le vol MH17 de la Malaysia Airlines.
D’emblée, j’ai constaté qu’une base solide étayait déjà un effort pangouvernemental pour la réponse du Canada à la catastrophe du vol PS752. Un groupe de travail à temps plein formé par Affaires mondiales Canada était en interaction directe avec tous les autres ministères et organismes concernés. Ce groupe assume le rôle de coordination à l’échelle du gouvernement – joué initialement par le Bureau du Conseil privé – et prend les devants pour communiquer avec les familles et comprendre leurs difficultés individuelles, leurs préoccupations communes et les progrès globaux du Canada relativement à trois piliers : transparence, responsabilité et justice. Ce travail essentiel se poursuit. Il en va de même pour le rôle de sensibilisation que joue le Canada dans le monde au moyen d’un Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination) créé par les cinq pays touchés. Ce groupe a commencé à collaborer, à la suggestion du Canada, immédiatement après la catastrophe. Estimant que les faits penchent fortement en notre faveur, le but collectif des pays du Groupe de coordination consiste à recourir au droit international et au système international fondé sur des règles pour s’assurer que l’Iran soit tenu pour responsable et que justice soit faite. Nous ne ménagerons aucun effort à cet égard.
J’ai tiré profit, particulièrement au début, mais aussi tout au long de ma mission, de séances d’information détaillées et de communications ininterrompues du Bureau du Conseil privé, du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, d’Affaires mondiales Canada, de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Justice Canada, du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, du Centre de la sécurité des télécommunications, de Sécurité publique Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de Patrimoine canadien. Je leur en suis reconnaissant.
Les ministres Champagne, Garneau, Mendicino, Blair et d’autres, ainsi que les secrétaires parlementaires Alghabra et Oliphant, ont toujours été énergiques et serviables. Des centaines de fonctionnaires dévoués ont rempli leurs fonctions – et bien plus – avec beaucoup de compétence et d’empathie. En outre, les membres de notre Parlement – de tous les partis – ont montré leur soutien aux familles par des résolutions parlementaires unanimes (voir annexe C).
Je tiens également à remercier les nombreuses autres personnes qui ont généreuses de leur temps et de leurs conseils, notamment Payam Akhavan, éminent juriste international; Thomas Juneau, observateur et analyste de l’Iran; Craig Forcese , professeur de droit de la sécurité nationale à l’Université d’Ottawa; Bob Rae et Irwin Cotler, mes anciens collègues parlementaires et sages conseillers; Ted Zarzeczny, juge à la retraite de Saskatchewan; Stan Kutcher, sénateur (Nouvelle-Écosse), expert en matière de deuil et de traumatisme; Barbara Hall conjointement avec la campagne Canada Strong; Heidi Illingworth, ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels; Larisa Galadza, envoyée du Canada en Ukraine; Andriy Shevchenko, ambassadeur d’Ukraine au Canada et auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal); et une équipe de fonctionnaires néerlandais ayant acquis une vaste expérience lors de la gestion de la catastrophe du vol MH17.
Les familles elles-mêmes ont aussi été une source importante de conseils et d’informations que le Canada recueille et évalue dans le cadre de ses engagements à chercher la vérité. De nombreuses familles doutent des explications fournies par l’Iran jusqu’à présent. L’Iran a d’abord nié toute implication étatique ou militaire. Les autorités ont rapidement déblayé le lieu de l’écrasement. Le téléchargement des enregistreurs de bord (les « boîtes noires ») aurait pu être fait « sans tarder » en janvier ou février ou au début mars, mais ce n’a pas été le cas. Les preuves pertinentes n’ont pas été complètement divulguées. L’identité des auteurs présumés et la procédure à suivre pour les déférer à la justice sont entièrement secrètes. Des membres des familles, tant au Canada qu’en Iran, ont été menacés et harcelés. Des questions cruciales sur l’enchaînement exact des événements et la prise de décision restent sans réponse, tout comme les enquêtes sur la manière dont cet espace aérien dangereux a pu être laissé ouvert à la circulation civile.
Aux fins de clarification, le Canada enquête sur trois fronts :
- le Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui est un organisme indépendant, examinera et commentera le rapport final d’enquête sur la sécurité de ses homologues iraniens lorsqu’il sera publié, signalant toute lacune, le cas échéant;
- la GRC continuera d’aider ses homologues en Ukraine dans les enquêtes criminelles concernant le vol PS752 dans ce pays; elle continuera également d’enquêter sur les incidents de harcèlement, d’intimidation et d’ingérence étrangère au Canada;
- une équipe canadienne d’examen et d’évaluation médico-légale recueille et analyse les informations, les preuves et les renseignements disponibles pour permettre au Canada d’établir, au mieux de sa capacité, la véritable chronologie des événements qui ont entraîné l’écrasement de l’avion et de reconnaître les responsables.
Le Canada poursuivra également sans relâche sa collaboration avec le Groupe international de coordination et d’intervention en vue de tenir l’Iran pour responsable de l’abattage de l’avion qui effectuait le vol PS752 et d’assurer une certaine forme de justice en s’efforçant d’obtenir des réparations intégrales de l’Iran pour les victimes, leurs familles en deuil et les États touchés. Le Canada s’engage également à exprimer ses préoccupations sur ce qui est arrivé au vol PS752 dans toutes les tribunes internationales appropriées afin de faire écho à l’angoisse des familles, à prévenir la répétition des conditions et comportements qui ont rendu le ciel de Téhéran si dangereux ce matin fatidique.
En ce qui concerne la rédaction de ce rapport, je tiens à exprimer ma gratitude personnelle à une solide équipe de fonctionnaires particulièrement coopératifs et serviables, notamment ceux du Bureau du Conseil privé et d’Affaires mondiales Canada : Vincent Rigby, Mike MacDonald, Michelle Cameron, Jeff Yaworski, Beth Champoux, Katie Fry, Rebeka Tekle et Megan Bujold. Je remercie également tout spécialement Greg Dempsey, pour sa compétence, son jugement et son travail acharné.
L’honorable Ralph Goodale, C.P.
Conseiller spécial auprès du premier ministre
Regina (Saskatchewan)
Député fédéral de la Saskatchewan pendant plus de 31 ans, Ralph Goodale possède une expérience à la fois au sein du gouvernement et de l’opposition. Il a assumé les portefeuilles ministériels de l’Agriculture, des Ressources naturelles, des Travaux publics, des Finances et de la Sécurité publique, en plus d’exercer le rôle du leader du gouvernement à la Chambre.
Table des matières
- Chapitre 1 - Qu’est-il arrivé au vol PS752? Une douloureuse tragédie canadienne
- Chapitre 2 - Le gouvernement du Canada répond... dans ses propres mots
- Chapitre 3 - Chronologie des événements et des mesures prises
- Chapitre 4 - Leçons tirées et recommandations pour l’avenir
- Chapitre 5 - Travailler pour la sécurité aérienne et des enquêtes plus crédibles
- Annexe A : Renseignements généraux sur les catastrophes dans le cadre desquelles des avions civils ont été abattus
- Annexe B : Cadre juridique international
- Annexe C : Trois résolutions adoptées unanimement par la Chambre des communes relativement au vol PS752
- Annexe D : Documents officiels concernant l’écrasement du vol PS752 produits à ce jour par l’Iran
- Annexe E : Services consulaires
- Annexe F : Liste de départs connus de l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran avant et après la tragédie du vol PS752 le 8 janvier 2020 (selon les données compilées par Transports Canada)
Chapitre 1
Qu’est-il arrivé au vol PS752? Une douloureuse tragédie canadienne.
Le Canada pleure encore la terrible perte de vies humaines subie au matin du 8 janvier 2020 lorsque le vol 752 d'Ukraine International Airlines a tragiquement été frappé au-dessus de la ville de TéhéranNote de bas de page 1.
Contrairement aux obligations légales internationalesNote de bas de page 2, des missiles sol‑air iraniens ont abattu cet avion de ligne civil, un Boeing 737-800 au comportement normalNote de bas de page 3, causant la mort des 176 passagers, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents du Canada et 53 autres personnes se dirigeant vers le Canada via Kyiv ce jour fatidique. Les autres victimes provenaient d’Iran, d’Ukraine, de Suède, d’Afghanistan et du Royaume‑Uni.
L’ampleur de la catastrophe devenant évidente – pire bilan humain canadien depuis la catastrophe aérienne du vol 182 d’Air India, en 1985Note de bas de page 4 –, le premier ministre du Canada a exprimé les condoléances de toute une nation aux familles endeuilléesNote de bas de page 5 et a mis en branle un effort pangouvernemental exhaustif visant à fournir le soutien dont ces familles auraient besoin sur le plan humain. De plus, il a exigé une enquête complète et crédible pour expliquer comment une telle tragédie pouvait survenir, et a promis que le Canada resterait mobilisé jusqu’à ce qu'on réponde aux questions cruciales et qu’une transparence, une responsabilité et une justice soient obtenues pour les famillesNote de bas de page 6.
Cette volonté de savoir se manifeste partout dans le monde. À l’initiative du Canada, cinq pays (Canada, Ukraine, Suède, Afghanistan et Royaume-Uni) travaillent en étroite collaboration au sein d’un Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination)Note de bas de page 7. Ils ont exhorté l’Iran à mener une enquête exhaustive et transparente, et ils demanderont réparation, notamment une compensation correspondant aux normes internationales, ainsi que des réponses à de nombreuses questions cruciales. On pense par exemple à la séquence des événements et au processus décisionnel qui a mené au tir de missiles meurtriers sur un avion civil autorisé à s’envoler dans un espace aérien dangereuxNote de bas de page 8 demeuré ouvert pendant et après le lancement par l’Iran de missiles sur des cibles américaines en Iraq.
Un grand nombre de renseignements importants sur cet horrible événement demeurent inconnus du Canada, des autres nations membres du Groupe de coordination et des familles des victimes. Cet état de fait est imputable à l’Iran, qui n’a pas encore prouvé – jusqu’à présent, à tout le moins – que ses enquêtes (sécurité, violations au droit pénal ou autres) sont véritablement indépendantes, objectives et transparentes; en outre, les réponses aux questions critiques n’ont pas encore été fourniesNote de bas de page 9. Parallèlement, au lendemain de cette catastrophe et dans le but d’en éviter d’autres, une occasion est donnée au monde de réfléchir à l’efficacité de procédures et de normes internationales qui, entre autres choses, confient la direction des enquêtes aux pays qui pourraient vraisemblablement être les premiers responsables des conditions à l’origine des tragédies et accordent un statut de participation limitée aux pays qui ont parfois subi le plus de pertesNote de bas de page 10.
Sans égard à l’information manquante et aux entraves, le présent rapport tente de résumer ce que nous croyons savoir jusqu’ici.
À la fin de 2019, les montées de tension et les cycles de violence continuaient d’affecter la région où se trouvent l’Iran et la Syrie. Par exemple, le 27 décembre, des milices soutenues par l’Iran ont lancé des roquettes sur des positions occupées par les forces américaines, près de Kirkouk, en Iraq, tuant un entrepreneur américain qui fournissait des services de traduction à l’armée des États-Unis. Deux jours plus tard, les Américains ont répliqué en attaquant cinq bases de milices sur lesquelles les soupçons pesaient. La veille du jour de l’An, une manifestation pro-Iran à Bagdad s’est transformée en attaque contre l’ambassade des États-Unis. Puis, le 3 janvier, une importante attaque par drone des États-Unis près de l’aéroport de Bagdad s’est soldée par la mort d’un puissant et éminent général iranien, Qassem Soleimani, le chef des brigades al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) qui dirigeait les actions des milices contre les États-Unis et d’autres cibles. Sa mort, qui a été un fait marquant en Iran, a donné lieu à une période de deuil officiel et à des promesses de vengeance. En alerte, le monde attendait la réponse.
Cette réponse a débuté vers 2 h (heure locale) le mercredi 8 janvier. Pendant environ deux heures, plusieurs salves de missiles iraniens ont été lancées en direction de deux bases aériennes en Iraq, l’une à l’ouest de Bagdad et l’autre près d’Erbil, où les forces américaines étaient installées. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, a qualifié ces frappes de [traduction] « mesures proportionnelles d’autodéfense selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies…Note de bas de page 11 ».
Réagissant au danger évident de guerre ouverte dans la région, la Federal Aviation Administration (FAA) a, dans un avis officiel (NOTAMNote de bas de page 12), ordonné aux avions civils américains d’éviter une zone comprise entre la mer Méditerranée et le golfe d’Oman incluant l’ensemble du territoire iranienNote de bas de page 13. Les transporteurs aériens commerciaux d’autres pays – Canada, Australie, Singapour et autres – ont suivi la directiveNote de bas de page 14. L’Iran, qui avait placé son système de défense aérienne au niveau d’alerte élevé, était prêt pour la réplique des États-Unis, ses militaires assurant un plus grand contrôle aux procédures sur les opérations des vols civils. Des unités mobiles de lancement de missiles sol-air ont été déployées à des postes temporaires autour de TéhéranNote de bas de page 15. Toutefois, le pays n’a pas fermé son espace aérien à la circulation civile.
Quelques heures à peine après que l’Iran eut cessé de bombarder les positions américaines en Iraq, quelques centaines de kilomètres à l’est, l’avion effectuant le vol PS752 en direction de Kyiv était sur le point de quitter l’aéroport international Iman Khomeini (IKA) de Téhéran. Ayant obtenu son autorisation de décoller tant des autorités civiles que militaires, il s’est envolé vers 6 h 12 heure locale. Bien que le départ de l’appareil ait été retardé de près d’une heure, son décollage, son ascension en direction nord-ouest, sa vitesse, son altitude et sa trajectoire correspondaient aux attentesNote de bas de page 16. Soudainement, à 6 h 15 et à 2 400 mètres d’altitude, le transpondeur du PS752 a cessé de fonctionner. Et à 6 h 18, l’appareil s’est écrasé sur un terrain de jeu en périphérie de la ville.
De l’autre côté de la planète, dans un Ottawa en plein hiver, on était encore mardi soir, le 7 janvier.
Affaires mondiales Canada, le ministère de la Défense nationale, le Bureau du Conseil privé, le Cabinet du premier ministre (CPM) et les organismes de renseignement canadiens avaient suivi attentivement et avec une préoccupation grandissante la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Le premier ministre était régulièrement mis au courant et consulté. Transports Canada surveillait de près les éventuelles implications pour l’aviation civile, en particulier pour Air Canada.
Dans les heures et les jours précédents, le premier ministre avait parlé à d’autres leaders, comme la chancelière allemande Angela Merkel, le secrétaire général de l’OTAN, le président du conseil européen et le roi de Jordanie pour tenter de trouver un moyen de favoriser une désescalade dans la région. Le mardi soir, des fonctionnaires avaient été réunis au Cabinet du premier ministre, en face de la colline du Parlement, pour préparer une déclaration officielle condamnant le lancement par l’Iran de missiles sur les positions américaines en Iraq. Entre autres choses, le Canada s’inquiétait de la sécurité de plusieurs centaines de Canadiens présents dans la région afin de donner une formation parrainée par l’OTAN aux forces de sécurité iraqiennesNote de bas de page 17.
Bien après 22 h (heure locale), le Centre des opérations aériennes de Transports Canada, sis au centre-ville d’Ottawa, a appris qu’un avion civil s’était écrasé près de Téhéran. Il faudrait attendre pour en savoir plus… Les renseignements qui sont arrivés progressivement durant cette terrible nuit ont révélé qu’une tragédie canadienne d’envergure venait de se produire. Si nos troupes étaient sauves, 138 des personnes ayant péri dans l’écrasement de l’avion étaient liées de près au Canada : certaines en avaient la citoyenneté, d’autres étaient résidentes permanentes, d’autres encore venaient au pays munis de visas d’étudiants et de visiteurs. Les Canadiens demanderaient l’information la plus précise, et les familles angoissées auraient besoin de soutien pour composer avec les lendemains douloureux.
Il fallait d’abord dissiper le brouillard de la catastrophe et obtenir les faits. Des employés de Transports Canada, de la Défense nationale, d’Affaires mondiales Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications à Ottawa ont passé toute la nuit et une partie de la journée de mercredi à réunir les premiers renseignements disponibles : listes des passagers, rapports de renseignements intérieurs et étrangers, information militaire, médias publics et sociaux et données de vol des systèmes au sol et des systèmes satellitaires qui suivent la circulation aérienne civile partout dans le monde. Des contacts ont été pris avec nos alliés en Ukraine et avec le gouvernement italien, qui agit comme « puissance protectrice » du Canada en Iran (en l’absence d’une ambassade du Canada)Note de bas de page 18. Le premier ministre Trudeau a personnellement communiqué avec le président de la France Emmanuel Macron, le premier ministre Boris Johnson au Royaume-Uni, le président Donald Trump à Washington et le premier ministre de l’Australie Scott Morrison. Un premier échange a aussi eu lieu avec l’Iran pour organiser une conversation urgente entre les ministres des Affaires étrangères – premier contact direct depuis la fermeture de l’ambassade du Canada en Iran plus de sept ans auparavant.
Le même jour, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a reçu une notification officielle de la catastrophe du vol PS752 du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran. Il a donc commencé son travail selon les modalités de l’Annexe 13 de la Convention de ChicagoNote de bas de page 19.
Également le mercredi, à la suite d’instructions données par le premier ministre, le Bureau du Conseil privé a amorcé la formation d’un groupe de travail d’urgence pangouvernemental chargé d’assurer une coordination du plus haut niveau parmi une douzaine de ministères et organismes fédéraux concernés. Et Affaires mondiales Canada a commencé à organiser des services consulairesNote de bas de page 20 pour les familles endeuillées, y compris celles qui, ignorant les faits, s’étaient rendues à l’aéroport international Pearson à Toronto pour accueillir des membres de leur famille censées arriver de Téhéran ce jour-là via Kyiv. Or, dans l’avion arrivant de cette ville, 138 sièges étaient vides.
Avec ses principaux ministres, des fonctionnaires de haut rang et tous les renseignements précis pouvant alors être réunis, le premier ministre a offert une séance d’information aux médias mercredi après-midi (8 janvier). Il a souligné la nécessité de déterminer la cause exacte de cette énorme tragédie canadienne à l’aide d’une enquête exhaustive et crédible, et a indiqué qu’il était trop tôt pour spéculer sur ce qui avait pu arriver. Le ministre des Transports Marc Garneau a mentionné que toutes les données disponibles laissaient croire à un décollage normal, mais qu’après celui-ci, elles s’arrêtaient soudainement, une indication que [traduction] « il s’est passé quelque chose de très inhabituel ».
Le reste de la journée et la nuit suivante, les fonctionnaires canadiens ont continué de rassembler tout ce qui pouvait alors être connu à propos du vol PS752, dont des photos et des vidéos dans le domaine public ainsi que des rapports de renseignement de sources canadiennes et alliées. La vérité s’avérait sombre. Si les médias d’information iraniens rapportaient diverses théories sur ce qui avait transpiré, une constante dans leurs reportages était le rejet de toute responsabilité de leur gouvernement – un problème de moteur ou une défectuosité technique quelconque devait être en cause, présumaient-ilsNote de bas de page 21. Mais le Canada a rapidement appris qu’il n’en était rien. Les détails ont été communiqués au premier ministre Trudeau tard dans la matinée du jeudi 9 janvier.
Peu après, dans une deuxième séance d’information aux médias en autant de jours, le premier ministre a annoncé que, sur la foi de renseignements fiables provenant de différentes sources et d’autres faits analysés depuis mercredi, le gouvernement canadien avait conclu que l’avion effectuant le vol PS752 avait bel et bien été abattu par des missiles sol-air iraniens. La nécessité d’une enquête exhaustive, crédible et approfondie était maintenant encore plus criante. Le premier ministre a également indiqué que le ministre des Affaires étrangères Francois-Philippe Champagne avait communiqué avec son homologue iranien (tard la veille) pour exprimer l’indignation du Canada et insister pour que celui-ci ait un accès immédiat à l’Iran pour assurer des services consulaires aux familles des victimes, participer à l’identification des morts et participer à une enquête.
Le premier ministre a continué de communiquer avec les leaders du monde. Pendant cette journée de jeudi, il s’est entretenu avec le président d’Ukraine Volodymyr Zelenskyy, le premier ministre de Suède Stefan Löfven, de Suède, le premier ministre des Pays‑Bas Mark Rutte et (pour une deuxième fois) le président de la France Emmanuel Macron. L’Ukraine, pays de la compagnie aérienne et ami indéfectible du Canada, serait un partenaire crucial dans toute enquête sur le vol PS752. La Suède, à l’instar du Canada, pleurait ses morts. La France apportait une assistance technique. Et les Pays-Bas, autre grand ami, avaient une importante expertise à offrir en raison de son enquête de sécurité ayant fait l’objet de beaucoup d’éloges sur l’abattage du vol MH017 de la Malaysian Airlines dans l’Est de l’Europe en 2014.
Également en ce jeudi 9 janvier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration avec différents services de police locaux du pays, a entrepris le difficile et délicat travail d’informer officiellement les familles de la perte d’êtres chers. Et à Affaires mondiales Canada, le ministre Champagne a commencé à rassembler ses homologues d’Ukraine, de Suède, d’Afghanistan et du Royaume-Uni dans le but de créer le Groupe international de coordination d’intervention, qui a été officiellement annoncé dans les cinq capitales le lendemain, le vendredi 10 janvierNote de bas de page 22.
Il était près de minuit le 10 janvier quand on a appris à Ottawa que l’Iran avait finalement admis, contrairement à ce qu’il avait prétendu jusqu’ici, que l’avion ne s’était pas écrasé en raison d’un incendie de moteur ou d’une défaillance mécanique. En effet, le président du pays, Hassan Rouhani, venait de déclarer sur Twitter que [traduction] « … des missiles tirés en raison d’une erreur humaine ont entraîné le terrible écrasement de l’avion ukrainien et la mort de 176 personnes innocentes.Note de bas de page 23 » Il a parlé de [traduction] « grande tragédie et d’erreur impardonnable », et a promis que les enquêtes se poursuivraient et que des poursuites seraient intentées. Aucune explication n’a été donnée sur la raison pour laquelle cette information avait été retenue pendant trois jours, celle-ci ayant été connue instantanément des commandants du CGRI responsables de l’espace aérien de Téhéran le matin de la catastrophe.
Le samedi 11 janvier, la volte-face de l’Iran diffusée, le premier ministre Trudeau s’est entretenu directement avec le président Rouhani pour exprimer la profonde douleur ressentie par le Canada et la colère qu’inspirait dans le pays cette terrible perte de vies causée par l’Iran, et pour manifester nos vives attentes d’une enquête crédible donnant lieu à une transparence, une reddition de comptes et une justice pour les familles ainsi que de réparations prévues par le droit international.
Entre-temps, à partir du 10 janvier et pendant toute la fin de semaine suivante, des enquêteurs du BST et des membres de l’Équipe permanente de déploiement rapide du Canada se sont rendus en Turquie, en route vers l’Iran, pour commencer le travail d’enquête et la prestation de services consulaires avec l’aide de l’ambassade du Canada à Ankara et l’ambassade d’Italie à Téhéran. Après quelques retards à la frontière, tous étaient arrivés à Téhéran le 13 janvier.
Pendant ses six jours à Téhéran, l’équipe du BST a eu plusieurs rencontres avec des représentants du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran; elle a visité le lieu de l’écrasement (mais seulement après qu’il eut été considérablement vidé de son contenu) et a examiné les débris de l’appareil à l’endroit où ceux-ci avaient été transportésNote de bas de page 24. Les reportages diffusés par les médias immédiatement après la catastrophe ont permis de constater que des douzaines de véhicules et de membres du personnel d’urgence, des militaires et des membres du public étaient présents sur les lieux. L’efficacité des mesures de sécurité n’était pas clairement visible. Des photos non vérifiées mais éloquentes des médias ont montré que des bulldozers étaient à l’œuvre sur le lieu dès le 10 janvierNote de bas de page 25. L’Iran a déclaré que les « boîtes noires » de l’avion, c’est-à-dire l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et l’enregistreur de données de vol, avaient rapidement été récupérées. Ce fut une bonne nouvelle, mais malgré les obligations énoncées à l’annexe 13 de l’OACI de télécharger et d’analyser les enregistrements « sans délai », il a fallu plus de six mois pour que cela survienneNote de bas de page 26.
Après son travail à Téhéran, l’équipe du BST a eu deux journées de rencontres à Kyiv avec le bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs d’Iran et le bureau national d’enquêtes sur les accidents aériens d’Ukraine. Parallèlement, la GRC était arrivée en Ukraine le 14 janvier pour établir avec l’ambassade du Canada à Kyiv et ses homologues ukrainiens la portée d’une collaboration relativement à une enquête criminelle. Ce même jour, un expert des enquêtes sur les accidents de Transports Canada est aussi arrivé à l’ambassade du Canada à Kyiv pour offrir une expertise technique aux autorités de l’aviation civile ukrainienne et aux lignes aériennes du pays. Le déploiement de Transports Canada s’est terminé à la fin janvier. Le déploiement de la GRC a été suspendu temporairement le 13 mars en raison de la COVID-19, mais le travail de la GRC et du procureur général de l’Ukraine en vue d’obtenir la vérité au sujet du vol PS752 est maintenant repris.
En soutien aux familles endeuillées et dans l’intérêt de la sécurité de l’aviation civile mondiale, le Canada n’a eu de cesse de réclamer une enquête complète et crédible sur les questions de sécurité techniques et les responsabilités criminellesNote de bas de page 27.
Les règles internationales prévoient que des entités équivalentes à notre BST réalisent une enquête de sécurité menée par des experts, et que la direction et le contrôle effectif de cette enquête sont confiés au pays où est survenue la catastrophe, l’Iran en l’occurrenceNote de bas de page 28. Une telle enquête de sécurité porte sur les causes techniques (y compris les facteurs humains et organisationnels); elle n’aborde pas la question de la responsabilité ou du blâmeNote de bas de page 29. Les questions criminelles doivent être traitées en vertu des lois de chacun des pays. Puisque les lieux sont sous son contrôle, la majeure partie de la preuve et les témoins relève de sa charge, tout comme la capacité pratique d’identifier et d’interroger les suspects. En somme, l’Iran a la pleine maîtrise de toute enquête criminelle directe et des poursuites pouvant en découler. Le monde a été informé que jusqu’à six Iraniens ont été accusés de certaines infractions liées à la destruction du vol PS752 et aux 176 morts, mais rien n’a été dit sur l’identité de ces personnes, ce qu’elles auraient fait, leur niveau de responsabilité, la preuve utilisée contre elles, la nature de leur défense et le processus judiciaire exact par lequel leur culpabilité ou innocence est ou sera déterminée.
Cette situation soulève des préoccupations évidentes de crédibilité, de conflits d’intérêts et de manque de transparence et de responsabilité, particulièrement à la lumière de l’aveu par l’Iran que ce sont ses propres militaires – nommément le CGRI – qui ont tiré les missiles ayant abattu cet avion commercial innocent qui avait obtenu toutes les autorisations de décoller des autorités militaires et civiles iraniennes. La partie responsable fait enquête sur elle-même, principalement en secret, ce qui n’inspire pas confiance.
Les inquiétudes sont particulièrement élevées en raison de la perturbation et de la contamination rapides du site de l’écrasement, du long délai précédant le téléchargement des boîtes noires et du harcèlement et de l’intimidation de certaines familles des victimes : interventions à des services funèbres, conservation d’effets personnels, communications inquiétantes, traques, détentions, interrogations, etc. Dans la même veine, les médias canadiens ont obtenu l'enregistrementNote de bas de page 30 d’un appel téléphonique fait à un membre d’une famille vivant au Canada par un haut fonctionnaire iranien, qui reproche à son interlocuteur d’avoir été critique de l’Iran sur les médias sociaux. Certaines parties de la conversation pourraient être interprétées comme des menaces. Le fonctionnaire laisse entendre que l’espace aérien iranien est demeuré ouvert pendant la période en cause pour éviter que l’horaire des vols soit perturbé ou que les Américains soupçonnent l’activité militaire des Iraniens.
En plus de l’enquête de sécurité indépendante du BST menée en vertu de la Convention de Chicago et de l’aide apportée par la GRC dans l’enquête criminelle de l’Ukraine, le Canada a mis en place une équipe d’expertise et d’analyse judiciaires chargée de répertorier et d’examiner tous les renseignements et éléments de preuve liés au vol PS752 afin de fournir au gouvernement du Canada des évaluations et des avis experts sur la valeur probante de ces informations, leur signification, leur crédibilité et l’intégrité du processus par lequel ils ont été obtenusNote de bas de page 31.
En ce qui concerne l’enquête de sécurité dirigée par le bureau iranien d’enquête sur les accidents d’aéronefs, le Canada attend le rapport final. Jusqu’ici, l’organisme a publié son avis original de catastrophe et quatre rapports provisoires subséquentsNote de bas de page 32. Ceux‑ci, dont les conclusions n’ont pas été appuyées par des éléments de preuve précis jusqu’ici, ont laissé entendre que c’est un long enchaînement d’erreurs humaines et d’autres déficiences qui a causé le tir malavisé de missiles iraniens sur l’un avion effectuant le vol PS752 le matin du 8 janvier. On espère que le rapport final du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de l’Iran exposera davantage de faits et de preuves.
De façon générale, l’explication donnée par l’Iran jusqu’ici se compose des éléments suivants :
- La mise au niveau d’alerte élevé du système de défense aérienne de l’Iran a entraîné le déploiement par le CGRI d’unités mobiles de lancement de missiles à des postes temporaires autour de Téhéran;
- Une erreur de 107 degrés a été commise par l’opérateur dans l’alignement vers le nord d’une unité mobile de défense aérienne située à une certaine proximité de l’aéroport IKA, ce qui a entraîné une erreur directionnelle majeure;
- Pendant toute la présence de l’unité à cet endroit, ni l’opérateur, ni son centre de commandement n’ont apparemment détecté des problèmes d’alignement, près d’un tiers du compas de sa position;
- Peu importe les systèmes d’identification (vision nocturne, vidéo, radar ou autres) qui pourraient avoir été disponibles ou fonctionnels, l’opérateur a apparemment été incapable de distinguer les appareils amis des appareils ennemis dans le ciel de la capitale iranienne;
- Il y avait un bris de communication entre l’opérateur et son centre de commandement, pour une certaine période, notamment au moment exact où l’avion s’est envolé;
- L’opérateur a confondu un avion à réaction commercial de 40 mètres décollant et s’éloignant dans une trajectoire ascendante d’est en ouest et un appareil ou un missile menaçant se rapprochant dans une trajectoire descendante d’ouest en est;
- L’opérateur a, de façon indépendante, décidé de lancer deux missiles sol-air en direction de l’avion, une violation directe des procédures selon lesquelles il est strictement interdit de faire feu sans l’autorisation du centre de commandement;
- Toutes ces erreurs et défaillances réunies se sont soldées par la destruction du vol PS752; un nombre important d’autres avions de passagers commerciaux ont décollé de l’aéroport IKA et y sont atterris, tant avant qu’après le vol PS752, sans être attaquésNote de bas de page 33.
Compte tenu de la nature extraordinaire de la description des événements, il est compréhensible que les familles des victimes trouvent l’explication de l’Iran difficile à accepter, du moins jusqu’à présent. Pour éliminer les doutes et apaiser l’anxiété, il incombe lourdement à l’Iran de se montrer complètement transparent dans sa manière d’appuyer ses explications par des preuves crédibles et convaincantes, ce qu’il n'a pas encore fait.
Il est également compréhensible que la communauté de l’aviation civile internationale puisse être préoccupée, entre autres, par le bon fonctionnement du système de défense aérienne de l’Iran; ses mécanismes de sécurité intégrée; la formation et la compétence de ses opérateurs et de ses commandants; le risque de comportements aberrants; l’interface défaillante entre les opérations aériennes militaires et civiles de l’Iran; les procédures (si elles existent) utilisées pour avertir les propriétaires et les exploitants d’avions commerciaux d’activités militaires; et la qualité du processus menant à la décision de garder l’espace aérien du pays ouvert durant et immédiatement après des hostilités militaires ou en prévision de celles-ci. Dans les circonstances, selon les renseignements que l’on a obtenus jusqu’à maintenant, on constate des indications d’incompétence, d’imprudence et de mépris pour la vie d’innocents. Il appartient à l’Iran de répondre à ces interrogations de façon ouverte et convaincante, sous peine de risquer une absence totale de confiance internationale dans sa capacité à assurer un espace aérien sécuritaire.
Si la communauté internationale n’est pas entièrement informée et satisfaite relativement aux événements exacts qui se sont produits le matin du 8 janvier dans le ciel de Téhéran, sur les raisons pour lesquelles les choses se sont déroulées ainsi et sur les mesures apportées pour éviter une répétition, des inquiétudes concernant la sécurité aérienne dans la région subsisteront, ainsi que des doutes permanents à l’égard des responsables.
Quelques grandes questions pour lesquelles le monde doit avoir des réponses complètes et honnêtes
Gestion de l’espace aérien et processus décisionnel du 8 janvier 2020
- Dans sa planification des attaques balistiques contre des secteurs occupés par les Américains en Iraq au matin du 8 janvier, l’Iran a-t-elle tenu compte des importants corridors de trafic aérien commercial qui croiseraient la trajectoire prévue des missiles? Quelles mesures ont été prises pour avertir les propriétaires et exploitants d’appareils commerciaux du monde entier?
- À partir du moment où l’Iran a commencé son lancement de missiles sur des positions américaines en Iraq le matin du 8 janvier, quelle est la séquence complète et exacte des événements et des décisions – civile et militaire (y compris le CGRI) – qui ont affecté le vol PS752? Comment les autorités civiles et militaires ont-elles communiqué ensemble pendant tous ces événements? Y a-t-il eu des conflits ou des défaillances de communication? Laquelle des autorités a pris la décision finale d’autoriser le décollage de l’avion? Quels facteurs ont-ils été pris en considération?
- Compte tenu de la hausse soutenue des tensions dans la région, de l’augmentation des hostilités, du fait que l’Iran venait tout juste de tirer des missiles vers les bases américaines en Iraq et du niveau d’alerte élevé des défenses aériennes iraniennes lié à une réplique américaine, qu’a fait l’Iran pour évaluer la pleine étendue des risques pour l’aviation commerciale en activité dans son espace aérien? Quel processus préside à la décision de fermer ou de laisser ouvert cet espace? Qui prenait part au processus? La fermeture de l’espace a-t-elle été demandée ou proposée par quiconque? Qui a pris la décision finale? Quel raisonnement a soutenu la décision de laisser l’espace aérien ouvert en dépit des risques?
- Après avoir décidé de ne pas fermer son espace aérien, malgré les risques, de quel système les autorités iraniennes disposaient-elles pour informer les propriétaires et les exploitants des avions civils des risques dans la région et pour leur permettre de juger eux-mêmes s’il était sécuritaire de faire voler des avions dans l’espace aérien iranien? Quelle information a été transmise exactement aux propriétaires ou exploitants du vol PS752 et des autres vols entrants et sortants? A-t-il été mentionné que l’aéroport IKA faisait l’objet d’une surveillance par des unités de défense aérienne (ADU) mobiles pouvant lancer des missiles sol-air?
- Quel système les autorités iraniennes avaient-elles pour informer les opérateurs d’ADU mobiles de l’identité des avions civils atterrissant à l’aéroport IKA ou décollant de celui-ci afin que ces appareils ne soient pas confondus avec des cibles hostiles par ces opérateurs?
- Comment la déconfliction des structures de commandement et des mécanismes de contrôle civils et militaires était-elle effectuée de sorte que de l’information complète et exacte soit transmise aux propriétaires et aux exploitants des avions civils ainsi qu’aux opérateurs d’ADU? Est-ce que ce sont les mêmes processus de déconfliction en vigueur aujourd’hui ou ont-ils été changés?
Système de missiles ADU et compétence des opérateurs
- Quels étaient les mécanismes de sûreté intégrée techniques et humains en vigueur au regard du système de missiles SA-15b pour assurer le mouvement, le positionnement, l’alignement et la configuration appropriés de chaque unité et pour prévenir les erreurs d’identification des cibles ou l’engagement erroné avec un appareil civil? Ces mécanismes de sûreté intégrée sont-ils encore en place aujourd’hui ou ont-ils été remplacés par d’autres?
- Quel type de formation est-elle donnée et quelles procédures sont en vigueur pour que les opérateurs d’ADU – y compris celui qui a tiré sur le PS752 – possèdent les habiletés et la compétence nécessaires pour faire leur travail de façon sécuritaire et éviter de causer des préjudices aux avions civils?
- Quel est l’élément précis lié à l’avion effectuant le vol PS752 qui a convaincu l’opérateur d’ADU qu’il s’agissait d’un missile hostile qui s’approchait et qui devait être détruit?
- Compte tenu du ciel occupé au-dessus de Téhéran le matin du 8 janvier, l’opérateur d’ADU qui a tiré le missile ayant détruit l’avion ou tout autre opérateur d’ADU a-t-il pris pour cible un autre avion civil après l’avoir confondu avec une cible hostile? Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises pour corriger la situation?
- Qui est l’opérateur d’ADU qui a lancé les missiles qui ont détruit l’avion du vol PS752? Quels sont son âge, sa formation, son expérience, son rang, son niveau de compétence et son statut actuel? D’autres personnes ont-elles travaillé avec cet opérateur au sein de l’ADU? Qui sont-elles?
Commandement et contrôle
- Quelles étaient les procédures explicites de commandement et de contrôle selon lesquelles l’opérateur d’ADU identifiait une cible, l’authentifiait et obtenait l’approbation pour faire feu sur elle? Quelles étaient les attributions exactes de chaque participant dans la chaîne de commandement? Quels étaient leurs systèmes de communication? En quoi précisément chacun d’eux ont-ils défailli, et pourquoi? Des changements ont-ils été apportés?
- Existait-il ou existe-t-il des encouragements ou des incitations, explicites ou implicites, pouvant inciter un opérateur d’ADU à violer les procédures et à tirer avant d’en avoir reçu l’autorisation?
- Qui, dans la chaîne de commandement militaire, assume la responsabilité ultime pour cette catastrophe? Qui étaient les commandants qui avaient sous leurs ordres l’opérateur d’ADU qui a tiré sur le vol PS752? Quels sont leur âge, leur formation, leur expérience, leur rang, leur niveau de compétence et leur statut actuel, et de qui relèvent-ils?
Responsabilité et enquête de l’Iran
- Le gouvernement de l’Iran a qualifié ce « terrible écrasement » de « grande tragédie » et d’« erreur impardonnable ». À la lumière de ce constat, qui au sein du gouvernement du pays assume la responsabilité politique de la destruction de l’avion et la mort de 176 personnes innocentes?
- Étant donné la certitude que le vol PS752 a été abattu par les propres militaires de l’Iran, pourquoi a-t-il été décidé de confier entièrement à l’interne (aux autorités iraniennes) les enquêtes criminelles et de sécurité nécessaires au lieu de déléguer ces responsabilités à des tiers externes impartiaux, comme cela a été fait dans des circonstances semblables?
- À quel moment l’ADU mobile utilisé pour tirer sur le vol PS752 a-t-il été positionné à proximité de l’aéroport IKA? Quelle position exacte occupait-elle? À quel moment a-t-elle été retirée de cette position? Où se trouve-t-elle maintenant? Est-elle encore en état de constituer un élément de preuve?
- Pourquoi l’avion a-t-il décollé à environ 6 h 12 (heure locale) au lieu de 5 h 15 comme le prévoyait l’horaire? Quand l’embarquement des passagers a-t-il commencé et fini? Des passagers ou membres d’équipage sont-ils descendus de l’appareil avoir y être montés? Y a-t-il des passagers confirmés qui ne se sont pas présentés pour l’embarquement? Qu’a fait l’Iran pour examiner cet ADU?
- Étant donné l’utilisation à grande échelle de la technologie cellulaire pour communiquer dans des situations d’urgence ainsi que pour prendre des photos et filmer, quelles mesures a-t-on prises pour déterminer si des passagers ou membres d’équipage ont tenté de communiquer avec des personnes au sol ou ont pris des photos ou filmé des vidéos pendant ces moments désespérés entre le premier impact de missile et l’écrasement? Des téléphones cellulaires, des caméras ou des enregistreurs vidéo ont-ils été retrouvés sur le lieu de l’écrasement? Où sont-ils maintenant?
- Quelle analyse technique a-t-elle été effectuée sur les restes de l’appareil pour déterminer s’il a été endommagé par un ou deux missiles? S’il a été frappé par deux missiles, à quel endroit l’a-t-il été dans chaque cas et avec quelle ampleur? Et quels dommages supplémentaires ont-ils été causés par l’impact au sol?
- Comment et pourquoi a-t-il été décidé d’annoncer avec trois jours de retard que l’avion avait été abattu par les militaires iraniens?
Alors que le Canada attend des réponses définitives à ces questions essentielles (ainsi qu’à d’autres) – et des faits tangibles appuyant ces réponses – pour s’assurer que l’Iran a été aussi transparent et exhaustif que possible dans son enquête sur la catastrophe du vol PS752, la réponse du Canada aux familles des victimes nécessite une action concertée sur plusieurs fronts.
Dans tous les cas où des membres des familles disent être menacés ou harcelés en personne, par téléphone ou en ligne, la police canadienne et les organismes de sécurité nationaux doivent enquêter et faire un suivi. Le gouvernement du Canada voit d’un très mauvais œil la perpétration de telles agressions au pays. Selon les faits, le harcèlement, l’intimidation, les menaces, le discours haineux, le terrorisme et l’ingérence étrangère constituent des infractions figurant dans le Code criminel et dans d’autres lois qui doivent engager des poursuites dans la pleine mesure permise par la loi. Par ailleurs, la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité peuvent développer, avec les communautés et les organismes irano-canadiens de tout le pays, une résilience locale et nationale qui contribuera à prévenir ces agissements commis contre les familles endeuillées.
Dans les jours et les semaines suivant immédiatement la catastrophe, des déplacements d’urgence entre le Canada et l’Iran ont dû être organisés pour les familles. Affaires mondiales Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada ont fourni de l’aide à cet égard. Dans les mois ultérieurs, des problèmes d’immigration et de visa ont été résolus. Le gouvernement a adopté une position de facilitation pour offrir du soutien et des orientations alors que les familles géraient leurs exigences de voyage. On continue de s’attaquer aux problèmes, sans relâche.
Par l’entremise du Groupe international de coordination et d’intervention, le Canada collabore avec tous ses partenaires lésés dans le but de négocier des réparations conformes au droit international. L’Iran a commis des actes illégaux sur le plan international. Il doit offrir des mesures de réparation complètes aux parties touchées, y compris les membres les plus proches des victimes et des pays touchés. Les pays membres du groupe de coordination souhaiteront également une description entière et franche de ce qui s’est vraiment passé, des assurances que ces événements ne se reproduiront jamais (y compris des mesures préventives concrètes) et des excuses officielles.
Le Canada se lance dans ce processus les yeux grands ouverts et paré à toute éventualité, et toutes ses options demeurent possibles. En cas d’échec des négociations, le Canada continuera de demander transparence, responsabilité et justice par l’entremise de tous les forums internationaux pertinents : Organisation des Nations Unies, Organisation de l’aviation civile internationale, Cour internationale de Justice, etc. Ces mesures seront bien entendu menées dans l’intérêt des familles en deuil et des nations lésées, mais elles sont aussi essentielles à la sécurité de l’aviation civile internationale.
Enfin, à l’approche du premier anniversaire de cette horrible catastrophe, le gouvernement du Canada doit veiller à ce que les personnes qui ont péri à bord du vol PS752 soient commémorées. Nous devons aussi honorer les vies précieuses perdues dans d’autres catastrophes aériennes, comme celles du vol 182 d’Air India et du vol 302 d’Ethiopian Airlines. Ces personnes étaient toutes – et sont encore – profondément aimées de leur famille. Elles représentaient un énorme potentiel humain pour le Canada, voire le monde. Elles ne seront jamais oubliées.
Chapitre 2
Le gouvernement du Canada répond… dans ses propres mots
Au cours des derniers mois, en travaillant sur la réponse du gouvernement à la perte tragique du vol PS752, j’ai eu maintes occasions d’examiner de plus près la façon dont les élus et les fonctionnaires ont géré cette crise majeure, douloureuse et continue. Trois constats s’imposent :
- Dès le début, la tragédie du vol PS752 a reçu toute l’attention du gouvernement aux plus hauts échelons;
- Une stratégie pangouvernementale a contribué à assurer une exhaustivité, une cohésion et une efficacité maximales;
- Les besoins et les attentes des familles des victimes ont été au cœur du travail du gouvernement, et le sont toujours.
Le premier ministre, les ministres et les secrétaires parlementaires se sont engagés intensément et personnellement dès les premiers instants – en prenant des décisions et en fournissant une orientation –, mais ils ont été épaulés solidement par une grande équipe de fonctionnaires. Ces équipes m’ont raconté de façon éloquente à quel point les fonctionnaires ont été touchés en plein cœur par l’énormité de la situation, l’angoisse qu’elle a générée et les besoins humains qu’elle a exposés. Et elles ont relevé le défi avec brio.
Une façon de bien saisir ce qu’ils ont fait consiste à lire leur propre compte rendu afin d’obtenir un aperçu de ce qui s’est passé pendant les heures et les jours fatidiques qui ont suivi la tragédie, et de comprendre le déroulement des événements par la suite. Leur récit donne une idée des questions fondamentales abordées et du savoir-faire requis pour accomplir le travail. Ces récits comportent sans doute des conseils pratiques pour tout futur gouvernement qui pourrait devoir faire face à une tragédie semblable.
Le préambule
David Morrison, conseiller du premier ministre en matière de politique étrangère et de défense, agissait comme conseiller à la sécurité nationale et au renseignement après du premier ministre, en décembre 2019. M. Morrison raconte les jours fatidiques qui ont précédé l’écrasement du vol PS752 :
« Pour moi, la chronologie commence à la fin décembre 2019, avec les événements qui ont mené à la tragédie. Le 27 décembre, nous avons appris qu’une base aérienne iraquienne dans la province de Kirkouk avait été attaquée à la roquette, action qui a fait des blessés et un mort parmi les troupes américaines. Ce soir-là, j’ai reçu un appel du Cabinet du premier ministre, et je me souviens qu’on m’a dit : ça commence. »
Bien avant le jour fatidique du 8 janvier, la sous-ministre d’Affaires mondiales Canada, Marta Morgan, et son équipe portaient toute leur attention sur les événements dans la région.
« Pendant la période des fêtes, la situation en Iran et en Iraq nous a tenus occupés, surtout après l’élimination du général Soleimani, le 2 janvier. Nous surveillions de très près ce qui se passait et tentions de comprendre les répercussions sur le monde et nos gens sur le terrain. »
Le 7 janvier, le temps était anormalement doux à Ottawa : la température étant légèrement au-dessous de zéro et le sol était recouvert d’une mince couche de neige qui avait commencé à tomber après le coucher du soleil.
Une faible neige tombait dans la rue Sparks lorsque le sous-ministre de Transports Canada, Michael Keenan, a quitté le bureau. Il était au gymnase quand il a reçu un appel urgent. Il raconte la discussion :
« Le téléphone sonne et c’est le personnel de la Sécurité qui m’annonce que l’Iran a mené une frappe balistique et que d’autres actions militaires sont possibles. Après une discussion avec la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, notre équipe a appris que cette dernière était sur le point de diffuser un NOTAM, un avis à ses transporteurs aériens leur indiquant qu’ils ne devraient pas voler dans l’espace aérien de l’Iran ou de l’Iraq. Selon les conventions internationales, chaque pays est responsable de son propre espace aérien, donc, normalement, c’est l’Iran qui aurait dû signaler qu’elle était en voie de diffuser un NOTAM, mais elle ne l’a pas fait. »
Des responsables de Transports Canada ont ensuite communiqué avec Air Canada, seule ligne aérienne du pays à offrir des vols dans cette région, et les représentants de l’entreprise ont confirmé qu’ils prenaient déjà des mesures pour détourner leurs vols de la zone dangereuse. Même si seuls les transporteurs américains sont tenus de respecter les NOTAM de la FAA, Air Canada, WestJet et les autres transporteurs du Canada suivent régulièrement ces avis concernant l’espace aérien étranger. M. Keenan mentionne :
« J’ai transmis l’information sur ces événements au ministre Garneau [des Transports], et il a été convenu que la population devait être mise au courant des circonstances le plus rapidement possible, ce qui a été fait à 23 h 55, à OttawaNote de bas de page 34. »
Cette nuit-là : « Une tragédie hautement canadienne »
David Morrison se souvient de cette soirée :
« Nous étions dans le Cabinet du premier ministre, tentant de comprendre ce qui s’était passé en Iraq, et discutions d’une possible déclaration au sujet de la frappe iranienne. Il se faisait déjà très tard lorsqu’on a annoncé aux informations qu’un avion s’était écrasé dans la région, mais à ce moment il n’y avait aucun lien avec le Canada. Je suis parti du bureau vers 2 h du matin, et quelques heures plus tard, à mon réveil, on annonçait aux informations qu’on avait à faire à une tragédie bien canadienne. »
Le sous-ministre Keenan a commencé à recevoir les premiers comptes rendus au sujet du vol PS752.
« Vers 23 h cette nuit-là, j’ai reçu le premier compte rendu annonçant qu’un avion s’était écrasé en Iran. Parce que nous savions que cela s’était passé en zone de conflit, il semblait peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence. J’ai immédiatement demandé à mon équipe de commencer à travailler à l’acquisition de renseignements de navigation commerciale par satellite à préparer un premier rapport pour le lendemain matin. Les systèmes de navigation peuvent donner des renseignements vraiment importants, comme l’altitude et la direction des avions, ainsi que la vitesse dans les instants précédant un écrasement. Nous étions donc déterminés à recueillir autant de renseignements que possible pendant la nuit. »
Adam Foulkes, du Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada, travaillait ce soir-là :
« C’est peu après minuit que nous avons commencé à comprendre qu’un transporteur aérien ukrainien en provenance d’Iran s’était écrasé peu après le décollage. J’ai immédiatement communiqué par téléphone avec nos ambassades à Ankara et à Kyiv pour demander des renseignements au sujet de la liste de passagers de l’avion. Pas plus de 2 h 30 plus tard, aux environs de 2 h 30, l’ambassade à Kyiv m’a rappelé. Je n’oublierai jamais le choc que j’ai ressenti quand on m’a dit que des dizaines de Canadiens figuraient sur la liste des passagers à bord de ce vol. Il me semble que ce n’est pas beaucoup plus tard que les premiers appels des familles touchées par la tragédie ont commencé à entrer. »
Ce matin-là : « Tant de personnes extraordinaires »
La sous-ministre Morgan décrit comment l’annonce de la tragédie lui est parvenue :
« J’ai appris en fin de soirée [le 7 janvier] qu’un avion de ligne civil s’était écrasé, mais ce n’est que le lendemain matin que nous avons pleinement compris que cet avion, effectuant le vol Téhéran-Kyiv, comptait en fait de nombreux passagers venant au Canada : des citoyens, des résidents permanents, des étudiants, et tant de personnes extraordinaires ayant des liens avec le Canada. »
Brent Robson, directeur des Opérations d’urgences, à Affaires mondiales Canada, raconte les difficultés propres à cet écrasement :
« Je savais ce matin-là que nous serions aux prises avec à des difficultés uniques. Dans la première liste de passagers qui a été transmise, il manquait des renseignements cruciaux, qui, normalement, auraient dû être transmis par le pays où a eu lieu l’accident (l’Iran en l’occurrence). Nous avons donc dû reconfirmer la liste de passagers à bord du transporteur auprès de notre ambassade à Kyiv. Elle a heureusement pu nous la transmettre assez rapidement. Une fois en possession de la liste, nous avons collaboré avec IRCC [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada], l’ASFC [Agence des services frontaliers du Canada] et la GRC afin de vérifier qui exactement était à bord de l’avion et d’établir la situation quant aux victimes ayant des liens avec le Canada. »
L’équipe du sous-ministre Keenan à Transports Canada a également travaillé toute la nuit pour recueillir des données; et elle avait une première idée de l’état la situation le lendemain matin.
« Nous avons pu examiner les données du système satellitaire ce matin-là et avons constaté que tout était normal en ce qui concerne le vol PS752 jusqu’à ce que l’appareil atteigne une altitude de 8 000 pieds (2 400 mètres) et qu’il cesse soudainement de transmettre ses coordonnées. Comme un interrupteur qu’on aurait fermé, le système satellitaire a cessé de recevoir des renseignements. Nous avons commencé à réfléchir à trois possibles raisons expliquant cette situation : une fusillade, une bombe ou un accident dans la soute qui a provoqué une explosion. »
M. Keenan a immédiatement informé le ministre Garneau et ses collègues clés de ces évaluations initiales.
Le premier jour : « Prise de conscience de l’ampleur de la tragédie »
Alors qu’Affaires mondiales Canada commençait à recevoir des appels et des renseignements très tôt le matin du 8 janvier, les équipes du Ministère responsables de l’Ukraine et de l’Iran se rendaient compte de la gravité de la situation.
Alison Grant, directrice de la direction responsable des relations avec l’Ukraine :
« Nous devions parler avec les autorités ukrainiennes dès le premier jour afin d’obtenir le plus de renseignements possible au sujet de l’avion et de l’intervention immédiate. Tôt ce matin-là, nous avions organisé des appels avec le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre. Je me souviens très bien du moment où il est apparu probable que de nombreux passagers à bord étaient des jeunes revenant au Canada pour la reprise des cours. À l’instant même, nous avons pleinement compris l’énormité de la tragédie. »
La sous-ministre Morgan raconte ses discussions avec le ministre Champagne le matin du 8 janvier :
« Notre priorité était d’aligner notre action sur celles des autres pays qui comptaient des victimes. Le ministre Champagne a discuté immédiatement par téléphone avec la Suède, le Royaume-Uni et à plusieurs reprises avec l’Ukraine. Ces contacts politiques de haut niveau continuent de nous aider dans notre intervention aujourd’hui. »
Chacun des appels a montré que tous les pays concernés devaient discuter ensemble. Mme Grant poursuit :
« Le deuxième jour [le 9 janvier], le ministre a demandé d’organiser une téléconférence réunissant tous les ministres des Affaires étrangères des pays touchés par la tragédie. Cette première téléconférence nous a permis de discuter de ce que nous dirions publiquement, de nos demandes à l’intention de l’Iran et du soutien à apporter aux familles des victimes. »
Cette première téléconférence est à l’origine du Groupe international de coordination et d’intervention (Groupe de coordination) venant en aide aux familles des victimes de l’écrasement du vol PS752.
Les premiers jours : « Les familles des victimes au cœur de nos préoccupations »
Catherine Blewett, sous-greffière du Conseil privé, a coordonné l’intervention du gouvernement du Canada à la suite de l’écrasement du vol PS752 lors des jours cruciaux qui ont suivi immédiatement la tragédie :
« Mon rôle était de m’assurer de réunir les bonnes personnes, et que le Canada s’appuyait sur une démarche satisfaisante aux yeux de la population. Affaires mondiales était pleinement mobilisé, l’aide d’Immigration a été demandée pour les demandes de visas, celle de Santé aussi pour s’assurer que notre action intègre des soutiens en santé mentale et des soutiens communautaires, Transports Canada s’est chargé de l’analyse et collaborait avec l’OACI, le Bureau de la sécurité des transports a dépêché des enquêteurs en Iran, l’ASFC facilitait le processus d’arrivée des familles, Justice Canada travaillait sur des soutiens financiers et juridiques supplémentaires, Sécurité publique était chargé d’établir un fonds équivalant à la valeur des dons du public; ce fut réellement un effort collectif. »
Mme Blewett parle du moment où elle a commencé à voir les efforts du Canada se concrétiser :
« Je m’en souviens très bien, c’était tard jeudi en soirée [le 9 janvier]. J’étais avec le greffier [Ian Shugart, greffier du Conseil privé], nous étions seulement tous les deux dans son bureau. Nous avons analysé minutieusement ce que l’écrasement du vol PS752 signifiait pour le Canada, quel type d’intervention le Canada devrait mener et comment s’assurer qu’elle est crédible et complète. »
La sous-greffière se remémore la priorité du gouvernement dès le départ :
« Je crois que l’importance que nous avons accordée aux familles des victimes a fait ressortir le meilleur de chacun des collègues. Cela a commencé avec le lien du premier ministre avec les familles, le travail du secrétaire parlementaire Alghabra à titre d’agent de liaison des familles. Et, selon moi, l’action de tous les ordres de gouvernement a été impressionnante. Je me souviens que l’organisation Pro Bono Ontario s’est vraiment démarquée, les municipalités ont mis les mains à la pâte et le soutien des provinces et des communautés était essentiel dans les lieux de rassemblement. C’était vraiment le Canada en tant que fédération qui a uni ses efforts. »
Selon Mme Blewett, les communications du gouvernement ont été particulièrement efficaces dans le cadre de son intervention, et c’est en raison de ses expériences antérieures. Mme Blewett poursuit :
« Nous avions déjà tiré des leçons sur le plan de la communication avec les familles et savions qu’il était de notre devoir de mettre en branle nos communications immédiatement. L’écrasement a eu lieu en Iran, et cela a compliqué énormément les communications; particulièrement au moment où nous regardions comment soutenir les familles vivant en Iran. Notre grande priorité était de trouver une façon de communiquer avec les familles. »
Les agents consulaires décrivent que le lien était efficace en pratique :
« Nous avons demandé à nos collègues qui parlent le farsi de nous appeler et de traduire des documents pour les familles. Le lendemain, des dizaines de volontaires appelaient pour des quarts de travail de 24 h, et parfois, il pouvait y avoir 15 appels en même temps. »
Leur soutien a été inestimable. Un employé du centre de surveillance l’a exprimé ainsi :
« Ce qui m’a vraiment frappé, c’est de voir nos collègues parlant le farsi pleurer ouvertement au téléphone avec les familles. C’était à la fois réellement frappant et triste. Nous composons avec toutes sortes de situations, et nos agents sont formés pour conserver un ton professionnel en tout temps. Mais l’ampleur de cette tragédie et la signification culturelle de cette sorte de deuil public pour nos collègues parlant le farsi ont vraiment changé notre façon de répondre aux besoins des familles. »
La réponse a touché tant d’employés que l’équipe travaillant pour le sous-ministre de la Santé du Canada, le Dr Stephen Lucas, a demandé au Bureau du Conseil privé de transmettre un message aux fonctionnaires participant à l’intervention à la suite de l’écrasement du vol PS752 au sujet des ressources disponibles afin d’aider toutes les personnes concernées à gérer l’ampleur de la tragédie.
IRCC a en outre mis rapidement sur pied des canaux exclusifs pour les familles des victimes pour régler les problèmes d’immigration avec lesquels elles étaient aux prises.
Catrina Tapley, sous-ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a décrit le processus :
« Notre équipe a pu instaurer, en moins de 48 heures, une ligne téléphonique et une adresse courriel destinées aux familles des victimes. Du personnel parlant l’anglais, le français ou le farsi s’occupait de ces canaux de communication sept jours sur sept. Offrir un numéro de téléphone international réservé constituait une étape jamais vue pour IRCC, et cette idée a été reprise dans le travail de l’équipe de préparation opérationnelle et de gestion de crise du Ministère, qui a travaillé à diffuser l’information, a participé aux négociations avec d’autres États et a mis sur pied une politique publique pour aider les familles des victimes.
Je suis très fière des personnes qui ont travaillé par téléphone ou au moyen des divers modes de service. Nous avons passé notre ministère au peigne fin pour trouver des personnes parlant le farsi et avons utilisé notre réseau d’établissements dans les situations où nous pouvions offrir un soutien particulier à des groupes au Canada. Nous avons même eu quelques personnes dans notre réseau d’établissements qui avaient perdu des proches qui étaient à bord du vol PS752, ce qui a rendu la tragédie encore plus personnelle. Nous avons ainsi pu écouter les gens, écouter leur douleur et leur colère, être capables d’entendre cette douleur et faire ce que nous pouvions pour eux. »
Une autre innovation importante a été créée dans le cadre de l’intervention : un portail Web protégé par un mot de passe pour les familles des victimes. Ce portail a été conçu pour faciliter la transmission de renseignements et la prestation de services pertinents offerts par tous les ministères et organismes fédéraux dès qu’ils sont disponibles pour que les familles puissent y accéder en cas de besoin; tout en garantissant la protection de la vie privée des familles. Un agent consulaire parle de la création du portail :
« Il est apparu assez rapidement que le processus de deuil de certaines familles était hautement personnel et que les familles ne voulaient pas recevoir beaucoup d’appels et de courriels. Il a permis aux familles d’obtenir les informations uniquement lorsqu’elles étaient prêtes à les traiter. »
La destruction : « Ils devraient cesser de nier la vérité »
C’est plus tard, le 8 janvier, que des employés ont commencé à recevoir des renseignements selon lesquels l’écrasement de l’avion n’était pas attribuable à une erreur mécanique ou humaine normale. Comme se remémore David Morrison :
« Transports Canada disposait des données radar et a décrit la façon dont l’avion a soudainement disparu de l’écran. Cela laissait entrevoir une sorte d’accident catastrophique qui était incompatible avec une défaillance mécanique. »
Ce constat a amené le ministre Garneau à noter, lors du point de presse du premier ministre du 8 janvier, que les données laissaient entrevoir que « quelque chose de très inhabituel s’était produit » en ce qui concerne le vol PS752.
L’unité d’évaluation d’Affaires mondiales Canada a également suivi de près la situation tout au long de la journée du 8 janvier :
« Le premier jour, nous avons commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles il y avait quelque chose de suspect au sujet de l’écrasement du vol PS752. Nous avons commencé à recevoir beaucoup d’informations de sources ouvertes, y compris sur la trajectoire de vol de l’avion et quelques vidéos publiées sur des médias sociaux qui montraient une explosion à proximité de l’avion ».
L’équipe d’évaluation a alors décidé de travailler toute la nuit pour continuer à surveiller la situation et à recueillir des informations pour faire un compte rendu à la haute direction lors de l’ouverture des bureaux :
« Je pense que c’est vers 4 h [le 9 janvier] que nous avons recueilli suffisamment d’informations fiables pour déterminer qu’un missile avait probablement causé l’écrasement. Nous avons rédigé un rapport, et je pense que notre analyse était terminée vers 6 h 30. Je me souviens de l’état du bureau ce matin-là, il y avait des gribouillis sur le tableau blanc de l’équipe, j’avais ouvert environ 75 onglets sur mon ordinateur et le sol était jonché de confettis à force de faire des trous dans les cahiers d’information. Je pense que je n’oublierai jamais ce moment où nous avons réalisé ce qui s’est réellement passé ».
Le rapport de l’unité a été diffusé aux plus hauts échelons du Ministère et du gouvernement.
M. Morrison décrit la chose en ces termes : « Le fait que l’avion ait été abattu a complètement changé la donne ». Une fois l’information confirmée, M. Morrison a rapidement reporté son attention sur l’intervention du Canada :
« En relativement peu de temps, le premier ministre a commencé à appeler nos alliés, tout particulièrement qu’il a appelé (le premier ministre néerlandais) Rutte pour obtenir des renseignements au sujet de la réponse néerlandaise à la tragédie du MH-17. Cette conversation a contribué à façonner le processus de réflexion du premier ministre Trudeau. M. Rutte avait mentionné à quel point l’incertitude avait été difficile pour les familles du MH-17; le premier ministre s’est donc concentré sur la manière d’éviter une longue période d’incertitude aux familles touchées par la tragédie du vol PS752.
Le premier ministre a décidé d’utiliser les voies diplomatiques pour lancer un message à l’Iran, soit que, dans l’intérêt des familles touchées, l’Iran devait cesser de nier la vérité. »
M. Morrison se souvient que le premier ministre a commencé à réfléchir à la manière dont il allait informer les Canadiens :
« Je pense qu’à partir de là, le premier ministre est passé directement à la préparation en vue d’une rencontre avec les médias. Je ne pense pas qu’il se soit écoulé beaucoup plus de deux ou trois heures entre le moment où le premier ministre a reçu l’information à propos de l’Iran et sa conférence de presse où il a informé les Canadiens. »
Après la conférence de presse du 9 janvier, David Morrison raconte que les choses ont évolué rapidement.
« Un peu plus de 24 heures plus tard, nous avons découvert que l’Iran tenait sa propre conférence de presse. Je pense que c’était vendredi soir que nous avons appris qu’une annonce iranienne était en cours de préparation, et peu après, l’incertitude était levée, car ils avaient admis avoir abattu l’avion. ».
La sous-greffière adjointe Blewett raconte :
« S’il y a un tournant qui est évident pour moi, c’est lorsque le premier ministre a confirmé que cet avion a été abattu. C’était plutôt surréaliste, car cela a beaucoup changé la nature de notre intervention. À un certain moment, nous réagissions dans le contexte d’un accident d’avion, nous faisions ce qu’un pays aurait fait dans ce genre de situation tout en étant attentif à cette partie du monde et aux tensions qui existent. Et pendant tout ce temps, l’Iran niait toute responsabilité. Mais lorsque notre premier ministre a confirmé que l’avion avait probablement été abattu, notre intervention a soudainement dû être complètement revue. C’est à ce moment que vous avez constaté que nous avons donné priorité à amener l’Iran à faire preuve de transparence et de responsabilité, et cela demeure une priorité. »
Équipe permanente de déploiement rapide en Iran : « Vers l’inconnu »
La sous-ministre Morgan raconte les difficultés inhérentes à réagir à cet accident :
« Nous savions que notre intervention allait être vraiment difficile, car nous n’avons pas de relations diplomatiques avec l’Iran. Donc, nous n’avions personne sur place pour offrir des services consulaires. Ne pas avoir de relations diplomatiques avec un pays rend très difficile la résolution des problèmes qui ont des incidences sur vos citoyens, surtout lorsqu’une urgence survient et que les Canadiens sont touchés. »
Le Canada a fermé son ambassade en Iran et a expulsé les diplomates iraniens d’Ottawa en 2012. À la suite de cette fermeture, le Canada a demandé à l’Italie d’être la puissance protectrice du Canada en Iran. À ce titre, l’Italie a accepté d’être la liaison diplomatique du Canada en Iran et de représenter les intérêts du Canada dans le pays. Mme Morgan décrit les appels qui ont été faits ce premier jour :
« Presque immédiatement, le ministre Champagne a communiqué avec son homologue italien, et j’ai fait de même avec le mien parce que nous savions que nous aurions besoin de leur aide. Nous devons une fière chandelle aux Italiens parce qu’ils ont travaillé jour et nuit pour que nous puissions fournir des services aux personnes en Iran. »
Comme le Canada n’a pas d’ambassade pour fournir des services, on a décidé de dépêcher à Téhéran l’équipe permanente de déploiement rapide (EPDP) d’Affaires mondiales Canada, d’abord en Turquie et ensuite en Iran (deux enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports se sont rendus aux mêmes destinations à la même période). Obtenir des visas pour ces diplomates canadiens pour qu’ils puissent entrer en Iran a été une tâche complexe; leurs premiers visas de courte durée ont fait l’objet de négociations, tout comme chaque prolongation de visa. M. Turner et de nombreux membres de son équipe sont montés à bord d’avions à destination de la Turquie avant même de savoir s’ils pourraient réellement se rendre en Iran.
Ryan Fortner, membre de l’équipe, décrit comment il a vécu son expérience en Iran :
« Nous avons procédé au contrôle des passeports, et les représentants iraniens ont discuté dans une arrière-salle, et nous sommes restés là pendant ce qui a semblé être un très long moment avant qu’ils nous laissent finalement passer. Les Italiens, qui étaient excellents, avaient proposé d’envoyer un chauffeur pour nous prendre à l’aéroport. Lorsque nous sommes sortis dans la salle des arrivées, le chauffeur était introuvable. Nous étions là, ces trois Canadiens à Téhéran, et nous avons commencé à penser : devrions-nous simplement sauter dans un taxi et nous diriger vers l’inconnu, mais heureusement pour nous, au moment où nous venions de décider de le faire, il est apparu. »
Sur le terrain : « Un moment que je n’oublierai jamais »
L’EPDP s’est chargé des communications continues avec les familles des victimes sur le terrain (celles qui résident en Iran et celles du Canada qui y étaient en visite), a rencontré les membres des familles et les a aidés lors de rencontres officielles (par exemple, le bureau du coroner), a coordonné les lettres de facilitation avec l’ambassade d’Italie et a obtenu des actes de décès et des documents d’exportation pour les dépouilles. Quand des membres des familles ont décidé de se rendre en Iran, les agents consulaires ont aidé bon nombre d’entre eux lors de leur retour au Canada, et l’ASFC a travaillé sans relâche en coulisse pour faciliter et accélérer les procédures d’arrivée.
François Shank s’est rendu en Iran avec l’équipe. Il raconte sa première rencontre avec les familles :
« Ma première rencontre avec une famille a rendu la tragédie encore plus réelle. Je ne pouvais m’empêcher de penser que ces personnes avaient fait montre d’une force et d’une résilience incroyables, même si je ne peux imaginer à quel point la situation avait pu être difficile. »
Andrew Turner, qui dirigeait l’équipe, se rappelle également ce qu’il a ressenti lorsqu’il parlait aux membres de la famille :
« Nous nous sentions privilégiés de recevoir autant de messages de la part de membres de la famille qui exprimaient leur bienveillance dans les pires circonstances imaginables. Il était important que nous puissions offrir du réconfort, même infime, en facilitant la résolution de problèmes immédiats avec lesquels les familles étaient aux prises. »
L’équipe a initialement été encouragée par l’apparente coopération de l’Iran, mais elle s’est rapidement heurtée à son premier obstacle de taille. M. Turner poursuit :
« L’Iran a déclaré que, de son point de vue, il n’y avait que quatre Canadiens à bord de l’appareilNote de bas de page 35. D’une manière ou d’une autre, nous étions là pour aider les familles des Canadiens et des résidents permanents. Notre stratégie consistait donc à leur faire savoir que nous n’allions pas manifester ouvertement notre désaccord sur les questions de citoyenneté, mais que nous étions là pour fournir des services à tous ceux qui avaient des liens avec le Canada. Nous leur avons expliqué que nos efforts seraient essentiellement guidés par les souhaits et les besoins des familles. Je pense que cette stratégie mais ferme nous a permis d’obtenir la coopération dont nous avions besoin de la part des autorités iraniennes. »
L’équipe a également eu l’occasion de se rendre sur le lieu de l’accident. Voici M. Turner qui décrit ce qu’il a ressenti :
« C’était vraiment difficile pour certains d’entre nous parce que nous avons visité le site de l’écrasement et vu les dégâts que l’avion avait causés. Cela nous a permis de mieux saisir l’ampleur sans commune mesure de la tragédie pour les familles. »
M. Shank parle aussi de la scène du lieu de l’écrasement :
« C’était incroyablement lugubre. On pouvait voir que l’avion s’est écrasé dans une cour d’école à environ 50 mètres de deux zones densément peuplées. Cela faisait penser à l’absurdité de cette tragédie. »
Soutien au Canada : « Je ne crois pas avoir rencontré des personnes plus gentilles »
Au lendemain de la tragédie, Affaires mondiales Canada a également dépêché pour la première fois des membres de l’EPDP dans certaines villes du Canada. En effet, des agents ont été dépêchés à Vancouver, à Edmonton, à Winnipeg, à Toronto et à Montréal pour apporter un soutien en personne aux familles. Brent Robson, directeur, Opérations d’urgence, décrit la séance d’information avec le ministre Champagne au cours de laquelle l’EPDP a pris en charge cette nouvelle mission :
« Je me souviens d’avoir rencontré le ministre Champagne pour discuter du déploiement de l’EPDP en Iran. Le ministre a demandé si nous pouvions également déployer nos gens au Canada, pour apporter un soutien direct aux familles. Nous avons expliqué que l’EPDP n’avait répondu à des crises que dans des contextes internationaux, mais il a insisté. Et je pense qu’en 12 heures, les agents étaient dans des avions en direction de certaines villes canadiennes. »
Ces derniers ont coordonné les arrangements auprès des salons funéraires (tant au Canada qu’en Iran) et ont travaillé avec l’ASFC, la GRC et les autorités aéroportuaires pour faciliter le rapatriement des dépouilles au Canada. En outre, des agents consulaires étaient présents à l’aéroport pour faciliter les treize rapatriements au Canada et protéger l’intimité des familles.
Au moment où l’on se préparait à soutenir les familles au Canada, l’ASFC a joué un rôle clé dans le rapatriement de la dépouille des victimes. Dans de nombreux cas, les agents de l’ASFC ont été le premier point de contact des membres des familles arrivant au Canada pour les aider à prendre les derniers arrangements. Mohsan Bokhari, chef des opérations de l’ASFC à l’aéroport international Pearson de Toronto, parle des efforts de ses collègues :
« Je suis très fier du travail que nous [ASFC, opérateurs d’entrepôt, personnel au sol et Affaires mondiales Canada] avons accompli sur le plan professionnel, mais surtout, je suis très heureux que nous ayons pu apporter notre soutien aux victimes de cette tragédie et à chaque membre des familles touchées. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c’est ce que mon équipe et moi allions vivre sur le plan personnel tout au long du processus. Les émotions évoluaient tout le temps. Pour ma part, même si l’arrivée de chaque vol était toujours difficile, l’un des moments les plus marquants a été lorsque nous avons rapatrié les restes d’un enfant auprès de sa famille. Je suis moi-même parent, et je n’oublierai jamais cette réunion. »
Cathy Rego faisait partie de l’équipe de l’EPDP qui s’est rendue à Toronto pour participer à l’intervention :
« J’ai appris que je partais le lendemain matin. Nous n’étions pas tout à fait sûrs de notre rôle jusqu’à notre arrivée, si ce n’est de mettre tout en œuvre pour aider les familles. »
David Lachance, directeur adjoint, Services de protection, est allé à Winnipeg pour aider les familles du Manitoba :
« Je n’avais pas beaucoup d’informations quand on m’a appelé, seulement que nous allions partir le lendemain pour installer un bureau et déterminerions comment nous pourrions aider les gens au fur et à mesure. »
Mme Rego et M. Lachance se rappellent très bien leurs interactions avec les membres des familles. Mme Rego :
« Je me souviens simplement de la gentillesse et de la générosité de ces familles, alors même qu’elles vivaient une perte inimaginable. C’était une expérience très difficile, et pourtant je ne pense pas avoir jamais rencontré de personnes plus gentilles que ces familles formidables. »
Rencontre avec l’Iran : « Ça semblait si dramatique et mystérieux »
En plus de faire étroitement concorder son action sur celle des autres pays en deuil, le Canada a lancé des discussions avec l’Iran à un niveau élevé pour souligner la nécessité d’enquêter de façon transparente sur l’accident, pour communiquer et défendre les souhaits des familles et pour demander un accès consulaire. Une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères est rapidement devenue possibilité dans le cadre de ces discussions.
Le Canada et l’Iran ont convenu qu’ils se réuniraient à Mascate, à Oman, Voici Peter MacDougall, sous-ministre adjoint à Affaires mondiales Canada, a voyagé avec le ministre Champagne :
« Avant le voyage, j’ai discuté pendant quelques jours de la logistique de la réunion avec un représentant iranien de façon presque informelle au moyen de l’application WhatsApp. Ces conversations ont été incroyablement dramatiques et secrètes au cours de la période qui a précédé la réunion, probablement parce qu’il s’agissait de notre première rencontre face à face avec l’Iran depuis de nombreuses années.
Nous avions déjà convenu de rencontrer les Iraniens avant de partir pour le Groupe de coordination à Londres, et nous avions pris l’avion de là pour Oman. Ce pays nous a beaucoup aidés et s’est chargé d’une bonne partie de l’organisation. Nous sommes allés voir le lieu de la réunion, ce qui n’a fait que renforcer le sentiment de mystère puisqu’elle se tenait dans un bâtiment isolé, situé dans une section privée de l’aéroport. »
M. MacDougall décrit cette réunion comme suit :
« Une fois la réunion commencée, il était saisissant de voir les différentes approches des deux ministres. Le ministre Champagne, qui revenait tout juste d’une veillée pour les victimes à Londres, était clairement motivé par les besoins des familles et profondément intéressé par les détails. »
Un ciel plus sûr : « Nous étions surpris que l’Iran n’ait pas fermé son espace aérien »
Dans les jours qui ont suivi l’accident, le sous-ministre Keenan et l’équipe canadienne se sont penchés sur les autres vols dans le ciel iranien ce jour-là :
« Nous étions tellement surpris que l’Iran n’ait pas fermé son espace aérien. Il semble qu’une demi-douzaine d’avions aient décollé après la frappe balistique iranienne [contre des bases en Iraq] et après l’écrasement du vol PS752. »
Cette prise de conscience est à l’origine d’un processus qui allait devenir la Stratégie sur la sécurité aérienne, conçue pour rassembler des partenaires motivés, afin d’établir un ensemble de pratiques communes pour protéger plus efficacement les passagers contre le risque de voler dans une zone de conflit étrangère ou à proximité d’une telle zoneNote de bas de page 36.
M. Keenan poursuit :
« Lorsque nous avons examiné le radar de vol de cette journée et que nous avons vu l’espace aérien au-dessus de l’Iran et de l’Iraq rempli d’avions civils, nous avons réalisé que le fait de laisser la décision de fermer l’espace aérien au-dessus des zones de conflit aux pays concernés ne donne presque jamais le résultat attendu. »
Le gouvernement a conclu rapidement que quelque chose devait être fait pour réparer cette erreur. Avant la mi-février, le premier ministre était en mesure d’annonce l’Initiative du Canada sur la sécurité aérienne à la Conférence de Munich sur la sécurité, qui vise à prévenir d’autres tragédies comme l’écrasement de vols MH-17 et PS752 (voir le chapitre 5).
Soutien continu : « Nous a préparés à l’opération suivante »
Le 17 janvier, le premier ministre Trudeau a annoncé la création d’un programme d’aide financière pour les familles. Samuel Moyer, directeur adjoint, Politiques et programmes consulaires, a coordonné la création de ce programme à Affaires mondiales Canada et a travaillé avec d’autres ministères pour le versement d’un paiement à titre gracieux aux familles de chaque victime canadienne et victime résidente permanente :
« Nous avons comparé les données entre Ethiopian Airlines et Ukrainian Airlines et avons constaté que les familles des victimes de l’écrasement du vol PS752 recevaient beaucoup moins de soutien de la part de la compagnie aérienne. Et nous n’avons pas d’ambassade en Iran pour fournir une aide consulaire sur place. Le sous-ministre nous a donc donné la directive de créer un programme de soutien le vendredi 10 janvier. Ce jour-là, nous avons élaboré un programme à partir de rien. »
Une contribution de 25 000 $ pour chaque victime en réponse aux circonstances spécifiques de l’accident pour alléger le fardeau des familles à la suite de cette tragédie. M. Moyer poursuit :
« Nous avons travaillé pendant la fin de semaine sur la première ébauche du programme et avons envoyé la version définitive à notre sous-ministre le mardi 14 janvier. Cette crise a entraîné un tel degré d’urgence que nous avons produit des instructions en temps réel, nous nous précipitions dans les bureaux pour discuter des versions des documents dès leur rédaction, car tout le monde reconnaissait la nécessité d’apporter ce soutien aux familles le plus rapidement possible. »
Un comité a immédiatement été formé pour évaluer les demandes des familles. Sarah Filotas, directrice adjointe des questions consulaires et de l’engagement consultaire international, parle de l’efficacité du travail de ce comité :
« Les membres se sont réunis tous les jours pour étudier les demandes et s’assurer qu’ils avaient le bon bénéficiaire. Le comité voulait s’assurer que la période entre la réception des demandes et le paiement soit la plus courte possible. »
La sous-ministre Morgan se réjouit de l’incidence durable de ce programme sur Affaires mondiales Canada :
« Les critères du programme de financement ont servi de base pour certaines des mesures que nous avons prises pour la COVID‑19, donc dans un certain sens, la terrible tragédie du vol PS752 nous a préparés au défi qui a suivi. »
La population a aussi répondu à l’appel. Peu après la catastrophe, l’homme d’affaires torontois Mohamad Fakih a lancé une collecte de fonds intitulée Canada Strong pour aider les familles des victimes. Le gouvernement du Canada a accepté d’égaler les contributions privées, jusqu’à un maximum de 1,5 million de dollars. L’offre du gouvernement a été pleinement utilisée. Environ trois millions de dollars ont été distribués aux familles par l’entremise de la Toronto Foundation, sous la direction de Barbara Hall.
Conclusion : « La volonté des Canadiens de faire tout ce qu’ils pouvaient »
Mme Morgan résume l’intervention de son ministère au fait que le vol PS752 ait été abattu :
« Affaires mondiales Canada, en tant que ministère, a une longue expérience des situations d’urgence, et nos systèmes sont réellement efficaces. Mais la tragédie du vol PS752 est hors du commun. Il y avait un énorme sentiment de perte, mais tout de suite, tous les employés du Ministère se sont retroussé les manches et se sont mis au travail pour venir en aide à ces familles extraordinaires. »
Lorsqu’on lui a demandé si un moment particulier dans la réponse l’avait marqué, Catrina Tapley a parlé des commémorations organisées à travers le Canada :
« Je me souviens du service commémoratif en Alberta et à quel point il était spécial. Et nous ne pleurions pas la perte d’étrangers, ou la perte de personnes à l’étranger, nous pleurions la perte de Canadiens. Ces services étaient percutants parce qu’ils parlaient de ce que chaque personne qui avait choisi de vivre au Canada apportait à nos communautés, à nos universités et à notre pays. Ce fut un moment très fort qui nous a permis de constater la chance que nous avons d’avoir des personnes parmi les meilleures et les plus brillantes du monde qui ont choisi de venir au Canada. »
Catherine Blewett parle également de ce que la tragédie signifie pour de nombreux fonctionnaires jouant un rôle dans l’intervention :
« J’aimerais que les gens puissent assister au travail qui se déroule en coulisse. Vous savez, nous avons eu des conversations très difficiles et tristes en parlant des familles, de la difficile réalité de la situation et de ce qui s’était passé. Notre intervention témoigne du professionnalisme exceptionnel dont la fonction publique sait faire preuve dans de telles situations; nous transformons ces moments difficiles en détermination et en énergie positive. Le système, nos sous-ministres et tous les autres membres de l’équipe ont travaillé d’arrache-pied. Cela a vraiment démontré la volonté des Canadiens de faire tout ce qu’ils pouvaient pour les familles. »
Chapitre 3
Chronologie des événements et des mesures prises
La chronologie qui suit présente un résumé des principaux faits relatifs à la réponse du gouvernement du Canada à la catastrophe du vol PS752. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des détails disponibles à ce jour. Les heures sont exprimées en HE (il est à noter qu’Ottawa a cinq heures de retard par rapport au temps universel coordonné ou TUC alors que Téhéran a trois heures et demie d’avance par rapport au TUC. Il y a donc un décalage de huit heures et demie entre Ottawa et Téhéran).
Le 2 janvier
- En raison des risques croissants dans la région, notamment des frappes aériennes en Iraq, Transports Canada commence à surveiller la sécurité aérienne au-dessus de l’Iraq et de l’Iran.
Le 3 janvier
- Transports Canada commence à communiquer régulièrement des informations sur les tensions dans la région à Air Canada, seul transporteur du Canada actif dans la région.
- Le premier ministre Trudeau est informé des tensions en Iran et en Iraq.
Le 5 janvier
- Transports Canada et Air Canada discutent d’itinéraires de rechange pour les avions qui survolent l’Iraq.
Le 6 janvier
- Le premier ministre est informé des tensions en Iran et en Iraq.
- Le premier ministre discute de la situation en Iran et en Iraq avec Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, et Charles Michel, président du Conseil européen.
Le 7 janvier
- Le premier ministre discute de la situation en Iran et en Iraq avec le roi Abdallah II de Jordanie et la chancelière allemande Angela Merkel.
- 17 h 30 (environ) – L’Iran commence à lancer des attaques aux missiles contre des positions américaines en Iraq.
- Transports Canada entre en contact avec Air Canada. À partir de ce moment, tous les vols d’Air Canada à destination et en provenance de Dubaï sont redirigés pour éviter qu’ils survolent l’Iraq.
- 21 h 42 – Le vol PS752 décolle de l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran.
- 21 h 44 – L’Iran tire le premier des deux missiles, ce qui cause la destruction de l’avion effectuant le vol PS752.
- 21 h 51 – L’agent de service de Transports Canada reçoit une CGOALERT concernant le vol PS752.
- 22 h 54 – Transports Canada transmet, à l’interne et à d’autres ministères, de l’information sur le vol PS752.
- 22 h 56 – Le Bureau du Conseil privé (BCP), Affaires mondiales Canada (AMC) et Sécurité publique Canada sont informés de l’écrasement.
- 23 h 55 – Transports Canada publie un communiqué indiquant qu’il suit de près la situation au Moyen-Orient et qu’il est en contact étroit avec la Federal Aviation Administration.
- Transports Canada avise le service de sécurité d’Air Canada de l’écrasement.
Le 8 janvier (nuit)
- Le BCP demande aux organismes de sécurité du Canada de fournir une évaluation de l’écrasement.
- Le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence (CSIU) d’AMC commence à se coordonner avec les ambassades du Canada à Kyiv et à Ankara pour obtenir la liste de passagers du vol PS752.
- Le CSIU informe le BCP dès réception de la liste de passagers du vol.
- Le CSIU commence à recevoir des appels des membres des familles de personnes à bord du vol PS752.
Le 8 janvier (matin)
- Transports Canada reçoit et analyse les données du vol PS752.
- Transports Canada publie un communiqué concernant le vol PS752 et entre de nouveau en contact avec Air Canada.
- La sous-greffière du Conseil privé convoque des sous-ministres et des hauts fonctionnaires pour coordonner la réponse du Canada. Le groupe se réunira régulièrement dans les semaines suivantes.
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
- AMC se coordonne avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour valider le liste de passagers et établir la situation des victimes ayant des liens avec le Canada.
- Le CSIU et les ambassades du Canada à Ankara et à Kyiv commencent à offrir des services consulaires d’urgence aux familles au Canada, en Iran et en Ukraine.
- Des agents de l’ASFC et les autorités aéroportuaires rencontrent les membres des familles qui attendent dans les aéroports au Canada et les informent de la catastrophe.
- Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada reçoit l’avis officiel concernant l’écrasement du vol PS752 du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation de la République islamique d’Iran (BEAA) et informe le BEAA de son intention de nommer un expert pour l’enquête de sécurité.
Le 8 janvier (après-midi et soir)
- Le premier ministre Trudeau tient un point de presse pour annoncer que, selon les premiers rapports, jusqu’à 63 Canadiens étaient à bord du vol PS752. Il présente les condoléances de la nation et demande qu’une enquête complète et sérieuse soit menée.
- Le premier ministre publie un communiqué concernant le vol PS752.
- Le premier ministre discute du vol PS752 avec le premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre australien Scott Morrison.
- AMC publie un communiqué concernant le vol PS752.
- Transports Canada, Aviation civile envoie une lettre à l’autorité de l’aviation civile ukrainienne pour lui offrir une assistance technique.
- Le BST propose son aide aux organismes iraniens et ukrainiens menant l’enquête.
- Les organismes de sécurité et l’unité d’évaluation d’AMC commencent à recevoir des informations selon lesquelles l’avion effectuant le vol PS752 pourrait avoir été abattu par des missiles iraniens. Des rapports sont rédigés à l’intention du premier ministre et des ministres.
Le 9 janvier (matin)
- Dès les premières heures, le ministre des Affaires étrangères, François‑Philippe Champagne, contacte le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, pour lui faire part des profondes préoccupations du Canada, notamment de la nécessité d’accorder aux responsables canadiens un accès rapide à l’Iran.
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation. Le premier ministre est avisé que le Canada dispose de renseignements provenant d’organismes nationaux et d’alliés selon lesquels le vol PS752 aurait été abattu par un missile sol-air iranien.
- Le premier ministre s’entretient au sujet du vol PS752 avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le président français Macron (de nouveau).
- La GRC commence à coordonner les notifications aux proches parents avec les services de police locaux.
- AMC continue à offrir des services consulaires aux familles des victimes 24 heures sur 24. Des services sont également fournis aux familles des victimes qui sont des résidents permanents du Canada.
Le 9 janvier (après-midi et soir)
- Le premier ministre Trudeau et le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan tiennent un point de presse pour annoncer que le Canada dispose de renseignements selon lesquels le vol PS752 aurait été abattu par un missile sol-air iranien.
- Le BST accepte une invitation du BEAA à se rendre sur le lieu de l’accident.
- AMC mobilise son Équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) en prévision d’un départ pour l’Iran.
- Le premier ministre Trudeau s’entretient au sujet du vol PS752 avec le premier ministre suédois Stefan Löfven.
- Le BST décide de dépêcher un expert désigné et un enquêteur supplémentaire en Iran, et publie un communiqué en guise de confirmation.
Le 10 janvier
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
- Le ministre Champagne s’entretient au sujet du vol PS752 avec ses homologues des États-Unis, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Turquie.
- Le Canada annonce la formation du Groupe international de coordination et d’intervention pour les familles des victimes du vol PS752 (Groupe de coordination), composé du Canada, de l’Ukraine, de la Suède, de l’Afghanistan et du Royaume-Uni.
- Le premier ministre s’entretient au sujet du vol PS752 avec le président ukrainien Zelenskyy (de nouveau) et le premier ministre japonais Shinzo Abe.
- Le premier ministre rencontre les familles des victimes du vol PS752 à Toronto.
- Transports Canada transmet aux exploitants aériens canadiens un avis leur conseillant d’éviter l’espace aérien de l’Iraq et de l’Iran.
- Les enquêteurs du BST, y compris l’expert désigné, quittent le Canada à destination de la Turquie. Le BST publie un communiqué en guise de confirmation et précise qu’il cherche à participer davantage à l’enquête de sécurité sur le vol PS752.
- Les membres de l’EPDR quittent le Canada et les ambassades à l’étranger à destination de la Turquie.
- L’EPDR est également déployée au Canada (Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto et Montréal) afin d’assurer la liaison avec les familles, les autres ministères et d’autres intervenants locaux.
- 23 h 45 – L’Iran admet avoir tiré les missiles qui ont provoqué l’écrasement de l’avion effectuant le vol PS752.
Le 11 janvier
- À la demande du premier ministre et du greffier du Conseil privé, le BCP convoque la première réunion quotidienne d’un groupe de travail des sous-ministres sur le vol PS752 afin de coordonner la réponse du Canada.
- IRCC annonce des mesures spéciales visant à résoudre les problèmes de déplacement et d’accès que subissent les membres des familles des victimes du vol PS752 qui sont des ressortissants étrangers.
- Le premier ministre discute de l’abattage du vol PS752, pour lequel l’Iran a reconnu sa responsabilité, directement avec le président iranien Hassan Rouhani.
- Le premier ministre organise un point de presse après que l’Iran eut reconnu sa responsabilité dans l’abattage du vol PS752.
- Les premiers membres chevronnés de l’EPDR arrivent en Iran.
- Le ministre Champagne organise un appel avec les cinq pays membres du Groupe de coordination. Ils disent s’attendre à une coopération entière de la part des autorités iraniennes, notamment en ce qui concerne la délivrance de visas, le rapatriement des dépouilles des victimes et la réalisation d’une enquête complète et sérieuse.
Le 12 janvier
- Le premier ministre assiste à une veillée funèbre pour les victimes du vol PS752 à Edmonton.
- Des représentants de Transports Canada, Aviation civile organisent la première téléconférence avec des représentants de l’aviation civile ukrainienne pour discuter de l’écrasement et de l’assistance technique que peut fournir le Canada.
Le 13 janvier
- Le premier ministre s’entretient de nouveau avec M. Löfven, premier ministre suédois.
- Le BST tient une conférence de presse pour préciser son rôle dans l’enquête de sécurité sur le vol PS752.
- Tard dans la soirée, les autres membres de l’EPDR arrivent en Iran, avec les enquêteurs du BST.
- Le ministre Champagne rencontre des familles de victimes à Vancouver.
Le 14 janvier
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
- Le premier ministre s’entretient de nouveau au sujet du vol PS752 avec le président ukrainien Zelenskyy, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, et le premier ministre iraquien Adel Abdul-Mahdi.
- Les représentants du BST rencontrent le BEAA pour discuter des aspects de l’enquête de sécurité et se rendent sur le lieu de l’écrasement.
- Des représentants de l’Équipe de sécurité nationale de la GRC arrivent à Kyiv pour travailler avec l’ambassade du Canada et leurs homologues ukrainiens sur une enquête conjointe.
- L’expert de Transports Canada, Aviation civile spécialisé en enquêtes sur les accidents arrive à l’ambassade du Canada à Kyiv pour fournir une expertise technique et assurer la liaison avec les représentants de l’aviation civile ukrainienne et d’Ukraine International Airlines.
- Le sous-ministre de Transports Canada envoie une lettre à son homologue iranien pour lui indiquer que le Canada s’attend une enquête rigoureuse, transparente et crédible.
- Le ministre Champagne rencontre des familles de victimes à Toronto.
Le 15 janvier
- Le ministre des Transports Marc Garneau et le secrétaire parlementaire Omar Alghabra organisent un point de presse pour informer les Canadiens au sujet du vol PS752.
- IRCC commence à accélérer les procédures relatives aux visas pour les familles des victimes.
- Le premier ministre s’entretient au sujet du vol PS752 avec le président afghan Mohammad Ashraf Ghani, le roi Abdullah II de Jordanie (de nouveau) et le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.
- Les enquêteurs du BST examinent une partie de l’épave de l’avion du vol PS752 à Téhéran.
- La GRC fait des appels de coordination quotidiens pour faciliter l’aide aux victimes en collaboration avec les services de police locaux.
- La GRC commence à fournir une assistance pour l’identification des dépouilles mortelles.
Le 16 janvier
- Le ministre Champagne organise la première réunion en personne des pays du Groupe de coordination à la Maison du Canada à Londres, au Royaume-Uni. Le Groupe de coordination convient d’un cadre pour traiter avec l’Iran afin d’assurer la responsabilité, la transparence et la justice pour les familles et les proches des victimes.
- Le Groupe de coordination crée également divers sous-comités chargés de l’aider à renforcer la coordination de son approche, y compris un sous-comité du droit international et de l’indemnisation.
- IRCC annonce de nouvelles mesures spéciales pour aider les membres des familles des victimes, notamment une assistance à ceux qui doivent se rendre en Iran, qui ont besoin de documents de voyage de toute urgence ou qui doivent rester temporairement au Canada.
- Le ministre d’IRCC, Marco E. L. Mendicino, approuve une politique publique d’exonération des frais pour les familles qui doivent venir au Canada pour assister à un service funèbre ou s’occuper d’affaires personnelles.
- IRCC crée une ligne téléphonique et une adresse électronique dédiées pour fournir une assistance aux familles.
Le 17 janvier
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
- Le premier ministre organise un point de presse pour faire le point sur le vol PS752.
- Reconnaissant les pressions financières extraordinaires auxquelles sont confrontées de nombreuses familles de victimes, le premier ministre annonce que le Canada versera la somme de 25 000 $ par victime aux familles composées de citoyens canadiens ou de résidents permanents pour les aider à acquitter leurs dépenses immédiates.
- Le premier ministre évoque également un certain nombre de mesures de soutien supplémentaires pour les familles, y compris des mesures mises en place par le secteur privé et grâce à la générosité des Canadiens.
- Pour aider les familles à s’y retrouver dans les questions juridiques, Justice Canada finance l’organisme Pro Bono Ontario, qui offre des conseils juridiques de base aux proches de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui ont perdu la vie à bord du vol PS752.
- Santé Canada crée une ligne d’assistance téléphonique gratuite et confidentielle, accessible jour et nuit, pour les familles ainsi que les personnes et les communautés touchées.
- Le ministre Champagne rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif à Mascate, en Oman, pour discuter du vol PS752, de la nécessité de mener une enquête rigoureuse et transparente et des obligations de l’Iran envers les familles endeuillées.
Le 18 janvier
- Le gouvernement du Canada crée un portail protégé par mot de passe accessible en tout temps pour les familles des victimes du vol PS752. Cet outil offre un accès complet à tous les renseignements pertinents, comme la manière d’obtenir des lettres de facilitation, des conseils en matière de deuil, des informations sur les voyages du Canada vers l’Iran ou de l’Iran vers le Canada, les visas et les passeports, et plus encore.
- Le premier ministre Trudeau, la vice-première ministre Freeland, le ministre Champagne et le secrétaire parlementaire Alghabra rencontrent les familles à Winnipeg.
- Une page Web de crise est créée pour centraliser les renseignements publics.
Le 19 janvier
- Le ministre Champagne organise un appel avec les pays du Groupe de coordination pour faire le point sur les travaux entrepris depuis la réunion du groupe, la semaine précédente.
- Le BST publie un communiqué pour faire le point sur le travail effectué par les enquêteurs du BST au cours de leur séjour de six jours en Iran, et réitère sa demande pour obtenir le statut de représentant accrédité dans l’enquête de sécurité entreprise.
Le 22 janvier
- Le secrétaire parlementaire Alghabra annonce que le gouvernement du Canada versera une somme égale aux dons du secteur privé amassés dans le cadre de la campagne « Canada Strong » pour aider les familles des victimes du vol PS752, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars. La campagne a été lancée par Mohamad Fakih, homme d’affaires de Toronto. La gestion des fonds sera assurée par la Toronto Fondation, sous la direction de Barbara Hall.
- Le premier ministre discute du vol PS752 avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan.
- Les enquêteurs du BST participent à une réunion en Ukraine avec leurs homologues d’Ukraine, d’Iran et de France.
Le 23 janvier
- Le BST publie un communiqué qui résume les activités d’enquête menées à ce jour, explique son rôle en vertu de l’annexe 13 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et décrit les prochaines étapes.
Le 25 janvier
- Les enquêteurs du BST rentrent au Canada. Les communications avec le BEAA iranien et les autres organismes internationaux de sécurité concernés se poursuivent régulièrement au cours des mois suivants.
Le 27 janvier
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
- Le ministre Champagne présente à la Chambre des communes une motion portant sur le vol PS752 qui est adoptée à l’unanimité (voir annexe C).
- Pro Bono Ontario commence à doter en personnel une ligne d’assistance pour permettre aux familles de parler gratuitement avec un avocat qui évaluera leurs besoins juridiques, leur fournira des conseils juridiques sommaires et une aide à la rédaction juridique, et les orientera vers des avocats bénévoles dans tout le Canada, le cas échéant.
Le 28 janvier
- Le ministre Champagne s’entretient à propos du vol PS752 avec le président d’Ukraine International Airlines, notamment sur l’état des enquêtes, la lecture des enregistreurs de bord et l’urgence d’indemniser les familles.
Le 29 janvier
- Le rapatriement de toutes les dépouilles au Canada est terminé.
- Le conseiller juridique d’AMC préside la première réunion du Sous-comité du droit international et de l’indemnisation du Groupe de coordination, qui a été créé pour faciliter le processus visant à tenir l’Iran responsable de ses actes au moyen de négociations sur l’indemnisation, en conformité avec le droit international. Le Sous-comité tiendra plus d’une douzaine de réunions jusqu’en novembre 2020.
Le 30 janvier
- Les membres de l’EPDR qui ont été déployés au Canada rentrent dans leur ville d’attache.
Le 31 janvier
- Les derniers membres de l’EPDR déployés en Iran rentrent chez eux.
- Les ministres Garneau et Champagne rencontrent Salvatore Sciacchitano, président du Conseil de l’OACI, afin d’encourager l’OACI à faire pression sur l’Iran pour qu’il respecte ses normes.
Le 1er février
- Transports Canada amorce les consultations internationales sur l’élaboration d’une stratégie visant à améliorer la sécurité aérienne au-dessus et à proximité des zones de conflit.
Le 3 février
- Le ministre Garneau s’entretient par téléphone au sujet du vol PS752 avec Mohammad Eslami, ministre iranien des Routes et du Développement urbain, et l’exhorte à remettre les enregistreurs de bord.
- Le ministre Champagne organise un appel avec les membres du Groupe de coordination pour qu’ils s’informent mutuellement de leurs processus de rapatriement respectifs et conviennent de la nécessité de maintenir la pression afin de garantir la responsabilité, la transparence et la justice pour les victimes.
Le 4 février
- Le premier ministre et les ministres reçoivent des informations sur la situation.
Le 5 février
- Le ministre Champagne s’entretient de nouveau au sujet du vol PS752 avec le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif, soulignant la nécessité d’une enquête approfondie, crédible et transparente.
Le 14 février
- Le premier ministre annonce la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada lors de la Conférence de Munich sur la sécurité pour améliorer la sécurité aérienne au-dessus et à proximité des zones de conflit et empêcher que des catastrophes comme celle du vol PS752 ne se reproduisent.
- Le ministre Champagne rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif à Munich pour faire pression en faveur de la responsabilité, de la transparence et de la justice pour les victimes de cette catastrophe, ce qui comprend la tenue d’une enquête approfondie, crédible et transparente.
Le 15 février
- Le ministre Champagne organise la deuxième réunion en personne du Groupe de coordination en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité.
Le 20 février
- La GRC et les Victim Services of York Region organisent une soirée de soutien pour réunir les familles des victimes de l’écrasement du vol PS752.
Le 26 février
- AMC met sur pied un groupe de travail à plein temps pour coordonner la réponse internationale et consulaire à l’abattage du vol PS752.
Le 4 mars
- Le ministre Champagne organise un appel du Groupe de coordination depuis Kyiv, en Ukraine, et discute notamment de la nécessité de faire télécharger et d’analyser les données des enregistreurs de bord sans délai.
Le 5 mars
- Le ministre Garneau prononce un discours lors du Sommet de l’aviation 2020 à Washington pour communiquer à l’industrie le plan de mise en œuvre de la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada en réponse à la tragédie du vol PS752.
Le 11 mars
- Le ministre Garneau présente la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada au Conseil de l’OACI et demande un effort concerté pour réduire les risques pour les vols à proximité ou au-dessus des zones de conflit. Le soutien envers la Stratégie est vigoureux.
- Dans un communiqué distinct, le ministre Garneau demande à l’Iran d’assurer la lecture des enregistreurs de bord sans tarder. L’Iran s’engage à faire lire les enregistreurs dans les 14 jours, mais ne tient pas ses promesses.
- Le groupe de travail d’AMC sur le vol PS752 organise son premier appel avec les familles des victimes.
Le 13 mars
- Le déploiement de la GRC en Ukraine est suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.
Le 30 mars
- Le ministre Champagne s’entretient au sujet du vol PS752 avec Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères.
Le 31 mars
- Le premier ministre annonce la nomination de l’honorable Ralph Goodale en tant que conseiller spécial chargé de la réponse continue du gouvernement du Canada à la tragédie du vol PS752.
Le 1er avril
- Tous les paiements fédéraux de soutien aux familles ont été effectués.
Le 14 avril
- Le ministre Champagne s’entretient au sujet du vol PS752 avec Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères.
Les 14 et 15 avril
- Le conseiller spécial Goodale s’entretient avec les familles des victimes du vol PS752. Au cours des mois suivants, plusieurs autres conversations ont lieu avec différents groupes de familles.
Le 15 avril
- Le ministre Champagne organise un appel du Groupe de coordination.
Le 16 avril
- Le ministre Champagne et le Groupe de coordination publient des communiqués marquant les 100 jours de la tragédie.
Le 15 mai
- Le ministre Champagne s’entretient au sujet du vol PS752 avec Mohammed Haneef Atmar, ministre afghan des Affaires étrangères.
Le 18 mai
- Le ministre Champagne s’entretient de nouveau au sujet du vol PS752 avec Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères.
Le 10 juin
- Le ministre Garneau fait le point pour le Conseil de l’OACI sur la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada et l’enquête sur l’abattage du vol PS752.
Le 17 juin
- Le ministre Garneau présente à la Chambre des communes une motion portant sur le vol PS752 qui est adoptée à l’unanimité (voir annexe C).
Le 22 juin
- Le ministre Champagne s’entretient au sujet du vol PS752 avec le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif, exhortant l’Iran à envoyer sans plus tarder les enregistreurs de bord du vol PS752 en France pour analyse.
Du 22 au 29 juin
- Le ministre Champagne s’entretient avec les familles des victimes du vol PS752.
Le 23 juin
- Le BST annonce qu’il a été invité par le BEAA à participer au téléchargement des données des enregistreurs qui aura finalement lieu au Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) de la France, à Paris, durant la semaine du 20 juillet 2020.
- Le BST déclare qu’il déploiera une équipe d’enquêteurs, dont un spécialiste des enregistreurs, qui prêtera main-forte dans le cadre de cette activité.
Le 26 juin
- Les ministres Champagne et Garneau publient un communiqué sur la décision de l’Iran d’envoyer les enregistreurs de bord du vol PS752 en France et réitèrent la nécessité de tenir une enquête approfondie, crédible et transparente qui répondra à toutes les questions pertinentes.
Le 2 juillet
- Le ministre Champagne organise un appel du Groupe de coordination afin d’établir officiellement une ligne de conduite commune pour tenir l’Iran responsable de ses actes.
- Les pays du Groupe de coordination signent un protocole d’accord sur la coopération concernant les négociations sur les indemnisations. Ils acceptent d’adopter une position commune de négociation qui ouvrira la voie à des négociations d’État à État avec l’Iran.
Le 11 juillet
- L’Iran publie le PS752 Accident Investigation – Factual Report. Le rapport ne fournit pas de preuves à l’appui et n’aborde aucune question globale, comme la décision de l’Iran de maintenir son espace aérien ouvert.
Le 14 juillet
- La présidente du BST envoie une lettre au BEAA pour demander l’autorisation de jouer un rôle plus actif dans l’enquête de sécurité et souligne l’importance de mener une enquête approfondie qui apportera des réponses expliquant la raison pour laquelle le vol PS752 a été abattu, la raison pour laquelle l’espace aérien iranien est resté ouvert et la raison pour laquelle les compagnies aériennes commerciales n’ont pas interrompu leurs vols.
Le 16 juillet
- Le BST organise une séance d’information technique pour les familles des victimes du vol PS752.
Les 18 et 19 juillet
- Les enquêteurs du BST, dont un spécialiste des enregistreurs, se rendent à Paris pour assister au téléchargement, longtemps retardé, des données des enregistreurs de bord du vol PS752.
Le 20 juillet
- Les enregistreurs de bord du vol PS752 sont livrés et lus à Paris, au BEA.
- Le Groupe de coordination publie un communiqué sur la livraison par l’Iran des enregistreurs de bord du vol PS752.
Le 23 juillet
- L’analyse préliminaire des données extraites des enregistreurs de bord est effectuée par l’Iran, avec les représentants accrédités et leurs conseillers (Ukraine, États-Unis et France). On informe d’abord les experts (Canada, Suède et Royaume-Uni) de ce qu’il en est, puis on leur permet de participer à certains volets de l’analyse des données de vol.
- Le BST publie un communiqué confirmant l’achèvement du téléchargement et de l’analyse préliminaire des données des enregistreurs de bord du vol PS752 et exhorte l’Iran à publier dès que possible les informations factuelles tirées des enregistreurs.
Le 30 juillet
- Des représentants du Groupe de coordination rencontrent une délégation de l’Iran pour discuter des modalités de négociation des indemnisations dues par l’Iran aux victimes du vol PS752 et aux États touchés.
Le 31 juillet
- La présidente du BST envoie une lettre au BEAA pour demander que son expert désigné ait la possibilité d’examiner l’ébauche du rapport d’enquête de sécurité définitif et d’y contribuer, comme le permet l’article 6.3 de l’annexe 13 de l’OACI.
Le 6 août
- AMC tient une séance d’information technique sur le cadre juridique international à l’intention des membres des familles des victimes du vol PS752.
Le 23 août
- Le BEAA publie un rapport sur les données des enregistreurs de bord.
- Les ministres Champagne et Garneau publient un communiqué concernant la publication du rapport de lecture de l’enregistreur de bord du vol PS752.
- Le BST publie un communiqué confirmant la réception du rapport de lecture des enregistreurs de bord et souligne de nouveau les trois principales questions auxquelles l’enquête de sécurité en cours devrait répondre.
Le 1er septembre
- La GRC prend contact avec les familles pour leur fournir des renseignements sur son rôle antérieur et actuel, et inviter les membres des familles à fournir des informations pour étayer les enquêtes.
Le 9 septembre
- Le premier ministre rencontre le conseiller spécial Goodale pour discuter du vol PS752, notamment des activités d’enquête essentielles, des questions d’immigration touchant certaines familles, des initiatives visant à honorer et à commémorer les victimes, de la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada et du rapport attendu du conseiller spécial.
Le 2 octobre
- Le ministre Champagne commence à faire le point mensuellement auprès des familles.
- Le ministre Champagne annonce la formation d’une équipe canadienne médico-légale d’examen et d’évaluation, recommandée par le conseiller spécial Goodale et dirigée par Jeff Yaworski, ancien directeur adjoint des opérations du Service canadien du renseignement de sécurité. L’équipe recueillera, classera et analysera toutes les informations, toutes les preuves et tous les éléments de renseignement disponibles sur la tragédie du vol PS752, et conseillera le gouvernement quant à leur crédibilité, à leur sens et à leur valeur probante.
Le 5 octobre
- L’Association des familles des victimes du vol PS752 organise un rassemblement public sur la colline du Parlement, en même temps que d’autres événements similaires dans plusieurs villes du Canada et du monde entier. Les ministres Champagne et Garneau, le conseiller spécial Goodale et l’ambassadeur d’Ukraine au Canada Andriy Shevchenko sont présents pour exprimer leur appui.
Le 7 octobre
- Le ministre Mendicino signe une politique publique visant à accorder des dispenses de frais aux familles qui sont venues au Canada pour assister à un service funèbre ou pour s’occuper d’affaires personnelles et qui sont toujours au Canada, certaines y étant bloquées en raison des restrictions de voyage relatives à la pandémie de COVID-19.
Le 27 octobre
- Le ministre Champagne organise un appel du Groupe de coordination.
Le 29 octobre
- La députée Heather McPherson (Edmonton Strathcona) présente à la Chambre des communes une motion portant sur le vol PS752 qui est adoptée à l’unanimité (voir annexe C).
Le 6 novembre
- Le ministre Garneau fait le point pour le Conseil de l’OACI concernant la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada, le prochain Forum sur la sécurité aérienne et les attentes du Canada en ce qui concerne le rapport d’enquête de l’Iran.
Et le travail se poursuit…
Chapitre 4
Leçons tirées et recommandations pour l’avenir
À l’approche du premier anniversaire de l’écrasement tragique du vol PS752, il reste encore beaucoup à faire avant d’obtenir la transparence, la responsabilité et la justice dont les familles ont besoin et qu’elles méritent. Le travail se poursuit.
Transports Canada dirige une initiative vigoureuse à l’échelle internationale pour continuer à tenir le trafic aérien civil éloigné des zones de conflit dangereuses et pour rehausser la crédibilité des enquêtes. Ces efforts sont décrits au chapitre 5.
Au Canada, une équipe médico-légale d’examen et d’évaluation recueille et analyse tous les éléments de preuve et renseignements disponibles afin de préparer la description la plus fiable de ce qui s’est produit et des raisons pour lesquelles cela s’est produit. Les commentaires des familles demeurent une importante source d’information et d’orientation.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) collabore avec les autorités ukrainiennes pour faire avancer une enquête criminelle de l’Ukraine sur l’abattage de l’avion qui effectuait le vol PS752, tout en luttant contre le harcèlement et l’ingérence étrangère au Canada. Le Service canadien du renseignement de sécurité contribuera, par son action de proximité auprès des communautés iraniennes de partout au pays, à renforcer la cohésion et la résilience à cet égard.
Le Bureau de la sécurité des transports est prêt à examiner et à commenter, de façon indépendante, le rapport d’enquête de sécurité définitif sur l’écrasement du vol PS752 de ses homologues iraniens lorsqu’il sera rendu disponible dans le cadre du processus international.
Une solide équipe d’experts juridiques, dirigée par Affaires mondiales Canada (AMC) et appuyée par tous les ministères pertinents, travaille sans relâche avec des collègues experts du Groupe international de coordination et d’intervention (le Groupe de coordination), composé du Canada, de l’Ukraine, de la Suède, de l’Afghanistan et du Royaume-Uni, afin d’obtenir une série complète de réparations de la part de l’Iran pour cette catastrophe aérienne tragique et son terrible bilan, dont il a reconnu la responsabilité.
Le Canada prendra également toutes les mesures appropriées en vertu des lois nationales et par l’entremise d’organisations et d’organismes internationaux pour rappeler au monde la tragédie du vol PS752, rendre hommage aux victimes, chercher des solutions et sécuriser le ciel pour l’aviation civile internationale.
Nous ne nous arrêterons pas tant que ces efforts n’auront pas abouti à des résultats concrets. Entre-temps, le gouvernement du Canada continuera de communiquer avec ceux qui pleurent la perte d’un être cher, de les écouter et d’apprendre d’eux. Ce sont les familles qui importent le plus.
Nous devons assimiler ce que la perte du vol PS752 nous a appris – ainsi que les leçons tirées de l’écrasement du vol 302 d’Ethiopian Airlines et de celui du vol 182 d’Air India – afin de compiler les meilleurs conseils possibles pour ceux qui auront à composer avec de futures catastrophes aériennes et d’autres catastrophes causant un grand nombre de victimes canadiennes.
Jusqu’ici, je recommande de porter une attention particulière à ce qui suit :
- Pour combattre la peur, l’incertitude et la désinformation, le gouvernement doit réagir rapidement et en amont. La première étape consiste à désigner un ministère et un ministre qui dirigeront l’ensemble des efforts du gouvernement du Canada (tâche que le premier ministre pourrait choisir d’assumer dans un premier temps) avec l’appui d’un groupe de travail dirigé par le BCP composé des sous-ministres pertinents, afin d’assurer une prise en charge et une coordination complètes, de haut niveau et pangouvernementales dans le but d’obtenir rapidement des résultats. Entre autres, le groupe de travail devrait être composé, au besoin, d’organismes centraux (pour obtenir les ressources adéquates), d’organismes d’application de la loi et d’organismes du milieu de la sécurité nationale (pour obtenir les renseignements les plus complets, pour sensibiliser au maximum la diaspora au Canada et pour tirer parti de toutes les possibilités de communication à l’étranger).
- Les besoins des familles des victimes – tels que ces dernières les perçoivent – doivent être au cœur de l’intervention du Canada. Cette intervention doit être rapide, complète et généreuse, et elle doit être façonnée par les réalités de la situation (qui seront différentes dans tous les cas) et les souhaits des familles.
- Lorsque des Canadiens perdent la vie dans des catastrophes faisant de nombreuses victimes à l’étranger, le Canada devrait immédiatement prendre la situation en main pour montrer qu’il a l’intention d’appuyer ses citoyens et résidents permanents et qu’il considère les pertes comme une tragédie canadienne (et non étrangère). L’approche globale doit être empreinte d’agilité, d’humilité et d’empathie et adaptée au traumatisme.
- Tous les faits pertinents doivent être recueillis de toute urgence – comme ce qu’a accompli AMC en travaillant avec ses sources diplomatiques pour obtenir la liste de passagers du vol PS752 lorsqu’il n’était pas facilement disponible, et ce qu’a effectué Transports Canada pour obtenir les données de vol, recueillies par satellite, afin de vérifier de façon indépendante la trajectoire et le comportement de l’appareil PS752.
- Des renseignements exacts et fiables doivent être communiqués aux familles le plus rapidement possible et de façon continue. Un manque d’information combiné à l’incertitude qui persiste aggrave l’angoisse. Le gouvernement du Canada doit parler d’une seule voix claire et unifiée et, au sein de chaque famille, une personne-ressource responsable des communications devrait être désignée, avec un remplaçant. Des compétences linguistiques autres que le français et l’anglais seront requises.
- Un engagement ferme et rapide auprès des familles est de toute évidence une pratique exemplaire à adopter. Cet engagement doit être maintenu et évoluer. Il doit être significatif et substantiel, et mettre l’accent sur ce que les familles demandent ou affirment, ainsi que sur ce que le gouvernement croit que les familles doivent savoir (y compris les renseignements sur le pays dans lequel la catastrophe s’est produite, les documents de voyage et les autres dispositions qui pourraient être nécessaires, ainsi que le régime juridique international qui devra être appliqué).
- Le gouvernement devrait préparer et constamment mettre à jour un manuel d’instructions évolutif sur les situations d’urgence, basé sur l’expérience pratique. Ce manuel devrait être prêt à l’emploi et remis rapidement à chaque membre des familles, qui y trouverait des renseignements généraux sur ce à quoi s’attendre à mesure que la situation évolue, les nombreuses questions qui devront être traitées ainsi que les services disponibles (tant publics que privés) et la façon d’y avoir accès. Une publication officielle de ce genre, envoyée immédiatement aux membres des familles, enverrait également le message qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent compter sur le gouvernement du Canada.
- En cas de catastrophe, le gouvernement devrait mettre sur pied le plus tôt possible un portail Web protégé par un mot de passe à l’intention des familles. Un tel portail permet aux familles d’obtenir les renseignements, services et conseils disponibles et de se tenir pleinement informées, de poser des questions, d’avoir des réponses et de régler leurs problèmes au moment qui leur convient le mieux.
- Des services de counseling en santé mentale et en stress post-traumatique seront presque certainement nécessaires. Le gouvernement devra mettre en place des mécanismes de disponibilité pour assurer un accès rapide à des professionnels qualifiés, dont les services pourraient être nécessaires à long terme. Dans les cas où un membre des familles touchées obtient de tels services par lui-même (par exemple en utilisant sa propre assurance) et que ces services arrivent à échéance, le gouvernement devrait envisager la façon d’étendre cette couverture pour qu’il puisse consulter encore un conseiller qu’il connaît.
- Le gouvernement du Canada devrait être prêt à fournir des « lettres de facilitation » au lieu des actes de décès et maintenir un engagement continu avec les intervenants nationaux, y compris les provinces, les territoires, les municipalités, les compagnies d’assurance, les banques et d’autres entités qui pourraient avoir besoin de ces lettres (pour faciliter les choses).
- Dans des cas exceptionnels, le gouvernement devrait tenir compte rapidement de la nécessité d’une dispense des frais pour les services gouvernementaux, d’une aide financière d’urgence immédiate, d’un soutien concernant l’accès à des conseils juridiques gratuitsNote de bas de page 37, de la mise en place d’équipes de déploiement rapide à l’étranger et au pays, et de la disponibilité des services consulaires à d’autres personnes en plus des citoyens.
- Dans les cas où d’autres pays subissent des pertes en même temps que le Canada, il serait prudent d’établir rapidement un front commun entre les pays de même sensibilité pour déterminer les recours internationaux les plus appropriés. On doit miser sur la force de travailler ensemble. Le Groupe de coordination formé par AMC constitue un bon modèle, et la création d’un tel groupe est une pratique exemplaire.
- Un engagement rapide et de haut niveau avec le pays où la catastrophe a eu lieu est également une pratique exemplaire, même si ce pays n’est pas nécessairement un ami ou un partenaire de confiance. Il est souhaitable d’établir un contact direct, mais il faut procéder avec la plus grande prudence. Il est également sage de profiter des conseils d’autres pays qui ont récemment vécu des catastrophes semblables; comme ceux généreusement fournis par les Pays-Bas au sujet du vol MH017 de la Malaysia Airlines, abattu en 2014.
- Les familles des victimes voudront savoir exactement ce qui a causé la catastrophe, qui en est responsable et comment les personnes impliquées seront tenues responsables. Les processus pertinents doivent être clairement expliqués dès le début, y compris leurs limites – par exemple, la différence entre une enquête de sécurité indépendante dans le cadre de laquelle le blâme n’est jeté sur personne (en vertu de l’annexe 13 de l’Organisation de l’aviation civile internationale) et d’autres types d’enquêtes civiles et criminelles. Pour aider les enquêteurs et les avocats du gouvernement qui se pencheront sur ces questions, il serait judicieux de consulter les familles et d’obtenir leurs commentaires afin de s’assurer qu’elles sont entendues, qu’elles ont la possibilité de divulguer toute source d’information à laquelle elles peuvent avoir accès et qu’elles comprennent les étapes à venir.
- En cas de doute sur l’indépendance, la transparence, l’impartialité ou l’efficacité des enquêtes menées par d’autres parties lors d’une catastrophe, le gouvernement devrait envisager rapidement la création d’un instrument d’enquête canadien semblable à l’Équipe médico-légale d’examen et d’évaluation pour s’assurer que le Canada a la capacité d’effectuer sa propre analyse des événements – comme s’y attendent les familles.
- Les ministères qui sont susceptibles d’avoir de multiples questions à traiter – comme Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en ce qui concerne les visas, les voyages, la citoyenneté et bien d’autres questions de la part de nombreux membres des familles – devraient se référer au modèle utilisé par IRCC lors de l’écrasement du vol PS752. IRCC a mis en place des canaux exclusifs de soutien à la clientèle accessibles sept jours sur sept et par lesquels des services multilingues (anglais, français et farsi) étaient offerts concernant des questions précises. Il s’agit d’une pratique exemplaire qui contribue à l’obtention rapide de résultats cohérents.
- L’Association canadienne des chefs de police a proposé la création d’un centre d’expertise national pour aider les ordres de gouvernement, les organismes d’application de la loi et le secteur privé à développer et à coordonner leur capacité à se préparer à des événements qui font de nombreuses victimes canadiennes. Il s’agit d’une idée pratique qui pourrait être mise en œuvre par Sécurité publique Canada en collaboration avec les ministères et organismes fédéraux et d’autres partenaires qui ont participé à l’intervention à la suite de l’écrasement du vol PS752. La GRC a déjà pris des mesures en ce sens.
Les États-Unis et l’Union européenne disposent de systèmes d’aide aux victimes consolidés. Il serait judicieux d’inclure l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels dans la discussion. Le centre d’expertise pourrait notamment aider à déterminer le meilleur réseau d’intervenants qualifiés et les façons de les contacter et de les mobiliser. Il pourrait évaluer les plans d’intervention d’urgence que l’on utilise déjà pour gérer des situations d’urgence comme des incendies de forêt, des inondations, des attentats terroristes, des urgences sanitaires et des situations internationales, et déterminer les améliorations nécessaires ou les possibilités de renforcement mutuel. Il pourrait faire des recherches sur les pratiques exemplaires, y compris sur la façon de tester et de répéter à l’avance les plans d’intervention. Il pourrait se charger de la préparation d’un manuel d’instructions en situation d’urgence évolutif et créer les meilleurs portails Web possible pour assurer une communication continue avec les familles. Il pourrait également évaluer l’intérêt d’avoir des programmes permanents en place pour offrir une aide financière, juridique et psychologique ainsi que d’autres types d’assistance aux familles des victimes, selon les circonstances.
Chapitre 5
Travailler pour la sécurité aérienne et des enquêtes plus crédibles
Il est répréhensible de permettre des vols d’aéronefs civils avec des passagers innocents à bord au-dessus ou à proximité de zones de conflit sans se doter de systèmes pour veiller à ce qu’ils ne soient jamais attaqués. Pourtant, les zones de conflit dans le monde continuent de présenter des dangers évidents pour la sécurité des voyageurs et le système d’aviation international. La tragédie du vol PS752 – à peine cinq ans et demi après la perte du vol MH017 – montre que ce problème est bien réel.
Comment pouvons-nous renforcer la qualité et la crédibilité des enquêtes de sécurité aérienne après l’abattage d’un avion commercial? Et comment pouvons-nous mieux prévenir ces épouvantables catastrophes?
Enquêtes plus crédibles
Il faut rappeler que dans le cas de l’immense majorité des enquêtes de sécurité aérienne, l’actuel système international à base de règles fonctionne bien et sert les fins prévues : faire la lumière sur ce qui s’est passé et améliorer la sécurité aérienne. Cela dit, dans des circonstances semblables à celles de la catastrophe du vol PS752 – lorsque l’activité militaire est la cause – l’expérience fait ressortir plusieurs problèmes graves. Enquêter sur un écrasement consécutif à une défaillance mécanique, un vice de conception, des intempéries, une erreur de pilotage, entre autres, ne revient pas enquêter sur un cas d’appareil abattu par l’armée. Le système actuel n’est pas adapté pour prendre en charge ce dernier cas.
Tout d’abord, les normes et procédures internationales actuelles attribuent les principales responsabilités liées à l’enquête au pays dans lequel la catastrophe se produit. Dans le cas d’un avion abattu par l’armée, ça signifie que le même gouvernement associé à la survenance de la catastrophe (l’Iran en l’occurrence) a la pleine maîtrise de l’enquête sur la sécurité, malgré les conflits d’intérêts évidents, avec peu de garanties d’assurer l’indépendance, l’impartialité ou légitimité. Cette situation mine la crédibilité de l’enquête et crée un sentiment d’impunité en ne répondant pas aux questions essentielles. L’aptitude de la communauté internationale à appliquer des mesures efficaces pour empêcher des catastrophes semblables est donc compromise.
Deuxièmement, bien que les normes internationales laissent entendre que des éléments essentiels de preuve (comme les données de vol et les enregistreurs de conversations du poste de pilotage) devraient être téléchargés et analysés « sans délai », aucun délai ferme n’est précisé. Ces preuves sont essentielles pour aider les enquêteurs à comprendre ce qui s’est passé. Plus les preuves sont accessibles rapidement, mieux c’est. Après l’écrasement du vol PS752, l’Iran disposait d’au moins neuf semaines pour faire le nécessaire pour lire le contenu des enregistreurs, avant l’imposition des restrictions mondiales sur les déplacements en raison de la pandémie de COVID-19. Or, l’Iran ne l’a pas fait, ce qui a occasionné plus de six mois de retard avant que des preuves importantes soient accessiblesNote de bas de page 38
Troisièmement, les procédures internationales en vigueur reconnaissent l’importance de l’État dans lequel l’écrasement se produit, et des États dans lesquels l’aéronef est immatriculé et où se trouvent l’exploitant aérien, les concepteurs et les constructeurs, mais les États qui comptent de nombreux citoyens tués ou blessés ont le statut garanti d’« expert » uniquement. Cet arrangement semble insensible et abusif. Dans les cas d’un avion abattu par l’armée, il semble que ce soit encore plus vrai.
Il n’est certainement pas facile de corriger ces arrangements pour remédier plus convenablement à des situations comme celle du vol PS752. La modification de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago) ou même de ses annexes est un processus long et compliqué auquel certains pays s’opposeront sans doute, et les questions en cause ne sont pas banales. Cependant, le Canada devrait élaborer une série de propositions sensées pour améliorer les protocoles et les procédures d’enquête, applicables spécifiquement à des situations d’abattage d’avion, et s’efforcer de les mettre en œuvre en concertation avec nos alliés – afin de créer une plus grande probabilité que la vérité puisse être établie et que les tragédies futures puissent être évitées.
Deux tragédies gigantesques en moins de six ans
Après que le vol 17 de la Malaysia Airlines (MH017) eut été abattu en juillet 2014 au-dessus de la frontière orientale de l’Ukraine avec la Russie, l’Ukraine a rapidement délégué aux Pays-Bas ses responsabilités principales en matière d’enquête. Au-delà de la recherche de la vérité sur ce qui s’est passé, les Néerlandais se sont également penchés sur la façon d’améliorer les normes de sécurité aérienne pour les vols civils au-dessus ou à proximité des zones de conflit. Grâce en grande partie au leadership de ces derniers, la communauté internationale de l’aviation civile a fait d’importants progrès – 11 recommandations ont été formulées concernant une meilleure gestion de l’espace aérien, l’évaluation des risques et la responsabilisation des exploitants aériens. Les Pays-Bas ont fait tout ce qu’ils ont pu pour tracer la voie à suivre en vue de provoquer le changement; ils ont également révélé les difficultés qui font obstacle. Aussi, la destruction de l’appareil du vol PS752 au début de 2020 a montré qu’il reste encore beaucoup à faire pour intégrer fermement des normes internationales plus efficaces dans les activités mondiales de l’aviation, et la coordination entre l’aviation civile et les opérations militaires nécessite encore une attention particulière.
Il s’agit d’un problème mondial, et les États, les associations internationales, l’industrie et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) doivent collaborer plus efficacement pour éviter d’autres tragédies. C’est l’objectif de la Stratégie sur la sécurité aérienne du Canada, lancée au lendemain de la tragédie du vol PS752, faisant état de l’engagement du Canada envers la sécurité aérienne mondiale, les familles touchées et la communauté internationale en général.
Zones de conflit
Il existe un risque constant lorsque les trajectoires de vol des aéronefs civils s’approchent de l’espace aérien de pays en conflit ou le survolent. Les parties à ce conflit, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, ont des systèmes antiaériens de plus en plus sophistiqués, sans nécessairement avoir des mécanismes et des pratiques de sécurité intégrée tout aussi sophistiqués pour protéger les innocents.
La catastrophe du vol PS752 illustre les risques inhérents à la gestion d’espaces aériens en périodes de conflit et de tension accrue, et les conséquences tragiques qui peuvent en découler à l’échelle mondiale. Les systèmes d’alerte ont échoué, n’existaient pas ou n’ont jamais été activés en raison de considérations commerciales excessives ou du secret militaire ou étatique, de l’insouciance ou de l’incompétence. Le système actuel dépend entièrement des pays en conflit pour fermer ou restreindre l’accès à leur espace aérien, mais propose peu de normes pour guider cette prise de décisions. La mise en œuvre de changements majeurs s’est révélée difficile, surtout lorsqu’ils touchent les intérêts commerciaux ou concurrentiels des exploitants aériens et des fournisseurs de services de navigation aérienne responsables de la gestion de l’espace aérien.
Attributions actuelles
L’OACI est un organisme spécialisé des Nations Unies qui collabore avec 193 États membres pour faciliter et maintenir le transport aérien civil mondial. L’organisme s’acquitte de son mandat en adoptant des normes et des pratiques recommandées concernant la navigation aérienne (annexes de l’OACI), en prévenant l’ingérence illégale et en facilitant les procédures de passage de la frontière pour l’aviation civile internationale. L’OACI définit également les protocoles relatifs aux enquêtes sur les accidents aériens que doivent suivre les autorités de la sécurité des transports dans les pays signataires de la Convention de Chicago.
Les normes internationales contenues dans les annexes de l’OACI ne remplacent jamais la primauté des lois nationales ou des exigences réglementaires. L’OACI n’a aucun pouvoir sur les décisions des gouvernements nationaux – elle n’est pas un organisme de réglementation de l’aviation internationale. L’OACI ne peut pas, par exemple, fermer ou restreindre arbitrairement l’espace aérien d’un pays, fermer des itinéraires ou pénaliser les aéroports ou les compagnies aériennes en raison de leurs piètres résultats en matière de sécurité. Au lieu de cela, pour favoriser le respect des normes internationales, l’OACI dispose d’un système de vérification et de surveillance continues des résultats des États membres en matière de sécurité aérienne.
L’État membre gère son espace aérien comme il l’entend. La saine gestion de cet espace suppose un engagement explicite d’assurer la sécurité des vols et de s’abstenir d’utiliser des armes contre des vols d’aéronefs civils. Cela suppose également de communiquer rapidement les risques auxquels font face les opérations de l’aviation civile sur son territoire, y compris ceux liés aux activités militaires. Dans les situations où une activité militaire peut survenir, l’annexe 11 de l’OACI ordonne aux autorités responsables des services de navigation aérienne de travailler en étroite collaboration avec les autorités militaires responsables. Dans l’annexe, on demande aux fournisseurs de services de circulation aérienne civils et militaires de conclure des accords pour l’échange immédiat de renseignements afin de limiter les conséquences des activités dangereuses.
En cas de conflit armé (ou de risque d’un conflit armé), l’autorité responsable des services de la circulation aérienne devrait déterminer la zone géographique de conflit, évaluer les dangers réels ou potentiels pour l’aviation civile, et décider si l’exploitation d’aéronefs civils doit être évitée dans cette zone, ou pourrait être autorisée à continuer dans certaines conditionsNote de bas de page 39. Elle devrait publier un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) internationaux contenant les renseignements, les recommandations et les mesures de sécurité nécessaires.
Les normes de l’OACI exigent également que les États informent leurs propres exploitants aériens en temps utile des risques à la sécurité aérienne – dans leur propre espace aérien et dans l’espace aérien étranger. Certains États, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, peuvent interdire aux exploitants aériens nationaux (à qui ils ont délivré un permis ou un certificat) de voler dans l’espace aérien d’un autre pays ou d’imposer une restriction sur l’espace aérien étranger.
Une modification récente apportée à l’annexe 6 de l’OACI, à la suite d’une recommandation du Dutch Safety Board (le Bureau de la sécurité des Pays-Bas), comprend l’exigence d’effectuer une évaluation des risques et de prendre les mesures d’atténuation des risques appropriées pour assurer un vol sûr et sécuritaire lorsqu’on survole une zone de conflit. La version précédente de cette exigence n’était pas propre aux zones de conflit, mais plus générale à tous les aspects de la sécurité d’un vol.
Malgré les risques probables pour l’aviation civile, les États qui ont des zones de conflit ne ferment pas ou ne restreignent pas toujours leur espace aérien, et les États où l’exploitant aérien est basé ne publient pas toujours des avis, des restrictions ou des interdictions pertinentes. Il y a un certain nombre de raisons à cela, par exemple, la perte de services de navigation aérienne à la suite d’une attaque, le manque d’information et de renseignements pertinents, l’apparition soudaine d’un conflit ainsi que le désir d’un État de garder secrets les renseignements militaires et des considérations commerciales (qui peuvent être considérables dans certains cas). Dans ces circonstances, c’est l’exploitant aérien qui décide d’utiliser ou non cet espace aérien, et il est donc essentiel que les exploitants aériens reçoivent les renseignements les plus à jour sur l’espace aérien mondial.
Il est triste de constater que les normes internationales de gestion de l’espace aérien ne sont pas appliquées de façon uniforme et égale par tous les États membres de l’OACI. Malgré les améliorations récentes apportées aux annexes de l’OACI et aux normes internationales relatives aux zones de conflit, il reste encore beaucoup de travail à faire du côté de la concertation et de la mise en œuvre, pour lesquels les capacités d’application de l’OACI sont limitées. Il faut donc prendre des mesures parallèles, indépendantes de l’OACI, auxquelles participent de nombreux intervenants étatiques et non étatiques de l’industrie de l’aviation civile.
C’est dans ce contexte que le Canada a créé sa Stratégie sur la sécurité aérienne. Le premier ministre Trudeau en a fait l’annonce à la Conférence de Munich sur la sécurité le 14 février 2020 pour réunir une coalition d’États de même sensibilité et d’associations de l’aviation civile privée afin d’atteindre trois objectifs clés :
- échanger de l’information sur l’aviation civile et les activités militaires;
- mieux faire connaître les normes internationales;
- prendre immédiatement des mesures coordonnées lorsque les membres de la coalition agissent collectivement dans la mesure du possible pour protéger l’aviation civile autour des zones de conflit en fermant l’espace aérien étranger comportant des risques liés aux conflits pour tous leurs exploitants aériens.
Document de travail sur la Stratégie sur la sécurité aérienne présenté au Conseil de l’OACI
À la 219e session du Conseil de l’OACI à Montréal, le 11 mars 2020, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a présenté un document de travail demandant à l’OACI d’analyser ce qui a été fait pour améliorer la sécurité aérienne dans les zones de conflit au cours des dernières années, ainsi que le travail qui reste à faire pour que les normes et les pratiques internationales soient aussi bonnes que possible. Dans le document de travail on a également souligné les limites inhérentes à ces normes et pratiques, et proposé la Stratégie sur la sécurité aérienne comme initiative parallèle nécessaire. Il a reçu l’appui unanime des 36 membres du Conseil.
Les progrès à ce jour de la Stratégie sur la sécurité aérienne
Cette stratégie a pour grand objectif que les pays de même sensibilité adoptent une approche commune pour mieux protéger les aéronefs civils commerciaux en interdisant les vols de leurs propres exploitants aériens dans les espaces aériens étrangers dangereux et à proximité.
Malgré la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a mis sur pied, au moyen de réunions virtuelles et de conférences téléphoniques, les éléments clés suivants de la Stratégie sur la sécurité aérienne :
- Le Bureau d’information sur les zones de conflit : Ce bureau a commencé à surveiller l’information sur l’espace aérien mondial en ce qui touche les conflits civils et militaires dans le monde. Le Bureau recueille, surveille et analyse aussi des renseignements classifiés afin de prendre des décisions sur les restrictions et les avertissements relatifs à l’espace aérien et d’informer les exploitants aériens des problèmes potentiels dans l’espace aérien découlant de conflits. Ces renseignements sont transmis à des partenaires étrangers de confiance. Une fois pleinement opérationnel, le Bureau d’information sur les zones de conflit fera du Canada un chef de file mondial et un collaborateur principal à l’OACI et à d’autres forums internationaux voués à l’amélioration de l’atténuation des risques dans les zones de conflit.
- Le Comité consultatif sur la sécurité aérienne : Composé d’experts en la matière provenant d’États clés, de l’industrie privée et d’organisations internationales, ce Comité joue le rôle de plateforme mondiale prééminente pour consolider les discussions sur les questions liées aux zones de conflit. Il plaide également auprès de l’OACI en faveur de mesures de sécurité plus strictes en ce qui concerne les zones de conflit. Des pays comme l’Australie, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis y participent, de même que l’Association du transport aérien internationale (IATA) et le Groupe d’experts sur l’information sur les risques dans les zones de survol conflictuelles.
- Un forum international annuel sur la sécurité aérienne : Ce forum réunira chaque année des États, des organisations internationales et des représentants de l’industrie afin d’offrir une tribune où faire part des pratiques exemplaires en matière d’atténuation des risques dans les zones de conflit, le renforcement du consensus mondial et la promotion du renforcement des capacités avec des partenaires internationaux.
Ces composantes essentielles de la Stratégie sur la sécurité aérienne aideront à sécuriser l’aviation civile internationale. Sur la base de renseignements fiables, les pays de même sensibilité pourront conclure des accords entre eux et avec d’autres pays en vue d’échanger des renseignements et d’agir, d’interdire les vols commerciaux dans les espaces aériens étrangers dangereux ou à proximité. En dépit de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur le secteur de l’aviation, l’initiative progresse bien, malgré un échéancier serré.
Afin de promouvoir la sécurité aérienne et de contribuer à honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à bord du vol PS752, il est fortement recommandé que le Canada continue de poursuivre vigoureusement cette initiative.
Annexe A
Renseignements généraux sur les catastrophes dans le cadre desquelles des avions civils ont été abattus
(Données compilées par Transports Canada : les trois premiers cas pourraient être les plus pertinents à des fins de comparaison. Les autres sont inclus afin de brosser un portrait plus complet.)
Vol 655 d’Iran Air
Résumé
Le vol 655 d’Iran Air, vol de passagers régulier reliant Téhéran à Dubaï via Bandar Abbas (Iran), a été abattu le 3 juillet 1988 par un missile sol-air tiré par un navire militaire américain, le USS Vincennes. L’avion, un Airbus A300, a été détruit et les 290 personnes se trouvant à bord ont été tuées. L’avion à réaction a été touché en plein vol au-dessus des eaux territoriales iraniennes, dans le golfe Persique, alors qu’il suivait sa trajectoire de vol habituelle, peu après son départ de l’aéroport international de Bandar Abbas, lieu de son escale.
Principales considérations
- L’accident s’est produit pendant les derniers moments de la guerre entre l’Iran et l’Iraq.
- Le USS Vincennes était entré dans les eaux territoriales iraniennes après que l’un de ses hélicoptères eut essuyé des tirs d’avertissement provenant de vedettes iraniennes opérant dans les limites territoriales du pays.
- Selon les États-Unis, l’équipage du Vincennes avait malencontreusement pris l’Airbus pour un avion de chasse F‑14 Tomcat venu pour déclencher une attaque. Les Iraniens ont rejeté cette conclusion et plutôt soutenu qu’il s’agissait de négligence.
- Dans les jours qui ont immédiatement suivi l’accident, le président américain, Ronald Reagan, a fait parvenir au gouvernement iranien une note diplomatique écrite exprimant ses plus profonds regrets. Toutefois, les États-Unis ont continué de soutenir que le Vincennes avait agi en légitime défense dans les eaux internationales.
Résultat
- En novembre 1988, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié son rapport d’enquête sur les faits entourant l’accident : Airbus A300B2, EP-IBU, accident in the vicinity of Qeshm Island, Islamic Republic of Iran on 3 July 1988Note de bas de page 40.
- En août 1988, une enquête militaire sur l’accident a été menée par les États-Unis et présentée dans un rapport final rédigé par l’amiral William Fogarty, intitulé Formal Investigation into the Circumstances Surrounding the Downing of Iran Air Flight 655 on 3 July 1988Note de bas de page 41.
- Refusant l’offre d’indemnisation à titre gracieux des États-Unis, l’Iran a amené la cause devant la Cour internationale de Justice (CIJ). En 1996, soit plus de huit ans après l’accident, les gouvernements américains et iraniens ont conclu un accord. Cet accord prévoyait le versement de 61 millions de dollars aux familles des victimes iraniennes, sans autre aveu de responsabilité civile ou forme officielle d’excuse à l’intention de l’Iran.
Vol 007 de Korean Air Lines
Résumé
Le vol 007 de Korean Air Lines (KAL007), vol de passagers régulier reliant New York à Séoul via Anchorage, a été abattu le 1er septembre 1983 par un avion militaire soviétique. Entre Anchorage et Séoul, le Boeing 747 qui assurait le vol KAL007 a dévié de sa trajectoire initialement prévue en raison d’une erreur de navigation du personnel d’équipage et a traversé l’espace aérien soviétique interdit, où il a été abattu. Les 269 passagers et membres d’équipage ont été tués.
L’Union soviétique a d’abord nié toute connaissance de l’accident, mais a pourtant admis, six jours plus tard, avoir abattu l’avion en prétextant qu’il était en mission d’espionnage. Les Soviétiques ont toutefois continué de nier savoir où se trouvait l’épave du vol KAL007.
Il a plus tard été révélé que les Soviétiques avaient localisé l’épave le 15 septembre 1983, et découvert les enregistreurs de bord un peu plus tard, en octobre de la même année. Ces renseignements ont été gardés secrets jusqu’en 1993, soit après la dissolution de l’Union soviétique.
Principales considérations
- L’accident s’est produit pendant la Guerre froide, à un moment où les relations étaient extrêmement tendues entre les Américains et les Soviétiques. Le vol KAL007 a pénétré dans l’espace aérien soviétique à peu près au moment où se déroulait une mission de reconnaissance aérienne des États-Unis. Les Forces aériennes soviétiques ont ainsi traité l’avion comme un avion-espion des Américains et l’ont détruit après avoir tiré des coups de semonce que les pilotes du Boeing n’ont probablement pas aperçus.
- Puisque l’avion avait décollé du sol américain et que des citoyens américains étaient décédés dans l’accident, c’est le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) qui devait légalement mener l’enquête. Toutefois, le département d’État des États-Unis a clos l’enquête du NTSB au motif qu’il ne s’agissait pas d’un accident et a plutôt exigé une enquête de l’OACI.
Résultat
- Dans le cadre de son enquête, l’OACI ne disposait pas de l’autorité voulue pour exiger que les États impliqués lui remettent leurs preuves et a ainsi dû se fier aux renseignements qui lui ont été remis volontairement. Par conséquent, les enquêteurs n’ont pu avoir accès aux éléments de preuve confidentiels comme les données radar, les données interceptées, les enregistrements du contrôle de la circulation aérienne ou encore l’enregistreur de données de vol (EDV) et l’enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) (dont la découverte avait été gardée secrète par l’URSS). L’enquête a donc été en grande partie fondée sur des simulations. L’OACI a publié son rapport le 2 décembre 1983.
- Le 18 novembre 1992, le président russe Boris Eltsine a rendu accessibles l’EDV et le CVR du vol KAL007. Ainsi, le 28 mai 1993 (soit dix ans plus tard), l’OACI a pu présenter un second rapport au secrétaire général des Nations Unies.
Vol 17 de Malaysia Airlines
Résumé
Le vol 17 de Malaysia Airlines (MH17), vol de passagers régulier reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, a été abattu le 17 juillet 2014 par des missiles sol-air lancés à partir d’un territoire de l’Ukraine contrôlé par des séparatistes prorusses alors qu’il survolait l’est du pays. Les 283 passagers et 15 membres d’équipage ont été tués.
Selon les conclusions de l’équipe d’enquête mixte (EEM) dirigée par les Pays-Bas, les missiles provenaient de la 53e brigade de missiles antiaériens de la Fédération de Russie. Les gouvernements néerlandais et australien tiennent la Russie pour responsable du déploiement des missiles sol-air et exercent des recours juridiques. Le gouvernement russe nie toute implication dans l’abattage de l’avion.
Principales considérations
- Le Bureau national d’enquête sur les accidents aériens de l’Ukraine, qui a mené l’enquête dans les premiers jours suivant l’écrasement, a délégué l’enquête au Bureau de la sécurité des Pays‑Bas (DSB) en août 2014 en raison du grand nombre de passagers néerlandais présents dans l’avion et du lieu de décollage de celui-ci, soit Amsterdam. Ultimement, l’Ukraine a également transmis aux Pays-Bas la direction de l’enquête sur les motifs techniques de l’écrasement ainsi que l’enquête criminelle distincte. Le DSB a ainsi mené l’enquête sur les causes techniques, alors que l’EEM, dirigée par les Pays-Bas et composée de représentants de la Belgique, de l’Ukraine, de l’Australie et de la Malaisie, a mené l’enquête criminelle.
Résultat
- Le DSB a publié son rapport technique préliminaire le 9 septembre 2014, et son rapport technique définitif le 13 octobre 2015Note de bas de page 42. En février 2019, soit cinq ans plus tard, le DSB a publié un rapport faisant le suivi des recommandations émanant de son enquête sur l’écrasement du vol MH17.
- Dans les années qui ont suivi l’écrasement, l’EEM a présenté une série de conclusions basées sur les faits connus de cet accident.
- En juin 2015, les Pays-Bas, avec l’appui des autres membres de l’EEM, ont cherché à créer un tribunal international qui aurait pour mission de traduire en justice les responsables de l’abattage du vol MH17 et de reprendre l’affaire en charge une fois l’enquête criminelle close. La Russie a toutefois mis son veto à la constitution d’un tel tribunal devant le Conseil de sécurité de l’ONU.
- Le 5 juillet 2017, il a été annoncé que les pays de l’EEM traduiraient en justice aux Pays-Bas, en vertu des lois néerlandaises, toute personne soupçonnée d’avoir joué un rôle dans l’abattage du vol MH17Note de bas de page 43.
- Le 10 juillet 2020, le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il traduirait la Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme pour « son rôle dans l’abattage » du vol MH17.
Autres catastrophes aériennes résultant d’abattages
1988 : Ariana Afghan Airlines
Le 19 novembre 1988, un Antonov An-26 exploité par Ariana Afghan Airlines effectuait un vol entre Kaboul et Jalalabad, deux villes de l’Afghanistan, lorsque le pilote s’est perdu. Après avoir pénétré dans l’espace aérien du Pakistan, le pilote a sollicité l’aide d’un aéroport pakistanais situé à proximité. L’appareil a par la suite été abattu par un tir terrestre des Forces aériennes pakistanaises près de Parachinar, au Pakistan, ce qui a fait 30 morts. Le ministère de la Défense du Pakistan a déclaré que l’avion avait été abattu après avoir pénétré en territoire pakistanais et avoir omis de s’identifier.
1988 : DC-7 de T&G Aviation
Le 8 décembre 1988, un Douglas DC-7 nolisé par l’Agence de développement international des États‑Unis a été abattu au-dessus du Sahara occidental par le Front Polisario, faisant cinq morts. Les dirigeants du mouvement ont déclaré que l’avion avait été confondu avec un Lockheed C-130 marocain. Les passagers de l’avion se rendaient au Maroc pour une « mission de lutte antiacridienne ». Un deuxième avion a également été touché, mais a pu atterrir à Sidi Ifni, au Maroc.
1992 : Abattage d’un avion arménien par les forces militaires azerbaïdjanaises
Le 27 mars 1992, un Yak-40 parti de l’aéroport de Stepanakert pour se rendre à Erevan et ayant à son bord 34 passagers et membres d’équipage a été pris pour cible par un Sukhoi Su-25 des Forces aériennes azerbaïdjanaises. Malgré une défaillance du moteur et un incendie à l’arrière de l’appareil, l’avion a pu atterrir en toute sécurité sur le territoire arménien.
1993 : Avions géorgiens
En septembre 1993, deux avions de ligne appartenant à Transair Georgia et un troisième appartenant à Orbi Georgia ont été abattus par des missiles et des tirs d’artillerie à Soukhoumi, dans la région de l’Abkhazie, en Géorgie. Le premier, un Tupolev Tu-134, a été abattu par un missile le 21 septembre 1993 pendant son processus d’atterrissage. Le deuxième, un Tupolev Tu-154, a été abattu le lendemain, également pendant son approche. Le troisième a été bombardé et détruit au sol, pendant l’embarquement des passagers. Au total, ces attaques ont fait 150 morts.
1994 : Avion présidentiel rwandais
Un avion Dassault Falcon 50 transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira a été abattu alors qu’il se préparait à atterrir à Kigali, au Rwanda, le 6 avril 1994. Les deux présidents sont morts lors de cette attaque. C’est ce double assassinat qui a été le déclencheur du génocide rwandais et de la Première guerre du Congo. La responsabilité de cette attaque n’a toujours pas été revendiquée, quoique la plupart des théories suggèrent que la culpabilité revient soit au Front patriotique rwandais (FPR), soit au groupe extrémiste progouvernemental Hutu Power, opposé aux négociations avec le FPR.
1998 : Vol 602 de Lionair
Le vol 602 de Lionair, assuré par un Antonov An-24RV, s’est écrasé dans la mer au large de la côte nord-ouest du Sri Lanka le 29 septembre 1998. L’appareil, qui avait quitté la base des forces aériennes de Jaffna-Palaly à destination de Colombo, a disparu des écrans radars tout juste après que le pilote eut signalé une dépressurisation. Selon les rapports initiaux, l’avion aurait été abattu par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Les 7 membres d’équipage et les 48 passagers ont péri.
2001 : Abattage d’un hydravion Cessna au Pérou
Le 20 avril 2001, un hydravion Cessna A185E enregistré sous l’indicatif OB-1408 a été abattu par un avion d’attaque Cessna A-37B Dragonfly péruvien au-dessus de la frontière de la province de Mariscal Ramón Castilla, au Pérou. Deux des quatre passagers – la missionnaire chrétienne américaine Roni Bowers et sa fille en bas âge Charity – ont été tués, alors que le pilote, Kevin Donaldson, a été grièvement blessé. L’accident s’est produit pendant le déroulement de l’Air Bridge Denial Program, alors qu’un avion de surveillance de la CIA a pris à tort l’appareil pour un avion participant au trafic de drogue et l’a signalé aux Forces aériennes péruviennes, qui ont provoqué l’écrasement. Un an plus tard, le gouvernement américain a versé une indemnisation de 8 millions de dollars américains à la famille Bowers et au pilote.
2001 : Vol 1812 de Siberia Airlines
Le 4 octobre 2001, le vol 1812 de Siberia Airlines, assuré par un Tupolev Tu-154, s’est écrasé dans la mer Noire, après avoir quitté Tel-Aviv, en Israël, à destination de Novossibirsk, en Russie. Bien qu’on ait initialement soupçonné un attentat terroriste, des sources américaines ont démontré que l’avion avait été touché par un missile sol-air S-200 tiré à partir de la péninsule de Crimée pendant un exercice militaire ukrainien, et cette information a été confirmée par le Comité aéronautique inter‑États, dont le siège se trouve en Russie. Toutes les personnes à bord (66 passagers et 12 membres d’équipage) ont trouvé la mort. Le président de l’Ukraine, Leonid Kuchma, et plusieurs hauts gradés de la force militaire ont exprimé leurs condoléances aux proches des victimes. Le gouvernement ukrainien a versé une indemnisation de 200 000 $ à la famille de chaque victime de l’écrasement, pour un total de 15 millions de dollars.
2003 : Attaque du vol DHL à Bagdad
Le 22 novembre 2003, peu après son décollage de Bagdad, un avion-cargo Airbus A300-200F, enregistré sous l’indicatif OO-DLL, a été touché à l’aile gauche par un missile sol-air alors qu’il était en route pour Muharraq, à Bahreïn. Comme aucune commande hydraulique ne répondait, l’équipage a dû utiliser uniquement la commande de poussée des moteurs pour manœuvrer l’avion. Malgré la perte des commandes, la grande vitesse à l’atterrissage et l’aile endommagée, l’équipage a réussi à poser l’avion à l’aéroport de Bagdad. Quelques secondes après avoir touché terre, l’appareil a quitté la piste en raison de la perte de contrôle. Les trois personnes à bord ont survécu. La dernière position signalée de l’avion en 2011 indique qu’il se trouvait toujours à l’aéroport de Bagdad.
2007 : Base aérienne de Balad, en Iraq
Le 9 janvier 2007, un avion Antonov An-26 s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir à la base aérienne de Balad, en Iraq. Bien que les autorités aient blâmé les mauvaises conditions météorologiques, des témoins affirment qu’ils ont vu l’avion être abattu, et l’Armée islamique en Iraq a revendiqué l’attaque. Au total, 34 des 35 passagers civils à bord sont morts.
2007 : Avion Il-76 de TransAVIAexport Airlines, à Mogadiscio
Le 23 mars 2007, un appareil Ilyushin Il-76 de TransAVIAexport Airlines s’est écrasé à la périphérie de Mogadiscio, en Somalie, pendant la bataille de Mogadiscio. Des témoins, dont un journaliste de Radio Shabelle, ont affirmé qu’ils avaient vu l’avion être abattu. Le Bélarus a donc entrepris une enquête antiterroriste, mais la Somalie a insisté pour dire que l’écrasement était accidentel. Les 11 civils bélarusses à bord sont morts.
2020 : Avion EMB-120 d’East African Express
Le 4 mai 2020, un appareil Embraer EMB-120 Brasilia nolisé d’East African Express s’est écrasé alors qu’il s’apprêtait à atterrir sur la piste de Bardale, en Somalie. Les six personnes à son bord sont décédées. Des soldats éthiopiens auraient abattu l’avion en pensant qu’il était en mission suicide en raison de sa trajectoire « inhabituelle ». Une enquête est en cours.
Annexe B
Cadre juridique international
Droit international
Le droit international est en grande partie fondé sur les principes de souveraineté et d’égalité des États. De ces principes émanent les concepts de compétence étatique exclusive sur un territoire et sur les personnes qui y demeurent. Outre certaines exceptions, ces principes imposent également aux États un devoir de ne pas intervenir dans un territoire sous la compétence exclusive d’un autre État. Généralement, un État doit accepter les règles auxquelles il sera lié, que ce soit explicitement par des traités ou implicitement par ses pratiques. Évidemment, tous les États sont liés par des normes impératives. Ces concepts établissent les limites des droits d’un État de prendre des mesures contre un autre État. Ils expliquent également pourquoi les cours et tribunaux internationaux n’ont pas un pouvoir automatique et général sur les États.
Responsabilité des États
La violation, par un État, d’une obligation légale contenue dans un traité ou une convention constitue un fait internationalement illicite. En application du droit coutumier international, un État qui se rend coupable d’un fait internationalement illicite se trouve généralement dans l’obligation de réparer les préjudices auprès de l’État lésé ou des États lésés. Les réparations peuvent comprendre une reconnaissance publique du méfait par l’État fautif; des excuses officielles et publiques; la punition des responsables; une assurance de non-répétition, notamment en précisant les mesures prises pour prévenir la récidive; une indemnisation; la restitution; toute autre forme de réparation qui procure satisfaction. Selon la nature du fait internationalement illicite, les États peuvent avoir recours à divers moyens pour garantir qu’un État fautif est tenu pour responsable et procure une réparation complète aux États lésés. En règle générale, les États font appel à un processus de négociation entre États. Toutefois, advenant l’échec des négociations, un État peut opter pour des mécanismes de règlement des différends. Selon la nature du fait internationalement illicite, il peut s’agir de porter le différend devant les cours et tribunaux internationaux ou les organismes internationaux, d’avoir recours à un processus de médiation ou d’arbitrage, ou de demander les bons offices d’un État neutre.
Convention relative à l’Aviation civile internationale (aussi appelée Convention de Chicago)
La Convention de Chicago (qui remonte à 1944) établit les règles qui encadrent l’aviation civile internationale. Elle contient des obligations juridiques applicables à tous les États contractants, notamment l’interdiction de faire usage d’armes contre des aéronefs civils en vol. L’annexe 13 de la Convention de Chicago établit les normes et pratiques recommandées pour ce qui est des enquêtes sur les accidents et les incidents impliquant des aéronefs. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application de la Convention de Chicago peut être soumis au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Toutefois, les États doivent d’abord tenter de résoudre le différend au moyen de négociations avant que le Conseil de l’OACI dispose de la compétence nécessaire pour rendre une décision au sujet du différend. Les parties peuvent en outre interjeter appel de cette décision devant la Cour internationale de Justice (CIJ).
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (aussi appelée la Convention de Montréal de 1971)
La Convention de Montréal de 1971 exige que les États interdisent, préviennent et punissent certaines infractions contre l’aviation civile, y compris la destruction d’un aéronef en service. De plus, les États sont soumis à des obligations internationales visant la poursuite ou l’extradition de toute personne présumée avoir commis un délit contre l’aviation civile, et le signalement au Conseil de l’OACI, aussi rapidement que possible, de tout renseignement pertinent en leur possession, notamment les circonstances de tout délit contre l’aviation civile. En outre, les États sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les infractions mentionnées à l’article 1 de la Convention. Finalement, cette Convention contient une disposition qui exige que tous les différends associés à l’interprétation ou à l’application de ce traité soient réglés d’abord au moyen de négociations, ensuite par arbitrage. Si les parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage dans les six mois, le différend peut alors être soumis à la CIJ.
Négociations entre États
Dans le contexte des traités sur l’aviation mentionnés précédemment, les négociations entre États, en plus d’être la méthode privilégiée pour tenir un État fautif responsable de ses actes et veiller à ce qu’il assure la réparation complète de son fait internationalement illicite, constituent la première étape nécessaire pour obtenir tout règlement juridiquement contraignant en cas de différend. Il s’agit d’une condition qui doit précéder toute demande au Conseil de l’OACI ou à la CIJ. Par le passé, les États ont accordé la priorité aux négociations entre États pour l’établissement des réparations dans les cas de destruction d’aéronefs civils, puisque ce mécanisme est considéré comme le plus efficace pour le règlement de telles questions interétatiques.
Cour internationale de Justice
La CIJ constitue un forum pour régler les différends entre États. La CIJ gère les violations du droit international perpétrées par les États et n’exerce aucune compétence pénale sur les personnes. La Cour peut uniquement régler les différends lorsque les États concernés ont reconnu sa compétence, soit de façon générale ou en qualité de parties d’un traité qui accorde à la CIJ le pouvoir de régler les différends qui en découlent. La Convention de Chicago et la Convention de Montréal de 1971 contiennent une disposition sur les mécanismes de règlement des différends qui confère la compétence voulue à la CIJ. Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, cette compétence ne peut être exercée qu’après l’échec d’autres mesures : des négociations et la présentation d’une demande au Conseil de l’OACI dans le cas de la Convention de Chicago; des négociations et un processus d’arbitrage dans le cas de la Convention de Montréal de 1971.
Autres traités pertinents
La Convention de Montréal de 1999 et la Convention de Varsovie concernent exclusivement l’indemnisation due aux passagers par les transporteurs aériens et ne traitent pas de la responsabilité des États ou de l’indemnisation à verser pour les dommages aux passagers découlant du fait internationalement illicite d’un État.
Annexe C
Trois résolutions adoptées unanimement par la Chambre des communes relativement au vol PS752
Le 27 janvier 2020
La motion qui suitNote de bas de page 44, présentée par l’hon. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, a été adoptée avec le consentement unanime de la Chambre :
Que cette Chambre :
- se tienne aux côtés des familles et proches des victimes qui ont perdu la vie lors de la tragédie du vol PS752 le 8 janvier 2020;
- demande qu’une enquête internationale complète et transparente soit menée afin que les familles obtiennent les réponses à leurs questions et la justice;
- exige la coopération de l'Iran qui doit demeurer totalement transparent sur l'enquête;
- exige que l’Iran offre une juste compensation aux familles des victimes;
- exige que l’Iran respecte pleinement la volonté des familles des victimes;
- exige que l'Iran veille à ce que les responsables de cette tragédie rendent des comptes en menant une enquête criminelle indépendante suivie de procédures judiciaires transparentes et impartiales qui respectent les normes internationales;
- demande que le Canada continue à appuyer les familles des victimes, à tenir l’Iran responsable de ses actes et à travailler avec la communauté internationale dans ce but.
Le 17 juin 2020
La motion qui suitNote de bas de page 45, présentée par l’honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a été adoptée avec le consentement unanime de la Chambre :
ATTENDU QUE le vol PS752 d’Ukranian Airlines a été abattu de manière illégale le 8 janvier 2020 près de Téhéran, emportant la vie de 176 innocents à bord, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents en plus de plusieurs citoyens de l’Iran, de l’Ukraine, du Royaume-Uni, de la Suède et de l’Afghanistan;
ATTENDU QUE le gouvernement de l'Iran a publiquement affirmé que ses forces armées ont tiré les missiles qui ont causé ces décès, et qu'il existe une obligation légale de mener une enquête criminelle afin de poursuivre les responsables en justice et afin de protéger l'aviation civile, que l'État soit obligé d’offrir des réparations aux États affectés, incluant sous la forme d’une compensation aux familles de toutes les victimes en vertu du droit international;
ATTENDU QUE les boites noires ont été retrouvées par l'Iran mais qu'elles n'ont pas encore été téléchargées et analysées, ce qui aurait dû être fait « sans délai » selon les standards internationaux dans les jours suivant le 8 janvier, bien avant toute restriction imposée par la pandémie de la COVID-19;
ATTENDU QUE les familles et les victimes au Canada, en Iran et dans d'autres pays à travers le monde continuent leur deuil et sont anxieuses d'apprendre la vérité à propos de la tragédie du vol PS752 et de savoir qui est responsable et comment ils sont tenus responsables pour leurs actions, en plus de demander un traitement respectueux et une compensation de la part de la compagnie aérienne et de l'Iran ainsi que dans d'autres dossiers concernant leur bien-être et leur sécurité;
Qu’il soit résolu que la Chambre :
- exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes qui ont perdu des proches lorsque le vol PS752 s'est fait abattre, condamne les personnes responsables, et exprime sa solidarité avec les familles dans leur quête de transparence, de responsabilité et de justice pour ces familles;
- supporte les étapes prises jusqu'à maintenant, incluant l'implémentation d'une approche pangouvernementale qui répond aux besoins des familles, la prestation des services consulaires, fournit un appui pour l'immigration et le transport, l'identification des dépouilles, du soutien financier (directement du gouvernement sous la forme d’assistance financière d’urgence et de dons en contrepartie vis-à-vis les dons privés à la campagne Canada Strong), des services de santé mentale, un afflux constant d'information et de réponses aux demandes de renseignements, du travail d'enquête et la formation d'un groupe mené par le Canada (Groupe international de coordination et d'intervention (GC)) et le lancement de l'initiative sur la sécurité aérienne du premier ministre lancée à la conférence de Munich et les représentations du Canada auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
- demande à tous les ministères et agences du gouvernement du Canada concernés d'appliquer la diligence, la persévérance et la détermination nécessaires afin de naviguer de manière efficace les complexités associées à une tragédie internationale de telle importance, ainsi que par les défis causés par la pandémie de la COVID-19, afin que les familles puissent enfin connaitre la vérité à propos de cette tragédie, nonobstant le temps et les efforts nécessaires qu’une telle poursuite de la justice peut demander;
- demande au gouvernement du Canada entre-temps :
- de poursuivre, avec les autres États affectés du GC, des négociations sur des réparations pour obtenir une compensation appropriée provenant de l'Iran pour les familles des victimes, en plus des obligations de la compagnie aérienne,
- de résoudre les enjeux d'immigrations en suspens de manière juste, équitable et avec compassion,
- de mettre en place les moyens appropriés pour honorer et commémorer les précieuses vies perdues,
- d'aider à protéger les familles de l'ingérence étrangère, de l'intimidation, du harcèlement et des menaces virtuelles;
- appuie le travail du gouvernement du Canada, en partenariat avec la communauté internationale à travers le GC et l'OACI et, en plus, d'exposer le plus possible la séquence d'évènements et le processus décisionnel qui a mené aux lancement de ces missiles meurtriers contre un aéronef civil, violant plusieurs lois et conventions internationales et de déterminer comment et pourquoi un aéronef civil passager a eu la permission d'être dans cet espace aérien au-dessus d'une zone de conflit dangereuse avec l'objectif de s'assurer que de tels évènements ne se reproduisent plus.
Le 29 octobre 2020
La motion qui suitNote de bas de page 46, présentée par Heather McPherson (Edmonton Strathcona), a été adoptée par la Chambre sans opinion divergente :
Que la Chambre :
- condamne les menaces, le harcèlement et les tactiques d'intimidation qui visent les membres des familles des victimes du vol PS752;
- demande au gouvernement de faire enquête sur ces plaintes;
- demande que des mesures plus importantes soient prises pour assurer la sécurité de tous les membres des familles des victimes du vol PS752.
Annexe D
Documents officiels concernant l’écrasement du vol PS752 produits à ce jour par l’Iran
Le jour de l’accident, soit le 8 janvier 2020, le Bureau d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) de l’Organisation de l’aviation civile iranienne (CAO) a publié un avis officiel indiquant que l’avion assurant le vol 752 d’Ukraine International Airlines s’était écrasé peu après son décollage de l’aéroport international Imam Khomeini, près de Téhéran, et qu’il n’y avait aucun survivant parmi les 167 passagers et 9 membres d’équipage.
- Le 9 janvier 2020, l’AAIB de la CAO a publié son Preliminary Report (rapport préliminaire) concernant le vol PS752. (anglais seulement)
- Le 21 janvier 2020, l’AAIB de la CAO a publié son Preliminary Report #2 (deuxième rapport préliminaire) concernant le vol PS752. (anglais seulement)
- En juillet 2020, l’AAIB de la CAO a publié le Factual Report (rapport factuel) sur son enquête concernant le vol PS752. (anglais seulement)
- En août 2020, l’AAIB de la CAO a publié le Flight Recorder Read-out Report (rapport sur les données extraites de l’enregistreur de bord) concernant le vol PS752. (anglais seulement)
Pour respecter les normes internationales définies dans la Convention relative à l’aviation civile internationale ainsi que les attentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, les autorités iraniennes doivent normalement publier un rapport final sur l’écrasement du vol PS752 dans les douze mois suivant celui-ci.
Annexe E
Services consulaires
Lorsque les citoyens canadiens doivent composer avec des urgences à l’étranger, y compris les conséquences d’une catastrophe comme un écrasement d’avion, Affaires mondiales Canada (AMC) tente de leur offrir l’aide dont ils ont besoin, dans les limites légales et physiques possibles. Cette aide peut prendre diverses formes et être adaptée aux circonstances particulières en jeu et aux pays touchés. L’objectif général est de veiller à ce que les Canadiens disposent des renseignements et services de soutien dont ils ont besoin pour gérer efficacement l’urgence avec laquelle ils sont aux prises.
En ce qui concerne les écrasements d’avion, les services consulaires incluent généralement ce qui suit :
- Recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et organismes gouvernementaux en vue d’aider à l’identification des victimes et à la localisation des plus proches parents.
- Établir la situation ou l’état des victimes et en aviser les plus proches parents.
- Établir les points de contact familiaux et les moyens de communication, notamment en déterminant les aptitudes en langue étrangère et en offrant des services de traduction, s’il y a lieu.
- Établir et expliquer les processus et enjeux à venir afin que les familles sachent à quoi s’attendre, et assurer la transmission continue des renseignements à mesure que la situation évolue.
- Aider à réunir les documents de voyage, comme les passeports et visas, afin de faciliter le transport d’urgence du Canada jusqu’au lieu de l’incident, ou vice versa.
- Aider à identifier les dépouilles et à organiser leur inhumation sur les lieux, ou leur rapatriement au Canada, selon les souhaits de chaque famille. Le rapatriement inclut les dispositions pour le départ du pays où est survenu l’accident et l’arrivée au Canada.
- Traiter avec les autorités locales (p. ex. les forces policières, les coroners, les organismes gouvernementaux, etc.) afin d’obtenir les éléments nécessaires comme les actes de décès, et de faire connaître les préoccupations ou demandes des familles.
- Rencontrer les familles dans le pays où s’est produit l’incident et, s’il y a lieu, faciliter les visites jusqu’au lieu de l’écrasement ou participer aux cérémonies commémoratives.
- Faciliter certains processus, comme la communication avec le transporteur aérien concerné, les compagnies d’assurance, les institutions bancaires et les autres entités publiques ou privées; la récupération et le retour des effets personnels; la liaison et la coordination avec les autres entités gouvernementales canadiennes comme la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, Transports Canada ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; la gestion des demandes des médias et de toute demande d’entretien des familles avec des élus canadiens, etc.
- Fournir une liste d’avocats locaux et faciliter le transfert de fonds privés, s’il y a lieu.
Étant donné l’ampleur des événements entourant l’écrasement du vol PS752 et l’absence de liens diplomatiques importants avec l’Iran, plusieurs mesures extraordinaires ont dû être prises dans ce cas particulier. Par exemple, puisque ni Ukraine International Airlines ni les autorités iraniennes locales n’ont pu immédiatement produire une liste complète des passagers en vue de permettre une évaluation précise de la portée de la catastrophe, AMC a travaillé à partir de l’ambassade du Canada à Kyiv afin d’obtenir ces renseignements essentiels.
AMC a dépêché une équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) en Iran pendant la plus grande partie de janvier afin qu’elle gère les questions consulaires pour les familles des victimes, avec l’appui de l’ambassade du Canada en Turquie et de l’ambassade d’Italie en Iran (l’Italie faisant office de « puissance protectrice » pour le Canada en Iran). Le travail acharné effectué par l’Italie au nom du Canada s’est révélé inestimable.
Pour la toute première fois, une EPDR a également été déployée dans cinq villes canadiennes, soit Toronto, Edmonton, Winnipeg, Montréal et Vancouver, afin de simplifier la prestation de services consulaires aux nombreux proches des victimes se trouvant dans ces centres. À titre extraordinaire, les membres de l’équipe ont aussi élargi leur offre de services aux familles des citoyens canadiens, mais aussi des résidents permanents. En raison des circonstances particulières entourant l’écrasement du vol PS752, le Canada a également simplifié l’accès à des services de consultation, à des conseils et à des renseignements juridiques de base ainsi qu’à une aide financière.
Puisque les actes de décès officiels sont difficiles à obtenir en Iran, un document consulaire de remplacement a été créé sous la forme de lettres personnalisées d’AMC ayant la même fonction. En outre, un certain travail a été exécuté auprès de l’industrie de l’assurance et d’autres entités afin de solliciter leur compréhension et leur coopération.
Il importe de noter que nombre des services extraordinaires offerts aux familles des victimes de l’écrasement du vol PS752 n’avaient pas été offerts aux familles des victimes de l’écrasement du vol ET302, ou étaient différents de ceux dont elles avaient bénéficié. Les commentaires fournis au gouvernement du Canada par les familles des victimes de l’écrasement du vol ET302 ont contribué à façonner la réponse à l’écrasement du vol PS752. Les leçons tirées de ces deux écrasements continueront à orienter et à améliorer les interventions du Canada à l’avenir.
Annexe F
Liste de départs connus de l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran avant et après la tragédie du vol PS752 le 8 janvier 2020 (selon les données compilées par Transports Canada)
- Neuf avions ont décollé avant l’écrasement du vol PS752.
- Plus d’une heure après l’écrasement du vol PS752, les vols ont repris.
| Vol | Compagnie aérienne | Destination | Heure prévue | Heure réelle | Appareil |
|---|---|---|---|---|---|
| J2 9006 | Azerbaijan Airlines | Bakou, Azerbaïdjan | 1 h 25 | 1 h 36 | Embraer 190 |
| LX 4021/ LH 601 | Swiss/Lufthansa | Francfort, Allemagne | 2 h 25 | 2 h 43 | Airbus 330-300 |
| TK 875 | Turkish Airlines | Istanbul, Turquie | 3 h | 3 h 35 | Airbus 321 |
| OS 872 | Austrian Airlines | Vienne, Autriche | 3 h 45 | 4 h 23 | Airbus 320 |
| PC 513 | Pegasus Airlines | Istanbul, Turquie | 4 h 20 | - | - |
| AFL/ SU 513 | Aeroflot | Moscou, Russie | 4 h 30 | 4 h 31 | Airbus 320 |
| TK 873 | Turkish Airlines | Istanbul, Turquie | 4 h 45 | 5 h 07 | Airbus 321 |
| QR 491 | Qatar Airways | Doha, Qatar | 4 h 45 | 5 h 01 | Airbus 320 |
| PS 752 | Ukraine International Airlines | Kyiv, Ukraine | 5 h 15 | 6 h 12 | Boeing 737-800 |
| KK 1185 | AtlasGlobal | Istanbul, Turquie | 5 h 15 | 5 h 17 | Airbus 330 |
| QR 8408 | Qatar Airways | Hong Kong | 5 h 30 | 5 h 40 | Boeing 777-200 |
| IR 719 | Iran Air | Istanbul, Turquie | 5 h 45 | 12 h 41 | Airbus 306 |
| TBZ 6650 | ATA Airlines | Nadjaf, Iraq | 6 h | - | - |
| IR 721 | Iran Air | Francfort, Allemagne | 6 h 20 | 7 h 49 | Airbus 330 |
| TK 899 | Turkish Airlines | Istanbul, Turquie | 6 h 20 | - | - |
| W5 112 | Mahan Air | Istanbul, Turquie | 6 h 50 | - | - |
| IR 658 | Iran Air | Dubaï, Émirats arabes unis | 7 h | 3 h 11 | Airbus 321 |
| IR 717 | Iran Air | Vienne, Autriche | 7 h 30 | 7 h 53 | Airbus 306 |
| TK 879 | Turkish Airlines | Istanbul, Turquie | 7 h 40 | 8 h 23 | Airbus 330 |
| W5 61 | Mahan Air | Dubaï, Émirats arabes unis | 8 h | 8 h 19 | Airbus 340 |
| IR 713 | Iran Air | Stockholm, Suède | 8 h 50 | 8 h 41 | Airbus 330 |
| W5 116 | Mahan Air | Istanbul, Turquie | 9 h | 9 h 07 | Airbus 340 |
| IR 715 | Iran Air | Ankara, Turquie | 9 h 30 | 9 h 55 | Airbus 300 |
| IRQ 2213 | Qeshm Air | Istanbul, Turquie | 11 h | 2 h 32 | Airbus 300 |
| EK 972 | Emirates | Dubaï, Émirats arabes unis | 11 h 05 | 11 h 18 | Boeing 777-300 |
| W5 63 | Mahan Air | Dubaï, Émirats arabes unis | 11 h 15 | 11 h 25 | Airbus 310 |
| W5 120 | Mahan Air | Istanbul, Turquie | 11 h 30 | 11 h 40 | Airbus 340 |
| W5 5058 | Mahan Air | Souleimaniye, Iraq | 12 h | - | - |