Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019
Table des matières
- Volume 1
- Messages des ministres
- Rapport sur l’aide internationale: Les engagements et les obligations législatives du Canada
- Tour d’horizon de l’aide internationale fédérale du Canada en 2018-2019
- Introduction
- Enveloppe de l’aide internationale et présentation des décaissements en regard des allocations
- Aide internationale et versements d’aide au développement officielle du gouvernement du Canada par organisation, 2018-2019
- Soutien aux objectifs de développement durable
- Politique d’aide internationale féministe du Canada
- Champ d’action : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles
- Champ d’action : La dignité humaine
- Champ d’action : La croissance au service de tous
- Champ d’action : L’environnement et l’action pour le climat
- Champ d’action : La gouvernance inclusive
- Champ d’action : La paix et la sécurité
- Les partenaires du Canada
- Innovation et efficacité
- Organisations fédérales qui fournissent de l’aide internationale
- Volume 2 : Engagement avec les institutions financières internationales
- Introduction
- Section A : Les objectifs d’engagement stratégique du Canada envers les institutions financières internationales
- Section B : Participation du Canada aux opérations du Groupe de la Banque mondiale
- Section C : Participation du Canada aux opérations du Fonds monétaire international
- Section D : Les engagements du Canada à la Banque européenne pour les activités de reconstruction et de développement
Volume 1
Messages des ministres
Message de la ministre du Développement international et du ministre des Affaires étrangères
En tant que ministres des Affaires étrangères et du Développement international, nous sommes heureux de présenter le Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019. Il s’agit du portrait le plus complet depuis l’adoption de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle qui explique comment l’aide du Canada a atteint ses résultats en matière d’aide internationale.
En œuvrant pour réduire la pauvreté et améliorer la vie des gens partout sur la planète, notre gouvernement a fait du respect des droits de la personne, ici et à l’étranger, une priorité. Il s’applique notamment à favoriser l’inclusion, à faire progresser l’égalité des genres et à renforcer le pouvoir des femmes.
Favoriser l’émergence de sociétés ouvertes, inclusives et fondées sur les droits, où toutes les personnes, quel que soit leur genre, peuvent tirer pleinement parti d’une participation égale à la vie économique, politique, sociale et culturelle, est un moyen efficace de contribuer à un monde plus sûr et plus prospère, de consolider le système international fondé sur des règles et de défendre des valeurs progressistes.
La politique étrangère féministe du Canada est ancrée dans la conviction que tous et toutes devraient jouir des mêmes droits de la personne, avoir les mêmes chances de réussir et vivre en sécurité. Cette politique est mise en œuvre par le biais d’une série de politiques, de programmes et d’initiatives internationaux complémentaires comme la Politique d’aide internationale féministe, la stratégie de diversification du commerce du Canada et son approche inclusive du commerce, le plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité, l’Initiative Elsie, et la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, ainsi qu’une multitude d’actions diplomatiques soutenant ses objectifs.
Depuis l’adoption de la Politique d’aide internationale féministe en juin 2017, le Canada a réorienté son approche pour se concentrer sur l’éradication de la pauvreté et l’édification d’un monde pacifique, inclusif et prospère, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030).
L’aide internationale du Canada fait une différence, et nous sommes fiers d’en présenter les résultats dans le présent rapport.
Les réalisations notables présentées ci-dessous ne sont que quelques exemples reflétant nos efforts pour améliorer la vie des moins bien nantis et des plus vulnérables, et pour promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes :
- Nous sommes fiers des contributions du Canada à l’aide humanitaire en 2018-2019. Notre pays a en effet contribué à sauver la vie et à atténuer les souffrances de plus de 86 millions de personnes dans le besoin, grâce à une aide de plus de 910 millions de dollars fournie à 62 pays et territoires et en intervenant à la suite de 37 catastrophes naturelles. En 2018-2019, par exemple, le Canada a fourni plus de 90 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents dans le Sahel, dont 35,13 millions pour lutter contre la sécheresse dans la région. Grâce à l’aide du Canada, les organisations non gouvernementales (ONG) partenaires ont aidé plus de 2 millions de personnes au Sahel, dont plus de 57 000 enfants traités pour malnutrition aiguë sévère.
- En complément de son aide humanitaire, le Canada a contribué aux efforts de gestion et de stabilisation des conflits dans les pays fragiles et touchés par des conflits. Conformément à son Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité et à l’objectif de développement durable (ODD) no 16, le Canada a, en 2018-2019, mobilisé des appuis en faveur des femmes en leur qualité d’agentes actives de la paix, s’est attaqué à la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG) lors des conflits, a perturbé les réseaux de traite de personnes, assuré la réinsertion des anciens combattants et augmenté le nombre de femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies, entre autres efforts.
- Pendant la période visée par ce rapport, le Canada a été l’hôte du Sommet du G7, qui s’est tenu les 8 et 9 juin 2018 dans la région de Charlevoix, au Québec, et a fait de l’égalité des genres une priorité clé de sa présidence. Il a adopté une approche globale et systématique pour intégrer l’égalité des genres dans tous les domaines d’activités du G7 et a créé le Conseil consultatif sur l’égalité des genres. Avant le Sommet, le Canada a été l’hôte de la première rencontre des ministres du Développement du G7 en 10 ans. Les ministres y ont adopté quatre déclarations ambitieuses qui visaient à favoriser l’essor de l’innovation, à promouvoir l’égalité des genres, à renforcer le pouvoir de toutes les femmes et les filles, et à empêcher l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements dans le milieu de l’aide internationale. Le Canada, ses partenaires du G7 et d’autres partenaires se sont également engagés à verser 4,3 milliards de dollars (dont 400 millions du Canada) en appui à la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement.
- En août 2018, le Canada a accueilli la Conférence de la Coalition pour les droits égaux axée sur la promotion des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, bispirituelles et intersexuées (LGBTQ2+) à Vancouver, en Colombie-Britannique. En février 2019, le Canada a annoncé un financement de 30 millions de dollars sur cinq ans, puis de 10 millions par an, pour promouvoir les droits de la personne et améliorer les résultats socioéconomiques des personnes LGBTQ2+ dans les pays en développement.
- En juin 2019, le Canada a accueilli la conférence Women Deliver, qui représente le plus important rassemblement mondial à ce jour portant sur l’égalité des genres et sur la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. Cet événement a réuni à Vancouver des dirigeants mondiaux, des militants, des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des représentants d’ONG et des gens d’affaires pour discuter de l’égalité des genres et de la santé et des droits sexuels et reproductifs. À cette occasion, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un engagement de 10 ans au cours duquel le gouvernement du Canada augmentera son financement, qui atteindra une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars d’ici 2023, pour soutenir la santé des femmes, des enfants et des adolescents partout dans le monde. Cet investissement historique soutiendra les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et la santé maternelle, néonatale et infantile.
Notre gouvernement s’est doté de nouveaux outils qui permettent à notre pays d’attirer plus de ressources pour le développement durable. À l’ONU, en septembre 2019, le Canada a co-animé le 7e Dialogue de haut niveau sur le financement du développement. Cette rencontre a rassemblé des dirigeants mondiaux pour discuter des enjeux et prochaines étapes pour réduire l’écart en matière de financement pour le développement.
Pour maximiser les bénéfices de son aide internationale, le Canada noue de nouveaux partenariats multipartites, notamment avec le secteur privé, et adopte des approches flexibles, novatrices et intégrées. À la conférence Women Deliver, par exemple, notre gouvernement a annoncé qu’il travaillerait avec le Fonds pour l’égalité, un partenariat de 300 millions de dollars entre le gouvernement, la communauté philanthropique, le secteur privé et la société civile, pour créer une source durable de financement pour les organisations et mouvements de femmes des pays en développement.
Nous amorçons un virage important dans notre façon de faire en adoptant une stratégie féministe en matière d’aide internationale. En juillet 2019, le Canada a adopté des politiques pour chacun des champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe. Ces politiques fourniront une orientation supplémentaire aux objectifs que le Canada souhaite atteindre. Le Canada accorde la priorité aux initiatives les plus susceptibles de réduire les disparités entre les genres et de contribuer au Programme 2030. Ces efforts bénéficieront en outre de l’engagement pris dans le budget de 2019 d’affecter 700 millions de dollars supplémentaires à l’aide internationale en 2023-2024. Le Canada pourra ainsi s’appuyer sur les résultats atteints et continuer à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale.
Ce rapport présente les résultats tangibles obtenus grâce aux investissements de notre gouvernement dans l’aide internationale. Il montre l’incidence du Canada et de ses partenaires sur l’extrême pauvreté, l’égalité des genres et le développement durable et inclusif. Nous espérons que les contributions internationales et les grandes réalisations du Canada présentées dans ce résumé vous inspireront.
Message du ministre des Finances
Le gouvernement du Canada s’emploie à accroître la place qu’occupe le pays dans le monde grâce à une approche en matière d’aide internationale qui reflète les intérêts et les valeurs des Canadiennes et des Canadiens. Il soutient notamment une croissance inclusive et durable, en s’assurant que l’aide internationale consentie par le Canada est axée sur les besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.
Dans le budget de 2018, notre gouvernement s’est engagé à rendre nos rapports sur l’aide internationale plus transparents et accessibles à la population canadienne. Auparavant, le gouvernement rendait compte de ses activités en matière d’aide internationale par l’intermédiaire de trois rapports qui répondaient aux exigences de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes et de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Désormais, dans un effort pour rationaliser la reddition de compte et améliorer la transparence, l’honorable Karina Gould, ministre du Développement international, l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et moi-même sommes heureux de présenter ce premier rapport annuel, intitulé Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019.
Le développement durable et inclusif est essentiel à une économie mondiale forte et stable. Le Canada se tourne vers des partenaires multilatéraux comme le Fonds monétaire international (FMI), le Groupe de la Banque mondiale (GBM), la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour soutenir et faire progresser ces objectifs. À titre de gouverneur du Canada au sein de ces institutions, je veillerai à ce que le Canada continue son étroite collaboration avec ces entités pour faire progresser les objectifs de sa Politique d’aide internationale féministe, qui reconnaît que favoriser l’égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes et des filles est essentiel à un monde pacifique, inclusif et prospère.
En 2018, le Canada a eu le privilège d’accueillir le Groupe des Sept (G7). Notre présidence du G7 reposait sur l’idée qu’investir dans la croissance économique profite à tout le monde. En juin 2018, les ministres des Finances et du Développement du G7 ont tenu une toute première réunion à Whistler, en Colombie-Britannique, pour discuter de mécanismes novateurs visant à attirer de nouveaux partenariats et de nouvelles sources de financement, et à promouvoir la participation entière et égale des femmes, le tout dans le cadre du développement durable. Ces discussions s’arrimaient aussi au thème de la promotion de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes, qui a été intégré à toutes les activités de la présidence du Canada.
Dans la dernière année, les prêts du FMI ont contribué considérablement à la stabilité économique dans les pays souffrant ou menacés d’une crise économique. L’organisation – toujours avec le ferme soutien du Canada – a aussi accru son champ d’action dans la recherche et les conseils stratégiques sur les avantages d’une croissance inclusive, de l’ouverture économique et du renforcement du pouvoir des femmes.
La participation du Canada à l’augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et aux négociations pour la reconstitution de l’Association internationale de développement (IDA) ont démontré son engagement indéfectible envers les institutions du GBM.
Un autre moment charnière de 2018 : le Canada a officiellement rejoint la BAII. Depuis, nous travaillons avec elle pour formuler des politiques et stratégies saines, et des cadres de gouvernance solides de façon à structurer des investissements inclusifs et répondant aux normes internationales les plus élevées.
La BERD fait la promotion et favorise l’essor d’économies de marché prospères qui sont inclusives, compétitives, respectueuses de l’environnement et bien gouvernées. En insistant sur les activités du secteur privé, la BERD a démontré sa capacité à exploiter des ressources publiques pour mobiliser des capitaux privés à des fins de développement. Elle a en outre redoublé d’efforts pour promouvoir la participation économique des femmes, s’alignant ainsi sur le rôle de premier plan que joue le Canada pour promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes. La BERD a redoublé d’efforts pour améliorer l’accès des femmes à l’aide financière, au soutien aux entreprises, aux possibilités d’emploi et d’acquisition de compétences, et à d’autres services.
Ce premier rapport présente les principaux résultats de l’aide internationale en 2018-2019 et examine les objectifs et les résultats du Canada. En ma qualité de gouverneur du Canada au FMI, au GBM, à la BAII et à la BERD, je peux attester de l’importante contribution de ces institutions à la collaboration et au développement internationaux. Je veillerai à ce que le Canada continue d’affirmer son point de vue dans ces institutions pour parvenir à des solutions communes durables et à une croissance favorable à tous.
Rapport sur l’aide internationale : les engagements et les obligations législatives du Canada
Ce rapport rend compte d’un engagement ferme à l’égard de la transparence sur l’utilisation des fonds publics pour le développement international durable, l’action humanitaire, et la promotion de la paix et la sécurité. La population canadienne et les intervenants des pays partenaires doivent savoir comment le Canada répartit ses ressources et les résultats ainsi obtenus.
Auparavant, trois rapports qui répondaient aux exigences de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRADO), de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Loi de Bretton Woods) et de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Loi sur la BERD), étaient présentés au Parlement à divers moments de l’année. Il fallait donc se reporter à différents documents selon le moment de l’année. La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a apporté des modifications législatives qui ont fait coïncider les calendriers de présentation de ces rapports, permettant ainsi la publication et le dépôt d’un rapport global sur l’aide internationale. De plus, grâce à la nouvelle date d’échéance, à savoir un an après la fin de chaque exercice financier ou, si une des deux chambres du Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, le rapport global peut inclure un ensemble final de résultats et de statistiques.
En 2018-2019, le gouvernement du Canada a aussi mis en place une nouvelle structure de financement pour l’enveloppe de l’aide internationale (EAI). Six « réserves de fonds » ont été créées pour chaque type d’activités : Développement de base, Aide humanitaire, Institutions financières internationales (IFI), Paix et sécurité, Compte de crises et Fonds pour les priorités stratégiques. De plus, dans le budget de 2019, le gouvernement s’est engagé à rapprocher les fonds prévus et les dépenses réelles de l’EAI, ce que le présent rapport fait pour la première fois pour 2018-2019.
Ensemble, ces engagements et ces modifications législatives donneront à la population canadienne et à la communauté internationale une information plus claire et complète des progrès réalisés par le Canada pour appliquer la Politique d’aide internationale féministe et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
La LRADO est entrée en vigueur en 2008 et exige que toute l’aide canadienne déclarée au Parlement comme aide au développement officielle vise à faire reculer la pauvreté et, entre autres, qu’elle se fasse le miroir des principes d’efficacité et des valeurs canadiennes.
En vertu de la LRADO, le ministre du Développement international, ou tout autre ministre compétent au sens de la LRADO, doit rendre compte annuellement au Parlement des dépenses et des activités fédérales d’aide au développement officielle (ADO) faites au nom du gouvernement du Canada.
Pour qu’une activité d’aide internationale soit déclarée au Parlement comme ADO au titre de la LRADO, elle doit, de l’avis du ministre compétent :
- contribuer à la réduction de la pauvreté;
- tenir compte des points de vue des pauvres;
- être compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.
Le volume 1 de ce rapport sur l’aide internationale porte sur toute l’ADO fédérale fournie, en vertu des exigences en matière de rapports de la LRADO, ainsi que sur l’aide ne répondant pas à la définition de l’ADO qui est fournie par l’entremise de l’enveloppe de l’aide internationale. Veuillez consulter le chapitre sur l’enveloppe de l’aide internationale pour obtenir d’autres renseignements sur les activités qui ne sont pas considérées comme de l’ADO.
La LRADO exige également que le ministre du Développement international publie un rapport statistique sur l’ADO dans l’année qui suit la fin de chaque exercice financier. Ce rapport fournit plus de détails sur les dépenses d’aide internationale par organisation, secteur et bénéficiaire. Il peut être consulté sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Pour en savoir plus, consultez la LRADO sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
La Loi de Bretton Woods est entrée en vigueur en 1985 et régit la participation du Canada auprès des institutions créées en application des Accords de Bretton Woods : le FMI et le GBM (la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [BIRD], l’Association internationale de développement, la Société financière internationale et l’Agence multilatérale de garantie des investissements). Les institutions de Bretton Woods sont, pour le Canada, d’importants intermédiaires de prestation de l’aide internationale et de soutien à la stabilité économique et financière mondiale.
La Loi de Bretton Woods exige que le ministre des Finances dépose au Parlement un rapport annuel contenant un résumé général des opérations visées par cette loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, ainsi que les communiqués publiés par le comité directeur de chaque institution. Les communiqués sont présentés dans le volume 2 du présent rapport.
Pour en savoir plus, consultez la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
La Loi sur la BERD est entrée en vigueur en 1991 et constitue le cadre juridique à la participation du Canada à la BERD. Membre fondateur et huitième actionnaire en importance de la Banque, le Canada contribue activement à l’élaboration des politiques de la BERD et surveille les activités financières de cette dernière. Il le fait principalement grâce à ses sièges au sein du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration.
Des objectifs clés guident la participation du Canada à la BERD. Renouvelés chaque année, ces objectifs s’inspirent des objectifs stratégiques du gouvernement du Canada, de son dévouement au mandat de transition sous-jacent de la BERD et des principes généraux de bonne gouvernance, de responsabilisation et d’efficacité institutionnelle. Ils visent à faire en sorte que la BERD demeure une institution efficace, avantageuse et moderne pour la clientèle et les pays qu’elle sert.
La Loi sur la BERD exige que le ministre des Finances dépose au Parlement un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la loi, y compris des éléments concernant le développement durable et les droits de la personne. Veuillez consulter le Volume 2 du présent rapport.
Pour en savoir plus, consultez la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Tour d’horizon de l’aide internationale fédérale du Canada en 2018-2019
Le gouvernement du Canada a fourni de l’aide internationale par le truchement de 19 organisations fédérales.
Le financement de l’aide internationale du gouvernement du Canada a connu une hausse de 7 % entre 2017-2018 et 2018-2019.

* Ce rapport ne porte que sur l’aide internationale et l’ADO déboursées par le gouvernement du Canada. Le Rapport statistique sur l’aide internationale comprend également l’aide internationale et l’ADO déboursées par les provinces, les territoires et les municipalités canadiennes. Veuillez consulter le Rapport statistique pour obtenir des définitions détaillées de l’aide internationale et l’ADO.
Version texte
6,1 milliards de dollars dont 5,9 milliards de dollars en ADO*:
| Organisation | Contribution |
|---|---|
| Affaires mondiales Canada | 4 648 M$ |
| Ministère des Finances Canada | 797 M$ |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 390 M$ |
| Centre de recherches pour le développement international | 156 M$ |
| Autres organisations fédérales | 70 M$ |

Version texte
Types d’aide internationale
- Aide au développement à long terme
- Aide humanitaire
- Paix et sécurité
Moyens de prestation de l’aide internationale
- Organisations multilatérales
- Gouvernements partenaires
- Organisations de la société civile (le terme « société civile » renvoie à un vaste éventail d’organisations non gouvernementales, à but non lucratif et dirigées par des bénévoles, de même qu’à des mouvements sociaux au sein desquels les gens s’organisent afin de défendre des intérêts, des valeurs et des objectifs communs dans le domaine public)
- Secteur privé
Résultats obtenus dans les pays partenaires
- Recul de la pauvreté et hausse des perspectives économiques pour les populations des quatre coins de la planète
- Aide aux personnes vivant des crises humanitaires
- Stabilité favorisée dans les régions fragiles
Politique d’aide internationale féministe du Canada
La Politique d’aide internationale féministe du Canada, lancée en juin 2017, vise à éradiquer la pauvreté et à bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Elle intègre un cadre de responsabilités solide pour mesurer les résultats. Les progrès réalisés sont observés et mesurés pour chacun des six champs d’action.
Décaissements du gouvernement du Canada au titre de l’aide internationale, par champ d’action de la Politique d’aide internationale féministe

* Le montant indiqué pour le champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles ne tient pas compte des programmes ciblant ou intégrant la dimension de genre inclus dans les autres champs d’action.
Version texte
- L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles : 90 millions de dollars*
- La dignité humaine : 2 671 millions de dollars
- La dignité humaine – Santé et nutrition : 1 171 millions de dollars
- La dignité humaine – Éducation : 434 millions de dollars
- La dignité humaine – Action humanitaire tenant compte des genres : 910 millions de dollars
- La dignité humaine – Activités transversales : 157 millions de dollars
- La croissance au service de tous : 983 millions de dollars
- L’environnement et l’action pour le climat : 630 millions de dollars
- La gouvernance inclusive : 443 millions de dollars
- La paix et la sécurité : 314 millions de dollars
- Activités multi-champ d'action, telles que les activités reliées aux réfugiés : 610 millions de dollars
- Coûts administratifs : 318 millions de dollars
Pourcentage de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada qui cible ou intègre l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles

* Ciblé : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont les principaux objectifs des investissements.
Intégré : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont des objectifs importants et délibérés des investissements, mais pas les principaux.
Ni ciblé ni intégré : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles ne sont pas des objectifs spécifiques des investissements.
En 2018-2019, plus de 94,9 % de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada ont ciblé ou intégré l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Cela représentait des investissements de 2,8 milliards de dollars.
Version texte
Résumé : Entre 2015-2016 et 2018-2019, la proportion de l’aide bilatérale au développement international d’Affaires mondiales Canada qui cible et intègre l’égalité des genres a augmenté, contribuant ainsi à l’atteinte de la cible de 2021-2022.
- 2015-2016 (données de référence) : Genre ni ciblé ni intégré 25 %, Genre intégré 72 %, Genre ciblé 3 %
- 2017-2018 : Genre ni ciblé ni intégré 10 %, Genre intégré 87 %, Genre ciblé 3 %
- 2018-2019 : Genre ni ciblé ni intégré 5 %, Genre intégré 89 %, Genre ciblé 6 %
- Cibles 2021-2022 : Genre ni ciblé ni intégré 5 %, Genre intégré 80 %, Genre ciblé 15 %
Résultats indicatifs*
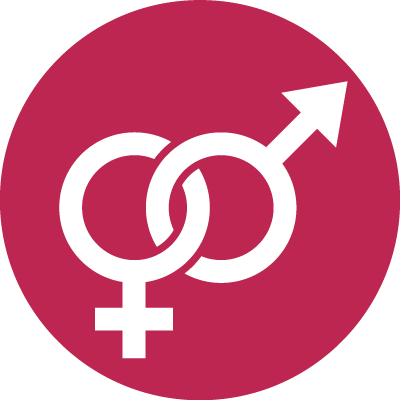
408 323 personnes ont été touchées par des projets visant la prévention ou l’interdiction de la violence sexuelle et fondée sur le genre, incluant les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, et les mutilations génitales féminines.

3 804 639 entrepreneurs, agriculteurs et petits exploitants agricoles ont bénéficié de services financiers ou de services au développement d’entreprises.

2 864 301 femmes et filles ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive, incluant des méthodes modernes de contraception.

176 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre réduites ou évitées**

355 268 enseignants ont été formés conformément aux normes nationales.
220 493 personnes ont complété un programme d’enseignement et de formation technique ou professionnelle soutenu par Affaires mondiales Canada.

18 035 845 personnes ont été touchées par des projets qui soutiennent le leadership des femmes en gouvernance.
5 609 organisations de la société civile qui font la promotion des droits de la personne ou de la gouvernance inclusive ont été soutenues.

15 % des projets d’aide humanitaire comportaient un volet sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ou sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

165 818 gardiens de la paix ont été formés dans le cadre de déploiements et de projets visant la prévention et l’intervention en matière d’exploitation et d’abus sexuels.
* Les résultats comprennent des données cumulatives provenant de nombreux projets d’aide internationale d’Affaires mondiales Canada. Les données tiennent compte des résultats depuis le début de la mise en œuvre du projet jusqu’au 31 mars 2019. La date de début varie pour chaque projet. Ces résultats ne sont qu’un aperçu de l’aide internationale d’Affaires mondiales Canada et ne rendent pas compte de toute l’étendue de ses programmes.
** Ce résultat indique les effets cumulatifs et attendus calculés au prorata des programmes d’Affaires mondiales Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada.
Exemples des principaux engagements du Canada en matière d’aide internationale
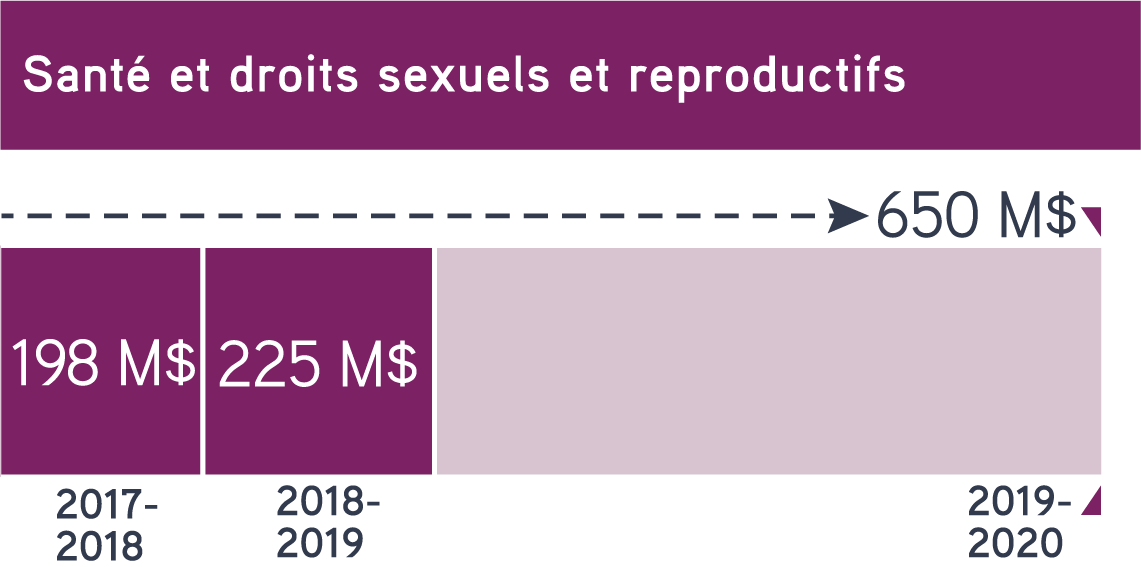
Le Canada s’est engagé à verser 650 millions de dollars de 2017 à 2020 pour combler les lacunes importantes en matière de santé sexuelle et reproductive. Il a notamment investi dans des programmes visant à faciliter l’accès des femmes et des jeunes filles à la planification familiale, à une éducation sexuelle complète, à des soins de santé reproductive de base, à des avortements sûrs et à des soins après avortement, et à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre.
Version texte
Engagement à investir 650 millions de dollars entre 2017 et 2020 pour la santé et les droits sexuels et reproductifs
Décaissements par année :
- 2017-2018 : 198 millions de dollars
- 2018-2019 : 225 millions de dollars
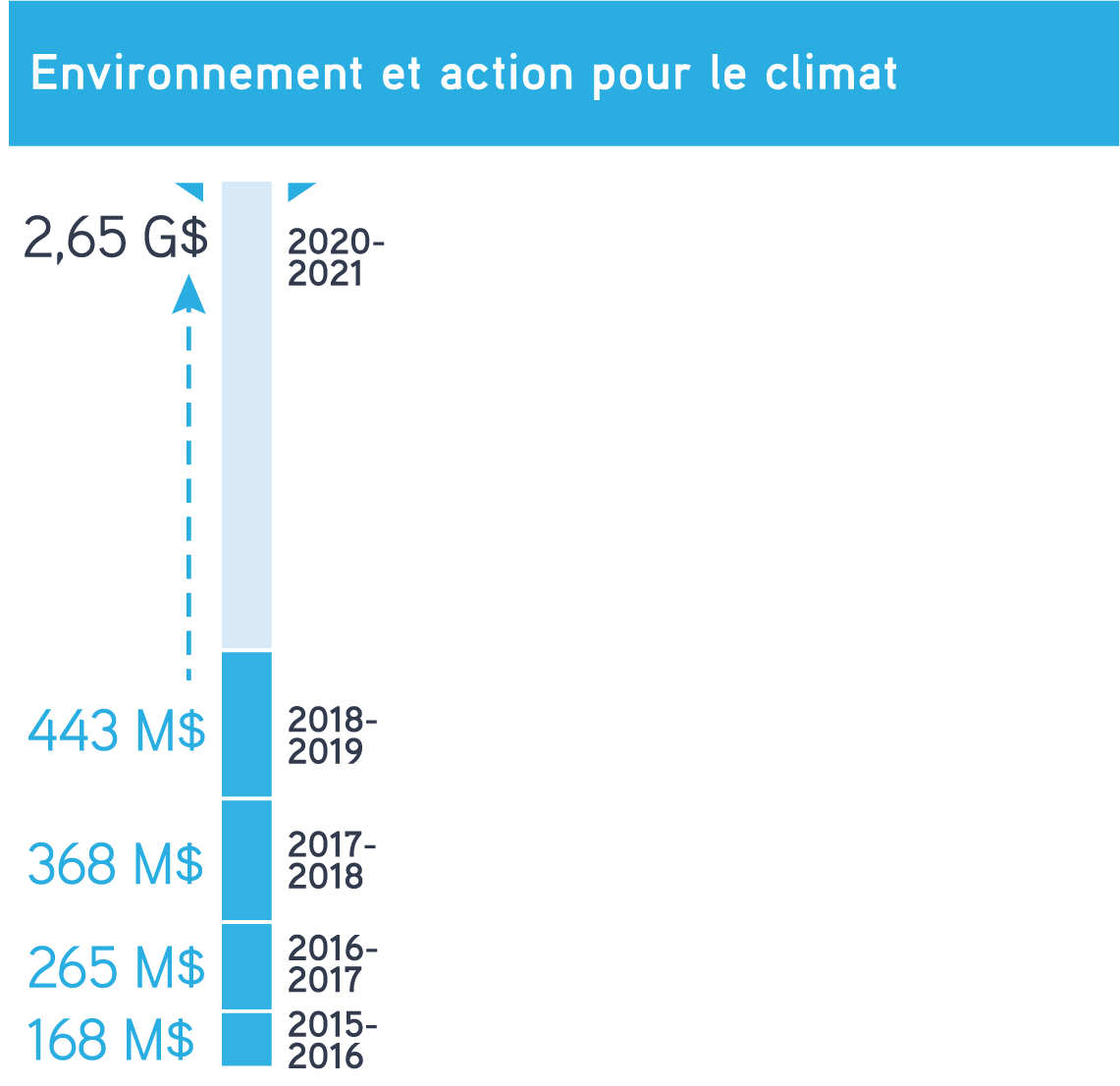
Pour aider les pays en développement dans leurs efforts contre les changements climatiques, le Canada a annoncé des initiatives à hauteur de 1,7 milliard de dollars des 2,65 milliards de dollars de son financement climatique. Cela comprend l’engagement de 162 millions de dollars que le Canada a pris, en 2018, en tant qu’hôte du G7 pour soutenir les objectifs du Plan d’action de Charlevoix pour la santé des océans et des mers et des communautés côtières résilientes. Le Canada a également annoncé un financement de 100 millions de dollars pour débarrasser les océans de la planète des déchets marins et de la pollution plastique.
Version texte
Engagement à investir 2,65 milliards de dollars entre 2015 et 2021 en financement climatique
Décaissements par année :
- 2015-2016 : 168 millions de dollars
- 2016-2017 : 265 millions de dollars
- 2017-2018 : 368 millions de dollars
- 2018-2019 : 443 millions de dollars
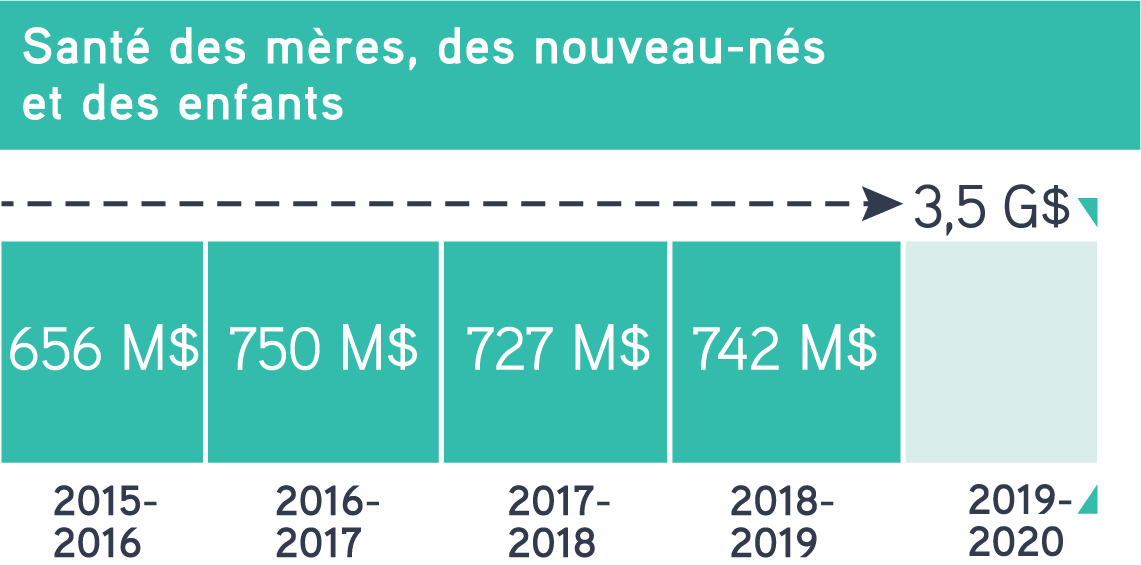
Le Canada a continué d’honorer son engagement de verser, de 2015 à 2020, 3,5 milliards de dollars pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. À cet égard, le Canada a investi 742 millions de dollars en 2018-2019.
Version texte
Engagement à investir 3,5 milliards de dollars entre 2015 et 2020 pour la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants
Décaissements par année :
- 2015-2016 : 656 millions de dollars
- 2016-2017 : 750 millions de dollars
- 2017-2018 : 727 millions de dollars
- 2018-2019 : 742 millions de dollars
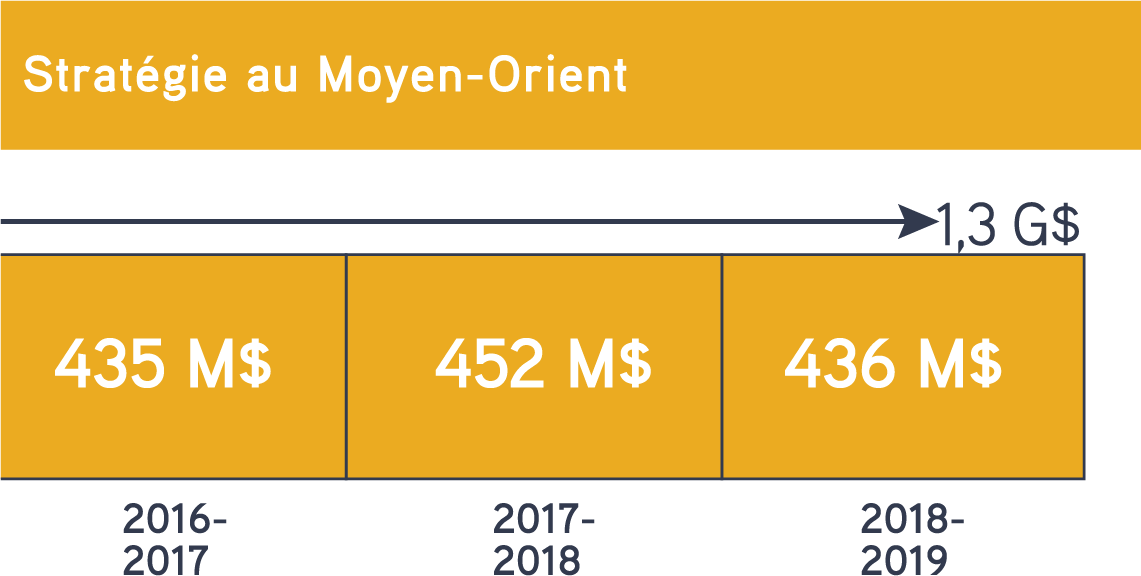
Le Canada soutient des changements concrets au Moyen-Orient par le biais de sa Politique d’aide internationale féministe, de sa Politique étrangère féministe et de son Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. En février 2016, le Canada s’est engagé à verser 2,1 milliards de dollars sur trois ans à la région pour lutter contre les crises en Irak et en Syrie et atténuer leur incidence sur le Liban, la Jordanie et la région. De ce montant, 1,3 milliard de dollars ont été consacrés à l’aide internationale offerte par Affaires mondiales Canada et axée sur la sécurité et la stabilisation, l’aide humanitaire et les activités de développement. En mars 2019, le Canada a prolongé de deux ans sa Stratégie au Moyen-Orient et a assorti ce renouvellement d’un engagement de 1,4 milliard de dollars.
Version texte
Engagement à investir 1,3 milliard de dollars entre 2016 et 2019 dans la Stratégie du Canada au Moyen-Orient
Décaissements par année :
- 2016-2017 : 435 millions de dollars
- 2017-2018 : 452 millions de dollars
- 2018-2019 : 436 millions de dollars
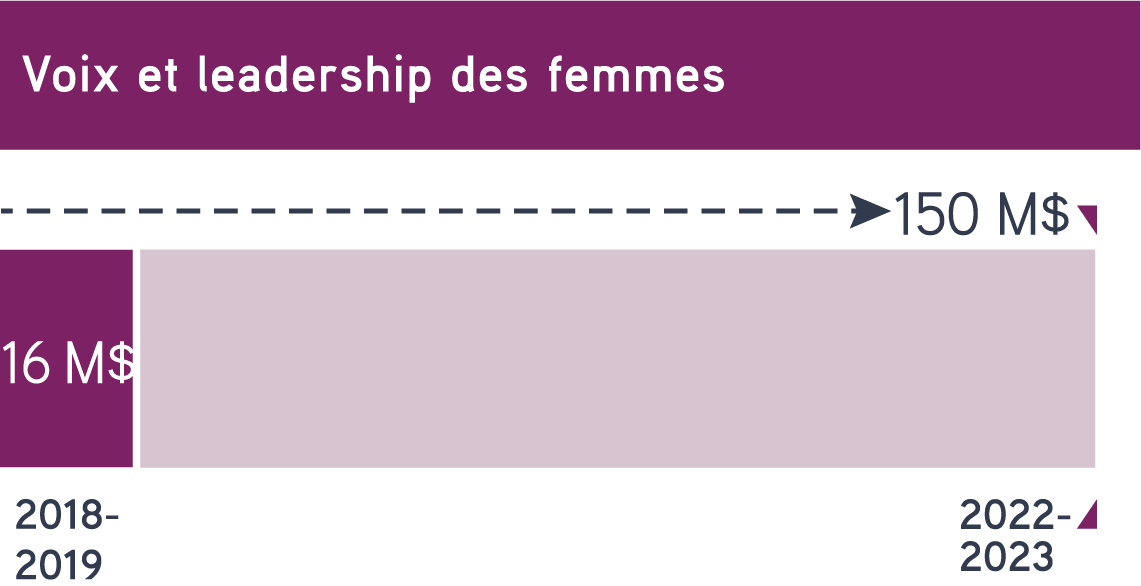
Le Canada a lancé le programme Voix et leadership des femmes et s’est engagé à verser plus de 150 millions de dollars dans plus de 30 pays et régions sur cinq ans. Les projets du programme répondent aux besoins des organisations féminines locales de pays en développement.
Version texte
Engagement à investir 150 millions de dollars entre 2018 et 2023 dans le programme Voix et leadership des femmes
Décaissement en 2018-2019 : 16 millions de dollars
Le Canada sur la scène internationale
La Politique d’aide internationale féministe oriente la mise en œuvre internationale du Programme 2030 par le Canada. En utilisant l’objectif de développement durable (ODD) no 5 sur l’égalité entre les sexes comme tremplin pour sa politique, le Canada contribue largement à la réalisation des 17 ODD.
Pendant sa présidence du G7, le Canada a fait preuve de leadership mondial à l’égard des enjeux du développement en mettant l’accent sur les femmes et les filles, l’innovation en matière de développement et le financement innovant. Par exemple, le Canada s’est engagé à verser 400 millions de dollars dans le cadre d’un investissement conjoint de près de 3,8 milliards de dollars dans l’éducation des femmes et des filles en zone de crise ou de conflit, un investissement historique.
Dans la Politique d’aide internationale féministe, le Canada s’est engagé à aborder le développement sous un angle différent en encourageant l’innovation, une plus grande expérimentation et le déploiement à grande échelle de nouvelles solutions pour relever les défis en matière de développement. Ces travaux pourraient amener à améliorer ou créer des modèles d’affaires, des pratiques stratégiques, des approches, des partenariats, des technologies, des connaissances comportementales, des mécanismes de financement ou des moyens de prestation de produits et de services qui donnent de meilleurs résultats que les stratégies habituelles.
Une aide humanitaire de plus de 910 millions de dollars a été fournie par l’intermédiaire de partenaires des Nations Unies, du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour intervenir à des crises dans 62 pays et territoires. Cette aide a permis d’améliorer la vie de plus de 86,7 millions de personnes.
Le Canada soutient les principes de Busan pour une coopération efficace au service du développement et participe activement au Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Améliorer l’efficacité de l’aide internationale du Canada est aussi une importante caractéristique de la Politique d’aide internationale féministe.
Aide internationale du gouvernement du Canada aux quatre coins du monde
En 2018-2019, le gouvernement du Canada a fourni une aide internationale dans 149 pays et territoires. Pour en savoir plus sur les activités et les résultats dans le monde, consultez les pages de chaque pays sur le site Web Le Canada et le monde. Le Rapport statistique sur l’aide internationale fournit de plus amples informations sur l’aide internationale par pays et par région.
Les 10 principaux bénéficiaires de l’aide internationale du Canada
- Éthiopie
- Bangladesh
- Afghanistan
- Syrie
- Mali
- République démocratique du Congo
- Tanzanie
- Jordanie
- Nigéria
- Colombie
Histoires
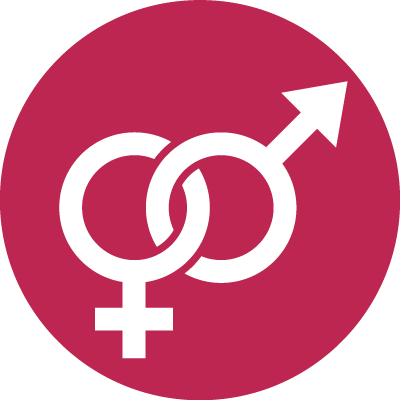
Apprenez-en plus sur le leadership des femmes en Afrique.

Apprenez-en plus sur le soutien à la formation professionnelle des femmes au Bangladesh.

Apprenez-en plus sur les solutions financières dirigées par les jeunes au Rwanda.

Apprenez-en plus sur l’amélioration de la mesure, de la notification et de la vérification des émissions de gaz à effet de serre en collaboration avec l’Alliance du Pacifique.

Apprenez-en plus sur l’aide apportée aux migrants LGBTQ2+ en Équateur.

Apprenez-en plus sur les équipes de déminage formées sur place en Irak.
Colombie
La Colombie se remet de 50 ans de conflit interne et gère actuellement une migration de masse venant du Venezuela. Le Canada est en première ligne des efforts visant à aborder le développement sous un angle différent en Colombie afin de générer plus de retombées et de multiplier les partenariats entre le secteur privé et le gouvernement, tout cela pour faire progresser l’égalité des genres, aider les petits producteurs à créer des entreprises viables grâce aux coopératives et au crédit, et améliorer les résultats en matière d’éducation. Le Canada répond à la crise des réfugiés et des migrations en fournissant une aide humanitaire et une aide au développement solides aux migrants et aux collectivités qui les accueillent, et aide le gouvernement de la Colombie à obtenir de nouveaux fonds de la Banque mondiale pour faire face à la crise.
Mali
Depuis 2012, la crise multidimensionnelle que connaît le Mali a miné les progrès vers un développement équitable pour les Maliennes et Maliens, exacerbé la situation humanitaire et l’insécurité alimentaire et provoqué la fermeture d’écoles. Pour répondre aux besoins qui en découlent, le Canada contribue à améliorer l’accès aux services sociaux de base, notamment en matière de santé, d’alimentation et d’éducation. Le Canada encourage une croissance inclusive, l’égalité des genres et une gouvernance responsable, contribuant ainsi à créer un environnement propice à une paix durable. L’initiative Justice, prévention et réconciliation, financée par Affaires mondiales Canada, favorise l’accès à des services juridiques pour les victimes de la crise et aide les dirigeants du Mali dans leurs efforts pour encourager la réconciliation et prévenir les conflits.
Ukraine
L’Ukraine est en pleine transformation économique, sociale et institutionnelle et vue de renforcer sa démocratie et la règle de droit. Et cette transformation a lieu alors que le pays est en plein conflit. L’aide exhaustive du Canada contribue à renforcer la prestation des services publics, à épauler les populations touchées par les conflits, à affermir les réformes de l’armée et de la police, à soutenir la lutte contre la désinformation et à donner aux citoyens, en particulier aux femmes et aux populations vulnérables, les moyens de participer à la gouvernance de leur pays. Parmi les points saillants récents, citons le soutien à la création de 535 cliniques d’aide juridique gratuite pour les plus Ukrainiens les plus vulnérables.
Afghanistan
Malgré 40 ans de conflit, l’Afghanistan a continué à faire des progrès impressionnants en matière de développement et à transformer les relations avec les citoyens et la gouvernance. Le Canada contribue à créer un environnement plus pacifique où tous les Afghans sont en sécurité, car il appuie les priorités de l’Afghanistan en matière de santé, d’éducation et de droits de la personne et renforce les Forces de défense et de sécurité nationale afghanes. La défense des droits des femmes et des filles, la mise en place de mesures de lutte contre la corruption plus efficaces, l’amélioration de la primauté du droit et la prestation d’aide humanitaire aux personnes qui en ont le plus besoin sont d’autres priorités. Par exemple, en 2018-2019, le Canada a aidé 273 000 jeunes Afghans (parmi lesquels 81 % étaient des filles) à fréquenter des écoles communautaires. De plus, 17 571 patientes ont eu accès à des services obstétriques et gynécologiques, jusqu’alors non disponibles, offerts dans un hôpital que le Canada a aidé à construire.
Jordanie
Les crises régionales ont fait de la Jordanie un pays d’accueil généreux pour un grand nombre de réfugiés, ce qui sollicite considérablement les systèmes d’éducation, de santé et de protection sociale du pays. Le Canada contribue aux efforts de réforme de la Jordanie pour favoriser la croissance économique et créer des emplois. Nous fournissons notamment une aide humanitaire pour répondre aux besoins des réfugiés, en particulier les femmes et les filles, et des collectivités qui les accueillent. Notre aide au développement vise à améliorer la qualité de l’éducation et son accessibilité, en particulier pour les réfugiés et autres groupes vulnérables. Elle contribue aussi à l’amélioration des services municipaux et aux activités visant à stimuler la croissance économique, comme le développement des compétences, l’accès au financement et le soutien aux entreprises.
Mozambique
Le Mozambique se classe 180e sur 189 pays dans l’indice de développement humain de 2019. En 2018-2019, le Canada a contribué aux programmes et aux efforts de sensibilisation visant à réduire les disparités entre les hommes et les femmes en matière de santé et d’éducation, à renforcer le pouvoir des femmes et des filles et à renforcer la gouvernance. Le Canada a, par exemple, aidé des partenaires de la société civile et du gouvernement dans leurs efforts qui ont abouti à l’adoption d’une loi contre le mariage des enfants, à la modernisation du code d’enregistrement des actes d’état civil, à l’amélioration de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à la hausse des inscriptions dans les écoles. À l’échelle nationale, les inscriptions à l’école secondaire ont augmenté de 8,4 % entre 2017 et 2018.
Introduction
Ce rapport porte sur la totalité de l’aide internationale fédérale fournie par le Canada entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, dont la majorité était de l’ADO. En tout, 19 institutions fédérales ont fourni plus de 6,1 milliards de dollars en aide internationale, dont 5,9 milliards en ADO. Les activités ont été déployées dans 149 pays et territoires, où le Canada a travaillé avec divers partenaires internationaux et locaux : gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), organismes internationaux, secteur privé, etc.
À l’instar du Rapport au Parlement sur l’aide au développement officielle du gouvernement du Canada de l’année dernière, le présent rapport s’articule autour des six champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe. D’autres parties décrivent les principes directeurs et les approches de l’aide internationale du Canada, comme la transparence, l’efficacité et l’innovation, ainsi que ses partenariats et collaborateurs.
Le Canada a fait d’importants progrès dans l’application de sa Politique d’aide internationale féministe, qui oriente la mise en œuvre par le Canada du Programme 2030. Le rapport donne des exemples de la façon dont le pays respecte ses engagements dans le monde en vue d’éliminer les obstacles à l’égalité des genres et de contribuer à réaliser les ODD du Programme 2030. Il présente aussi des améliorations importantes, comme l’enrichissement des données financières et statistiques, et une sélection de résultats cumulatifs de nombreux projets d’Affaires mondiales Canada. Il renvoie aussi à d’autres ressources Web pour en savoir plus.
Le Canada continue de travailler à améliorer l’efficacité de son aide internationale, notamment en favorisant l’ouverture et la transparence et en diffusant des résultats axés sur des preuves et des données améliorées. Le gouvernement du Canada se réjouit de l’intérêt, de la participation et de l’engagement continus de toutes les parties prenantes dans ses efforts d’aide internationale.
Enveloppe de l’aide internationale et présentation des décaissements en regard des allocations
L’enveloppe de l’aide internationale (EAI) est un regroupement de ressources dont le gouvernement du Canada se sert pour financer la majorité de l’aide internationale fédérale. La plus grande partie de l’aide internationale financée par l’EAI correspond à de l’aide au développement officielle (ADO). L’aide qui ne s’inscrit pas dans l’ADO comprend entre autres des activités de sécurité, de prévention des conflits, de stabilisation ou de consolidation de la paix qui ne répondent pas à la définition en raison de l’admissibilité du pays ou du type d’activité. Plusieurs organisations fédérales ont reçu un financement de l’EAI ces dernières années, notamment Affaires mondiales Canada, le ministère des Finances Canada, le Centre de recherches pour le développement international, Environnement et Changement climatique Canada, l’Agence du revenu du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. En 2018-2019, 5,6 milliards de dollars de l’aide internationale du Canada provenaient de l’EAI, soit 92 % de l’aide internationale fédérale totale.
Dans le budget de 2018, l’EAI a été réorganisée selon des réserves de fonds spécifiques qui servent à mieux définir et prévoir l’attribution de l’aide fédérale (Développement de base, Aide humanitaire, Institutions financières internationales, Paix et sécurité, Compte de crises et Fonds pour les priorités stratégiques). Des ressources additionnelles ont également été annoncées pour l’EAI, soit 2 milliards de dollars sur cinq ans (de 2018-2019 à 2022-2023).
Dans le budget de 2019, le gouvernement s’est engagé à rendre compte des dépenses par rapport aux allocations présentées dans le budget de 2018. La comparaison est présentée dans les graphiques ci-dessous.
1. Allocations annoncées dans le budget de 2018*

* Le Fonds pour les priorités stratégiques a été attribué aux réserves de fonds suivantes : Développement de base (96 %) et Aide humanitaire (4 %). Le Compte de crises a été attribué aux réserves de fonds suivantes : Aide humanitaire (70 %), Développement de base (29 %) et Paix et sécurité (1 %) pour la réponse à des crises internationales et la stabilisation. Le nouveau financement prévu dans le budget de 2018 a été réparti entre divers programmes s’inscrivant dans les réserves de fonds suivantes : Développement de base (75 %), Aide humanitaire (21 %) et Paix et sécurité (4 %).
Version texte
Allocations annoncées dans le budget de 2018
- Développement de base : 3 104 millions de dollars
- Nouveau financement du budget de 2018 : 200 millions de dollars
- Fonds pour les priorités stratégiques : 136 millions de dollars
- Institutions financières internationales : 777 millions de dollars
- Paix et sécurité : 401 millions de dollars
- Compte de crises : 200 millions de dollars
- Aide humanitaire : 738 millions de dollars
2. Décaissements en 2018-2019

* Le montant de la réserve de fonds Aide humanitaire est différent de celui indiqué dans le Rapport statistique sur l’aide internationale à titre d’aide humanitaire du Canada (919 millions de dollars), qui est fondé sur la norme internationale de communication de l’information et non sur les sources de fonds. Les différences sont essentiellement attribuables à la portée (Canada par opposition à l’enveloppe de l’aide internationale), à l’aide multilatérale imputée qui est communiquée en regard des secteurs humanitaires ex-post, ainsi qu’à la méthodologie utilisée (affectations par opposition aux dépenses).
** Un montant exceptionnel de 250 millions de dollars versé à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a ensuite été ajouté à la réserve de fonds Institutions financières internationales pour une augmentation de la part de capital.
Version texte
Décaissements en 2018-2019
- 3 235 M$ pour le développement de base, incluant :
- Compte de crises
- Fonds pour les priorités stratégiques
- Nouveau financement du budget de 2018
- 438 M$ pour la paix et la sécurité, incluant :
- Compte de crises
- Nouveau financement du budget de 2018
- 867 M$*pour l'aide humanitaire, incluant :
- Compte de crises
- Fonds pour les priorités stratégiques
- Nouveau financement du budget de 2018
- 1 062 M$** pour les institutions financières internationales
Aide internationale et versements d’aide au développement officielle du gouvernement du Canada par organisation, 2018-2019
Le gouvernement du Canada a versé 6,1 milliards de dollarsNote de bas de page 1 en aide internationale en 2018-2019, par le truchement de 19 organisations fédérales. L’ADO en représentait 97 %, soit 5,9 milliards de dollars. Le Rapport statistique sur l’aide internationale fournit des détails supplémentaires sur l’aide internationale et les dépenses d’ADO par source, secteur et bénéficiaire, et donne des informations sur les voies de décaissement de l’enveloppe de l’aide internationale (EAI).
Le tableau suivant indique le montant déboursé par chacune des 19 organisations fédérales.
| Organisation | Aide internationale | notamment | |
|---|---|---|---|
| Aide financée par l’EAI | ADO | ||
| Affaires mondiales Canada | 4 647,51 | 4 619,67 Versée à partir des réserves de fonds suivantes :
| 4 479,68 |
| Ministère des Finances Canada | 796,65 | 796,65 Versée à partir de la réserve de fonds Institutions financières internationales | 788,63 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 389,79 | - | 389,79 |
| Centre de recherches pour le développement international | 156,01 | 156,01 Versée à partir de la réserve de fonds Développement de base | 156,01 |
| Environnement et Changement climatique Canada | 19,81 | 13,49 Versée à partir de la réserve de fonds Développement de base | 19,57 |
| Gendarmerie royale du Canada | 15,13 | 15,13 Versé à partir de la réserve de fonds Paix et sécurité | 15,13 |
| Agence du revenu du Canada | 5,26 | 1,74 Versé à partir de la réserve de fonds Développement de base | 5,26 |
| Ministère de la Défense nationale | 4,75 | - | 4,75 |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 0,99 | - | 0,99 |
| Emploi et Développement social Canada | 0,94 | - | 0,94 |
| Parcs Canada | 0,92 | - | 0,92 |
| Agence de la santé publique du Canada | 0,78 | - | 0,78 |
| Postes Canada | 0,39 | - | 0,39 |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 0,31 | - | 0,31 |
| Statistique Canada | 0,27 | - | 0,27 |
| Agence spatiale canadienne | 0,20 | - | 0,20 |
| Office de la propriété intellectuelle du Canada | 0,05 | - | 0,05 |
| Musée canadien de la nature | 0,02 | - | 0,02 |
| Commission de la fonction publique | 0,01 | - | 0,01 |
| Services appuyant les activités d’Affaires mondiales Canada | 19,95 | - | 19,95 |
| Total des organisations fédérales | 6 059,72 | 5 602,69 | 5 883,63 |
| Autres sources (à des fins d’information et d’exhaustivité) | Aide publique au développement | ||
| Coût liés aux réfugiés sur le territoire canadien (première année) – Gouvernements provinciaux et territoriaux | 244,92 | - | 244,92 |
| Subventions imputées aux étudiants étrangers | 46,78 | - | 46,78 |
| FinDev Canada | - | - | - |
| Provinces, territoires et municipalités | 43,48 | - | 43,48 |
| Sous-total (autres sources) | 335,18 | - | 335,18 |
| Total – ensemble du Canada | 6 394,90 | 5 602,69 | 6 218,82 |
Soutien aux objectifs de développement durable
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est un appel mondial à l’action visant à mettre fin à l’extrême pauvreté, à protéger la planète et à faire en sorte que tous et toutes jouissent de la paix et de la prospérité. Au cœur du programme se trouvent 17 objectifs de développement durable (ODD) et l’engagement de n’abandonner personne. Pour la première fois de l’histoire, les pays en développement et les pays développés mettent en œuvre un programme universel qui cherche un équilibre entre les trois dimensions du développement durable : les dimensions sociale, économique et environnementale. Par des actions nationales et internationales, le Canada s’efforce de faire progresser tous les aspects des ODD.
À l’international, l’application par le Canada du Programme 2030 sera dictée par sa Politique d’aide internationale féministe. L’Objectif 5 – Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles – est au cœur de l’approche qu’a adoptée le Canada pour mettre en œuvre le Programme 2030.
En 2018, le Canada a présenté son premier Examen national volontaire au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Le rapport décrivait les actions et les mesures prises par le Canada depuis 2015 pour atteindre les ODD, les progrès réalisés, les défis qui restent à relever et les plans d’avenir.
Toujours en 2018, le gouvernement du Canada a créé une unité des ODD qui relève d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Cette équipe supervise la mise en œuvre du programme de financement des ODD et la formulation de la stratégie nationale du Canada pour l’application du Programme 2030, aussi annoncée dans le budget de 2018. Elle coordonne également la réalisation des ODD par le gouvernement fédéral, dirige les consultations et assure la coordination avec les autres ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les organisations de la société civile (OSC), le secteur privé et les autres intervenants concernés sur les efforts du Canada pour soutenir le Programme 2030. Si tous les ministres sont tenus de faire progresser les ODD, le premier ministre a demandé à six ministères principaux d’assumer un rôle d’intendance et de superviser les progrès réalisés par rapport aux ODD, dont Affaires mondiales Canada, qui dirige leur mise en œuvre sur le plan international.
En 2018-2019, EDSC a lancé un document intitulé Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, première étape vers la formulation d’une stratégie nationale pour les ODD. D’autres efforts sont en cours pour que ce document provisoire devienne une stratégie nationale qui traduit une approche coordonnée de l’ensemble de la société pour la mise en œuvre du Programme 2030 par le Canada.
Mesure des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable
Statistique Canada participe à plusieurs groupes d’experts internationaux axés sur l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des ODD. Cette participation a aidé des pays, dont des pays en développement, à adopter des mesures statistiques et des indicateurs rigoureux permettant d’évaluer les progrès par rapport au Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En 2018-2019, Statistique Canada a continué de jouer un rôle clé au sein du Groupe d’experts et interinstitutions des Nations Unies sur les indicateurs relatifs aux ODD, et est resté membre du Groupe directeur sur les statistiques des ODD de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. L’agence est également membre de plusieurs groupes de travail des Nations Unies et de groupes de travail informels pour des ODD et des indicateurs spécifiques, afin de garantir la solidité du cadre mondial entourant les indicateurs du Programme 2030.
Cette participation a permis à Statistique Canada de contribuer considérablement à l’élaboration d’indicateurs mondiaux de mesure des progrès accomplis vers la réalisation des ODD, en plus de soutenir les systèmes statistiques des pays en développement pendant la mise en œuvre du Programme 2030. Pour en savoir plus, consultez le Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable du gouvernement du Canada, hébergé par Statistique Canada.






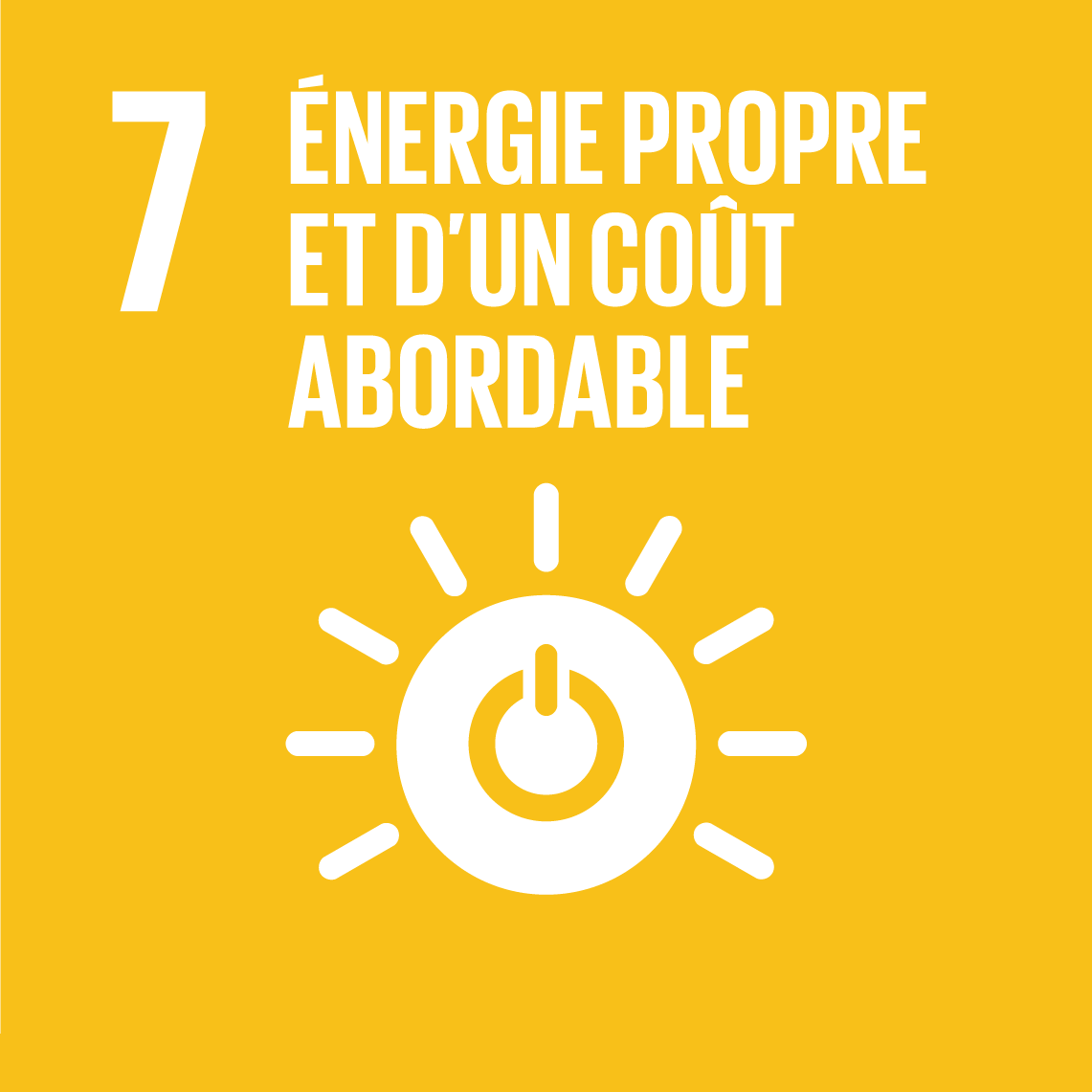





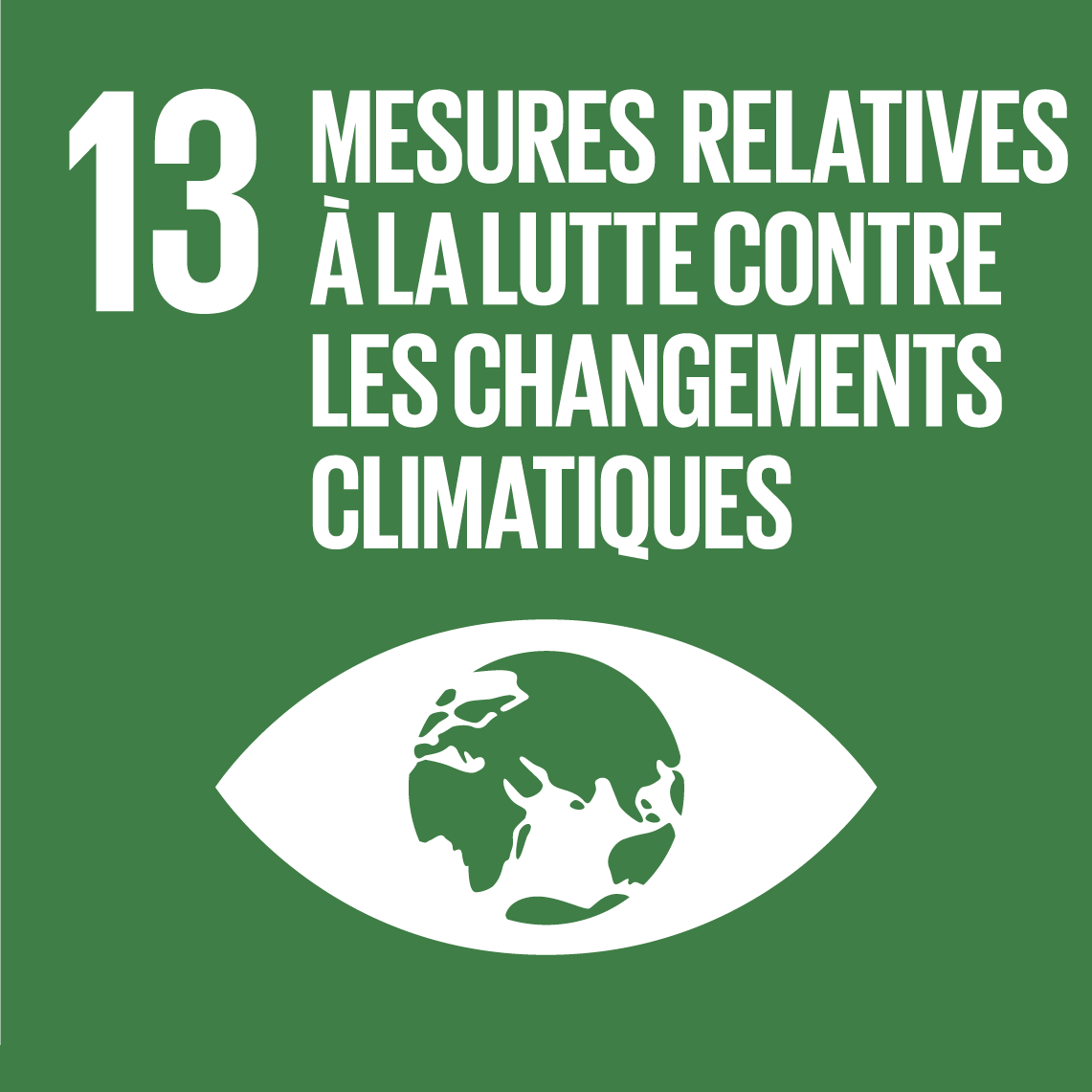



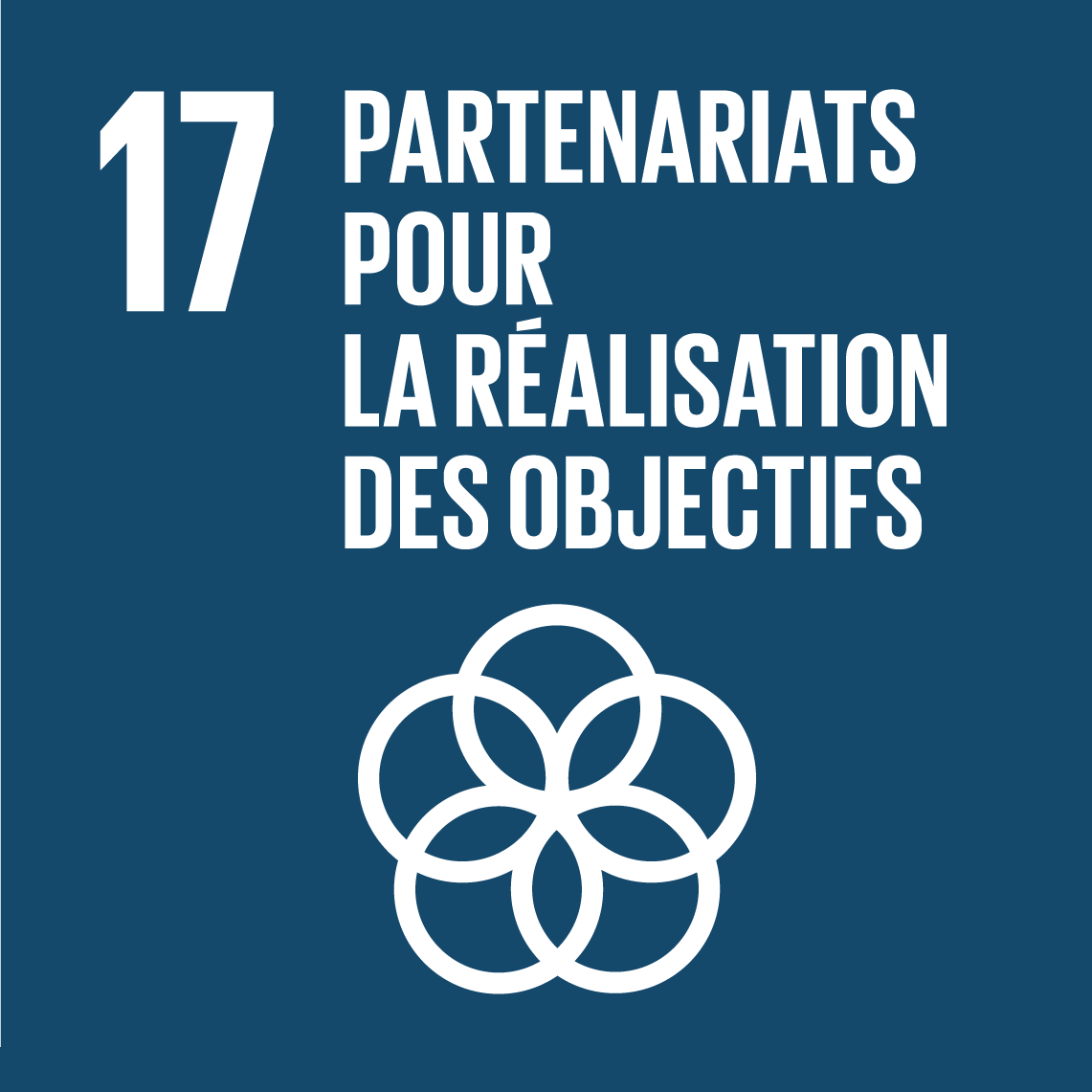
Politique d’aide internationale féministe du Canada
La Politique d’aide internationale féministe du Canada, adoptée en 2017, a pour but de bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Le Canada croit fermement que la promotion de l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles constituent la manière la plus efficace d’atteindre cet objectif. Notre engagement en faveur d’une stratégie féministe en matière d’aide internationale représente un changement significatif dans ce que nous faisons, comment nous le faisons et où nous le faisons.
Cette politique est un élément clé dans les instruments du Canada en matière de politique étrangère, qui comprennent une série de politiques internationales comme le programme commercial inclusif, le deuxième Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité et la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. La Politique soutient et oriente la mise en œuvre par le Canada du Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’Objectif 5 — Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles — est au cœur de l’approche du Canada pour la mise en œuvre du Programme 2030, car cela favorisera les progrès vers la réalisation des autres ODD.
La Politique d’aide internationale féministe du Canada est le résultat d’un examen exhaustif de l’aide internationale dans lequel s’inscrivaient de vastes consultations avec des partenaires et des intervenants canadiens et internationaux. L’objectif de l’examen était de vérifier que l’aide internationale du Canada était centrée sur l’aide aux plus pauvres et aux plus marginalisées, appuyait les États fragiles et alignait nos priorités d’aide internationale sur le Programme 2030. L’approche consultative pangouvernementale adoptée par l’examen a permis de tirer parti de l’expertise de citoyens, de la société civile, de chercheurs universitaires et de fonctionnaires partout au Canada, dans le but de formuler une politique exhaustive reposant sur des faits probants.
Transformer l’action du Canada
La Politique d’aide internationale féministe adopte une approche intégrée de l’aide au développement, de l’aide humanitaire et du soutien à la paix et à la sécurité. Cette approche compte six champs d’action interreliés qui tiennent compte de l’expérience et de l’avantage comparatif du Canada :
- l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles (principal champ d’action);
- la dignité humaine, qui comprend :
- la santé et la nutrition,
- l’éducation,
- l’action humanitaire tenant compte des genres;
- la croissance au service de tous;
- l’environnement et l’action pour le climat;
- la gouvernance inclusive;
- la paix et la sécurité.
Pour assurer un changement véritable, le Canada a adopté une stratégie globale pour les six champs d’action, qui compte des programmes, des politiques et des efforts de sensibilisation. Cette stratégie éclaire les cadres de résultats, les rapports d’étape et l’évaluation des résultats. Le 5 juillet 2019, le Canada a lancé des politiques dans ces champs d’action afin de fournir des précisions sur ce qu’il cherche à réaliser par le biais de la Politique d’aide internationale féministe. Les politiques des champs d’action aident à définir les paramètres généraux de l’aide internationale du Canada, tout en permettant une certaine souplesse en fonction du contexte national et institutionnel.
Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Politique d’aide internationale féministe et fixe sans cesse les priorités parmi les objectifs de ses programmes pour qu’ils cadrent avec les cibles de la Politique.
L’un des grands engagements de la Politique est que, d’ici 2021-2022, au moins 95 % des investissements d’aide bilatérale au développement international seront injectés à des initiatives qui cibleront ou intégreront l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, dont 15 % devront cibler expressément ces objectifs.
Le Canada a déjà fait d’importants progrès dans la réalisation de ces engagements. En 2018-2019, plus de 99,9 % de l’aide bilatérale au développement international récemment approuvée d’Affaires mondiales Canada ont ciblé ou intégré l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et 22,2 % de l’aide visait spécifiquement ces objectifs. Ces nouveaux investissements ont porté à 94,9 % le pourcentage global des décaissements d’aide bilatérale au développement international ciblant ou intégrant l’égalité des genres en 2018-2019, dont 6,2 % ciblaient expressément l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
En 2018-2019, le Canada a continué à augmenter les investissements dans la mise en œuvre de la Politique :
- Le budget de 2018 a annoncé une hausse de 2 milliards de dollars sur cinq ans en aide internationale, à laquelle est venu s’ajouter un financement supplémentaire de 700 millions en 2023-2024, annoncé dans le budget de 2019.
- Le Canada a pris la tête d’une initiative du G7 sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement, et a contribué à hauteur de 400 millions à un financement historique de 3,8 milliards de dollars pour l’éducation de qualité des filles et des femmes dans les situations de conflit et de crise.
Le Canada progresse dans la mise en œuvre des initiatives énoncées par la Politique. Par exemple :
- En 2017, il a engagé 650 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la santé et les droits reproductifs des femmes et des adolescentes. En 2018-2019, une tranche de 408 millions de dollars avait été investie en programmes fonctionnels. L’initiative Partenariats pour sa voix, son choix, par exemple, contribue à améliorer l’accès des femmes à une éducation sexuelle complète, à des moyens de contraception, à la planification familiale, à des avortements sûrs et légaux et à des soins après avortement. Le Canada joue également un rôle de premier plan au sein de mouvements et de partenariats internationaux comme les initiatives Chaque femme, chaque enfant, She Decides, Family Planning 2020 et le Partenariat de Ouagadougou.
- En 2018-2019, le Canada a fait progresser la mise en œuvre du programme « Voix et leadership des femmes », pour lequel il a engagé 150 millions de dollars sur cinq ans. À la fin de 2018-2019, 28 projets avaient été lancés dans le cadre du programme pour soutenir des organisations et des réseaux de femmes dans 30 pays et régions, dont le Ghana, le Mozambique et la Tunisie. Le programme contribue, entre autres avantages, à renforcer la capacité des organisations pour les droits des femmes de mettre en œuvre des programmes et de défendre l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
Le Canada réalise également des progrès significatifs en matière de développement, d’aide humanitaire, de stabilisation et de diplomatie dans des domaines prioritaires importants :
- favoriser le leadership et la participation de toutes les femmes et les filles comme agentes du changement;
- intensifier les opérations de paix en vue de faire progresser le Plan d’action du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment en déployant plus de femmes au sein des troupes de maintien de la paix et parmi les membres du personnel civil.
- accroître l’accès des femmes et des adolescentes à tous les types de services de santé sexuelle et reproductive, y compris leur accès à la contraception;
- renforcer les organisations et mouvements de femmes qui défendent les droits des femmes, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;
- augmenter le nombre de filles qui terminent leurs études élémentaires et secondaires;
- améliorer l’accès des femmes aux terres, aux ressources productives, aux services financiers et aux droits à l’héritage et à la propriété, accroître leur contrôle en la matière, encourager leur participation à l’économie et renforcer leur pouvoir économique;
- mieux répondre aux besoins des femmes dans les situations de crise humanitaire et réduire les incidents d’exploitation sexuelle et de mauvais traitements;
- renforcer la résilience aux changements climatiques et soutenir une agriculture adaptée au climat;
- accroître la participation des femmes, des filles et des personnes appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés au leadership public, à la prise de décisions et aux processus démocratiques;
- intensifier les opérations de paix en vue de faire progresser le Plan d’action du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, notamment en déployant plus de femmes au sein des troupes de maintien de la paix et parmi les membres du personnel civil.
Transformer la façon dont le Canada apporte son aide internationale
Le Canada continue de maximiser l’efficacité de son aide internationale, notamment en la rendant plus flexible, intégrée et adaptée aux besoins. Son approche féministe maximise la portée de son aide internationale, car elle s’attaque à la discrimination et à l’inégalité qui sont les causes sous-jacentes de la pauvreté. La Note d’orientation sur l’approche féministe du Canada détaille les principes, leviers de changement et pistes d’action pour mettre en œuvre une approche féministe cohérente. Le Canada investit également dans l’innovation et la recherche afin d’élargir la portée des résultats obtenus de façon novatrice. Une note d’orientation a été produite concernant l’approche du Canada relative à l’innovation dans l’aide internationale. En 2018-2019, le Canada a été le premier pays à s’engager activement dans ce domaine et a fait progresser l’innovation lors de sa présidence du G7 et à l’OCDE (pour plus d’informations, consultez la section « Favoriser l’innovation dans le travail de développement » du présent rapport). En outre, le Canada a fait des progrès dans son investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour financer les petits et moyens organismes (PMO) du Canada. Ces investissements soutiennent la conception et la mise en œuvre de programmes novateurs en partenariat avec des organisations locales en vue de soutenir les six champs d’action de la Politique, et plus particulièrement l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
Lors du Sommet du G7 à Charlevoix, au Québec, l’attention des membres du G7 a été attirée sur la question du financement novateur pour le développement. Dans le budget de 2018 ont été annoncés le Programme d’innovation en aide internationale et le Programme de prêts souverains qui s’ajouteront aux instruments de développement du Canada et renforceront notre capacité à tirer parti de l’aide internationale canadienne pour mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement durable. En juin 2018, le Canada a publié une Note d’orientation sur son approche en matière de financement novateur du développement durable, qui expose pourquoi, comment et quand le Canada s’appuiera sur des instruments financiers novateurs pour soutenir la réalisation des objectifs de sa Politique d’aide internationale féministe et des ODD. Un engagement de 300 millions de dollars a aussi été annoncé en 2018 pour nouer un nouveau partenariat pour l’égalité des genres – le Fonds Égalité – qui vise à encourager les philanthropes et le secteur privé à se joindre au gouvernement et à la société civile pour mobiliser des niveaux de ressources sans précédent grâce à un partenariat unique en faveur de l’égalité des genres et des droits des femmes.
D’autres efforts sont en cours pour maximiser l’efficacité de l’aide internationale du Canada, notamment pour accroître la transparence de l’aide et favoriser un dialogue ouvert, comme le souligne une Note d’orientation sur l’approche du Canada en la matière, et pour promouvoir des partenariats plus efficaces, diversifiés et inclusifs qui font progresser les intérêts des femmes et des filles. En septembre 2017 a été lancée la Politique du Canada des partenariats avec la société civile pour l’aide internationale : une approche féministe qui vise à favoriser la coopération efficace avec la société civile canadienne, internationale et locale afin d’optimiser l’incidence et les résultats de l’aide internationale et de rendre la société civile plus robuste et dynamique. En 2018-2019, un groupe consultatif sur la Politique relative à la société civile composé de représentants d’Affaires mondiales Canada et d’organismes de la société civile a travaillé à la formulation d’un plan commun de mise en œuvre pour concrétiser les objectifs de la Politique. Le plan a été approuvé en 2019.
Transformer les lieux d’action du Canada
La Politique d’aide internationale féministe du Canada propose une approche géographique moins figée, qui va au-delà des pays de concentration, pour mieux répondre aux besoins locaux et aux occasions à saisir dans les pays où nous sommes présents. Cette nouvelle approche permet au Canada de cibler l’aide dans les régions où elle contribuera le plus à faire reculer la pauvreté et les inégalités, en particulier chez les femmes et les filles. Elle facilite aussi un déploiement plus cohérent de l’aide au développement, de l’aide humanitaire et du soutien à la paix et à la sécurité. Elle rend aussi compte de façon plus réaliste des types de partenariat que le Canada utilise pour déployer son aide, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale et livrée de concert avec la société civile et le secteur privé.
De plus, le Canada a fait des progrès en regard de son engagement, énoncé dans la Politique, de consacrer au moins 50 % de son aide bilatérale pour le développement international aux pays de l’Afrique subsaharienne d’ici 2021-2022. En 2018-2019, 45 % de l’aide bilatérale au développement international ont été versés aux pays de l’Afrique subsaharienne. Cela constitue une légère baisse de 3 % en 2018-2019 par rapport à l’année précédente, attribuable à d’importants investissements dans d’autres régions et au soutien de priorités gouvernementales plus générales, comme les crises au Myanmar et au Venezuela.
Le Canada prône la prestation d’aide internationale dans des contextes fragiles selon une approche cohérente et concertée, conformément aux pratiques exemplaires internationales énoncées dans le rapport historique de l’ONU et de la Banque mondiale Chemins pour la paix (2018). Le Canada a également pris des mesures concrètes pour intégrer les éléments relatifs aux conflits dans l’ensemble de son aide internationale, dans tous les champs d’action. Pour ce faire, nous avons examiné comment notre aide internationale et la dynamique des conflits interagissent afin de pouvoir atténuer les risques et de maximiser la portée de nos actions.
Pour en savoir plus, consultez la Politique d’aide internationale féministe
Champ d’action : L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles
ODD soutenus dans le cadre du champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles


* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles constituent le champ d’action principal de la Politique d’aide internationale féministe, et un objectif stratégique pour tous les champs d’action.
L’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont des éléments fondamentaux de la reconnaissance réelle des droits de la personne, de l’élimination de la pauvreté, ainsi que de l’instauration du développement durable et de la paix. Les femmes et les filles peuvent être de puissantes agentes de changement, mais en raison d’inégalités persistantes fondées sur le genre, un nombre disproportionné de femmes et de filles se heurtent à la violence, à la discrimination et à la marginalisation socioéconomique. Il faut davantage promouvoir des milieux qui leur permettent d’avoir un accès égal à la prise de décisions au sein de leur foyer et dans la société, de contrôler leur vie et leur corps, et de contribuer au développement et à la prospérité et d’en tirer profit en toute égalité. Le Canada cherche à faire progresser l’égalité des genres et à accélérer les progrès dans toutes ses priorités. En ce qui concerne ce champ d’action, le Canada crée un espace permettant d’investir dans des efforts soutenus et coordonnés en vue de relever les défis fondamentaux et multidimensionnels que représentent l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
À ce titre, dans le cadre de ce champ d’action en particulier, le Canada fait progresser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles selon trois volets :
- contribuer à lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG), y compris les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, ainsi que la mutilation génitale féminine ou l’excision;
- soutenir et renforcer les organisations et mouvements de femmes qui jouent un rôle important pour défendre les droits, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles;
- appuyer la formulation de politiques et la mise en œuvre de programmes visant l’égalité des genres, qui se fondent sur des données probantes.
Pour en savoir davantage sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Bangladesh : 8,5 millions de dollars
Afghanistan : 5,6 millions de dollars
Cisjordanie et Gaza : 3,8 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 90,25 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 88,44 millions en ADO, dans le cadre d’efforts consacrés spécifiquement aux enjeux d’au moins l’un des trois volets ci-dessus. Puisque l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles sont le moteur de tous les champs d’action en vertu de la Politique d’aide internationale féministe, d’autres enjeux, comme le renforcement économique et politique du pouvoir des femmes, l’éducation de qualité pour les femmes et les filles, la santé et les droits sexuels et reproductifs, sont déclarés séparément, dans leurs champs d’action respectifs. En gros, lorsque l’on compte tous les champs d’action, 2,8 milliards de dollars (soit 94,9 %) de l’aide bilatérale au développement d’Affaires mondiales Canada ciblent ou intègrent l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles en 2018-2019.
Dans le champ d’action de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles, le Canada collabore avec des partenaires étrangers, canadiens et locaux afin d’accroître les connaissances et les capacités dans les pays en développement pour qu’ils s’attaquent aux obstacles nuisant à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Le Canada soutient également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes, y compris ceux des organisations et des institutions publiques de femmes, afin de prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre et d’y répondre, d’éliminer les écarts entre les genres et de promouvoir le changement social en faveur de l’égalité des genres.
L’une des initiatives phares du Canada est le Programme Voix et leadership des femmes (VLF), lequel permet de soutenir des organisations et des réseaux communautaires de femmes qui font avancer les droits des femmes et des filles. Les projets du programme VLF sont mis en œuvre localement et conçus pour répondre aux besoins et aux priorités des organisations locales de femmes. En 2018-2019, le programme a permis de mettre en œuvre des projets dans 13 pays d’Afrique subsaharienne et un projet régional. Sur le continent américain, des projets du programme VLF ont été établis dans la région des Caraïbes et en Colombie, en Haïti, au Honduras et au Pérou. Dans la région de l’Asie-Pacifique, des projets ont été établis en Afghanistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Myanmar et au Pakistan et au Sri Lanka. Des projets du programme VLF ont été mis en œuvre au Maroc, en Tunisie et en Ukraine.
408 323 personnes ont été touchées par des projets visant la prévention ou l’interdiction de la violence sexuelle et fondée sur le genre, incluant les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés, et les mutilations génitales fémininesNote de bas de page 2.
Les initiatives du Canada ont entraîné :
- une plus grande sensibilisation, un meilleur accès aux services et l’application des lois liées à la VSFG et aux mariages d’enfants et aux mariages précoces et forcés;
- une influence et un pouvoir décisionnel accrus chez les adolescentes et les jeunes femmes dans toute leur diversité sur des questions qui les concernent elles-mêmes ainsi que leur avenir;
- l’efficacité accrue des organisations et des réseaux locaux et nationaux de femmes à stimuler le changement et à responsabiliser les gouvernements;
- des données probantes solides au sujet des causes profondes et des coûts des inégalités entre les genres.
Afrique subsaharienne
Le Canada a poursuivi l’avancement de ce champ d’action dans l’Afrique subsaharienne pour accroître l’intégration de l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l’ensemble de ses programmes.
L’initiative Madame la Présidente au Kenya, mise en œuvre par Media Focus in Africa, est un exemple de projet axé sur le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. En tirant profit de la très grande popularité de la téléréalité au Kenya, le projet consistait à filmer et à diffuser une émission de téléréalité de 26 épisodes dans le cadre de laquelle on demandait aux participantes en lice pour le titre de « Madame la Présidente » de présenter des stratégies et des solutions sur certains des enjeux sociopolitiques contemporains les plus difficiles. Diffusée de février à juillet 2019, l’émission très prisée a retenu l’attention générale et a permis de mettre en vitrine les solides compétences en leadership des Kényanes. Fait notable, l’émission a également permis de lancer des discussions et des idées nouvelles sur des enjeux comme la lutte contre l’extrémisme violent, la correction des inégalités entre les genres en politique, la croissance économique inclusive et le changement du discours stéréotypé des médias sur les femmes.
Un autre exemple de soutien du Canada dans le cadre de ce champ d’action provient du projet Meilleure éducation grâce à la formation d’enseignants pour renforcer l’autonomie et les résultats au Mozambique, projet mis en œuvre par CODE, une ONG canadienne. Ce projet permet de former des enseignants à lutter contre la violence faite aux femmes et à changer les normes sociales préjudiciables en produisant des films au moyen de leur téléphone cellulaire (que l’on appelle « cellphilms »). Ces films portent sur des sujets difficiles, mais importants comme la violence familiale, les mariages forcés, les grossesses précoces, la répartition équitable des tâches ménagères entre les femmes et les hommes, et la violence sexuelle et fondée sur le genre. Ces films ont été utilisés dans les collèges de formation des enseignants.
Apprendre ensemble pour un leadership féministe

Pays : Ghana © Justin Cyprian Bayor
En février 2019, dans le cadre du Programme Voix et leadership des femmes, Affaires mondiales Canada a organisé un atelier à Accra, au Ghana, afin de bâtir des connaissances et une fondation communes pour la surveillance, l’évaluation et l’apprentissage féministes. Les partenaires de mise en œuvre, les organisations locales de femmes de plus de 14 pays et le personnel d’Affaires mondiales Canada ont collaboré pour encadrer les discussions. Les différentes étapes de l’atelier étaient axées sur les façons de recueillir des données et d’apprendre de façon simplifiée des méthodes efficaces permettant de mobiliser les partenaires et de mesurer l’incidence des organisations communautaires de femmes sur la promotion de l’égalité entre les genres et des droits des femmes. L’atelier était financé par Affaires mondiales Canada et l’African Women’s Development Fund, qui a une expérience considérable dans le financement direct d’organisations de femmes en Afrique et en a tiré plusieurs leçons. Les participants ont examiné les procédures pour mesurer les résultats et ont effectué une analyse pour déterminer si ces procédures permettaient réellement la participation des femmes et des filles marginalisées provenant de milieux ruraux et agricoles ou de centres urbains en mesurant le taux de réussite du projet, et ont appris de nouvelles compétences pour les mobiliser.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Voix et leadership des femmes - Ghana.
Amériques
Le Canada a fait d’importantes contributions dans ce champ d’action sur le continent américain. Le projet Protéger les filles et adolescentes contre la violence sexuelle et les grossesses et unions précoces, mis en œuvre en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a permis de concevoir et de déployer des ateliers au Honduras, au Nicaragua et au Salvador. Au Nicaragua, le projet a accordé la priorité aux régions présentant les indicateurs les plus élevés de mortalité maternelle, de grossesses et de violence chez les adolescentes, et a permis de renforcer une éducation sexuelle exhaustive tant dans les contextes officiels que non officiels.
Au Guatemala, le Canada s’est concentré sur la promotion d’une gouvernance inclusive qui tient compte des genres, sur l’accroissement de l’utilisation par les groupes de femmes des mécanismes internationaux des droits de la personne, et sur la formation concernant les normes internationales en matière de droits de la personne. Le Canada a également fait la promotion des droits des femmes et des filles en Amérique latine et dans les Caraïbes par l’intermédiaire du Groupe de travail interaméricain sur le renforcement du pouvoir des femmes et leur leadership. Il s’agit d’une collaboration entre des institutions clés interaméricaines et onusiennes pour accroître la participation des femmes aux processus décisionnels publics.
Asie-Pacifique
Dans la région de l’Asie-Pacifique, le Canada a consolidé ses partenariats avec les organisations de femmes pour faire progresser l’égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes. En Indonésie, le Canada a collaboré avec des organisations de défense des droits des femmes, des entreprises dirigées par des femmes, le grand public et des acteurs du secteur privé pour accroître les compétences en leadership des femmes dans les processus démocratiques et économiques, et pour rehausser la protection des droits des femmes.
Le Canada a continué de lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre en Afghanistan, où il a soutenu l’application de lois visant à éliminer la violence faite aux femmes. Le Canada a également aidé 7 754 personnes travaillant à prévenir la VSFG, à lutter contre ce problème et à y mettre fin. Au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, au Népal, au Pakistan et aux Philippines, le Canada a travaillé avec Oxfam Canada (en anglais) sur le projet Établir un environnement favorable pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles afin de réduire la violence faite aux femmes et aux filles et la prévalence des mariages d’enfants et des mariages précoces et forcés. Au Népal, des centres de discussion communautaires ont été mis sur pied dans le cadre du projet, soit des espaces sûrs permettant aux femmes de discuter de VSFG et des mariages d’enfants et des mariages précoces et forcés.
kNOw Fear : Rendre les espaces publics ruraux plus sûrs pour les femmes et les filles

Pays : Inde © Steven Morris, CRDI
En raison de la crainte de la violence sexuelle et fondée sur le genre, 450 millions de femmes et de filles des collectivités rurales en Inde restent à la maison, ce qui les empêche d’accéder à l’éducation et à d’autres possibilités.
Le Centre de recherches pour le développement international du Canada soutient le kNOw Fear, le premier modèle permettant d’examiner la sécurité des femmes dans les espaces publics des collectivités rurales de l’Inde. L’initiative kNOw Fear réunit l’expertise de trois organisations indiennes pour documenter la nature de la violence sexuelle et fondée sur le genre, déterminer la portée du problème et concevoir des interventions. Par exemple, l’absence de transport sécuritaire vers une école secondaire peut empêcher un grand nombre de filles de poursuivre des études secondaires. En réponse, les femmes d’un village rural se sont organisées et ont fait pression, avec succès, auprès de leur conseil municipal pour qu’un autobus du gouvernement emmène les filles à l’école et les ramène à la maison en toute sécurité.
L’équipe de kNOw Fear prépare le terrain pour un changement générationnel en travaillant avec les jeunes du village en vue de remettre en question les conventions qui favorisent les garçons au détriment des filles. Cela s’inscrit dans une stratégie à long terme pour répondre aux normes culturelles profondément ancrées qui nuisent à la sécurité des femmes et des filles.
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez consulter le site Web du CRDI.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
En Ukraine, en Cisjordanie et Gaza, en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie, le Canada se concentre sur la progression des droits des femmes et la réduction de la violence sexuelle et fondée sur le genre. En Ukraine, le premier plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été élaboré et approuvé. Cela a été rendu possible en partie grâce au soutien du Canada et au leadership de la vice-première ministre de l’Ukraine, responsable de la Coordination de l’égalité des genres et de l’Intégration européenne et euro-atlantique.
Afin de réduire la vulnérabilité à la VSFG en Cisjordanie et Gaza, le Canada, par l’intermédiaire de son projet de développement des capacités en criminalistique et médecine légale, a formé 7 médecins (dont une femme) dans le domaine de la médecine légale, 16 infirmiers en soins infirmiers médico-légaux et en matière de violence sexuelle et fondée sur le genre, et 4 femmes scientifiques à titre de spécialistes dans les enquêtes de médecine légale. Quatre cliniques ont été équipées pour l’examen de victimes de VSFG. Les capacités cliniques en matière de médecine légale ont été élargies, et les procédures d’utilisation normalisées tenant compte du genre qui réglementent et intègrent les travaux d’intervenants pertinents ont été établies. Un code de pratique pour les praticiens palestiniens en médecine légale a été élaboré, lequel comporte les enjeux liés au genre, y compris le maintien de la confidentialité, la protection des renseignements personnels et la protection contre la discrimination.
Multirégion
Le Canada a contribué aux investissements dans ce champ d’action au moyen de ses contributions centrales et volontaires à diverses organisations mondiales multilatérales. Le Canada a soutenu la mise au premier plan de l’égalité des genres par le Groupe de la Banque mondiale (GBM), notamment au moyen de sa stratégie sur l’égalité entre les genres. En 2018, le GBM a intensifié ses efforts en vue du renforcement du pouvoir économique des femmes et de la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre. En 2018, le GBM a publié Unrealized Potential: the high cost of gender inequality in earnings (en anglais). Le rapport présente une analyse des données provenant de 141 pays, représentant plus de 95 % de la population mondiale, et permet de constater que, en 2014, la perte de richesse à l’échelle mondiale en raison de l’inégalité entre les genres était estimée à 160 200 milliards de dollars américains.
Le Canada a soutenu un certain nombre de projets clés avec la société civile internationale visant à éliminer les mariages d’enfants, ainsi que les mariages précoces et forcés. Par exemple, le Canada soutient l’initiative Filles, pas épouses, un partenariat mondial représentant plus de 1 300 organisations de la société civile de plus de 100 pays, lesquelles se sont réunies pour mettre un terme aux mariages d’enfants et aux mariages précoces et forcés. En 2018, l’initiative Filles, pas épouses a continué à raffiner et à élargir son soutien aux membres en travaillant avec 10 pays et États et dans 14 coalitions nouvelles et établies, au moyen d’ateliers, de formations, de réunions avec des représentants clés et d’un soutien continu.
Le Canada a soutenu les efforts du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) visant à éliminer les mariages d’enfants et les mariages précoces et forcés en abordant la santé et les droits sexuels et reproductifs et les grossesses chez les adolescentes dans six pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Par exemple, au moyen du projet Action pour les adolescentes, le soutien du Canada auprès de l’UNFPA en Sierra Leone a contribué à l’élaboration d’une stratégie nationale en vue de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes et les mariages d’enfants, dirigée par le secrétariat national pour la réduction du nombre de grossesses chez les adolescentes et lancée en décembre 2018. En outre, en collaboration avec l’UNICEF et les partenaires locaux, dans le cadre du Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, le soutien du Canada auprès de l’UNFPA en Sierra Leone a contribué à mettre en œuvre 225 plans d’action communautaires dans les 9 districts, qui mobilisent 14 374 familles et membres de la collectivité pour promouvoir des normes sociales positives en vue de prévenir les mariages d’enfants, les grossesses chez les adolescentes, ainsi que la mutilation génitale féminine ou l’excision.
Le Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC), hébergé au Centre de recherches pour le développement international (CRDI), est un centre international de ressources qui appuie activement les efforts nationaux visant à élaborer, à renforcer et à intensifier des systèmes d’ESEC utiles pour tous, surtout les femmes et les filles. Ces systèmes sont essentiels à la protection des droits de la personne et à l’amélioration de la santé reproductive et maternelle, de la santé du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, car ils fournissent une preuve d’identité juridique, ce qui facilite l’accès aux services sociaux, et produisent des statistiques qui fournissent les preuves essentielles nécessaires à l’amélioration de la prestation de ces services sociaux.
Champ d’action : La dignité humaine
Les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées se heurtent à des obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder à des ressources, à un soutien et à des services en matière de santé, de nutrition, et d’éducation. Elles connaissent également une vulnérabilité accrue en temps de crise. Lorsqu’elles ont accès aux services dont elles ont besoin, il est encore possible qu’elles subissent de la violence et de la discrimination en raison de rapports de pouvoir inégaux profondément enracinés. En conséquence, elles ne sont pas en mesure d’atteindre leur plein potentiel et de se sortir du cycle de la pauvreté. L’approche féministe du Canada en matière de dignité humaine est axée sur trois champs principaux :
- la santé et la nutrition,
- l’éducation,
- l’action humanitaire tenant compte des genres.
En 2018-2019, le Canada a investi un total de 2 670,67 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 2 667,37 millions en aide au développement officielle (ADO), dans le cadre d’initiatives du champ d’action de la dignité humaine.
La santé et la nutrition
ODD soutenus dans le cadre de la composante sur la santé et la nutrition du champ d’action de la dignité humaine*



* Les ODD sont soulignés en fonction d'objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
La réduction des inégalités en santé que connaissent les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables constitue la première étape en vue de possibilités et d’autonomisation. Au cours des dernières décennies, il y a eu une amélioration généralisée de l’espérance de vie, et les taux de mortalité chez les nourrissons et les enfants ont diminué, de même que le nombre d’enfants atteints de malnutrition. En raison de l’amélioration de l’hygiène, de la nutrition, des médicaments et des vaccins, l’incidence de nombreuses maladies infectieuses a également diminué.
Cependant, il reste beaucoup à faire. Les faibles systèmes de santé limitent la capacité des pays à répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels de leurs populations. L’accès inégal aux services de santé demeure un obstacle persistant, et les femmes et les filles en particulier se heurtent à un très grand nombre d’obstacles. Dans certains pays, les femmes et les filles n’ont toujours accès qu’aux aliments les moins nutritifs et mangent les dernières, ce qui nuit à leur santé et à celle de leurs enfants. Le respect en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs a également reculé dans différents endroits dans le monde. Cette situation menace le droit pour une femme de décider si et quand elle souhaite avoir des enfants, ainsi que le nombre d’enfants et la personne avec laquelle elle désire enfanter (le cas échéant). Ces décisions sont pourtant essentielles dans le cheminement de la vie d’une fille ou d’une femme.
Le Canada concentre ses efforts sur les éléments suivants en matière de santé et de nutrition :
- améliorer la qualité et l’accessibilité des services de santé pour les plus marginalisés;
- accroître l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs complets;
- améliorer la nutrition en tenant compte du genre pour les plus pauvres et les plus marginalisés.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur la santé et la nutrition. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Tanzanie : 69,9 millions de dollars
Bangladesh : 57,2 millions de dollars
Nigéria : 54,1 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 1 170,56 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 1 170,36 millions en ADO, dans le cadre d’initiatives visant la dignité humaine.
Ces investissements ont contribué à améliorer la nutrition et l’accès aux vaccins, à renforcer les systèmes de santé, à offrir des services de santé accessibles de qualité ainsi que des services de santé sexuelle et reproductive et à réduire les taux de maladies infectieuses. Le Canada adopte une approche exhaustive en matière de santé et de nutrition, de lutte contre les maladies graves (comme le VIH/SIDA, le paludisme et la poliomyélite), de soutien aux programmes de nutrition et de renforcement des systèmes de santé.
Pendant plus de 10 ans, le Canada s’est concentré sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE) et, depuis 2017, sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). Les travaux du Canada à cet égard en 2018-2019 s’inscrivaient dans son engagement à fournir 3,5 milliards de dollars de 2015 à 2020 pour la SMNE et 650 millions de dollars de 2017 à 2020 pour la SDSR. Le Canada a appuyé un meilleur accès aux soins de SDSR exhaustifs au moyen de la sensibilisation et d’un dialogue constructif, un accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale et la contraception, ainsi que l’accès à l’avortement sécuritaire et légal et aux soins après avortement.
Les efforts déployés par le Canada consistaient notamment à collaborer avec les ministres de la Santé et les autres intervenants, tels que les entrepreneurs et les experts, dans le but de renforcer les chaînes d’approvisionnement pour les médicaments et les produits de santé afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services de santé. Le Canada a également soutenu des activités liées à l’éducation nutritionnelle et à la promotion de la santé et a accru la mobilisation des partenaires non traditionnels pour résoudre les enjeux complexes de nutrition.
2 864 301 femmes et filles ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive, incluant des méthodes modernes de contraceptionNote de bas de page 3.
Ces contributions ont donné lieu aux résultats suivants :
- des systèmes de santé solides qui sont mieux en mesure d’offrir des soins de qualité et accessibles des services de santé;
- une meilleure protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes;
- un meilleur accès pour les femmes à des services de santé sexuelle et reproductive, comme des contraceptifs modernes, et, par conséquent, une réduction du nombre de grossesses non désirées et d’avortements dangereux;
- un plus grand nombre de femmes recevant des soins prénataux, fournis par un plus grand nombre de préposés qualifiés au moment de la naissance, et, par conséquent, une réduction de la mortalité maternelle et infantile;
- un meilleur accès aux vaccins, donc la réduction de l’incidence des maladies infectieuses;
- un nombre inférieur de décès attribuables à des maladies diarrhéiques;
- un nombre inférieur de cas de retard de croissance.
Afrique subsaharienne
En Afrique subsaharienne, le Canada s’est axé sur le soutien de la santé et des droits des femmes et des enfants. Plusieurs pays partenaires dans la région ont intégré ces enjeux à leurs stratégies nationales de développement. Grâce à sa programmation en matière de santé, les efforts de développement du Canada dans la région permettent de soutenir toute la gamme des services et des renseignements relatifs à la santé sexuelle et reproductive, y compris une éducation sexuelle complète, la planification familiale, la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre et les interventions à cet égard, ainsi que l’accès à l’avortement sécuritaire et légal et aux soins après avortement.
Au Mozambique, le Canada s’est hissé au rang de donateur de premier plan et s’est donné comme principaux objectifs de renforcer le pouvoir des femmes et des filles en tant que décideuses et de surmonter les obstacles comportementaux à la SDSR. Par exemple, dans la province d’Inhambane, où le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est particulièrement élevé, une formation a été offerte à 432 travailleurs de la santé, dont les membres de la direction (95 % étaient des femmes). La formation était axée sur les complications obstétriques, les soins en vue d’avortements sécuritaires et la réanimation de nouveau-nés, et a contribué à la mise en place de réseaux communautaires de soutien à la santé dans 20 collectivités, où un total de 16 329 participants (plus de 50 % de femmes) ont assisté à des séances éducatives sur la SDSR.
En 2018, par l’intermédiaire du programme « Supplies » de l’UNFPA, le Canada a contribué à la hausse de deux millions de nouveaux utilisateurs des services de planification familiale en République démocratique du Congo. En janvier 2019, le Canada a également co-organisé l’événement Safe Abortion Dialogue (dialogue sur l’avortement sécuritaire) avec le ministère du Développement international du Royaume-Uni, la David and Lucile Packard Foundation et la Children’s Investment Fund Foundation. Cette plateforme a offert l’occasion aux intervenants d’assurer une coordination, de partager les pratiques exemplaires et de déterminer ensemble les options en vue de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs activités de défense des droits et de prestation de services d’avortement sécuritaire et de soins après avortement.
Former des travailleurs de la santé hautement qualifiés dans l’État de Cross River au Nigéria

Pays : Nigéria © Organisation mondiale de la Santé
Anita Ejah rêvait de devenir sage-femme, un rêve qui est maintenant réalisable. Ce n’était pas le cas en 2014, lorsqu’elle s’est inscrite à la School of Midwifery Calabar dans l’État de Cross River au Nigéria. À l’époque, l’école manquait des ressources et de l’infrastructure requises pour offrir une formation de sages-femmes de qualité.
Avec le soutien financier du Canada, l’école a amélioré les aptitudes et les compétences des tuteurs, a mis à jour les programmes d’études et a fourni de l’équipement d’enseignement et d’apprentissage. Ces changements lui ont permis d’obtenir son agrément complet.
« Les modèles dans la salle de démonstration m’ont aidée à compléter la théorie par la formation pratique, indique Anita. Si je vois des patientes dans l’aire de service, je sais que je peux les traiter grâce à ma formation. »
Anita fait partie des centaines d’étudiants de 11 institutions de formation en santé qui, grâce au soutien du Canada, sont agréés pour conférer un diplôme à des travailleurs de la santé de première ligne dans les établissements de soins de santé primaires au Nigéria.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Renforcer les capacités des travailleurs de la santé de première ligne pour améliorer la santé.
Amériques
Le Canada a contribué à renforcer la gouvernance des systèmes de santé en Amérique latine et dans les Caraïbes au moyen d’un financement à l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). En conséquence, 15 000 personnes dans 11 pays ont pu profiter de l’accroissement des capacités, ce qui a amélioré leur effort de planification et de coordination dans les systèmes de santé. Cette initiative a également permis d’améliorer la santé néonatale dans la région. Par exemple, 19 427 nouvelles mères au Nicaragua ont reçu des conseils et un soutien en matière de nutrition, d’allaitement et de meilleures pratiques sanitaires.
Grâce à son soutien institutionnel au Groupe de la Banque interaméricaine de développement (Groupe de la BID), le Canada a contribué aux travaux de celui-ci auprès des gouvernements et du secteur privé pour financer l’amélioration des services de santé à l’échelle de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ce soutien, par exemple, a aidé plus de 5 millions de personnes à recevoir des services de santé, quelque 160 000 ménages à obtenir un accès nouveau ou amélioré à l’eau potable et quelque 300 000 ménages à accéder à une hygiène nouvelle ou améliorée.
En Haïti, en partenariat avec l’UNFPA, le Canada a offert un soutien aux femmes enceintes en recrutant 118 sages-femmes étudiantes et 9 enseignants, et en déployant 6 sages-femmes dans les zones les plus mal desservies. Elles ont fourni à 8 122 femmes enceintes des services et des renseignements relatifs à la santé sexuelle et reproductive.
En 2018-2019, un projet mis en œuvre avec Horizons d’amitié au Guatemala a permis de former 820 sages-femmes autochtones traditionnelles et d’accroître de façon importante le pourcentage de femmes enceintes qui obtiennent au moins quatre rendez-vous avec un professionnel de la santé. De 2017-2018 à 2018-2019, dans les régions où le projet a été mis en œuvre, le nombre de femmes enceintes ayant accès à des services de santé est passé de 37,8 % à 45,6 %, et les naissances vivantes suivies par un préposé qualifié en soins de santé sont passées de 37,2 % à 58,5 %.
Un partenariat avec CAUSE Canada s’est donné comme objectif d’améliorer la participation et l’accès des mères à des formations communautaires pour diffuser des messages sur la santé communautaire au Guatemala et au Honduras. Ces messages ont été adaptés aux différents contextes locaux, au moment de travailler, par exemple, avec les femmes autochtones vivant dans des collectivités pauvres et rurales. Adapter les messages de promotion de la santé pour ces collectivités, y compris leur traduction dans les langues locales, a contribué à accroître la demande de services de santé de qualité. Cette pratique a également permis de favoriser une meilleure relation entre les collectivités et les fournisseurs de soins de santé.
L’Agence de la santé publique du Canada offre un soutien financier et en nature aux initiatives de l’OPS et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont l’objectif est de renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement. Grâce au soutien du Canada, l’OPS a pu évaluer et renforcer la capacité des pays des Caraïbes à recenser les maladies non transmissibles et les facteurs de risque associés. Il a aussi amélioré la surveillance, le dépistage et la prévention du cancer du col de l’utérus au moyen de la formation et de l’éducation au Guatemala et au Suriname.
Renforcer le pouvoir des jeunes pour qu’ils atteignent leurs droits en matière de santé

Pays : Bolivie © Plan Canada
La Bolivie présente l’un des taux les plus élevés de grossesses chez les adolescentes en Amérique du Sud. En 2018-2019, le Canada a soutenu le projet de Plan International Canada, intitulé « Atteindre les droits reproductifs des adolescents, réduire la mortalité maternelle et néonatale », qui promeut la participation politique des adolescents dans les communautés autochtones Aymara et Quechua dans l’Altiplano bolivien. Les activités du projet ont permis de renforcer le pouvoir des jeunes pour protéger et promouvoir leurs droits sexuels et reproductifs et ont contribué à réduire les taux de grossesses chez les adolescentes.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Atteindre les droits reproductifs des adolescents, réduire la mortalité maternelle et néonatale.
Asie-Pacifique
Dans la région de l’Asie-Pacifique, les programmes de santé et de nutrition sont axés sur le renforcement des systèmes de santé locaux et nationaux, ce qui permet de réduire le fardeau des maladies et d’améliorer la SDSR. En Afghanistan et au Bangladesh, par exemple, le Canada cherche principalement à renforcer les systèmes de santé locaux. Le projet canadien Ressources humaines pour la santé au Bangladesh a offert une formation afin d’accroître la capacité des gestionnaires, des enseignants en soins infirmiers et des préposées aux naissances qualifiées, ce qui, en revanche, a permis d’améliorer la qualité de l’éducation des praticiens et des services qu’ils offrent. Une base de données électronique a également été installée dans le cadre du projet pour améliorer la gestion du personnel, lequel était composé de 56 733 infirmières et sages-femmes autorisées et de 9 182 préposées aux naissances qualifiées.
Aux Philippines, grâce au soutien du Canada, Inter Pares œuvre avec un partenaire local, Likhaan, dans le but d’offrir des services axés sur les femmes et de promouvoir certaines questions relatives aux femmes, en particulier la santé et les droits reproductifs. En 2018-2019, des cliniques ont offert à 24 804 femmes et filles un accès aux services de santé reproductive. Les activités de sensibilisation et d’éducation de 382 promoteurs communautaires de la santé ont permis de diffuser à 18 309 femmes et filles de l’information au sujet de leurs droits sexuels et reproductifs.
En décembre 2018, l’Agence de la santé publique du Canada a déployé deux épidémiologistes dans les camps de réfugiés bangladais, où vivent principalement des réfugiés Rohingyas fuyant le Myanmar voisin, à l’appui d’un système de surveillance de l’OMS fondé sur les syndromes, ce qui a permis d’accroître la capacité de dépistage et d’évaluation de la maladie répandue dans les camps de réfugiés, et d’intervenir à cet égard.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Au Maroc, le Canada s’est concentré sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles, tout en soutenant l’éducation ainsi que la formation professionnelle et technique.
En Cisjordanie et Gaza, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a offert 8 544 035 consultations médicales, et 376 025 enfants âgés de moins de 60 mois ont été inscrits dans les établissements de santé primaire de l’Office. De ce nombre, 89 091 étaient des nourrissons nouvellement inscrits. La couverture vaccinale représentait 99,8 % des enfants âgés de 12 mois et 99,2 % des enfants âgés de 18 mois inscrits à l’UNRWA, un taux de couverture au-dessus de la cible de vaccination de l’OMS, soit 95 %.
Multirégion
Le Canada soutient des initiatives en matière de santé et de nutrition de portée mondiale et est chef de file dans les efforts de défense des droits partout dans le monde. Le Canada est un des principaux partenaires de l’engagement de Family Planning 2020, un mouvement mondial qui soutient la SDSR des femmes. Le Canada a fourni son soutien à de nombreuses organisations, dont l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), Marie Stopes International, Population Services International et Ipas. Cela a permis d’accroître la planification familiale, les services d’avortement sécuritaire et légal et les soins après avortement pour les femmes et les filles mal desservies, y compris les adolescentes, en Afrique et en Amérique latine. Les projets entrepris avec l’IPPF et Marie Stopes International ont contribué à éviter 1 087 308 grossesses non désirées et 63 764 avortements non sécuritaires en 2018-2019.
En octobre 2018, le Canada a également organisé la septième conférence internationale des parlementaires (en anglais) sur la mise en œuvre du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD). Lors de la conférence, les parlementaires de 78 pays se sont engagés à l’égard d’une série de mesures en vue de réaliser le programme d’action de la CIPD au moyen de l’accès universel à la SDSR. Cela a donné lieu à la Déclaration d’engagement d’Ottawa, et à des appels à l’action concrets pour respecter, protéger et réaliser la SDSR pour tous, au moyen de l’éducation sexuelle et de services d’avortement, là où l’avortement est légalement autorisé.
Affaires mondiales Canada collabore avec trois des plus importants fonds de santé dans le monde pour offrir de meilleurs services de santé dans les pays en développement : l’initiative Accélérer la fin des épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme du Fonds mondial, Gavi, the Vaccine Alliance, et la Global Financing Facility (GFF) pour les femmes, les enfants et les adolescents (en anglais). Pour renforcer les partenariats, favoriser le partage d’innovations et de connaissances et réduire les frais généraux administratifs, Gavi, le Fonds mondial et d’autres organisations de santé, y compris le partenariat Halte à la tuberculose, ont été transférés vers le Campus de la santé mondiale à Genève. Cette approche contribuera à diriger plus de fonds vers les programmes qui aideront à améliorer les résultats de santé dans les pays à revenu relativement faible.
Le Fonds mondial a contribué à sauver plus de 32 millions de vies depuis 2002. En 2018, le Fonds mondial a fourni à 18,9 millions de personnes un traitement antirétroviral contre le VIH, a traité 5,3 millions de personnes aux prises avec la tuberculose et a distribué 131 millions de moustiquaires de lit pour prévenir le paludisme. En outre, le Fonds mondial continue de réaliser des investissements importants pour les filles adolescentes et les jeunes femmes, notamment dans le contexte de la prévention du SIDA. Il s’agit de programmes visant à encourager les filles à poursuivre leur éducation, à soutenir des groupes d’autonomisation des filles, des programmes de prévention et d’éducation en matière de SDSR adaptés aux adolescentes. Le Canada continue également de faire la promotion d’enjeux relatifs à l’égalité des genres et aux droits de la personne.
La poliomyélite demeure une priorité globale en matière de santé. Depuis 1988, les cas de polio dans le monde sont passés de 350 000 par an à moins de 170 en 2019, soit une réduction de 99,9 %. Seuls l’Afghanistan et le Pakistan continuent de connaître des cas de poliovirus sauvage, mais tant et aussi longtemps qu’il y aura des cas de polio, les enfants du monde devront être vaccinés. En 2018, avec l’appui du Canada, la Global Polio Eradication Initiative (en anglais) a aidé les gouvernements des pays à vacciner plus de 470 millions d’enfants à de multiples reprises dans plus de 40 pays, au moyen de plus de 2,2 milliards de doses de vaccins oraux contre la polio.
Gavi, qui cherche à sauver la vie d’enfants et à protéger la santé des personnes en accroissant l’utilisation équitable des vaccins dans les pays à revenu relativement faible, est l’un des principaux partenaires du Canada dans les efforts déployés pour renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement. En 2018, Gavi a vacciné 66 millions d’enfants. Les travaux de Gavi en 2018 ont permis de prévenir 1,7 million de décès et d’éviter 80 millions d’années de vie future en situation de handicap.
La Global Financing Facility (GFF) est un mécanisme de financement catalytique dirigé par les pays, qui vise à mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-nés, d’enfants et d’adolescents et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des enfants et des adolescents. La GFF collabore actuellement avec 36 pays partenaires. En 2019, des résultats étaient disponibles pour 27 pays sur 36. En particulier, les dépenses en santé, par habitant, financées par les sources nationales ont connu une hausse dans 19 des 27 pays en question; dans les 27 pays, les taux de mortalité chez les nouveau-nés et les enfants âgés de moins de cinq ans ont diminué; et le taux de fertilité adolescente a diminué dans 26 des 27 pays.
En 2018-2019, en partenariat avec Nutrition International, le Canada a fourni des suppléments de micronutriments à 557 millions de personnes. Parmi ces personnes se trouvaient 4 millions de femmes enceintes, lesquelles ont reçu des suppléments en acide folique et en fer, et 149 millions d’enfants, lesquels ont reçu leurs doses annuelles de vitamine A.
Le GBM joue un rôle important dans les efforts internationaux visant à renforcer les établissements de santé et de nutrition dans les pays en développement. Par exemple, en 2018-2019, l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, qui soutient les pays les plus pauvres du monde, a financé des projets qui ont contribué à immuniser 73,64 millions d’enfants, ainsi que des projets grâce auxquels 71,17 millions de femmes et d’enfants ont reçu des services nutritionnels de base, et 27,51 millions de femmes ont reçu des soins de la part de professionnels de la santé qualifiés pendant l’accouchement.
Le Canada joue un rôle actif au sein du Conseil de Halte à la tuberculose, et est le principal soutien financier de TB Outreach, une initiative de lutte contre la tuberculose au moyen d’approches innovatrices. En 2019, TB Outreach a soutenu une série de projets spécialisés visant à renforcer le pouvoir des femmes et des filles afin qu’elles jouent un rôle plus direct dans les activités d’intervention.
L’éducation
ODD soutenus dans le cadre de la composante sur l’éducation du champ d’action de la dignité humaine*


* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
Le droit à une éducation de qualité fait partie intégrante d’une plus grande dignité humaine et constitue un moyen de réaliser tous les autres droits. La Politique d’aide internationale féministe du Canada engage le Canada à travailler pour faire en sorte que les plus pauvres et les plus vulnérables aient accès à une éducation de qualité, et porte une attention particulière aux femmes et aux filles. Malgré le progrès mondial dans l’accessibilité à l’éducation, il reste un certain nombre d’importants défis à relever. Les obstacles bloquant l’accès à l’éducation auxquels se heurtent les groupes marginalisés et vulnérables persistent et sont profondément ancrés dans les dynamiques de pouvoir et les inégalités. La qualité de l’éducation est un autre facteur sur lequel se pencher, puisqu’une éducation médiocre peut également constituer un obstacle à la réussite. Les lacunes dans la gouvernance et la responsabilisation des systèmes d’éducation nécessitent également une intervention, notamment en ce qui a trait à la création et à la mise en œuvre de solutions tenant compte de l’égalité des genres.
L’approche globale du Canada en matière d’éducation est axée sur les éléments suivants :
- améliorer la qualité de l’éducation en tenant compte du genre;
- élargir l’accès à l’acquisition de compétences de qualité, sensible à la demande et tenant compte du genre;
- améliorer la qualité de l’éducation et le développement des compétences en tenant compte du genre dans les situations de conflit, de crise et de fragilité.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur l’éducation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Jordanie : 31,1 millions de dollars
Bangladesh : 27,45 millions de dollars
Afghanistan : 17,2 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 433,52 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 432,36 millions en ADO, dans le cadre dans d’initiatives axées sur l’éducation.
Le Canada a travaillé avec des partenaires internationaux, nationaux, multilatéraux et locaux pour promouvoir les avantages qu’offre l’éducation des femmes et des filles. Les initiatives du Canada comprennent les activités suivantes :
- soutenir le développement et l’amélioration de programmes éducatifs exempts de stéréotypes sexistes;
- créer ou entretenir des établissements éducatifs sûrs pour les filles, en s’assurant notamment que les écoles ont de l’eau potable et des toilettes séparées pour filles et garçons, et que les filles ont accès à une hygiène menstruelle appropriée et à de l’information sur la santé, de même qu’à des produits sanitaires à l’école;
- intervenir dans les situations de violence sexuelle et sexiste à l’école, au moyen, notamment, de la prévention et de la sensibilisation;
- promouvoir et soutenir l’accès à l’éducation préscolaire (la maternelle) et secondaire, ainsi qu’un meilleur accès à l’éducation dans les contextes où le Canada fournit une aide humanitaire;
- offrir des compétences essentielles, l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et des formations pour les femmes et les jeunes marginalisés, y compris dans des domaines non traditionnels et mieux rémunérés.
En 2018-2019, les programmes du secteur de l’éducation et du développement des compétences soutenus par le Canada ont produit des résultats tels que l’accès accru à l’éducation pour les populations vulnérables (y compris celles qui habitent les zones en situation de crise, de fragilité ou de conflit), l’amélioration des résultats en matière de littératie et des niveaux de scolarité atteints, et enfin, l’amélioration des compétences et de l’employabilité des diplômés des programmes de formation technique et professionnelle. Des précisions sur les réalisations régionales et multilatérales sont indiquées ci-après.
La Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement, adoptée en juin 2018, pendant la présidence du Canada au G7, fut l’une des réalisations clés de l’exercice 2018-2019. Cela a mis en branle des mesures mondiales pour contrer les obstacles à la qualité de l’éducation et de la formation des compétences pour les filles et les femmes, et à améliorer ce champ d’action.
À l’appui de la Déclaration de Charlevoix, le Canada a réuni la communauté internationale et annoncé un investissement historique d’un total de 3,8 milliards de dollars pour soutenir l’éducation de qualité et des formations professionnelles pour les femmes et les filles dans les régions en crise et aux prises avec des conflits. Plus tard la même année, à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Canada a salué les engagements d’un total de 527 millions de dollars afin d’aider les pays en développement à offrir aux enfants l’accès à l’éducation et à la formation dont ils ont besoin pour réussir.
355 268 enseignants ont été formés conformément aux normes nationalesNote de bas de page 4.
220 493 personnes ont complété un programme d’enseignement et de formation technique ou professionnelle soutenu par Affaires mondiales CanadaNote de bas de page 5.
L’engagement du Canada à verser 400 millions de dollars pour soutenir la Déclaration de Charlevoix est axé sur :
- la suppression des obstacles à l’égalité des genres;
- l’offre d’une éducation primaire et secondaire de qualité dans les contextes fragiles;
- l’amélioration des données désagrégées selon le sexe et l’âge et la nécessité de rendre compte;
- la préparation des femmes aux emplois de l’avenir.
Un certain nombre d’annonces de programmation initiales ont été faites en 2018-2019 pour contribuer à remplir l’engagement du Canada à verser 400 millions de dollars. Il s’agit, entre autres, de :
- 50 millions de dollars à Education Cannot Wait, pour contribuer à ce que les enfants, en particulier les filles et les adolescentes vivant dans des États fragiles et touchés par des conflits, aient accès à une éducation de qualité;
- 50 millions de dollars pour le Mécanisme de financement mondial, afin d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation en tenant compte de l’égalité des genres;
- différentes initiatives pour la collaboration entre Right to Play International et l’UNRWA afin de créer des salles de classe sûres, inclusives et tenant compte du genre, et de former des enseignants à l’intégration des méthodologies axées sur le jeu et centrées sur l’enfant;
- l’annonce d’un soutien de 11 millions de dollars pour l’éducation des filles le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.
Afrique subsaharienne
Le Canada a fourni un soutien financier direct pour sélectionner des pays partenaires en Afrique subsaharienne, afin de les aider à renforcer les systèmes d’éducation et à offrir des services d’éducation de qualité. Au Burkina Faso, le soutien du Canada a contribué à accroître de 77 % le nombre de salles de classe dans les écoles primaires entre 2009 et 2018, et à augmenter le taux de diplomation primaire, en le faisant passer de 46 % (43 % pour les filles) en 2009 à 63 % (68 % pour les filles) en 2018.
En 2018-2019, le Canada a soutenu le programme de formation des enseignants du primaire, qui a contribué à transformer 521 écoles primaires de la Tanzanie en milieux d’apprentissage stimulants dotés de coins de lecture, et à former 150 enseignants préscolaires en production et utilisation de matériel d’enseignement et d’apprentissage. Depuis la création du programme, 2 082 écoles primaires ont reçu au moins une intervention ciblant spécifiquement l’autonomisation des filles, dont ont pu tirer profit 236 176 filles et 228 449 garçons.
Le Canada a travaillé avec le York University Centre for International and Security Studies en vue d’améliorer les capacités d’enseignement des réfugiés vivant à l’intérieur et à l’extérieur du camp de Dadaab, au Kenya. Axé principalement sur l’amélioration de l’accès à l’éducation préscolaire et secondaire, ce partenariat a permis à 215 personnes participant au projet Borderless Higher Education for Refugees de devenir des éducateurs certifiés. Ce projet étant en mesure de rejoindre environ 55 étudiants par enseignant par année, il a eu une incidence sur la vie de 11 825 étudiants en 2018-2019.
Amériques
Le Canada a contribué à améliorer l’accès à l’éducation et à accroître le nombre de filles fréquentant l’école en Amérique latine et dans les Caraïbes, et ce, de diverses façons. Par exemple, en Colombie, plus de 9 500 bénéficiaires (principalement des femmes et des jeunes) ont reçu une formation technique et professionnelle par l’intermédiaire de travaux entrepris par CUSO en 2018-2019. Cette formation visait à développer les compétences d’autonomisation économique des bénéficiaires et à leur permettre de trouver des emplois convenables et d’échapper aux épreuves causées par des décennies de conflit. Le Canada a également travaillé avec Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés, Mercy Corps, War Child et Plan International afin d’améliorer l’accès à une éducation de qualité pour près de 24 000 enfants et jeunes (53 % de femmes et de filles) vivant dans certaines des zones rurales les plus touchées par les conflits en Colombie.
Au Pérou, le Canada a travaillé avec l’UNICEF pour appuyer les adolescents, et particulièrement les adolescentes autochtones, à exercer pleinement leurs droits, et ce, tout en les aidant à accéder à une éducation secondaire de qualité, exempte de violence et respectueuse de leurs identités ethnique et sexuelle.
En Haïti, le Canada a collaboré avec la Banque mondiale (Fonds fiduciaires BIRD) pour accroître l’inscription des filles dans les écoles secondaires. De concert avec le Programme alimentaire mondial, le Canada a en outre appuyé des efforts visant à nourrir les étudiants, ce qui a permis d’offrir des repas nutritifs à 180 000 enfants haïtiens chaque jour, et donc d’encourager la fréquentation scolaire et le succès académique des bénéficiaires. Le Canada a également travaillé avec des organisations canadiennes en Haïti, dont le Cégep de Saint-Jérôme, afin d’améliorer les compétences pour l’emploi dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Le projet cible les jeunes, les femmes et les personnes vivant en situation de handicap dans les régions de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien et a permis de former 52 enseignants, conseillers ou autorités scolaires (65 % de femmes) pour un certificat en éducation technique, et 26 personnes (80 % de femmes) sur la santé et la sécurité dans le service alimentaire, leur permettant ainsi d’être certifiées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le Canada a contribué aux efforts de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) en éducation dans l’ensemble de la région. Par exemple, 57 227 étudiants ont bénéficié d’investissements gouvernementaux dans l’éducation financés par la BDC.
Asie-Pacifique
Le Canada a travaillé avec des partenaires dans la région de l’Asie-Pacifique afin d’élargir l’accès à l’éducation pour les filles, les garçons et les étudiants des minorités ethniques, en éliminant les obstacles et en accroissant les ressources. En Afghanistan, le Canada a soutenu l’éducation communautaire dans les régions rurales et éloignées dépourvues de systèmes scolaires gouvernementaux en travaillant avec des enseignantes locales afin de lever les obstacles qui empêchaient les filles de fréquenter l’école. Ce programme a contribué à la sûreté et à la sécurité des filles, même dans les zones où les activités d’insurrection sont maîtrisées, et l’on rapporte en outre que 3 022 élèves qui n’étaient pas à l’école antérieurement la fréquentent actuellement.
En Asie du Sud-Est, les Bourses et les programmes d’échange éducationnels pour le développement Canada-ANASE ont été lancés en 2018-2019. Ces initiatives ont permis d’offrir à des étudiants et à des professionnels en milieu de carrière des États membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) la chance de faire une demande d’admission en vue d’études ou de recherches à court terme au Canada dans un domaine cadrant avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les efforts de développement de l’ANASE.
Au Vietnam, le Canada a aidé à améliorer la gestion d’établissements d’enseignement postsecondaire et à créer des cours. Les partenaires canadiens ont donné des cours de formation aux enseignants au niveau collégial et aux administrateurs de 132 établissements d’enseignement postsecondaire, ce qui a permis de transférer des connaissances sur les pratiques exemplaires, de perfectionner les compétences en approches axées sur les étudiants, et d’améliorer la conception et la gestion de programmes de formation.
En 2018-2019, le CRDI a soutenu un réseau mondial de recherche, soit le Digital Learning for Development (en anglais). Dans la première phase de cette initiative, des chercheurs des quatre coins de l’Asie ont travaillé de concert pour soutenir l’apprentissage numérique, la collaboration en recherche et la mise à l’échelle des innovations ayant fait leur preuve afin d’améliorer les systèmes d’éducation.
Le genre n’est pas un obstacle pour manœuvrer une machine de menuiserie

Pays : Bangladesh © Organisation internationale du Travail
Au Bangladesh, Parveen observe une pièce de bois et est témoin d’un monde en pleine évolution : son monde, du moins, et peut-être celui d’autres jeunes femmes également. Bien qu’elle n’ait que 20 ans et soit peu instruite, elle croit que la force n’est pas le fait de la capacité physique, mais de la volonté. Elle fabrique des armoires dans une usine où l’on n’avait pas vu beaucoup de femmes avant elle, encore moins travaillant avec une machine.
Parveen a été forcée d’abandonner l’école en cinquième année pour aider sa mère avec les tâches ménagères. Lorsque l’entreprise Akhter Furniture a lancé son programme de formation de compétences pour les femmes intitulé « B-SEP », Parveen s’est inscrite au cours d’opératrice de machine. Le cours a été conçu de façon à attirer les femmes vers les métiers non traditionnels. Elle a appris le fonctionnement des machines à découper le bois et la fabrication des armoires et des portes.
Après avoir terminé le cours, l’usine a embauché Parveen pour un salaire mensuel de 250 $, soit son premier travail rémunéré. Parveen apprécie son nouveau métier et sa nouvelle liberté économique.
« La formation m’a donné les compétences et m’a aidé à entrer dans le marché du travail. Autrement, comme de nombreuses filles, j’aurais pu finir par effectuer uniquement des tâches ménagères. Je remercie le gouvernement canadien et l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour les projets comme B-SEP. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Compétences pour l’emploi et productivité au Bangladesh.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Les efforts du Canada au Liban, en Jordanie, en Irak, au Maroc et en Tunisie ciblaient les milieux d’apprentissage protégeant les élèves vulnérables, la formation des enseignants et une approche axée sur les apprenants dans la formation professionnelle. Au Liban, le Canada a créé des espaces accueillants dans 303 écoles pour répondre aux besoins spécifiques des filles afin de prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre et d’intervenir sur ces questions. Une formation sur la prestation de services sociaux tenant compte du genre a également été offerte à 8 103 personnes (dont 7 277 femmes) participant au secteur de l’éducation. En Jordanie, le Canada a aidé 2 125 écoles qui ont mis en œuvre des changements divers (de nouvelles méthodes d’enseignement, par exemple) afin de créer des espaces accueillants qui répondent aux besoins spécifiques des filles. Au Maroc, le Canada a soutenu des programmes de formation technique et professionnelle correspondant aux besoins du marché du travail tout en favorisant une meilleure inclusion des jeunes garçons et des jeunes filles en situation de vulnérabilité. En Irak, deux interventions d’assistance technique et deux ateliers ont été fournis aux hauts représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Irak afin de promouvoir des programmes de compétences professionnelles tenant compte des genres.
Multirégion
Le Canada s’est taillé une place de donateur de premier plan d’Education Cannot Wait (en anglais) et du Partenariat mondial pour l’éducation (PME). Le PME continue de mobiliser des efforts à l’échelle internationale et nationale afin d’offrir une éducation de qualité et équitable dans près de 70 pays en développement et États fragiles. Au moyen d’un partenariat efficace, le PME simplifiera la manière dont les pays en développement accèdent au financement et soutiennent la planification de leur secteur de l’éducation. En 2018, les bourses du PME ont permis d’aider environ 22,2 millions d’écoliers (dont 10,6 millions de filles), dont 20 millions à l’école primaire et 2 millions dans les premières années de l’école secondaire. De ces élèves, 16,6 millions vivaient dans des États fragiles et touchés par les conflits, ce qui dépasse l’objectif du PME, qui consiste à offrir plus de 45 % de son aide à de tels pays. Ces efforts ont donné lieu à de meilleurs taux de réussite : on estime qu’au cours de l’année précédente, 4,9 millions d’enfants ont terminé l’école primaire et 2,6 millions d’enfants ont terminé les premières années de l’école secondaire.
L'éducation ne peut attendre

Pays : Tchad © Bahaji, UNICEF
« L’an dernier, nous étudions dans des tentes. Lorsqu’il y avait trop de vents de sable, les enseignants nous renvoyaient à la maison. C’était si bruyant que parfois nous ne pouvions même pas entendre ce qu’ils disaient. À présent, nous étudions dans de nouvelles salles de classe, et c’est avec bonheur que nous venons à l’école », affirme Kaka Mahamat, âgé de 12 ans, qui vit maintenant dans le camp à Dar es Salam, au lac Tchad.
Depuis 2017, avec l’appui d’une vaste coalition internationale et le gouvernement du Tchad, Education Cannot Wait (ECW), un fonds mondial pour l’éducation en crise, a aidé plus de 150 000 enfants au Tchad, dont 69 000 filles. En République centrafricaine, pays voisin, le fonds a eu une incidence sur quelque 65 000 enfants, dont 31 802 filles. Au Nigéria, le fonds a reçu une subvention de 2,5 millions de dollars américains, ce qui permettra d’aider environ 194 000 enfants déplacés, dont 52 % de filles.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Appui à L'éducation ne peut attendre 2017-2018.
Par des investissements en capital et un appui aux fonds fiduciaires comme le Partenariat mondial pour l’éducation, le Canada a contribué au travail de la Banque mondiale en matière d’éducation. En outre, notons que le Canada, de concert avec l’Union européenne, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Banque mondiale, verse 3,8 milliards de dollars en appui à la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation des filles et des femmes dans les pays en conflit ou en crise. La Banque mondiale en fournit une portion de 2 milliards de dollars.
En 2018-2019, le Canada a accru son soutien au Mécanisme de financement mondial (MFM) dans le cadre de l’initiative du G7 de Charlevoix en matière d’éducation afin de travailler dans un éventail de pays en situation de fragilité, de conflit et de violence. Cela a permis d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation en tenant compte de l’égalité des genres et de lever les obstacles de nature sanitaire qui entravent l’accès des filles à une éducation de qualité, y compris les filles en situation de handicap.
Le Canada collabore également avec des organisations multilatérales dans le cadre de certaines initiatives. Par exemple, le Canada collabore avec l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (en anglais), Gender at Work (en anglais) et l’Internationale de l’Éducation pour lutter contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire (VBGMS) à l’aide des syndicats nationaux et régionaux d’enseignants. Depuis 2016, 396 employés et membres de syndicats ont directement été mobilisés dans des mesures visant à lutter contre la VBGMS, lesquelles ont rejoint plus de 30 000 personnes.
Relativement à l’objectif de transférer la solide expertise technique du Canada quant à la formulation d’indicateurs et de méthodologies statistiques robustes, Statistique Canada continue d’apporter son expertise statistique au Groupe de coopération technique de l’UNESCO sur les indicateurs thématiques relatifs au quatrième objectif de développement durable (ODD) sur l’éducation, ce qui fait intervenir des représentants tant des pays développés que des pays en développement.
Le Canada accueille l’Institut de statistique de l’UNESCO à Montréal depuis sa création en 1999. En 2018-2019, le Canada a renouvelé son soutien au moyen d’une subvention d’une valeur de 4 millions de dollars sur quatre ans pour s’acquitter de son mandat, en portant une attention particulière aux efforts visant à bâtir la capacité des pays en développement sur le plan des données en vue de réaliser l’Objectif 4 qui a trait à l’éducation de qualité.
Grâce à l’adhésion et à la contribution annuelle d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Canada soutient le travail de l’Union pour promouvoir l’éducation et la maîtrise des technologies de l’information et de la communication dans les pays en développement. Outre une coopération technique et un renforcement des capacités en la matière, l’Union mène la campagne annuelle internationale de la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, qui encourage les filles et les jeunes femmes à entreprendre une carrière dans le domaine. En 2018, 131 pays ont organisé 2 186 événements à l’occasion de cette journée, encourageant 57 748 filles à étudier ou entreprendre des carrières en technologies de l’information et de la communication. De concert avec l’Organisation internationale du Travail, l’Union a également codirigé la campagne « Les compétences numériques pour l’emploi décent des jeunes ». Cette campagne a été lancée lors du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information de l’UIT, où l’on a encouragé les intervenants à former 5 millions de jeunes femmes et de jeunes hommes à des compétences les rendant aptes à l’emploi.
L’action humanitaire tenant compte des genres
ODD soutenus dans le cadre de la composante sur l’action humanitaire tenant compte des genres du champ d’action de la dignité humaine*




* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
L’augmentation récente du nombre et de l’intensité des conflits armés, ainsi que l’ampleur et la fréquence des catastrophes naturelles, exacerbées par les effets des changements climatiques, ont engendré des besoins humanitaires sans précédent. L’aide humanitaire internationale du Canada vise à répondre aux besoins des personnes touchées par ces crises en appuyant des interventions humanitaires rapides et coordonnées qui sont fondées sur les besoins et adhèrent aux principes humanitaires.
Le Canada continue de se concentrer sur son action humanitaire tenant compte des genres de façon à sauver des vies, à soulager la souffrance et à maintenir la dignité des personnes touchées par les conflits et les catastrophes naturelles. Une action humanitaire tenant compte des genres est nécessaire afin de répondre aux besoins et aux priorités spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité, particulièrement les femmes et les filles, pour aider à renforcer leur pouvoir et s’assurer que notre aide humanitaire ait une incidence plus forte et durable. Prendre en compte les vulnérabilités préexistantes rend les interventions humanitaires plus spécifiques à une crise donnée. Cela signifie également que l’on répond aux besoins spécifiques des femmes et des filles plutôt que de les négliger.
L’aide humanitaire vitale du Canada soutient des efforts visant à accroître la prise en compte des questions d’égalité des genres dans les interventions humanitaires au moyen d’approches ciblées et transversales dans quatre domaines clés :
- les principes humanitaires et le droit international humanitaire;
- la violence sexuelle et fondée sur le genre pendant les crises humanitaires;
- la santé sexuelle et reproductive pendant les interventions humanitaires;
- le renforcement du pouvoir des femmes et des filles.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur l’action humanitaire tenant compte des genres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Syrie : 132,8 millions de dollars
Yémen : 57,9 millions de dollars
Liban : 57,8 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 909,62 millions de dollars dans l’aide internationale (dont moins de 1 000 $ n’étaient pas de l’ADO) dans le champ d’action de l’action humanitaire. Nous avons investi dans 62 pays et territoires, et le Canada est intervenu à la suite de 37 catastrophes naturelles.
De concert avec les partenaires des Nations Unies, les ONG et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Canada, dans le cadre de son objectif en matière d’action humanitaire tenant compte des genres, poursuit sa réponse aux besoins différenciés de plus de 135,3 millions d’hommes, de femmes, de garçons et de filles nécessitant une aide humanitaire. Le Canada a fourni un soutien aux organisations internationales en vue d’atteindre les résultats suivants :
- la distribution accrue d’aide alimentaire de matériel de secours essentiel non alimentaire;
- un meilleur accès à l’eau et à l’aide en matière d’abris;
- un meilleur accès à des installations d’assainissement et d’hygiène, et à des services médicaux de qualité par l’intermédiaire de centres de santé et d’hôpitaux;
- un meilleur accès à la protection internationale pour les personnes déplacées de force;
- un meilleur accès à des services complets de santé sexuelle et reproductive en situation d’urgence, en particulier pour les femmes et les adolescentes.
15 % des projets d’aide humanitaire comportaient un volet sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ou sur la santé et les droits sexuels et reproductifsNote de bas de page 6.
Le Canada contribue aux efforts visant à répondre aux besoins et aux priorités des femmes et des filles en situation humanitaire. Par exemple, en 2018-2019, 96 % des projets d’aide humanitaire d’Affaires mondiales Canada tenaient compte de l’égalité des genres. Le Canada a fourni 50,5 millions de dollars en 2018-2019 à l’appui de services en SDSR dans les programmes d’aide humanitaire, ce qui a contribué à prévenir des décès, des maladies et des handicaps liés aux grossesses non désirées, aux complications obstétriques et aux troubles de la reproduction, et ce, tout en réduisant la violence sexuelle et fondée sur le genre.
Afrique subsaharienne
De mai 2018 à mars 2019, le Canada a fourni 3,25 millions de dollars en aide humanitaire d’urgence à l’appui des victimes des éclosions du virus Ebola en République démocratique du Congo. Par l’entremise de Médecins sans Frontières (en anglais), le Canada a soutenu trois centres de traitement de l’Ebola et 24 installations de santé, l’admission de 2 565 patients présentant des signes d’infection et la vaccination de 600 premiers intervenants en santé. Le soutien du Canada aidait à cibler les lacunes relevées par les premiers intervenants en matière de traitement, de surveillance et de soutien psychosocial pour les victimes et leur famille. Le Canada a également fourni 170 000 $ pour soutenir les activités de préparation dans les pays voisins, y compris le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud et l’Ouganda.
En 2018-2019, le Canada a fourni plus de 90 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents dans le Sahel, dont 35,13 millions de dollars ciblaient la lutte contre les conditions de sécheresse dans la région. Le Canada a également fourni une aide relative aux interventions quant à l’insécurité alimentaire et à la nutrition en collaborant avec des organismes des Nations Unies et avec des ONG. Avec le soutien du Canada, les ONG partenaires ont aidé plus de 2 millions de bénéficiaires au Sahel en 2018-2019 grâce à des activités telles la mobilisation communautaire et la sensibilisation aux saines pratiques d’hygiène et d’assainissement. Grâce à des installations et à des cliniques mobiles soutenues par Action Contre la Faim au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigéria, au Sénégal et au Tchad, le Canada a contribué à l’examen de près d’un demi-million d’enfants et au traitement de la malnutrition aiguë chez plus de 57 000 enfants.
De concert avec ses partenaires des Nations Unies, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des ONG, le Canada a aidé à fournir de l’aide alimentaire, un accès à l’eau potable et à l’assainissement, des soins de santé, des logements et une protection d’urgence à plus de 3 millions de personnes affectées par le cyclone Idai un peu partout au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Le Canada a répondu rapidement au cyclone par plusieurs moyens : des fonds accessibles, un déploiement de stocks d’urgence à partir de Dubaï, des fonds versés à des organismes humanitaires d’expérience, et le soutien au déploiement d’un hôpital mobile d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. Cette unité, déployée au Mozambique, a fourni des soins de santé d’urgence essentiels à plus de 9 800 patients sur une période de trois mois.
Amériques
En 2018-2019, le Canada a contribué à fournir une aide vitale aux populations vulnérables touchées par la crise au Venezuela et par les catastrophes naturelles à Cuba et en Haïti. Grâce à des programmes axés sur l’eau, l’assainissement et la nutrition dans les départements frontaliers de la Colombie, le soutien du Canada a permis d’aider 6 000 personnes vulnérables et touchées par les crises à accéder à de l’eau potable. En outre, plus de 900 femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des enfants, ont pu accéder à des soins nutritionnels et médicaux complets. Le Canada a fourni un financement régional souple aux organisations humanitaires comme le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), Action Contre la Faim et le PAM pour aider les personnes vulnérables et touchées par les crises d’un bout à l’autre de l’Amérique latine et des Caraïbes, y compris les réfugiés et les migrants provenant du Venezuela et des collectivités hôtes voisines.
À Cuba, le Canada a aidé la Société canadienne de la Croix-Rouge à fournir de la nourriture, de l’eau, des mesures d’assainissement et d’hygiène, ainsi que des abris d’urgence à la suite de la tornade qui s’est abattue sur La Havane en janvier 2019.
En Haïti, un projet exécuté avec l’Organisation internationale pour les migrations a permis de relocaliser 28 500 personnes déplacées (8 679 familles) dans les zones de Port-au-Prince touchées par le séisme.
Asie-Pacifique
En 2018, le Canada a lancé sa Stratégie pour répondre à la crise des Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh, et l’a dotée d’un budget de 300 millions de dollars en aide internationale sur trois ans. Cette stratégie répond au déplacement forcé de quelque 805 000 réfugiés rohingyas du Myanmar au Bangladesh, ainsi que d’autres habitants du Myanmar affectés par le conflit. Grâce à ce financement qui cible à la fois les réfugiés et les communautés hôtes, le Canada soutient la livraison d’aide alimentaire d’urgence à plus de 900 000 personnes au Bangladesh et 470 000 au Myanmar, et plus de 200 000 consultations médicales aux réfugiés rohingyas à Cox’s Bazar, au Bangladesh. Dans le cadre de son intervention, le Canada fournit aussi 4,65 millions de dollars à un projet pilote en vue de renforcer les capacités, le leadership et la responsabilisation, et de stimuler un changement à l’échelle du système. Le Canada appuie une action humanitaire tenant compte des genres, au moyen notamment d’un carrefour des Nations Unies sur le genre dirigé par des femmes et d’autres initiatives de recherche, de politiques et de formation pour mobiliser les partenaires de la société civile et les collectivités hôtes du Bangladesh.
Le 28 septembre 2018, un séisme d’une magnitude de 7,5 suivi d’un tsunami a secoué la région de Sulawesi central en Indonésie, ce qui a incité le gouvernement de l’Indonésie à demander une aide internationale. En réponse, le Canada a fourni 1,5 million de dollars pour aider des organisations humanitaires à distribuer des trousses d’hygiène, des filtres à eau, des abris montables et des latrines aux quelque 14 000 personnes affectées. Les Forces armées canadiennes ont déployé un aéronef CC-130 Hercules et un équipage ayant permis de transporter du matériel d’aide humanitaire de la Croix-Rouge et de créer un pont aérien.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Le Canada s’est engagé à fournir 840 millions de dollars en aide humanitaire sur trois ans pour intervenir dans les situations de crise en Syrie et en Irak et atténuer leur incidence sur les pays voisins. En 2018-2019, le Canada a versé 262,8 millions de dollars en aide humanitaire en Irak, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Ce financement souple et pluriannuel cadre avec les engagements pris lors du Sommet mondial humanitaire de 2016. Un financement est fourni aux partenaires humanitaires afin qu’ils distribuent une aide vitale comme de la nourriture, des abris, de l’eau, des services en matière de santé, d’assainissement, d’éducation et de protection, y compris des soins spécialisés pour les survivants de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Le financement canadien a permis de soutenir la prestation de services de santé sexuelle et reproductive destinés aux adolescents à environ 1 435 000 bénéficiaires en Syrie, 52 000 en Irak, 30 000 en Jordanie et 6 000 au Liban. En outre, le Canada a financé plus de 81 espaces sûrs pour les femmes et les filles et contribué à distribuer des trousses de dignité (contenant des articles de base pour le maintien de la santé et de la dignité) à plus de 200 000 bénéficiaires en Irak, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
En 2018-2019, le Canada a soutenu une intervention humanitaire complète en réponse à la détérioration de la crise au Yémen. En collaborant avec le PAM, l’UNICEF et l’UNFPA, le Canada a contribué à offrir des services de santé reproductive à plus de 360 000 femmes et filles yéménites et à prévenir la famine grâce à une aide alimentaire pour plus de 7 millions de personnes.
Le Canada a fourni un soutien aux réfugiés en Cisjordanie et Gaza et a contribué à réduire leur insécurité alimentaire et à améliorer leur santé. Les niveaux d’assainissement ont en outre été améliorés en construisant des unités de traitement des eaux usées et distribuant des trousses d’hygiène.
La capacité de la Société du Croissant-Rouge de Palestine (SCRP) à offrir des services de santé et à intervenir en situation d’urgence s’est grandement améliorée par l’ajout de 11 véhicules de transferts de patients et par la mise en place d’un nouveau centre des opérations d’urgence (le premier en son genre en Cisjordanie et Gaza).
Le financement canadien a contribué à faire diminuer les taux de décrochage de l’ensemble des écoliers de l’UNRWA, et à examiner le matériel d’apprentissage pour s’assurer que les élèves ont accès à des ressources de qualité. En 2018, 5 609 employés de l’UNRWA ont reçu une formation sur la protection, les genres, l’exploitation et les agressions sexuelles, ainsi que la VSFG. L’UNRWA a repéré et aidé environ 2 530 enfants à risque de violence physique, de mauvais traitements, de négligence, de mariages d’enfants, de châtiments corporels, de travail des enfants, et de problèmes liés à l’enregistrement des naissances. En outre, 15 908 réfugiés palestiniens ont reçu une aide juridique.
Le soutien du Canada au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a contribué à renforcer le respect du droit international humanitaire en Ukraine par le dialogue et la défense des intérêts, notamment sur les lois relatives aux personnes disparues et à la contamination par les armes.
Renforcer la capacité à intervenir en cas d’urgence humanitaire

Territoire : Cisjordanie et Gaza © Alary, Société canadienne de la Croix-Rouge
Le projet Renforcement de la capacité de répondre aux urgences humanitaires en Cisjordanie et Gaza, mis en œuvre par la Société canadienne de la Croix-Rouge, vise à accroître la capacité de la Société du Croissant-Rouge de Palestine (SCRP) à répondre aux besoins médicaux d’urgence et à fournir des services de santé spécialisés aux Palestiniens les plus vulnérables. Le projet permet également de renforcer et d’accroître les travaux de la SCRP, un des principaux acteurs locaux en matière de prestation de soins de santé, de services médicaux d’urgence, de gestion des catastrophes, et de programmes de réadaptation et de programmes psychosociaux.
Jameela Yahya Nasasreh a travaillé comme bénévole au sein de la SCRP au cours des neuf dernières années, et vit à Ein Shibli, un petit village de 1 000 habitants dans la vallée du Jourdain, près de Tubas. À titre de bénévole, elle a suivi des cours pour s’informer sur la santé reproductive, la santé communautaire et les premiers soins.
« Après avoir suivi ces cours et ces ateliers avec la SCRP, nous transférons les connaissances et l’information vers les communautés locales en visitant les élèves dans les écoles et les aînés à domicile, explique Jameela. Nous leur offrons des conseils et approfondissons leurs connaissances; parfois, nous organisons même des ateliers pour eux à notre centre, où nous transférons nos connaissances et notre expertise afin d’en faire profiter la communauté locale. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Renforcement de capacité de répondre aux urgences humanitaires.
Multirégion
Le Canada continuera d’être un chef de file dans l’action humanitaire tenant compte des genres afin d’alléger la souffrance des populations les plus vulnérables dans le monde.
En juin 2018, lors de la rencontre des ministres du G7 responsables du développement, sous la présidence du Canada, les plus importants donateurs d’aide humanitaire se sont engagés envers la Déclaration de Whistler sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l’action humanitaire du G7. La déclaration reconnaît l’importance de promouvoir l’égalité des genres dans toutes les actions humanitaires. Elle cherche à promouvoir le changement dans l’ensemble du système pour s’assurer que les actions humanitaires sont fondées sur des principes et des données probantes, et renforcent le pouvoir des gens. Les gouvernements du G7, y compris le Canada, se sont notamment engagés à renforcer l’accès des femmes et des filles aux soins de santé, à renforcer la prévention et la réponse à la VSFG, et à mieux rendre compte aux populations affectées.
En décembre 2018, le Canada a adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le Pacte mondial sur les réfugiés des Nations Unies.
Le premier représente le premier cadre multilatéral pour une réponse concertée aux mouvements migratoires mondiaux. Il se fonde sur les principes des droits de la personne, de la souveraineté nationale et de l’égalité des genres. Le document met l’accent sur la contribution positive des migrants et sur la nécessité de capturer les bénéfices économiques et sociaux de la migration par les voies régulières, tout en répondant aux défis posés par la migration par d’autres voies.
Le second est un cadre définissant les responsabilités en matière de réfugiés de façon plus prévisible et équitable. Il reconnaît que les solutions durables ne peuvent être trouvées sans coopération internationale. Il fournit un modèle pour les gouvernements, les organisations internationales et les autres parties prenantes pour s’assurer que les communautés hôtes jouissent d’un soutien suffisant et que les réfugiés peuvent mener une existence productive.
Voix forte prônant une meilleure coopération internationale pour recueillir les bénéfices de l’immigration et répondre aux migrations forcées partout dans le monde, le Canada a participé activement aux négociations des deux documents. Ainsi, le Canada s’est assuré que les deux pactes contenaient des mesures pratiques pour promouvoir et protéger la dignité des migrants et des réfugiés, prendre en compte le genre et combattre les migrations irrégulières et la traite des personnes.
En 2018-2019, le Canada a affecté 74,35 millions de dollars au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour les opérations de protection et d’aide dans les zones de conflit armé de par le monde. En 2018, le CICR a amélioré l’accès à la nourriture pour plus de 7,3 millions de personnes, y compris 3,9 millions dans la région du Moyen-Orient. Des programmes en matière d’eau et d’assainissement ont fourni un accès à l’eau à 7,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Plus de 30 000 femmes, hommes et enfants blessés par des armes ont bénéficié de procédures chirurgicales dans les hôpitaux financés par le CICR. En Afrique, le CICR a œuvré à la prévention du recrutement forcé d’enfants dans les groupes armés et a réuni plus de 100 anciens enfants-soldats avec leur famille.
Le Canada promeut l’inclusion de réfugiés au moyen de mesures visant à aider les pays hôtes à accroître la résilience et à favoriser des solutions durables. Afin d’aider à répondre aux besoins des personnes déplacées de force, le Canada fournit un financement à l’UNHCR pour protéger et aider les réfugiés. En 2018, le Canada a affecté 95,6 millions de dollars au financement de l’UNHCR et a participé activement à la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés des Nations Unies.
En 2018, grâce au soutien du Canada, le PAM a directement aidé 86,7 millions de bénéficiaires dans 83 pays au moyen d’aide alimentaire et, de plus en plus, au moyen de transferts en espèces. L’organisation a fourni un tiers de son aide (1,76 milliard de dollars américains) au moyen de transferts en espèces conditionnels et non conditionnels profitant à 24,5 millions de bénéficiaires dans 62 pays. Le programme d’alimentation scolaire du PAM a permis d’offrir des repas nutritifs à 16,4 millions d’écoliers dans 61 pays. L’organisation a également rejoint 9,7 millions d’enfants et 6,1 millions de femmes grâce aux programmes visant à prévenir et à traiter la malnutrition.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a fourni plus de 555 millions de dollars en aide internationale en 2018-2019, dont :
- un soutien fédéral aux réfugiés, aux demandeurs d’asile ayant obtenu une réponse favorable et aux demandeurs d’asile en attente d’une décision de la part de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- les subventions administrées par l’intermédiaire du Programme d’élaboration de politiques en matière de migration de la CISR, qui comprend des projets d’accroissement des capacités liées à la migration et aux réfugiés dans les pays en développement;
- la contribution du Canada à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Le Programme d’aide à la réinstallation du Canada vient en aide aux réfugiés pris en charge par le gouvernement et aux personnes dans des situations similaires à celles des réfugiés admises au Canada au moment de leur arrivée. Le programme fournit des services immédiats et essentiels, généralement pendant les quatre à six premières semaines après l’arrivée au Canada, ainsi qu’un soutien mensuel du revenu, généralement pendant une période maximale d’un an. En 2018-2019, 26 026 réfugiés ont bénéficié d’un service dans le cadre de ce programme (sans compter le QuébecNote de bas de page 7). En 2018-2019, le Canada a réinstallé 27 769 personnes venues de tous les coins de la planète : 8 014 réfugiés pris en charge par le gouvernement, 18 590 parrainés par le secteur privé et 1 165 réfugiés désignés par un bureau des visas.
Le Programme d’établissement permet aux nouveaux arrivants (dont les réfugiés) de surmonter les obstacles propres à leur situation. En 2018-2019, 93 455 réfugiés ont bénéficié d’au moins un service d’établissement (sans compter le QuébecNote de bas de page 8). Parmi ces services : l’évaluation des besoins, de l’information et une orientation, une formation linguistique, des services liés à l’emploi, des services de garde, et un aiguillage vers d’autres services, comme les services de santé et les services sociaux.
Conformément à ses obligations en vertu de traités internationaux, le régime de l’asile du Canada protège les personnes qui craignent avec raison d’être persécutées ou risquent d’être victimes de torture ou de peines cruelles ou inusitées, ou en danger de mort dans leur pays d’origine. Les demandeurs d’asile ne sont pas encore des réfugiés selon la législation canadienne et ils sont traités par l’intermédiaire du régime d’octroi d’asile au Canada afin de déterminer s’ils ont besoin de protection. Dans le cadre du Programme d’octroi de l’asile au Canada, une fois que l’admissibilité d’une demande d’asile est déterminée, les demandeurs peuvent vivre au Canada et ont accès à un permis de travail temporaire, à de l’aide sociale, à des services de santé, à un hébergement d’urgence, et à l’éducation, pendant que les demandeurs attendent la décision de la CISR. En 2018-2019, le Canada a reçu 55 958 demandes d’asile, y compris des demandes faites par des migrants irréguliers qui sont entrés au pays entre deux postes frontaliers. Des fonds ont été investis pour gérer la migration irrégulière en assurant la sécurité à la frontière et un traitement plus rapide des demandes d’asile, ainsi que des mesures supplémentaires, y compris une couverture fédérale provisoire en matière de santé et le partage provisoire des coûts d’hébergement entre les provinces et les municipalités.
En outre, le Programme fédéral de santé intérimaire d’IRCC a fourni des services médicaux outre-mer à 26 279 réfugiés (avant leur départ) sélectionnés aux fins de réinstallation au Canada en 2018-2019. Au Canada, 52 586 réfugiés réinstallés étaient également admissibles au programme, et 27 603 ont utilisé les services. Ce programme offre en outre une protection en matière de soins de santé limitée et temporaire aux demandeurs d’asile jusqu’à ce qu’ils soient admissibles à un régime provincial ou territorial d’assurance-maladie ou jusqu’à ce qu’ils quittent le Canada. En 2018-2019, le programme a couvert 121 657 demandeurs d’asile en attente d’une décision de la part de la CISR, et 85 235 d’entre eux ont utilisé les services.
Le Canada prend la tête de l’appel à l’action pour la protection contre la violence fondée sur le genre dans les crises humanitaires

Pays : Belgique © Amy Duong
Le Canada a activement défendu l’action humanitaire tenant compte du genre par l’entremise de l’appel à l’action pour la protection contre la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, allant dans le même sens que la Politique d’aide internationale féministe du Canada et la Déclaration de Whistler sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l’action humanitaire. L’appel à l’action est une initiative internationale rassemblant plusieurs partenaires qui vise à guider le changement et à accroître la responsabilisation pour que chaque effort humanitaire prévienne et atténue la violence fondée sur le genre, et y réponde dès le début d’une crise.
Le Canada a pris la tête de l’appel à l’action le 1er janvier 2019 pour un mandat de deux ans. Partenaire clé de cette initiative dès son lancement en 2013, le Canada avait déjà coprésidé le groupe de travail des États et des donateurs en 2018. En décembre 2018, l’ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne a pris part à une cérémonie de changement de présidence à Bruxelles en compagnie de la directrice générale de l’Union européenne. Parmi les priorités du Canada en 2019-2020 figure la reformulation stratégique de l’appel à l’action pour la protection contre la violence fondée sur le genre dans les crises humanitaires, pour lancer la prochaine phase par l’entremise d’une feuille de route sur plusieurs années. Le Canada poursuit également la mise en œuvre sur le terrain de l’initiative, afin de provoquer des changements durables et d’aider les plus vulnérables, en mobilisant les acteurs locaux et les groupes de femmes.
Champ d’action : La croissance au service de tous
ODD soutenus dans le cadre du champ d’action de la croissance au service de tous*






* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
Les programmes de croissance au service de tous soutiennent la croissance inclusive, fondement du progrès dans toutes les dimensions du développement et essentielle à la réalisation de la prospérité, de la paix et de la sécurité à grande échelle. Lorsque tous les segments de la population en profitent de façon égale, la croissance permet aux pays de réduire radicalement la pauvreté extrême et les aide à l’éliminer. En particulier, les femmes sont des actrices économiques importantes, et la croissance inclusive ne peut être réalisée que lorsque les femmes participent de façon entière, libre et égale à l’économie. La croissance inclusive constitue le moyen le plus sûr pour les pays d’exploiter leurs ressources nationales et d’atteindre les capacités nécessaires pour relever leurs défis en matière de développement, y compris la santé, l’éducation et la protection de l’environnement.
L’accès accru aux technologies (y compris les technologies vertes) et leur adoption peuvent déclencher des changements transformationnels vers un développement économique durable dans les pays en développement. Des avancées technologiques bénéfiques peuvent être mises en œuvre dans différents secteurs économiques comme l’agriculture. Les systèmes agricoles et alimentaires, par exemple, constituent d’importants moteurs de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Ce secteur caractérisé par une forte intensité de main-d’œuvre est particulièrement important pour les femmes, car elles composent 43 % de la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement et représentent environ deux tiers des éleveurs pauvres dans le monde. Cela peut notamment donner lieu à différentes possibilités pour les femmes et leur permettre de gagner des revenus dans ce secteur qui sont de 30 % à 50 % supérieurs à ceux des secteurs non alimentaires.
Des infrastructures de qualité, y compris dans les secteurs des transports, des communications et de l’énergie, constituent un autre moteur clé de la croissance économique, car elles peuvent encourager l’accès aux marchés et à l’information et créer de nouvelles occasions économiques. L’inclusion de groupes vulnérables tels que les femmes dans les systèmes financiers permet également de stimuler la croissance économique inclusive.
Le Canada concentre ses efforts, en matière de croissance au service de tous, dans les trois programmes d’action suivants :
- réduire les obstacles au renforcement du pouvoir économique des femmes;
- bâtir des économies plus inclusives et durables;
- renforcer la résilience économique.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur la croissance au service de tous. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Éthiopie : 64,2 millions de dollars
Mali : 44,8 millions de dollars
Ghana : 43,8 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 983,27 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 982,61 millions en ADO, dans le cadre d’initiatives visant le champ d’action de la croissance au service de tous.
Une importance particulière est accordée à la participation du secteur privé, au développement de moyens de subsistance et au renforcement du pouvoir économique des femmes. Les activités sont notamment l’accroissement des capacités institutionnelles, l’aide à l’entrepreneuriat, l’accès à un travail décent, l’expansion de l’accès aux capitaux et au financement, et l’amélioration du soutien apporté au secteur privé. Les programmes du Canada jouent également un rôle important dans la transformation rurale, la promotion de technologies renouvelables, la gestion des ressources naturelles et les investissements dans des infrastructures de qualité. Le Canada soutient également le développement et la diffusion d’innovations et de pratiques technologiques susceptibles de contribuer à réduire le fardeau des tâches ménagères, afin que les femmes puissent participer davantage à des activités permettant de renforcer leur pouvoir économique à l’extérieur du foyer.
Dans le secteur agricole, le Canada soutient des initiatives qui permettent d’accroître la résilience et l’inclusion financière. Ces initiatives fournissent des formations en agriculture et en entreprise, et améliorent l’accès aux services financiers (comme les opérations bancaires, le crédit et les assurances) et les font mieux connaître.
3 804 639 entrepreneurs, agriculteurs et petits exploitants agricoles ont bénéficié de services financiers ou de services au développement d’entreprisesNote de bas de page 9.
Entre autres, ces contributions ont donné lieu à :
- l’accroissement de la participation économique des revenus des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes;
- des entreprises plus solides, en particulier des entreprises dirigées par des femmes;
- des capacités accrues pour les femmes dans des postes de direction;
- des droits économiques accrus et de plus grands débouchés commerciaux pour les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes.
Afrique subsaharienne
Le Canada a soutenu des initiatives de développement pour éliminer des obstacles structurels à l’égalité entre les genres (sur le plan social, culturel et juridique) qui limitent la capacité des femmes à prendre part aux activités économiques et restreignent leur accès aux ressources productives. Le Canada a aussi soutenu des initiatives pour améliorer l’accès à l’éducation et à la formation à l’appui de l’entrepreneuriat et du renforcement du pouvoir économique des femmes. Le Canada a soutenu de nombreux projets en vue d’accroître l’emploi des jeunes afin de tirer parti du potentiel économique et développemental de la population croissante de jeunes en Afrique. Il s’agissait de soutenir la formation technique et professionnelle, de renforcer les compétences en entrepreneuriat et de contribuer à la création d’emplois, en particulier pour les jeunes femmes.
Le Canada appuie TradeMark East Africa (en anglais), une ONG basée au Kenya qui travaille pour libérer le potentiel économique en réduisant les obstacles au commerce et en accroissant la compétitivité des entreprises. Dans le sillage du succès de sa première phase stratégique, qui a soutenu une augmentation de 25 % dans les exportations des secteurs ciblés, une réduction de 10 % des coûts commerciaux dans le réseau commercial de l’Afrique de l’Est, et des temps d’attente réduits aux frontières grâce à la modernisation et à l’amélioration des procédures de dédouanement, cette ONG a lancé sa deuxième phase stratégique pour la période allant de 2017-2018 à 2022-2023. Le Canada a poursuivi son financement à TradeMark East Africa en 2018 en investissant 15,3 millions de dollars pour contribuer à l’initiative Faire du commerce un succès pour les femmes en Afrique de l'Est. Ce projet cherche à promouvoir le pouvoir économique des commerçantes en Afrique de l’Est et à réduire la VSFG. Parmi les résultats attendus du projet, mentionnons une réduction de 30 % des incidences de violence contre les commerçantes à certains postes-frontières, une augmentation de 15 % dans la valeur commerciale de biens commercialisés par des femmes, un accès accru aux marchés et aux services commerciaux pour au moins 150 000 commerçantes, et enfin, des environnements politiques, réglementaires et institutionnels pour soutenir les femmes dans le commerce.
En Éthiopie, en partenariat avec le Programme de développement de l’entrepreneuriat féminin de la Banque mondiale, plus de 144,5 millions de dollars en prêts ont été octroyés à 11 731 femmes entrepreneures dans tous les métiers depuis 2014. Un prêt moyen ayant une valeur d’environ 11 800 $, ce financement a permis à des milliers de femmes de faire croître leurs entreprises. En outre, le projet a permis d’offrir à 18 243 femmes une formation en entrepreneuriat. Depuis 2018-2019, plus de 11 000 prêts agricoles ont été octroyés, dont 53 % ont été remis à des femmes. Près de 800 femmes ont en outre bénéficié d’un programme de littératie financière qui les a aidées à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la prise de décision financière.
En 2018-2019, le soutien du Canada à l’égard de FINCA Canada a permis d’accroître l’inclusion financière d’hommes et de femmes par l’accroissement des revenus et de l’accès à des comptes d’épargne en République démocratique du Congo. En particulier, le soutien du Canada a contribué à former 1 915 clients (996 femmes) en littératie financière et à fournir l’accès à des réseaux de services numériques et mobiles d’opérations bancaires pour 7 905 personnes (4 837 femmes) issues de communautés mal desservies en matière de services financiers.
Le soutien institutionnel du Canada à l’endroit de la Banque africaine de développement (BaFD) a contribué au rôle important de la Banque quant à son appui à la croissance économique viable et inclusive dans le continent. Par exemple, de juin 2017 à juin 2019, le soutien de la BaFD aux gouvernements régionaux a fourni un accès financier à plus de 500 000 microentreprises et petites entreprises, contribué à améliorer le commerce intra-africain et le déplacement de personnes grâce à un meilleur accès au transport pour 45,5 millions de personnes, et enfin, favorisé l’amélioration des pratiques agricoles pour 71 millions d’agriculteurs.
Solutions financières dirigées par les jeunes pour les Rwandais

Pays : Rwanda © Digital Opportunity Trust
Diplômée en 2017 du College of Science and Technology de la University of Rwanda, Jeanne Bovine Ishemaryayo a fondé « Computer Geek Technology », une entreprise sociale qui développe des logiciels en vue de répondre aux besoins de la communauté locale. Grâce au soutien de Digital Opportunity Trust (en anglais), Jeanne a mis sur pied des solutions numériques localement pertinentes permettant de régler des problèmes de la vie quotidienne.
La plateforme de Jeanne, « eSavingRw », permet aux groupes d’épargne locaux de gérer l’argent déposé et retiré par les membres tout en protégeant leurs avoirs. La plateforme permet aux Rwandais de participer de manière sécuritaire aux coopératives d’épargne. Le système de Jeanne aide à donner confiance en une solution financière communautaire, ce qui signifie qu’un plus grand nombre de femmes, de personnes marginalisées et de populations rurales peuvent accéder à des services financiers.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Moyens de subsistance numériques : les jeunes et l’avenir du travail à grande échelle.
Amériques
Le Canada soutient les microentreprises et des petites et moyennes entreprises dans les Amériques, en particulier en Colombie, à Cuba, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua et au Pérou, au moyen de formations et de soutiens techniques afin de créer des plans d’affaires. Certains de ces projets ont ciblé les femmes entrepreneures dans les industries comme la foresterie, l’agriculture et les industries extractives.
Le Canada a soutenu des projets pour aider les agriculteurs de Cuba, d’Haïti, du Honduras, du Nicaragua et du Pérou. Par exemple, le Canada a aidé les Cubains à mettre sur pied une approche de chaîne de valeur s’appliquant à la production alimentaire qui promeut la substitution des importations et une croissance économique viable à l’échelle locale. Ces programmes tenant compte des genres et respectueux du climat ont rejoint 4 200 bénéficiaires directs jusqu’à maintenant.
En Colombie, une attention spéciale a été accordée à la création d’emplois pour les jeunes défavorisés et à la relance économique dans les zones après conflit. Les projets financés par le Canada ont fourni à plus de 24 600 entrepreneurs, agriculteurs et petits exploitants des services financiers ou services d’expansion des entreprises, et ont soutenu plus de 1 300 Colombiens dans le cadre de projets d’adaptation au climat visant à assurer des moyens de subsistance viables. La contribution du Canada a également aidé des initiatives permettant d’accroître l’accès à des programmes inclusifs de protection et d’accès progressif au microfinancement pour les plus pauvres et les plus vulnérables, y compris les migrants, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les réfugiés. En partenariat avec la Banque interaméricaine de développement, 4 768 327 bénéficiaires ont reçu un soutien de la part du Canada et d’autres donateurs par l’intermédiaire de programmes ciblés de lutte contre la pauvreté.
Grâce à son soutien institutionnel au Groupe de la BID, le Canada a offert une formation en cours d’emploi à près de 290 000 personnes; plus de 460 000 femmes ont tiré profit de programmes de renforcement du pouvoir économique, et 864 000 microentreprises et petites et moyennes entreprises ont reçu un soutien financier et non financier. Le soutien institutionnel du Canada à la Banque de développement des Caraïbes a permis d’offrir une formation à plus de 1 000 personnes sur les normes respectueuses du climat en matière d’agriculture et de salubrité des aliments, d’installer des lignes de transmission et de distribution électrique sur 400 km, et plus de 100 petites et moyennes entreprises ont profité d’un meilleur accès au crédit.
Asie-Pacifique
Dans la région de l’Asie-Pacifique, le Canada s’est concentré sur les formations et le perfectionnement des compétences adaptées au marché, et sur la réduction des obstacles à la participation économique des femmes. Aux Philippines, le Canada a œuvré avec ses partenaires afin d’offrir des formations et des compétences adaptées au marché et des services financiers en vue d’améliorer les moyens de subsistance dans les communautés vulnérables. Par exemple, une formation ciblée sur les produits de la chaîne de valeur a été offerte à 32 000 personnes (57 % de femmes) composant toujours avec les effets du typhon Haiyan, qui a frappé la région en 2013. Grâce à une aide canadienne au Sri Lanka, 5 981 jeunes ont reçu des formations professionnelles dans les domaines comme le tourisme, la construction, et les technologies de l’information et des communications.
Dans le Pacifique Sud (Fidji, Vanuatu et les Îles Salomon), le Canada a fait la promotion du renforcement du pouvoir social et économique des commerçantes afin d’accroître leur sens de la gestion financière et des affaires.
En partenariat avec l’OCDE, le Canada travaille avec les pays de l’ANASE afin de créer des petites et moyennes entreprises qui sont plus concurrentielles, résilientes et novatrices. Cela contribuera à la formulation de politiques fondées sur des données probantes et a permis de soutenir le développement, le déploiement et la publication de l’index des politiques de l’ANASE en matière de petites et moyennes entreprises (en anglais). Le Canada a également financé le centre d’excellence en infrastructure de l’ANASE, géré par la Banque asiatique de développement (BAD), pour aider à préparer des projets de partenariats publics-privés (PPP) qui font la promotion de la connectivité et de l’intégration régionales. Le centre fournit une expertise et une assistance technique pour aider à concevoir et à structurer des PPP régionaux qui se prêtent à un concours bancaire et qui ont une forte incidence sur l’infrastructure.
Le soutien institutionnel du Canada à l’endroit de la BAD a contribué à des projets en collaboration avec des gouvernements régionaux et des entreprises privées qui, de 2014 à 2018, ont donné lieu à la construction et à la mise à niveau de 8 400 km de routes.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Les efforts du Canada en Cisjordanie et Gaza, en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Syrie, en Tunisie et en Ukraine ont tenu compte du genre dans la création d'emplois, l’accès à des postes de décideurs pour les femmes et leur participation à la croissance économique de la communauté, la promotion de petites et moyennes entreprises et l’accès à des sources d’eau potable.
En Jordanie, le Canada a fourni des services financiers ou des services d’expansion des entreprises à 8 685 entrepreneurs, agriculteurs et petits exploitants (dont 6 884 femmes) et a investi 2,35 millions de dollars dans 14 organisations de femmes pour renforcer le pouvoir économique des femmes en dehors de la capitale et promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres. En outre, le Canada a soutenu 727 activités de sensibilisation à la participation des femmes à l’économie, et a rejoint 60 906 personnes.
En Cisjordanie et Gaza, l’aide du Canada a permis d’accroître l’accès à des terres de qualité et à des ressources d’eau durables et d’améliorer la gestion de l’eau par les communautés et les coopératives agricoles. Le Canada a fourni un soutien technique et en nature à 40 coopératives, dont 25 coopératives agricoles et 15 coopératives de femmes (ce qui représente un total de 1 411 femmes membres).
Le Canada a continué à habiliter de petites et moyennes entreprises en Ukraine à profiter de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU). Cela a donné lieu à des exportations d’une valeur de plus de 1,1 million de dollars effectuées par de petites et moyennes entreprises de l’Ukraine à destination du Canada, et à des investissements de 750 000 $ du Canada vers l’Ukraine.
En 2018, le Canada, le Liban et la Banque mondiale ont convoqué la première conférence de haut niveau du Machreq pour le renforcement du pouvoir économique des femmes. Les gouvernements du Liban, de l’Irak et de la Jordanie y ont présenté des plans d’action nationaux pour le renforcement du pouvoir économique des femmes et se sont engagés à accroître la participation des femmes à la main-d’œuvre de 5 % en Irak et au Liban, et de 24 % en Jordanie au cours des cinq prochaines années. Grâce au soutien du Canada, le mécanisme en matière d’égalité entre les genres du Machreq a également été lancé.
En outre, en tant qu’actionnaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Canada contribue aux efforts de la BERD pour favoriser la croissance durable et inclusive en Europe, dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée, et en Asie centrale. Par exemple, les projets financés par la BERD ont contribué à de meilleurs services de chauffage, de déchets et d’eau pour 18 millions de personnes, versé 52 millions d’euros à des institutions financières partenaires appuyant des entreprises dirigées par des femmes, formé 1 452 femmes à de nouvelles compétences, et fourni une meilleure infrastructure sociale à plus de 1,35 million de personnes. Qui plus est, le Canada a contribué aux efforts de la Banque en ciblant les pays durement touchés par la crise des réfugiés syriens, tels que la Jordanie, le Liban et la Turquie. Lors de l’assemblée annuelle de la BERD en 2018, les intervenants ont convenu de mettre 15 millions d’euros de côté à partir du revenu net de la Banque en 2017 en faveur des pays accueillant des réfugiés dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée. Depuis mars 2019, la BERD a signé des investissements s’élevant à 419 millions d’euros dans le cadre de son programme d’intervention à la suite de la crise des réfugiés.
Multirégion
En 2018-2019, le Canada, grâce à ses contributions de base et volontaires, a soutenu plusieurs initiatives multilatérales dont l’objectif est de faire progresser les droits et le leadership économique des femmes et de promouvoir les marchés et l’entrepreneuriat inclusifs.
En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a créé le Mécanisme de déploiement d’experts (MDE) pour le commerce et le développement, qui est une initiative d’aide au développement de 16,5 millions de dollars sur sept ans, conçue pour optimiser les effets positifs des ententes de commerce et d’investissement entre le Canada et les pays admissibles à l’aide au développement officielle (ADO). Le MDE contribue à réduire la pauvreté par le déploiement d’experts techniques qui aident les pays en développement à négocier, à mettre en œuvre leurs accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux et les accords sur la protection des investissements étrangers avec le Canada, à s’y adapter et à en bénéficier. Le MDE harmonise l’aide technique avec la Politique d’aide internationale féministe et l’approche inclusive du Canada en matière de commerce.
Le soutien du Canada au GBM a contribué aux efforts internationaux à l’appui de la croissance économique durable et inclusive dans les pays en développement. Par exemple, en 2018-2019, l’IDA, l’une des cinq institutions du GBM, a financé des projets qui ont permis d’aider 4,41 millions d’agriculteurs à adopter de meilleures technologies agricoles et à construire ou remettre en état 12 356 km de routes.
Le Canada a également noué un partenariat avec la Banque mondiale ayant trait à l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (en anglais) pour aider les entrepreneures dans les pays en développement. Pendant sa première ronde de financement, cette initiative a affecté 120 millions de dollars américains à des programmes et projets mis en œuvre par les banques de développement pour des activités mondiales, régionales ou nationales. L’initiative vise à accroître le soutien des secteurs publics et privés pour les entrepreneures, en accordant une attention particulière aux milieux les plus pauvres et les plus fragiles.
Au Groupe de la Banque mondiale, les Fonds I et II de partenariat Canada-Société financière internationale (SFI) (FPCS) ont contribué à réduire les inégalités entre les genres grâce à des réformes des milieux d’entreprise, au renforcement des entreprises appartenant à des femmes et à la création de meilleures perspectives d’emploi pour les femmes. En 2018, le FPCS II a permis à 7 836 000 entrepreneures d’accéder plus facilement à des services non financiers en vue de lutter contre les obstacles à leur croissance économique.
Grâce à la contribution du Canada et d’autres donateurs, le Fonds international de développement agricole (en anglais) a rejoint plus de 115 millions de personnes dans les régions rurales, dont 51 % de femmes. En versant une contribution de 75 millions de dollars, le Canada se positionne comme huitième donateur en importance quant à la 11e reconstitution des ressources du Fonds (2019-2121). Les travaux du Fonds International de développement agricole en matière de financements ruraux ont contribué à améliorer l’accès à des services financiers ruraux pour plus de 25 millions de personnes. En outre, le Fonds a formé 2,6 millions de personnes à des pratiques et technologies de culture agricole et d’élevage afin d’accroître leur productivité agricole. Grâce à son programme d’adaptation au climat, il a aidé 2,63 millions de petits exploitants agricoles à composer avec les effets du changement climatique.
Le Canada est également un donateur fondateur de l’initiative AgRésultats (en anglais), qui recourt à un modèle novateur de concours de financement axé sur les résultats qui invite le secteur privé à rejoindre les petits exploitants agricoles dans les marchés mal desservis. Par exemple, le projet Nigeria Aflasafe™ Challenge (en anglais) a offert un financement qui encourageait les entreprises agricoles à faire la promotion d’Aflasafe (un produit qui aide à réduire le taux d'aflatoxine dans les grains) auprès d’environ 25 000 petits exploitants agricoles nigérians. Les agriculteurs qui ont appliqué Aflasafe à leurs cultures ont produit 82 335 tonnes métriques de maïs exempt d’aflatoxine qui se sont vendues à prix fort dans les marchés locaux.
En 2018-2019, Affaires mondiales Canada et le CRDI ont continué de financer conjointement le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale mobilisant 20 organisations canadiennes et 40 organisations du Sud. De 2010 à 2018, le Fonds a touché quelque 78 millions de personnes dans le monde en augmentant proportionnellement plusieurs dizaines des 144 innovations qu'elle a générées. Le renforcement économique des femmes figurait bien en évidence dans les projets du Fonds.
Le partenariat du Canada avec l’Institut canadien international des ressources et du développement (en anglais), créé par une coalition de l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université Simon-Fraser et Polytechnique Montréal, a contribué à renforcer les structures de gouvernance des secteurs des ressources naturelles de pays en développement. En 2018-2019, plus de 2 600 personnes (dont 1 011 femmes) ont reçu une formation sur les pratiques exemplaires mondiales relatives à une utilisation des ressources du secteur de l’extraction qui tient compte du genre et est durable sur le plan de l’environnement. En juillet 2018, un nouveau programme de maîtrise a été lancé au Sénégal pour améliorer la capacité du corps professoral et des étudiants à mettre en œuvre des pratiques exemplaires dans le cadre de la gestion des résidus miniers.
Développement International Desjardins (DID) a aidé des micro-entreprises et de petites entreprises à accéder à du financement au moment de créer et de démarrer leurs entreprises en Afrique et en Amérique latine. En 2018-2019, en mettant sur pied les Centres financiers aux entrepreneurs, et, grâce au soutien du Canada, DID a octroyé 8 198 prêts à des entrepreneurs dont plus du tiers étaient des femmes.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) fournit une aide technique aux pays en développement pour qu’ils renforcent leurs capacités en matière de salubrité des aliments, de santé des animaux et de protection des végétaux. En 2018-2019, l’ACIA est venue en aide à certains pays, dont l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et l’Ukraine, au moyen d’activités comme le partage d’information, des réunions, des séminaires et la visite d’installations. Ces activités ont contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires scientifiques axées sur les risques. En outre, l’ACIA a fourni une aide financière et une expertise technique pour que des webinaires abordent les problèmes de non-conformité ayant trait aux exportations d’aliments en provenance de pays en développement à destination du Canada. L’aide a contribué au développement économique durable de ces nouvelles économies en stimulant les exportations d’aliments qui satisfont aux exigences du Canada en matière d’importation.
Champ d’action : L’environnement et l’action pour le climat
ODD soutenus dans le cadre du champ d’action de l’environnement et de l’action pour le climat*


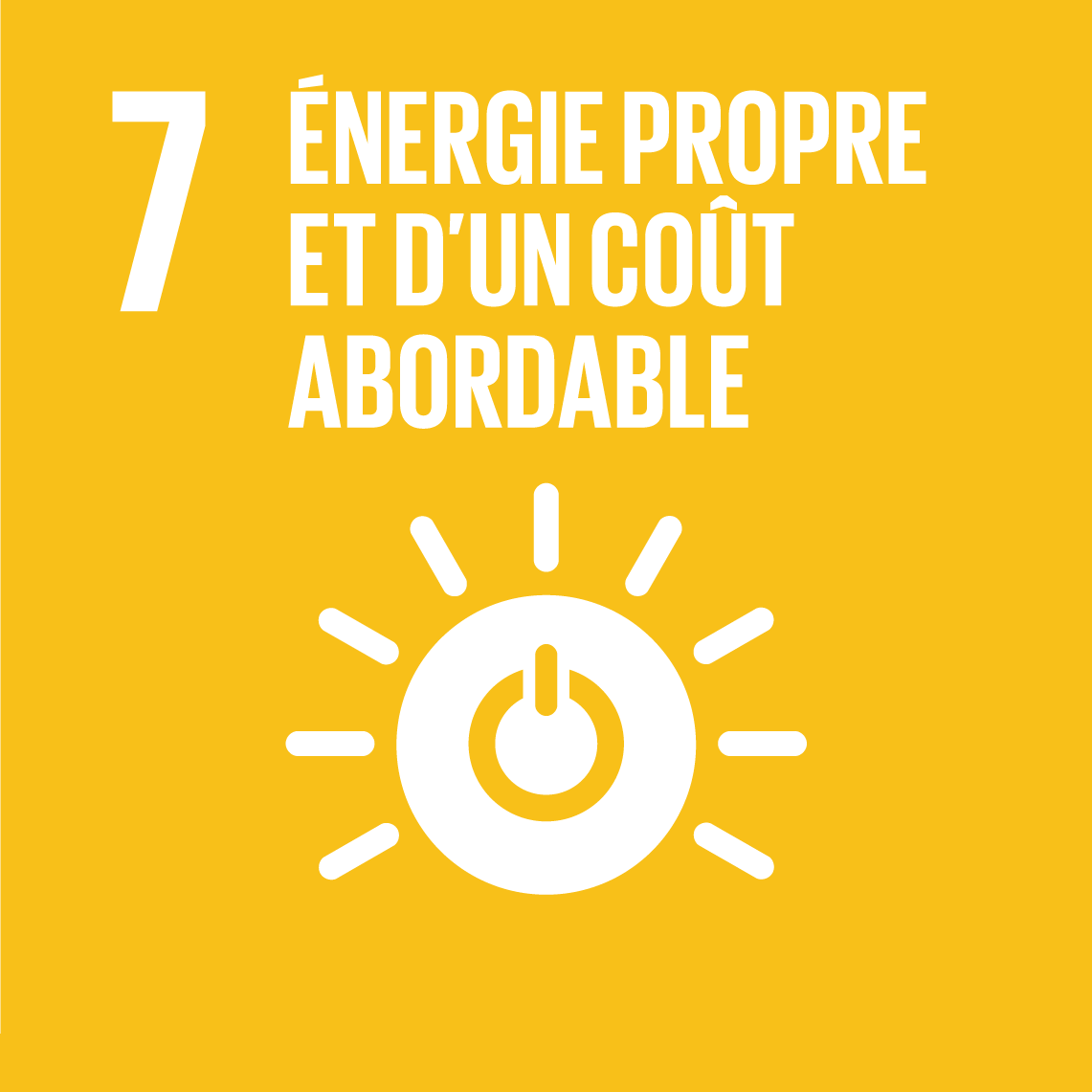
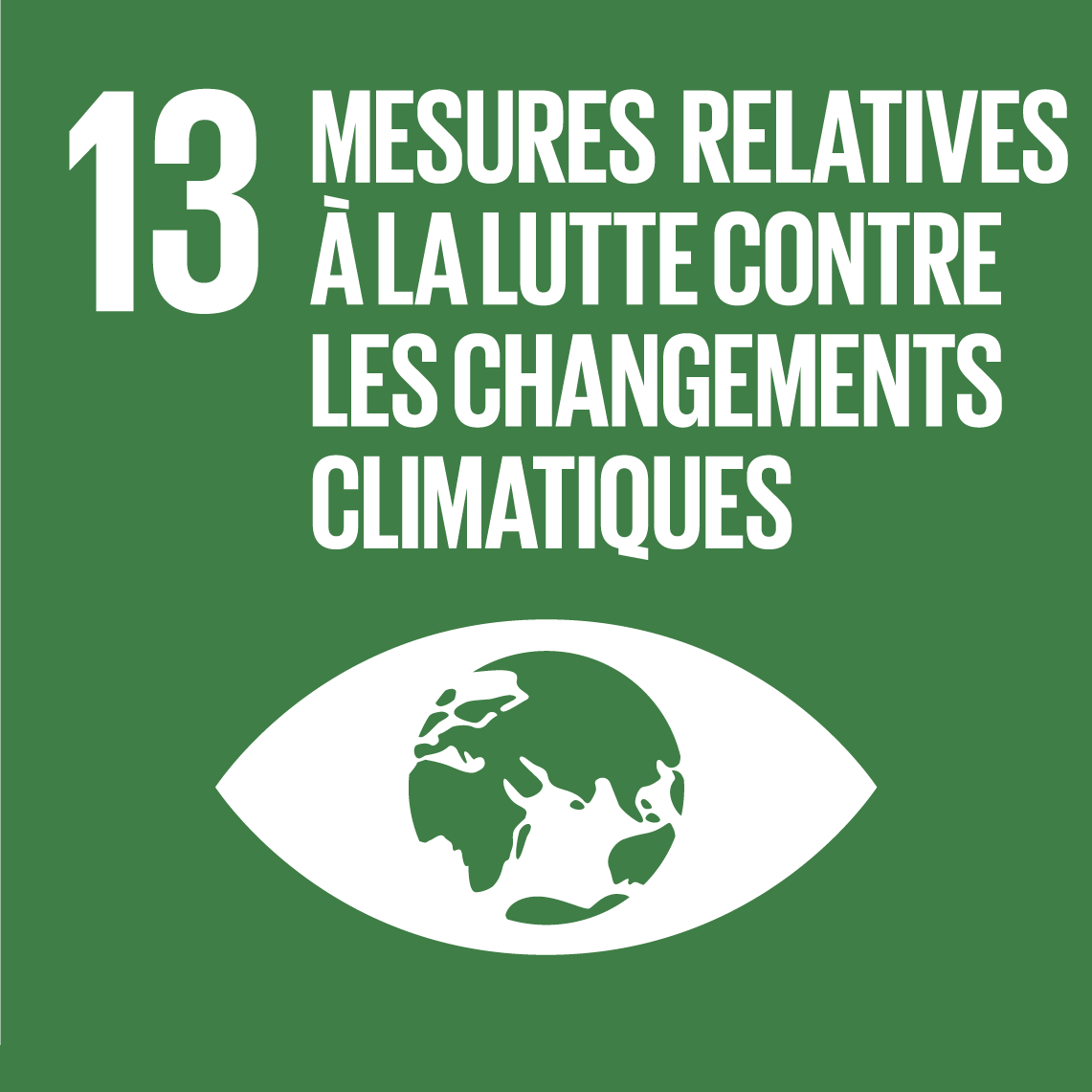


* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
L’état de l’environnement partout dans le monde se détériore à un rythme alarmant. Le changement climatique et la dégradation de l’environnement, y compris la plus grande fréquence et la plus grande intensité des catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations, les sources d’eau douce de plus en plus rares, la désertification et la dégradation des sols représentent une menace pour les gains issus du développement à long terme. Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent dans des zones à risque en matière de changement climatique : des deltas, des terres semi-arides et des bassins versants alimentés par les glaciers en Afrique et en Asie. La Banque mondiale estime que faute de mesures immédiates, les effets du changement climatique pourraient faire basculer 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté d’ici 2030. De nombreuses collectivités, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, connaissent les effets les plus importants de ces changements qui touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, surtout quand leurs moyens de subsistance dépendent de ressources naturelles.
Le Canada a signé l’Accord de Paris en 2015. Dans le cadre de cet engagement, le Canada octroie un financement aux pays en développement, dont diverses ressources de financement climatique, pour contribuer à l’objectif collectif de 100 milliards de dollars américains par année d’ici 2020. Le Canada tient sa promesse de 2,65 milliards de dollars canadiens pendant la période de 2016 à 2021 pour soutenir la transition des pays en développement vers des économies à faibles émissions de carbone et résilientes face au climat. En avril 2019, le Canada annonçait un financement de plus de 1,5 milliard de dollars canadiens pour des initiatives environnementales, en particulier dans le cadre de cette promesse.
Le Canada concentre ses efforts relatifs à l’environnement et à l’action pour le climat sur trois objectifs :
- renforcer la gouvernance environnementale et la participation des femmes à la prise de décisions;
- investir dans des économies à faibles émissions de carbone et résilientes aux changements climatiques;
- encourager les pratiques environnementales qui appuient des communautés saines, résilientes et adaptatives.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur l’environnement et l’action pour le climat. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Inde : 15,2 millions de dollars
Bangladesh : 14,7 millions de dollars
Éthiopie : 12,1 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 630,39 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 630,14 millions en ADO, dans le cadre d’initiatives relatives au champ d’action de l’environnement et de l’action pour le climat.
Le Canada soutient des initiatives qui permettent d’atténuer les changements climatiques et d’aider les pays en développement à s’adapter à ses effets environnementaux et socio-économiques. Le Canada fournit en outre un soutien dans le domaine de la gestion durable des ressources. Entre autres, ces contributions ont donné lieu à :
176 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre réduites ou évitéesNote de bas de page 10.
- une réduction accrue des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le recours à des technologies à faibles émissions de carbone telles que l’énergie éolienne, solaire et géothermique;
- l’adoption de pratiques agricoles respectueuses du climat par les petits exploitants agricoles;
- la production et la conservation de ressources forestières et de la biodiversité;
- l’accroissement du financement privé mobilisé vers l’action pour le climat dans les pays en développement;
- l’accroissement de l’accès à des technologies vertes pour les groupes marginalisés;
- le renforcement de la capacité du gouvernement et des collectivités de mettre en œuvre des mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements;
- la promotion d’une plus grande résilience des pays et des collectivités vulnérables aux catastrophes naturelles liées au climat.
Afrique subsaharienne
Le Canada a soutenu la transition de pays en développement vers des économies et des sociétés à faibles émissions de carbone et résilientes au climat, y compris en Afrique subsaharienne. Il s’agissait notamment de contributions en cours à l’Initiative de l’Afrique pour les énergies renouvelables (IAER), menée par des Africains et dont le but est d’améliorer l’accès aux énergies renouvelables, principalement grâce à des investissements directs dans les infrastructures renouvelables. Le Canada fournit 150 millions de dollars à l’IAER. Le Canada, ainsi que d’autres partenaires du G7, a continué d’apporter son soutien aux efforts visant à améliorer la résilience aux risques climatiques, notamment 40 millions de dollars à l’Organisme African Risk Capacity de 2017 à 2021. L’objectif de cette initiative est d’aider les gouvernements africains à améliorer leur capacité de planifier, de se préparer et d’intervenir en cas d’événements extrêmes et de catastrophes naturelles.
Le Canada a également travaillé en partenariat avec des organisations de la société civile canadiennes pour promouvoir l’énergie renouvelable dans la région. Le partenariat du Canada avec Polytechnique Montréal pour l’établissement d’un centre de formation destiné aux techniciens en énergie solaire en Afrique de l’Ouest a contribué à l’élaboration d’un groupe de praticiens professionnellement formés en énergie solaire. Au total, 275 techniciens principaux et 40 ingénieurs dans huit pays ont été formés et appliquent leurs connaissances à l’échelle de la région. Le projet a également donné lieu à l’installation de centres de santé et d’autres établissements alimentés par l’énergie solaire au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Ces travaux ont facilité l’accès des femmes aux centres de santé communautaires, aux cliniques de maternité et aux dispensaires de médicaments devant être réfrigérés, ainsi que l’accès aux écoles pour les filles et les garçons. Au Burkina Faso, il était question d’alimenter en énergie solaire les cliniques de santé maternelle de six villages (dont peuvent profiter 13 305 femmes et 12 284 hommes), au Mali, de doter trois villages d’éclairage et de pompes à eau potable alimentées à l’énergie solaire et, au Sénégal, de fournir des trousses d’alimentation à l’énergie solaire dans les foyers de deux villages, dont peuvent profiter 528 572 hommes et femmes.
Amériques
Les habitants d’Haïti, du Pérou et de nombreux autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont bénéficié du soutien du Canada pour des programmes de formation sur des enjeux environnementaux et l’agriculture durable, la gestion du risque lié aux catastrophes et l’adaptation au changement climatique.
En Haïti, 3 236 enseignants et élèves ont participé à des activités de sensibilisation sur le maintien d’un environnement propre et sain, y compris par le tri des déchets. En outre, cinq institutions financières et plus de 500 agriculteurs ont reçu une formation sur les enjeux environnementaux.
Au Pérou, le Canada collabore avec SUCO pour aider à améliorer les conditions et les perspectives économiques des jeunes agriculteurs, y compris les femmes, en fournissant une formation technique en matière d’agriculture, d’élevage et d’entrepreneuriat durables. En 2018-2019, ce partenariat a contribué à former 554 personnes sur des enjeux environnementaux, tels que la production de légumes biologiques, la gestion agro-écologique d’organismes nuisibles et de maladies, l’utilisation durable de l’eau et les techniques d’irrigation, ce qui a fait passer le nombre de personnes formées depuis 2015 à 1 310 (dont 1 062 jeunes agriculteurs).
Dans les Caraïbes, en partenariat avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, le Canada a mis en œuvre des stratégies et des outils communautaires tenant compte du genre pour gérer le risque et s’adapter aux changements climatiques. Le Canada a également soutenu un programme de gestion des risques liés aux catastrophes et un Fonds réactif en cas de catastrophes pour aider les Caribéens à intervenir en cas de catastrophes environnementales.
La Banque interaméricaine de développement (BID) a géré le Fonds canadien pour le climat pour le secteur privé dans les Amériques (C2F), et cherche à jouer un rôle de catalyseur pour les investissements du secteur privé dans des projets portant sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets dans la région, afin d’aider les pays à réduire leur empreinte carbone et à s’adapter aux effets négatifs des changements climatiques. Le Fonds est axé sur l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, les biocarburants, l’agriculture durable, la foresterie, l’utilisation des sols et l’adaptation. Seulement en 2018, les contributions du Canada et des co-investisseurs aux projets de C2F soutenaient la réduction de plus de 560 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) et la production d’environ 930 000 mégawattheures d’énergie renouvelable. En 2018-2019, le Canada a en outre prévu 223,5 millions de dollars pour la deuxième phase du Fonds, qui couvrira la période de 2018-2044. Le C2F mise sur la réussite de sa première phase et continuera de mettre à l’essai des moyens novateurs d’intégrer les considérations liées à l’égalité des genres aux projets du secteur privé.
Asie-Pacifique
Les manifestations climatiques auront probablement une incidence croissante sur la santé humaine, la sécurité, les moyens de subsistance et la pauvreté, dont le type et l’ampleur varieront considérablement partout en Asie et dans les îles du Pacifique. En 2018-2019, le Canada est demeuré résolu à aider les collectivités vulnérables à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter, et à intégrer des éléments de durabilité environnementale aux nouveaux et aux anciens projets dans la région.
Grâce à sa collaboration étroite avec la BAD en matière de changements climatiques, le Canada encourage des économies résilientes et à faibles émissions de carbone dans la région. Par exemple, le Fonds climatique canadien pour le secteur privé en Asie de la BAD soutient des projets du secteur privé des pays de l’Asie-Pacifique qui aident les pays à réduire leur empreinte carbone et à s’adapter aux effets négatifs des changements climatiques. En juin 2019, les résultats comprenaient déjà six projets d’octroi de ressources financières à des conditions favorables pour des initiatives relatives à l’énergie renouvelable qui devraient installer une capacité de production d’un total de 981 mégawatts d’énergie renouvelable, ce qui donnerait lieu à une réduction de 2 millions de tonnes d’émissions d’éq. CO2 par an. En 2016-2017, le Canada s’est également engagé à verser 200 millions de dollars pour la deuxième phase du Fonds climatique canadien pour le secteur privé en Asie – II de la BAD. En décembre 2018, les résultats comprenaient déjà trois projets d’octroi de ressources financières à des conditions favorables qui devraient permettre d’installer un total de 162 mégawatts d’énergie renouvelable, ce qui donnerait lieu à une réduction de 4,1 millions de tonnes d’émissions d’éq. CO2 par an.
Un autre projet dirigé par la BAD, Résilience aux changements climatiques et aux désastres naturels au Myanmar, a lancé la plateforme unifiée du Myanmar sur le risque de catastrophes (Myanmar Unified platform for Disaster Risk Application, ou MUDRA), un portail à guichet unique utilisé par les organismes gouvernementaux pour collaborer, partager et appliquer de l’information sur le risque de catastrophes en vue de la prise de décisions.
Le financement de 10 millions de dollars du Canada de l’Integrated Disaster Risk Management (IDRM) Fund pour l’ANASE est géré par la BAD. En 2018-2019, ce fonds a aidé à formuler et à mettre en œuvre des solutions régionales novatrices pour réduire l’impact des catastrophes sur les populations vulnérables et encourager une croissance durable dans la région. Le fonds a également contribué aux efforts de l’ANASE en matière de gestion des risques liés aux catastrophes en soutenant l’accord de l’organisme régional sur la gestion des risques et les réponses d’urgence.
Renforcer la résilience aux changements climatiques

Pays : Pakistan © Tom Pilston, CRDI
La hausse des températures, les régimes changeants des moussons et une panoplie d’autres facteurs rendent le nord du Pakistan extrêmement vulnérable aux changements climatiques. Plus d’un milliard de personnes dans la grande région de l’Asie du Sud dépendent de l’eau pour vivre, et cette ressource y est peu abondante. Avec l’appui du CRDI et du Department for International Development du Royaume-Uni, l’Initiative de recherche concertée sur l'adaptation en Afrique et en Asie soutient la résilience des populations vulnérables et leurs moyens de subsistance.
Asif Jehengir nettoie un système de pompe à eau à énergie solaire qui aide les fermiers à irriguer leurs champs. Il s’agit là de l’une des mesures d’adaptation ayant fait l’objet d’un projet pilote dans le nord du Pakistan pour initier les fermiers locaux aux pratiques agricoles soucieuses de l’environnement dans le but d’améliorer la gestion de l’eau. Outre la conversion du diésel à l’énergie solaire pour alimenter les pompes, une série de techniques telle l’irrigation goutte à goutte et la multi-culture ont été adoptées. Les mesures d’adaptation ont amélioré la productivité des cultures et le gouvernement est en train d’étendre cette initiative pour aider 30 000 fermiers au Pakistan.
Multirégion
Le Canada a soutenu un certain nombre d’activités et d’investissements importants au moyen de ses contributions de base et volontaires à des organisations multilatérales, y compris des institutions financières internationales. Par exemple, le Canada s’est taillé une place de donateur de premier plan à la Global Environment Facility (en anglais), qui soutient des activités dans les pays en développement liées à la biodiversité, aux produits chimiques et aux déchets, au changement climatique, à la dégradation des eaux internationales et des sols. En 2018-2019, le soutien du Canada à la Global Environment Facility (GEF) se chiffrait à 54,75 millions de dollars. Les résultats de la sixième reconstitution des ressources de la GEF au mois de juin 2019 incluent la gestion améliorée de 511,5 millions d’hectares de paysages terrestres et marins aux fins de conservation de la biodiversité et la réduction de 1 280 millions de tonnes métriques d’éq. CO2. En outre, le Canada a continué de collaborer sur des enjeux en matière de gouvernance, de politiques et de programmation à la GEF, notamment en promouvant l’intégration de l’égalité des genres dans tous les projets, en collaborant mieux avec le secteur privé et en adoptant un cadre plus robuste sur les résultats et le suivi.
Grâce à son siège au sein du conseil d’administration, le Canada est un donateur actif du Fonds vert pour le climat (en anglais), qui soutient des initiatives de développement à faibles émissions et résilientes au climat dans les pays en développement. Le Canada a déboursé 132 millions de dollars canadiens en 2018-2019, portant ainsi son soutien total au Fonds vert pour le climat (FVC) à 300 millions de dollars. Au mois de mars 2019, le FVC avait approuvé le versement de 5 milliards de dollars américains pour 102 projets d’atténuation et d’adaptation dans 97 pays en développement, ce qui a permis d’optimiser 12,2 milliards de dollars américains de financement de projet provenant des secteurs public et privé, soit un ratio de levier financier de 2,50 $ pour chaque dollar de financement du FVC. Les contributions du Canada et des autres donateurs et investisseurs devraient permettre d’éviter 1,5 milliard de tonnes métriques d’éq. CO2 et accroître la résilience de 273 millions de personnes. Par exemple, le programme Universal Green Energy Access en Afrique subsaharienne permettra d’accroître l’accès à l’électricité pour tous en mettant à l’échelle les investissements en énergie renouvelable.
Les institutions du Groupe de la Banque mondiale, dont le Canada est actionnaire, jouent un rôle important dans l’appui international à la gestion durable des ressources et au développement des sources d’énergie et des infrastructures propres dans les pays en développement. Par exemple, en 2018-2019, l’IDA a financé des projets soutenant une capacité de production de 6,9 gigawatts d’énergie renouvelable.
Le Canada disposait également d’une programmation en cours par l’intermédiaire du Fonds canadien pour les changements climatiques (en anglais), géré par la Société financière internationale, une autre institution du GBM. Le programme a facilité le passage des investissements relatifs aux changements climatiques vers l’énergie renouvelable, les prêts visant l’énergie durable, les améliorations en matière d’efficacité énergétique et d’autres projets novateurs à faibles émissions de carbone dans les marchés en développement. Au 30 juin 2018 (fin de la période d’investissement), le Canada et ses co-investisseurs avaient consacré 266,7 millions de dollars américains à 26 projets d’investissements et à 20 projets de service consultatif dans plus de 30 pays. Les résultats prévus de ces projets comprenaient la réduction directe des gaz à effet de serre de 572 000 tonnes métriques d’éq. CO2 par année, ce qui atteindra 1 100 000 tonnes métriques d’éq. CO2 dès que tous les projets auront été mis en œuvre. Un autre résultat est la mise en place d’une capacité de production de près de 400 mégawatts en énergie renouvelable éolienne, solaire, hydroélectrique et de biomasse. En 2018, le Canada a également annoncé un engagement de 250 millions de dollars (en anglais) en vue de poursuivre le programme de financement mixte pour la lutte contre les changements climatiques (en anglais), une mobilisation de capitaux du secteur privé dans l’action climatique mondiale.
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) offre une coopération technique et un renforcement des capacités aux pays en développement afin d’améliorer leur état de préparation aux catastrophes, de faciliter l’utilisation de produits et d’équipement écologiques, d’améliorer le développement et le déploiement de technologies respectueuses de l’environnement, et de soutenir l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. Par exemple, ECCC soutient la Coalition pour le climat et l’air pur, une coalition multipartite qui œuvre à réduire les émissions de polluants de courte durée de vie (PCDV) afin d’atténuer le changement climatique et d’améliorer la qualité de l’air. Réduire les émissions de PCDV est crucial pour éviter les effets les plus dangereux et les plus graves du changement climatique.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada est le représentant canadien officiel à l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’organisme des Nations Unies responsable des télécommunications et des technologies de l’information et des communications. En 2018, l’UIT a achevé la mise en œuvre de deux systèmes de préparation aux catastrophes en Zambie, avec alerte précoce qui permettra de communiquer des avertissements rapides relatifs aux inondations et aux glissements de terrain. L’UIT a également renforcé la capacité des pays comme la Papouasie–Nouvelle-Guinée et les Tonga, qui ont été frappées par des catastrophes en 2018, à coordonner les opérations de secours et à composer avec leurs effets immédiats en fournissant de l’équipement de télécommunication d’urgence.
Soutien à l’amélioration des mécanismes de mesure, de notification et de vérification avec l’Alliance du Pacifique

Pays : Mexique © Scott Mueller
Un défi clé de la réponse mondiale aux changements climatiques est la lutte contre l’augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde en développement. En renforçant leur capacité de mesure, de notification et de vérification des émissions, les pays en développement peuvent se faire une idée claire des sources d’émission et des tendances. Cela est nécessaire pour formuler des politiques efficaces d’atténuation, comme la tarification du carbone, et mettre en œuvre leurs contributions déterminées à l’échelle nationale. Environnement et Changement climatique Canada les y encourage en soutenant un groupe de travail de l’Alliance du Pacifique en vue de coopérer en la matière. Ce groupe de travail initie les pays de l’Alliance du Pacifique à la portée et la nature de leurs systèmes respectifs, cerne les défis communs et poursuit l’harmonisation de leurs systèmes de suivi. En mars 2019, ECCC a financé une rencontre de deux jours à Mexico, où ce groupe de travail s’est penché sur l’assise que fournissent les systèmes de suivi au sein de projets aux instruments efficaces fondés sur le marché qui permettent aux pays d’atténuer leurs émissions, d’atteindre leurs cibles et de tirer profit des transferts technologiques associés. Grâce à ce soutien, les pays ont pu définir un plan de deux ans pour atteindre un consensus sur les critères minimaux en matière de normes communes de suivi, afin de faciliter les liens éventuels avec le marché régional du carbone.
En 2018-2019, Statistique Canada a participé à des ateliers dont l’objet était d’approfondir les connaissances des participants sur le Système de comptabilité environnementale et économique intégrée (en anglais), une norme internationale novatrice élaborée par les Nations Unies pour rendre compte des actifs environnementaux faisant partie de l’économie. Un atelier pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes était axé sur la comptabilité expérimentale des écosystèmes. Un autre atelier, au Royaume-Uni, visait à créer un ensemble d’indicateurs du développement durable à l’appui du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (en anglais) de l’Union internationale pour la conservation de la nature. En outre, un atelier organisé sous l’égide des Nations Unies en Thaïlande visait à animer une communauté de pratique dans la région de l’Asie-Pacifique en ce qui concerne les normes relatives aux statistiques environnementales et économiques sur les océans.
Champ d’action : La gouvernance inclusive
ODD soutenus dans le cadre du champ d’action de la gouvernance inclusive*



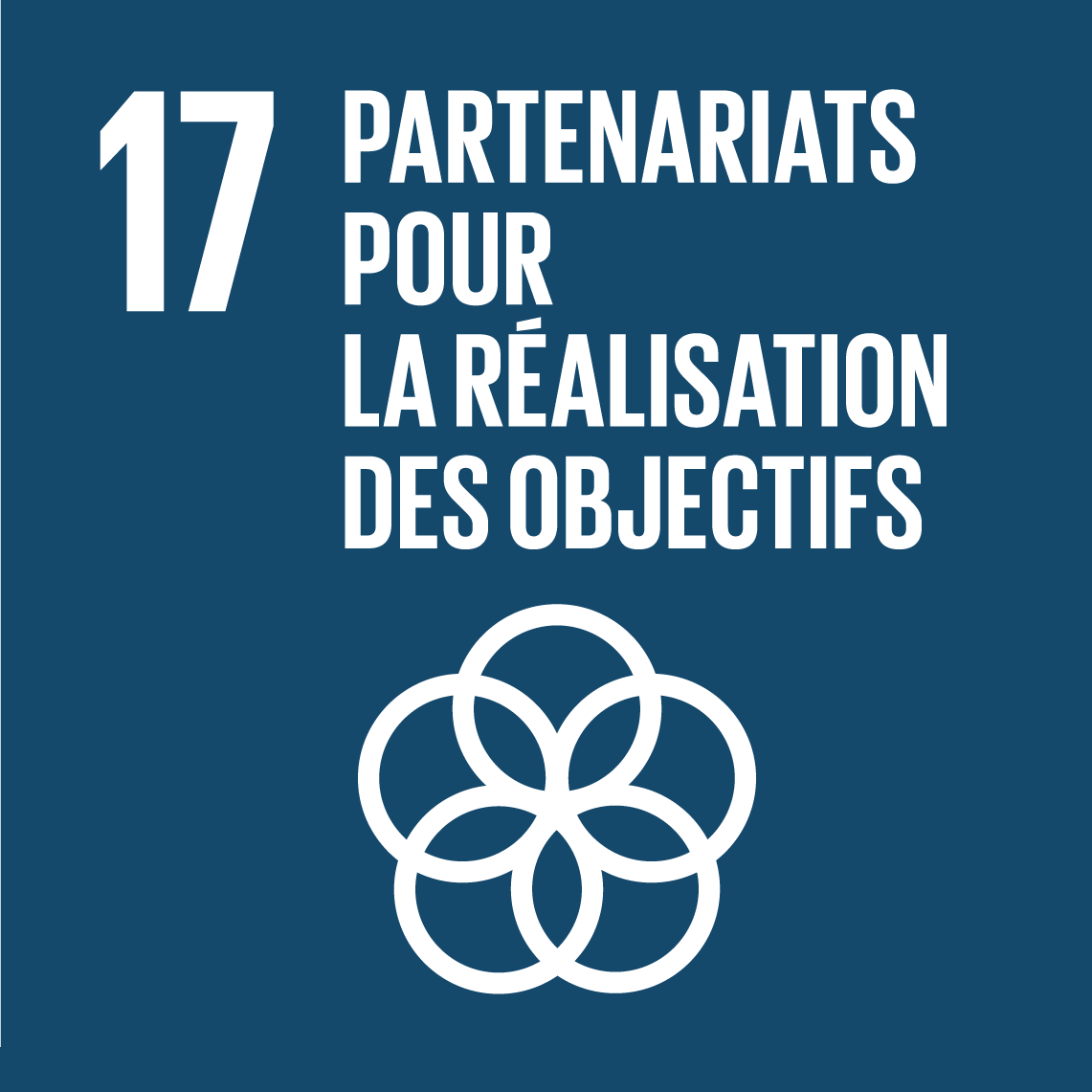
* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
La gouvernance inclusive est considérée comme fondamentale pour le développement durable à long terme. La gouvernance réfère à la façon dont le pouvoir est exercé et dont les ressources sont réparties entre les différents groupes de la société. Elle touche la façon dont les États gèrent des défis complexes comme l’inégalité, la migration, l’urbanisation, la violence, les ressources naturelles et les changements climatiques. En mettant l’accent sur l’inclusion, les pays peuvent libérer le potentiel des divers segments de leur population tout en contribuant à l’engagement du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de ne laisser personne pour compte, particulièrement en ce qui a trait à l’Objectif 16. La gouvernance est inclusive lorsqu’elle sert et mobilise efficacement tous les groupes, tient compte du genre et des autres facettes de l’identité, et rend les institutions, politiques, processus et services accessibles, responsables et adaptés à tous les membres de la société.
Le Canada concentre ses efforts de gouvernance inclusive de façon à :
- promouvoir et protéger les droits de la personne;
- accroître l’accès équitable à un système de justice qui fonctionne bien;
- renforcer la participation à la vie publique;
- veiller à ce que les services publics fonctionnent pour tout le monde.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur la gouvernance inclusive. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Afghanistan : 55,2 millions de dollars
Colombie : 31,0 millions de dollars
Ukraine : 27,6 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 442,56 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 437,17 millions en ADO, dans le cadre d’initiatives relatives au champ d’action de la gouvernance inclusive.
Le Canada soutient la gouvernance inclusive de façon concrète et multidimensionnelle. Collaborer au renforcement des capacités des institutions publiques constitue un élément central de l’approche du Canada. Il s’agit de renforcer les systèmes juridiques et d’application de la loi, les institutions démocratiques et électorales et les autres services locaux. Le Canada a également soutenu des réformes législatives, réglementaires et stratégiques qui visaient à renforcer la protection des droits de la personne, à améliorer les systèmes juridiques, électoraux et fiscaux et à consolider les services publics comme les capacités statistiques et les mécanismes de vérification. Les investissements du Canada ont également atteint les populations locales et les organisations de la société civile. Les projets ont contribué à des initiatives d’éducation civique pour renforcer les connaissances et la sensibilisation aux droits de la personne, à la participation politique et aux recours juridiques, notamment parmi les femmes et les communautés marginalisées.
18 035 845 personnes ont été touchées par des projets qui soutiennent le leadership des femmes en gouvernanceNote de bas de page 11.
5 609 organisations de la société civile qui font la promotion des droits de la personne ou de la gouvernance inclusive ont été soutenuesNote de bas de page 12.
Entre autres, ces contributions ont donné lieu à :
- la capacité améliorée des entités étatiques et non étatiques à protéger et à promouvoir les droits de la personne;
- un accès accru aux recours juridiques et au système de justice;
- la réduction des obstacles à la participation égale et efficace de tous dans toutes les formes de vie publique, y compris la politique;
- le renforcement des institutions démocratiques locales;
- le renforcement des efforts de lutte contre la corruption et l’impunité;
- une meilleure gestion des finances publiques et une meilleure prestation de service par les institutions des pays partenaires.
Afrique subsaharienne
Par sa défense d’enjeux et sa programmation, le Canada s’est engagé à aider les pays et les organismes locaux en Afrique subsaharienne, dont l’Union africaine, à renforcer les institutions démocratiques, à améliorer la gouvernance et à faire progresser les droits de la personne. Ces efforts visent à renforcer la capacité des organes électoraux et à améliorer la participation politique et le leadership de tous les citoyens. Le Canada collabore également de façon bilatérale et multilatérale pour promouvoir et protéger les droits de la personne dans la région.
Le Canada continue de soutenir les efforts visant à renforcer la responsabilité civique et la participation du public à la vie démocratique, comme l’accroissement de la participation politique des femmes et des jeunes pour aider à bâtir un environnement politique plus inclusif et plus responsable. Par exemple, par l’intermédiaire du projet Appui à l’éducation civique et électorale de Développement et Paix en République démocratique du Congo (RDC), plus de 8 millions de personnes ont participé à plus de 450 000 discussions de groupe dans le cadre de campagnes d’éducation civique et électorale axées sur les principes clés d’élections démocratiques et crédibles. Plus de 10 000 animateurs du projet ont reçu une formation supplémentaire à titre d’observateurs des élections. Ils ont été déployés aux bureaux de scrutin partout au pays dans le cadre de la mission nationale d’observation des élections en décembre 2018. En outre, le Canada a soutenu le Programme des Nations Unies pour le développement afin d’appuyer l’accréditation de 196 femmes comme observatrices des élections dans 10 provinces de la RDC ayant reçu une formation sur les moyens d’atténuer la violence et les conflits électoraux.
Le Programme des Nations Unies pour le développement a également soutenu le cycle électoral de 2015-2018 au Libéria, dont quatre élections partielles en 2018. Grâce au soutien du Canada et d’autres donateurs, la Commission électorale du Libéria a enclenché des processus qui ont donné lieu à un certain nombre de réformes électorales.
Le Canada travaille également à l’amélioration de l’accès à la justice, en particulier pour les femmes dans les pays en développement. Au Burundi et en RDC, TRIAL International a offert une aide juridique à 446 victimes de violations des droits de la personne. De plus, 91 avocats burundais et congolais ont été formés sur la documentation et la présentation d’affaires ayant trait à des crimes internationaux et à de graves violations des droits de la personne, et une attention particulière a été accordée aux crimes liés à la VSFG. Avocats sans frontières Canada, de concert avec l’Université Laval, a dressé un inventaire des violations des droits de la personne, y compris les crimes liés à la VSFG qui se sont produits au Mali depuis 1960. Cet outil sera utilisé pour planifier les enquêtes et les événements de réconciliation publics et les réunions en vue de la Commission vérité, justice et réconciliation de la RDC.
Réussite de Txeka-lá au Mozambique

Pays : Mozambique © Olho do Cidadão
Carmen Daniel dos Prazeres, étudiante universitaire âgée de 21 ans et vivant à Inhambane, au Mozambique, a fait partie des 70 étudiants formés sur la citoyenneté, la démocratie et les droits de la personne dans le cadre du projet d’élection municipale de Txeka-lá en 2018, mis en œuvre grâce au Fonds canadien d’initiatives locales d’Affaires mondiales Canada.
Txeka-lá est une plateforme en ligne qui cherche à donner une voix aux citoyens mozambicains pendant le processus électoral. À la suite de cette formation, Carmen a compris le rôle considérable qu’elle peut jouer en tant que citoyenne et l’importance d’être un membre plus actif de la société.
Carmen explique : « Avant, je croyais qu’être citoyen, c’était appartenir à un parti politique, mais après cette formation, je comprends que ce n’est pas limité aux partis politiques, mais un droit enchâssé dans la constitution du Mozambique, que je devrais exercer. »
Depuis sa formation, Carmen est très active politiquement. Pendant les élections locales de 2018, elle était citoyenne observatrice; elle a partagé plusieurs vidéos, photos et entrevues au sujet des élections sur la plateforme en ligne Txeka-lá. Depuis, Carmen est devenue un important pivot pour la plateforme à Inhambane, où elle mobilise d’autres jeunes femmes autour d’elle. Elle continue de produire des vidéos et des photos au moyen d’un téléphone Android reçu dans le cadre du projet et, à titre de journaliste citoyenne, elle donne voix aux citoyens anonymes par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Txeka-lá.
Amériques
En 2018-2019, le Canada a financé des projets de gouvernance inclusive au Honduras et en Haïti qui ont contribué à freiner la corruption et l’impunité, tout en faisant progresser les droits de la personne et l’égalité des genres.
Au Honduras, le renforcement des institutions locales a permis de cerner les réseaux de corruption et de traduire les responsables en justice. Le soutien du Canada a contribué à accroître la capacité du pays à faire enquête sur les structures du crime organisé et à traduire les responsables en justice, à adopter des réformes juridiques, et à obtenir l’appui du public pour réduire la corruption et l’impunité. Neuf affaires de réseaux de corruption de grande visibilité ont débouché sur des poursuites judiciaires à l’encontre de 38 représentants de haut niveau pour le détournement de fonds publics destinés à aider les familles pauvres en milieu rural.
Toujours au Honduras, le soutien du Canada au projet Justice, gouvernance, et lutte contre l’impunité au Honduras a permis de former 113 employés du système judiciaire afin qu’ils puissent traiter des accusations criminelles contre des défenseurs des droits de la personne. Le projet a aussi permis de promouvoir et protéger les droits de la personne, de concert avec les entités étatiques et non étatiques.
En Haïti, le Canada a contribué à des efforts de renforcement des capacités afin de permettre une planification et une gouvernance efficaces. Le Canada a également soutenu la création de politiques sur le harcèlement sexuel et l’égalité des genres en milieu de travail. En outre, le Canada a contribué à des efforts visant à renforcer la capacité des avocats en Haïti à défendre les droits de la personne et a fourni une aide technique spécialisée (adaptée à la législation haïtienne) pour élaborer une loi nationale sur la violence sexuelle et fondée sur le genre.
Soutenir les migrants LGBTQ2+ provenant du Venezuela en Équateur

Pays : Équateur © Maria Lorena Pasquel, Affaires mondiales Canada
Dans la foulée de la crise au Venezuela, l’Équateur accueille un nombre croissant de migrants vénézuéliens. Au sein de cette communauté vulnérable, les migrants lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et autres (LGBTQ2+) connaissent une situation d’oppressions concomitantes fondées sur leur identité sexuelle et leur statut de migrant. Par conséquent, il leur manque souvent un espace sûr et inclusif, et bon nombre d’entre eux sont aux prises avec des besoins urgents en soins de santé et en médicaments.
En novembre 2018, Danilo Manzano, un jeune activiste LGBTQ2+, a mis sur pied Dialogo Diverso, un organisme communautaire qui aide les migrants LGBTQ2+ à accéder à des services et à des réseaux de soutien à Quito. Grâce au Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL), Dialogo Diverso a lancé « Mi Casa Fuera de Casa » (mon deuxième chez-moi), premier lieu de rassemblement et centre de référence destiné aux migrants LGBTQ2+ pour leur fournir un accès aux services et aider à assurer le lien avec les réseaux de soutien locaux. Dialogo Diverso a également compilé un rapport sur l’expérience vécue de migrants LGBTQ2+ au Venezuela et a établi un guide pour les fournisseurs de services. Par l’intermédiaire de ces ressources, une formation est offerte aux organismes publics sur les moyens d’offrir un soutien adapté et ciblé aux migrants LGBTQ2+. Grâce au soutien du Canada, Dialogo Diverso a aidé plus de 500 personnes LGBTQ2+ et leur famille, tout en partageant son expérience et ses pratiques exemplaires avec d’autres organismes aux vues similaires au Chili, en Colombie et au Pérou.
Asie-Pacifique
Dans la région de l’Asie-Pacifique, la programmation en gouvernance inclusive est axée en grande partie sur le soutien de processus électoraux crédibles et transparents, la protection des droits des communautés marginalisées et vulnérables, la mobilisation de la société civile et une plus grande participation des femmes à la gouvernance. Par exemple, en Indonésie, le soutien du Canada à la société civile et l’aide technique pour la commission des élections générales ont contribué à la tenue d’élections générales crédibles en avril 2019.
Dans ses efforts pour améliorer la protection des travailleurs migrants, le Canada a aidé à harmoniser les cadres de gouvernance de la migration de main-d’œuvre dans la région de l’ANASE et a renforcé les capacités des organismes régionaux pour contribuer concrètement au dialogue national et régional en matière de migration.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
En Ukraine, en Irak, en Jordanie, en Cisjordanie et Gaza, et en Tunisie, le Canada a fait la promotion d’une gouvernance inclusive, encouragé la participation aux élections et soutenu l’établissement d’institutions et de lois en vue de réduire la corruption.
Le Canada a continué d’appuyer huit bureaux de soutien à la réforme et a aidé à établir deux nouvelles équipes de réforme au sein du gouvernement de l’Ukraine. Cela a permis de simplifier le dédouanement, faisant passer le temps de dédouanement de 26 à 6 heures. Le Canada a également aidé à lancer un nouveau système électronique de santé, qui a permis l’inscription de plus de 22 millions de patients et de 24 000 médecins. Le Canada a renforcé la mise en œuvre technique du système d’approvisionnement public ProZorro dans neuf villes, et a fait croître leurs revenus cumulatifs de 350 000 $. Dans le secteur de la justice, le Canada a soutenu la formation de juges, de professionnels juridiques et d’activités relatives aux droits de la personne et a aidé à mettre sur pied 535 centres d’aide juridique. Ces mesures, et d’autres encore, ont fait passer la confiance du public dans le système de tribunaux de 5 % à 16 % en 2018. En Ukraine, le Canada a déployé 232 observateurs des élections et huit députés du Parlement canadien pour le premier tour des élections présidentielles du 31 mars 2019.
Le Canada a aidé le gouvernement de l’Irak à préparer et à rédiger une loi révisée en matière de gestion des finances publiques. Cette loi, adoptée par le parlement irakien en mai 2016, soutient un cadre pour des budgets exhaustifs et une décentralisation.
En Cisjordanie et Gaza, la construction de l’infrastructure d’un palais de justice est en cours pour améliorer l’accès des Palestiniens à la justice. Le projet encourage également l’utilisation efficiente de ces installations grâce à des avancées dans la planification et la conception aux palais de justice, la gestion des installations et l’administration des tribunaux.
En 2018-2019, le Canada a soutenu les premières élections municipales en Tunisie et a contribué à améliorer l’intégrité du processus électoral. La participation significative de tous les citoyens a été encouragée au moyen d’approches adaptées aux régions rurales présentant des taux d’analphabétisme plus élevés, pour s’assurer que les femmes avaient des chances égales de participer au processus électoral.
Multirégion
Le Canada a soutenu de nombreuses activités et des investissements importants grâce à ses contributions de base et volontaires à des organisations multilatérales. Par exemple, il s’est taillé une place de donateur de premier plan au Forum des fédérations, une organisation qui renforce la gouvernance inclusive et responsable en faisant la promotion du fédéralisme. En 2018-2019, le Canada a signé un accord quinquennal de 2,5 millions de dollars à l’appui des efforts déployés par le Forum des fédérations pour renforcer la gouvernance inclusive et adaptée dans les États fédéraux et décentralisés. L’organisation œuvre à renforcer les capacités de gouvernance démocratique en encourageant le dialogue, entre autres efforts des intervenants, en vue de consolider la paix et de favoriser des développements solides et équilibrés avantageux pour tous.
Les efforts du Fonds monétaire international (FMI) en matière de renforcement des capacités visent à promouvoir une saine gouvernance économique nationale chez les pays membres. Allant de cadres juridiques améliorés et de gestion des finances publiques jusqu’à la collecte de données ventilées par genre, l’aide et la formation techniques du FMI aident les membres à s’attaquer à leurs priorités en matière de développement et à renforcer leurs institutions nationales afin de mettre en œuvre des politiques plus efficaces et d’offrir une plus grande inclusion économique et stabilité à leur population. En 2018-2019, le Canada a maintenu son soutien de longue date aux activités du FMI en matière de renforcement des capacités, au moyen de contributions se chiffrant à 19,2 millions de dollars américains. Au cours de l’exercice financier 2018-2019 du FMINote de bas de page 13, ce dernier a dépensé 306 millions de dollars américains pour des activités directes de renforcement des capacités (dont 48 % dans des pays en développement à faibles revenus) et a organisé 457 activités de formation destinées à 16 950 représentants des 188 pays membres (30 % en Afrique subsaharienne et 22 % dans des États fragiles).
Grâce à l’appui du Canada, le Ralph Bunche Institute s’est penché sur les violations des droits de la personne contre les femmes et d’autres situations de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les ateliers destinés aux intervenants en Argentine, en Tunisie et en Uruguay ont donné lieu à des échanges d’information et de capacités et à des collaborations entre spécialistes des Nations Unies et intervenants de ces communautés. Ces échanges ont alimenté des documents de recherche précieux, mené à une meilleure compréhension et permis le renforcement des mesures d’intervention en cas de pratiques préjudiciables. Ils ont également contribué à éclairer le compte rendu du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction.
Par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Canada a soutenu l’initiative Les droits humains avant tout, qui cherche à prévenir les violations des droits de la personne et du droit international humanitaire à grande échelle, et à y répondre. Grâce à un meilleur système d’alerte, à des analyses partagées, à une coordination accrue et à des capacités renforcées de s’engager et de répondre, l’initiative est conçue pour s’assurer que les droits de la personne deviennent une responsabilité fondamentale de l’ensemble du système des Nations Unies.
L’Initiative Think tank (ITT) qui se poursuit depuis 10 ans, est un partenariat de 200 millions de dollars entre le CRDI du Canada, la fondation Bill & Melinda Gates, le ministère du Développement international du Royaume-Uni, la fondation William and Flora Hewlett, l’Agence norvégienne de coopération pour le développement et la direction générale de la coopération internationale des Pays-Bas. L’ITT a aidé 43 groupes de réflexion dans 20 pays à se lancer dans une planification à long terme, à fixer des priorités de recherche, à renforcer leurs capacités en matière d’engagement et de communications stratégiques et à poursuivre des recherches opportunes et pertinentes. Le soutien de l’ITT a aidé des groupes de réflexion locaux à fournir des recherches fondées sur des données probantes qui ont amélioré la compréhension du public au sujet des plateformes électorales en Équateur, au Guatemala et au Pérou. Le soutien de l’ITT a également facilité le travail collaboratif entre les groupes de réflexion. L’exemple le plus notable est Southern Voice (en anglais), un réseau de 49 groupes de réflexion (y compris les 43 groupes appuyés par l’ITT) qui sert de plateforme pour combler le manque de recherche et de participation du Sud au dialogue mondial sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Emploi et Développement social Canada, grâce à son Programme du travail, contribue au renforcement des capacités des pays partenaires afin d’améliorer l’application des lois du travail et le respect des droits des travailleurs reconnus partout dans le monde. EDSC a soutenu de nouveaux projets en Jordanie, au Mexique et en Colombie, et en a poursuivi d’autres au Pérou et en Ukraine. Le Canada a notamment soutenu des efforts visant à institutionnaliser les négociations collectives dans le secteur du vêtement en Jordanie, la liberté d’association dans le secteur des exportations au Mexique et les capacités du ministère colombien du Travail en modernisant son système d’inscription des ententes entre employeurs et travailleurs, afin de respecter les engagements pris aux termes du Plan d’action en vertu de l’accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Colombie.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) encourage les pratiques de gouvernance inclusive, y compris l’égalité des genres et la diversité dans les systèmes fiscaux, tout en soutenant la mobilisation des ressources nationales. En 2018-2019, l’ARC a accueilli des visites d’études d’administrateurs fiscaux étrangers et a participé à des forums internationaux. Par exemple, l’ARC a fourni une aide technique au gouvernement du Bénin dans le cadre d’un projet financé par Affaires mondiales Canada, ce qui a entraîné une meilleure gestion des finances publiques et un plus grand nombre de possibilités de financement pour les services publics dont tous les citoyens profitent. L’ARC a poursuivi son appui à la Plateforme mondiale de partage de connaissances pour les administrations fiscales (KSPTA), qui soutient les efforts de renforcement des capacités fiscales dans les pays en développement, notamment une bibliothèque de pratiques exemplaires et une nouvelle composante d’apprentissage en ligne. En général, le nombre total d’usagers de la KSPTA a presque doublé chaque année et continue de croître. Par ailleurs, une plus grande proportion de femmes s’inscrivent aux cours d’apprentissage en ligne.
Enfin, dans le cadre du Programme d’élaboration de politiques en matière de migration d’IRCC, le Canada finance la participation de ce ministère aux principaux forums internationaux sur la migration et à des projets liés à l’élaboration de politiques, à la recherche et au renforcement des capacités dans le domaine de la migration. En 2018-2019, le programme a financé 13 projets en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Talent Beyond Boundaries (en anglais) et la Commission internationale catholique pour les migrations (en anglais).
Champ d’action : La paix et la sécurité
ODD soutenus dans le cadre du champ d’action sur la paix et la sécurité*


* Les ODD sont soulignés en fonction d’objectifs et de résultats communs. Tous les ODD ont des liens intersectionnels avec tous les autres champs d’action de la Politique d’aide internationale féministe du Canada.
Les conflits violents et l’insécurité ont des effets marqués, durables et diversifiés. Un soutien international continu est requis pour instaurer et maintenir la paix et la sécurité, tant pour la sûreté des citoyens que comme condition préalable au développement durable. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 admet qu’« il ne peut y avoir de développement durable sans paix ni de paix sans développement durable ». Cette idée se traduit dans l’Objectif 16 qui vise à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ». La paix, la gouvernance inclusive et la justice sont à la fois des catalyseurs et des résultats du développement.
Le Canada a une longue tradition de contribution à la paix, à la sécurité et à la stabilité par l’intermédiaire de son aide internationale. La politique étrangère féministe du Canada et la Politique d’aide internationale féministe orientent l’engagement du Canada à l’égard de l’Objectif 16 à l’échelle internationale et guident ses interventions tenant compte du genre intégrées aux défis de la paix et de la sécurité dans le monde. Le Canada soutient la paix et la sécurité durables en répondant aux facteurs systémiques de conflit et d’insécurité à long terme, mais aussi aux difficultés immédiates qui font obstacle à la paix et la stabilité.
Le Canada aide également à faire face aux facteurs immédiats et aux conséquences des conflits violents et de l’insécurité, en particulier par l’intermédiaire des programmes spécialisés d’Affaires mondiales Canada : le Programme pour la stabilisation et les opérations de paix, le Programme d’aide au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité, le Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes et le Programme de réduction de la menace des armes.
Dans ses efforts pour mettre en œuvre ses interventions dans ce champ d’action, le Canada se concentre sur les mesures suivantes :
- soutenir la prévention de conflits violents, l’intervention en cas de crise et la paix durable dans les États fragiles et touchés par des conflits, d’une manière inclusive et qui tient compte du genre;
- soutenir la réduction des menaces à la sécurité et la réforme du système de sécurité, en tenant compte du genre;
- améliorer la gestion multilatérale des défis en matière de paix et de sécurité.
Pour en savoir plus sur l’approche du Canada, veuillez consulter sa politique de champ d’action sur la paix et la sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada dans ce champ d’action, veuillez consulter la Banque de projets.
Activités et résultats en 2018-2019
Principaux récipiendaires
Afghanistan : 29,2 millions de dollars
Mali : 15,6 millions de dollars
Irak : 14,4 millions de dollars
En 2018-2019, le Canada a investi 314,07 millions de dollars dans l’aide internationale, dont 160,55 millions en ADO, dans le cadre d’initiatives relatives au champ d’action sur la paix et la sécuritéNote de bas de page 14.
En 2018-2019, le Programme pour la stabilisation et les opérations de paix (PSOPs) a déboursé 168 millions de dollars dans des États fragiles et touchés par les conflits, en ciblant les opérations de paix, la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix, l’inclusion, la diversité et les droits de la personne, la protection des civils, et enfin, les femmes, la paix et la sécurité. Ces efforts ont contribué à la paix et à la sécurité dans de nombreuses régions du monde, dont l’Afghanistan, la Colombie, Haïti, l’Irak, le Liban, le Mali et la région du Sahel, le Myanmar, le Soudan du Sud, la Syrie, l’Ukraine et la Cisjordanie et Gaza.
Le programme contribue à encourager la participation des femmes aux opérations de paix, à restaurer la confiance entre communautés et police dans des communautés à risque, à appuyer la résolution de conflits dans des régions aux prises avec des conflits pour assurer le respect des cessez-le-feu et des accords de paix, et à prévenir la participation des enfants à la violence. Le PSOPs soutient également des changements importants dans la manière dont le pouvoir politique, économique et social est négocié, partagé et utilisé par différents acteurs dans des États fragiles et des pays touchés par les conflits.
En 2018-2019, le Programme d’aide au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité (PARCLC) et le Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes (PARCA) ont déboursé respectivement 15 millions et 28 millions de dollars en aide internationale pour des initiatives de renforcement des capacités dans les Amériques, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Ces deux programmes ont mené des activités qui ont permis d’accroître les capacités des États bénéficiaires à relever les défis en matière de sécurité transnationale ou relative à l’extrémisme violent par les mesures suivantes :
- renforcer l’efficacité des institutions de sécurité et les autorités locales de sécurité et de renseignement;
- améliorer la pertinence et l’application d’instruments juridiques et du système judiciaire;
- améliorer les politiques, les cadres et les systèmes de contrôle humains et technologiques locaux.
Le premier programme a principalement soutenu des initiatives de renforcement des capacités au Mexique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Son principal objectif est d’aider les pays à atténuer l’incidence et la portée des entreprises criminelles transnationales. Les projets ont permis d’accroître la capacité des pays à prévenir, à intercepter, à perturber et à réduire les méfaits du commerce illicite de stupéfiants, du cybercrime, de la traite des personnes, du passage de clandestins, du blanchiment d’argent et des produits de la criminalité. Les États bénéficiaires ont indiqué que nos efforts avaient entraîné des saisies de stupéfiants et de leurs précurseurs, la perturbation des activités de traite des personnes, et un taux de réussite accrue quant à la poursuite en justice des membres des organisations criminelles transnationales.
En Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, le second programme a concentré ses activités sur le renforcement des capacités de la police, du système de justice, du secteur de la sécurité et du renseignement militaire afin de lutter contre l’extrémisme violent. Une aide supplémentaire a été fournie, lorsqu’il y avait lieu, pour réduire le financement du terrorisme, pour contrer la propagande terroriste et pour renforcer la gestion des frontières. Toutes les activités dans le cadre des deux programmes ont été guidées par une solide analyse comparative entre les genres, un respect accru des droits de la personne et les normes et pratiques exemplaires internationales.
En 2018-2019, le Programme de réduction de la menace liée aux armes (PRMA) a déboursé 71 millions de dollars à l’échelle mondiale pour empêcher les terroristes et les « États présentant des risques de prolifération » d’acquérir et d’utiliser des armes et du matériel de destruction massive. À titre de contribution phare du Canada au Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes dirigé par le G7, le programme a contribué à hauteur de plus de 1,4 milliard de dollars depuis 2002 pour traiter la sécurité nucléaire, radiologique et biologique, la réduction de la menace posée par les armes chimiques, et le soutien de la mise en œuvre de la résolution no 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2018-2019, le programme a également intégré des éléments tenant compte du genre dans plus de 40 % de ses projets, ce qui a permis de rendre sa programmation plus durable, plus inclusive et mieux adaptée aux contextes locaux, tout en traduisant les engagements du Canada en matière d’égalité des genres.
Dans sa deuxième année de mise en place, le Plan d’action du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité s’est poursuivi. Le Canada a travaillé sur la mobilisation du soutien pour les femmes en tant qu’agentes actives de la paix, la lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre lors des conflits, la promotion des droits des femmes et des filles et de l’égalité des genres dans les régions fragiles et touchées par les conflits, et l’assurance que nos interventions en faveur de la paix et de la sécurité tiennent compte du genre.
165 818 gardiens de la paix ont été formés dans le cadre de déploiements et de projets visant la prévention et l’intervention en matière d’exploitation et d’abus sexuelsNote de bas de page 15.
Ces différents programmes et activités ont notamment donné lieu à :
- l’accroissement des capacités des soldats de maintien de la paix et des missions de maintien de la paix, y compris pour traiter les questions liées au genre;
- l’accroissement des capacités des partenaires locaux et des populations pour prévenir et stabiliser les situations de conflit;
- des services de police, des institutions judiciaires et correctionnelles plus efficaces, responsables et sensibles au genre;
- une paix et une sécurité accrues dans les pays et les régions où le Canada est présent.
Afrique subsaharienne
Le Canada a soutenu la paix et la sécurité en Afrique subsaharienne par l’intermédiaire de programmes de sécurité et de développement, de missions militaires et de la diplomatie. L’aide internationale du Canada en Afrique subsaharienne a contribué à faire progresser un certain nombre de priorités, y compris la promotion du Programme mondial sur les femmes, la paix et la sécurité, la réduction au minimum de la propagation et de l’incidence de l’extrémisme violent et la prévention de l’utilisation et du recrutement d’enfants-soldats, au moyen des Principes de Vancouver.
Par exemple, par l’intermédiaire du Projet Justice et réconciliation au Mali (JUPREC), le Canada soutient la participation des femmes dans les efforts de réconciliation et de prévention des conflits. En 2018-2019, des comités communautaires pour la paix, y compris des associations de femmes, ont pris part aux activités liées au dialogue de paix et au dialogue social, à la prévention et à la gestion des conflits; 466 femmes dans des postes de direction y ont participé, et des activités de sensibilisation ont permis de rejoindre près de 2 000 femmes. Le projet JUPREC promeut également les droits des femmes et des filles qui sont victimes en facilitant leur accès à la justice locale. En 2018-2019, des services d’aide juridique ont été offerts à 1 414 personnes, dont 86 % étaient des femmes victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Les programmes de lutte contre le terrorisme étaient axés sur l’accroissement des capacités des forces de l’ordre, des systèmes judiciaires, des services frontaliers, de l’armée et des services du renseignement partout dans la région du Sahel, outre la lutte contre le financement du terrorisme. En réponse à la difficulté d’intenter des poursuites dans les cas d’infractions liées au terrorisme, des efforts considérables ont été déployés pour renforcer le système judiciaire. Des juges et des procureurs de la région du Sahel qui se spécialisent dans de tels cas ont rencontré des juges externes d’une cour suprême pour échanger de saines pratiques, comparer leurs expériences et recevoir une formation spécialisée. Cela a donné lieu à une augmentation du nombre de poursuites fructueuses partout dans la région. La programmation du PARCA en Afrique de l’Ouest comprenait également le renforcement des capacités au moyen de la formation de juges d’instance qui traitent des affaires de terrorisme, et d’un forum leur permettant d’échanger des pratiques exemplaires dans le règlement d’affaires terroristes.
Pour traiter les menaces graves de prolifération entraînées par l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest (2014-2015) et en République démocratique du Congo (2018-2019), le Canada, par l’intermédiaire du PRMA, procède au renforcement des capacités en Afrique pour prévenir, dépister les éclosions de maladies infectieuses et y répondre, qu’elles soient d’origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle, comme dans le cas du bioterrorisme.
Amériques
Compte tenu de la complexité du crime organisé transnational dans les Amériques, les États de la région sont aux prises avec le défi croissant de devenir des pays de source et de transit pour le trafic illicite de stupéfiants et de personnes. Le travail du Canada a permis de former des agents des douanes, des agents frontaliers et des policiers, de mettre en œuvre des normes et d’améliorer l’équipement des terminaux portuaires à conteneurs de la région. Ces efforts ont contribué à la lutte contre le crime organisé transnational menant ses activités au moyen de cargaisons conteneurisées.
Dans les Caraïbes, le PARCLC s’est concentré sur les drogues illicites, le blanchiment d’argent et les produits de la criminalité, entre autres priorités. Le Canada s’est forgé un créneau dans le Triangle du Nord (Guatemala, Honduras et Salvador), où la priorité du programme se situe principalement dans la réforme de la sécurité et la traite des personnes.
Le Canada collabore avec des organisations internationales comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation des États américains, ainsi que les ONG canadiennes telles que la Justice Education Society (en anglais) et Avocats sans frontières Canada en vue de renforcer les capacités des institutions et des organismes chargés de la justice et de l’application de la loi dans la région.
La traite des personnes constitue un secteur principal d’intervention dans les Amériques. Comme c’est le cas ailleurs dans le monde, la plupart des victimes sont des femmes et des filles. Au moyen du PARCLC, de multiples initiatives de renforcement des capacités ont été mises en œuvre à l’échelle des Amériques pour aider les États à lutter contre la traite des personnes. Par exemple, au Honduras, le Canada a bâti les capacités professionnelles d’acteurs clés dans les poursuites, la protection et la prévention relatives à la traite des personnes dont les victimes sont des femmes et des filles. Au Guatemala et au Mexique, le Canada a aidé les autorités douanières à mieux déterminer et intercepter les routes de contrebande et la migration irrégulière qui facilitent la traite des personnes à l’échelle internationale.
En Colombie, le Canada a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives inclusives tenant compte du genre qui visent à améliorer la prévention des conflits violents, l’intervention en cas de crise et la consolidation de la paix en situation de fragilité ou de conflit. À titre de deuxième donateur en importance au Fonds fiduciaire multipartenaires (FFM) des Nations Unies post-conflit en Colombie, le Canada a soutenu la programmation liée à la paix auprès de plus de 1,5 million de personnes dans 379 municipalités colombiennes. Le FFM a mis en œuvre 51 initiatives locales afin d’améliorer l’accès à la justice pour les victimes du conflit, réintégré 124 enfants-soldats démobilisés et fourni un soutien psychosocial à près de 24 000 victimes de conflits dans le cadre du processus de réparation. En outre, plus de 91 000 m2 de territoire ont été déminés.
Dans le contexte de la crise au Venezuela, le Canada a tenté d’encourager un dialogue constructif entre acteurs clés en Colombie et au Venezuela, et à rallier les appuis à la résolution de conflits. Ces efforts comprenaient un appui à des activités de défense ciblée des droits et la prestation de conseils de spécialistes aux parties prenantes, et d’expertise technique pour soutenir les négociations. En Colombie, cette initiative a renforcé la capacité des principaux intéressés dans leurs efforts pour trouver une issue négociée à la crise politique, économique, sociale et sécuritaire qui perdure dans cette région du monde.
Asie-Pacifique
Le soutien du Canada dans la région de l’Asie-Pacifique a contribué à bâtir des communautés sûres et sécuritaires dans des situations de conflit et dans le sillage de conflits. Par exemple, en Afghanistan, le Canada a soutenu des programmes communautaires de protection de l’enfance et l’établissement d’espaces adaptés aux enfants qui permettent d’assurer leur sécurité. Mis en place dans les centres communautaires, ces espaces adaptés fournissent aux enfants et aux jeunes l’occasion de s’adonner à des activités récréatives, de jouer et d’obtenir une aide psychologique. En 2018-2019, 9 680 enfants en Afghanistan ont bénéficié de ces espaces adaptés aux enfants mis en place grâce à un financement canadien.
Dans le sillage des conflits, l’action contre les mines constituait un élément important des efforts de consolidation de la paix et de réconciliation. Le Canada a noué un partenariat avec le HALO Trust (en anglais) pour éliminer toutes les mines terrestres et autres restes explosifs de guerre afin que les communautés puissent reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance. Par exemple, au Sri Lanka, en 2018-2019, 289 186 m2 de terre ont été déminés et 1 635 mines et autres restes explosifs ont été éliminés de façon sécuritaire, ce qui a permis de donner un accès sécuritaire aux zones de réinstallation à environ 30 000 personnes.
Le Canada est résolu à aider ses partenaires en Asie du Sud-Est et à travailler de concert avec les États membres de l’ANASE afin de renforcer leurs capacités à réduire les menaces à leur sécurité et à lutter contre ces menaces. Il s’agit des zones de prolifération, du crime transnational et du terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Par exemple, par l’intermédiaire du PRMA, le Canada a soutenu des efforts internationaux visant à aider ces pays à mettre en œuvre les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies imposées à la Corée du Nord en raison de ses programmes de développement nucléaire et de missiles.
En partenariat avec l’ANASE, le PARCA s’est assuré que l’aide au renforcement des capacités liées à la sécurité répondait aux besoins clairement définis. Dans le cadre d’un programme phare en collaboration avec INTERPOL, le Canada a renforcé les compétences d’enquête et de collaboration des organismes d’application de la loi de l’ANASE pour lutter contre le terrorisme, au moyen de formations ciblées, du mentorat et d’un exercice réaliste de 10 jours auquel tous les membres de l’ANASE ont participé. L’opération de 2018 a donné lieu à 8 millions de recherches, à 17 arrestations, y compris la déportation d’un combattant terroriste étranger, et la récupération de plus de 100 documents de voyage perdus ou volés.
En outre, le Canada a aidé les pays partenaires dans la région de l’Asie-Pacifique à bâtir des communautés sûres et sécuritaires dans les contextes de conflits et dans le sillage des conflits. Au Myanmar, le Canada a contribué aux efforts de promotion du genre, de la paix et de la sécurité des installations de l’ONG Paung Sie (en anglais) pour soutenir 18 groupes de femmes locales œuvrant au sein des processus de paix et de consolidation de paix à l’échelle locale. Ce projet aide les nouvelles organisations à influencer le processus de paix et offre un soutien technique afin de bien les outiller pour qu’elles puissent tirer profit des occasions et être à l’avant-plan de la promotion de l’utilisation de stratégies cohérentes et inclusives dans le but de mettre en œuvre un accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale.
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Promotion de la paix et de la sécurité en Géorgie par le biais du journalisme de paix

Pays : Géorgie © Réseau international pour le développement civil
Dix ans après la deuxième guerre d’Ossétie du Sud, la tension est toujours palpable le long de la frontière administrative qui borde les territoires occupés de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Des années de violence ont engendré des problèmes sociaux et économiques persistants dans cette région, notamment des taux de chômage élevés et des problèmes de violence faite aux femmes, de dépression et d’abus de substances. Par le biais du Fonds canadien d’initiatives locales, le Canada s’est associé au Réseau international pour le développement civil afin de promouvoir le journalisme de paix, qui encourage les journalistes à envisager des réactions non violentes face aux conflits par le biais de reportages objectifs et précis. Six ateliers sur le rôle du journalisme comme moyen de mettre fin au cycle de violence et sur l’importance d’inclure les voix des femmes dans les médias en général et dans les reportages ont été offerts à des jeunes, des journalistes et des militants locaux. Dans le cadre de ce projet, 103 hommes et femmes ont reçu une formation sur le journalisme de paix. Des messages de promotion de la paix ont également été véhiculés partout en Géorgie dans le but de favoriser la réconciliation et de renforcer la confiance des deux côtés de la frontière abkhaze et sud-ossète. Ces séances de formation visaient à aider les journalistes à apaiser les tensions plutôt que de les aggraver en temps de conflit, tout en renforçant les valeurs d’égalité des genres dans les médias et de consolidation de la paix.
Les questions liées au genre font partie intégrante des programmes du Canada dans ces régions. En Jordanie, par exemple, le Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes a appuyé la formation de femmes pour des postes d’officiers tactiques médicaux et des postes d’intervention clés au sein de la Gendarmerie jordanienne. Le taux de femmes ayant participé au projet a atteint la barre des 11 %, ce qui représente une hausse significative par rapport au taux de personnel féminin dans l’ensemble de la Gendarmerie jordanienne, qui est de seulement 3,5 %.
En Irak, un surintendant de police en chef de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été déployé à titre de directeur de l’égalité des genres et de la protection pour la Coalition mondiale contre Daech. Afin d’aider l’ONU à atteindre son objectif d’augmenter la participation de femmes policières dans ses missions, quatre policières canadiennes ont occupé des postes supérieurs en 2018-2019. Par exemple, la conseillère en matière d’égalité des genres de la Coalition en Irak est une femme, ce qui en fait la policière occupant le plus haut poste opérationnel en Irak. Elle est également commandante du contingent de la police canadienne.
Le soutien apporté aux femmes journalistes par le Programme pour la stabilisation et les opérations de paix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a permis à 338 journalistes et défenseurs des droits de la personne d’acquérir des compétences en matière de sécurité numérique et de prévention de la VSFG. À la suite de ce projet, 56 produits médiatiques ont été réalisés, et six organes de presse de la région ont adopté des mécanismes et politiques de surveillance qui ont pour but de prévenir la VSFG.
Éducation et déminage en Irak pour améliorer la qualité de vie

Pays : Irak © Fondation suisse de déminage
Alors qu’ils pansent toujours les plaies laissées par des années de conflits à la suite de l’ascension et de la chute de Daech, les Irakiens doivent désormais composer avec le danger quotidien que représentent les mines terrestres, les pièges et autres engins explosifs laissés un peu partout en Irak par Daech. Affaires mondiales Canada finance des équipes de déminage formées sur place dans le district de Mossoul. Depuis le début du projet, elles ont retiré les explosifs d’une zone dont la superficie correspond environ à celle de 200 terrains de football et contribué à éduquer plus de 20 000 personnes issues des communautés locales (principalement des femmes) sur les dangers posés par les engins explosifs toujours présents dans la région.
Le travail des équipes de déminage a aidé à améliorer la sûreté et la sécurité des habitants de ces régions et à accroître l’accès à des terres agricoles et à des zones résidentielles sécuritaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Déminage des engins explosifs dans le district de Mosul.
En 2018-2019, le ministère de la Défense nationale a continué à déployer des membres des Forces armées canadiennes en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza dans le cadre de l’opération PROTEUS. Cette opération fait la promotion de la paix dans cette région et aide l’autorité palestinienne à renforcer ses capacités. Le personnel déployé comprend également la Force opérationnelle Jérusalem, qui travaille en étroite collaboration avec le personnel canadien dans la région. Son objectif est de renforcer les capacités des Forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (FSAP) afin de fournir un environnement sûr et sécuritaire aux citoyens et de promouvoir la paix dans la région. En 2018-2019, la Force opérationnelle Jérusalem a fourni aux FSAP de la formation et du soutien pour renforcer leurs capacités logistiques, appuyé la construction d’infrastructures de sécurité et favorisé une certaine flexibilité en ce qui concerne les déplacements de biens et de citoyens palestiniens en Cisjordanie.
Au cours de la dernière année de la Stratégie pangouvernementale canadienne de soutien à la Coalition internationale de lutte contre l’EIIL et de l’élargissement de son engagement en Irak, en Syrie, en Jordanie et au Liban, le PARCA a permis d’atténuer la menace posée par les groupes terroristes comme Daech, Al-Qaïda et les groupes affiliés en renforçant la capacité des gouvernements et des organisations de la région à prévenir les activités violentes extrémistes et à y réagir adéquatement. Grâce à l’amélioration de l’efficacité des forces policières et militaires, plusieurs attaques ont été évitées dans la région en raison de l’augmentation du nombre d’arrestations et de saisies de matériaux explosifs. La meilleure gestion des frontières de la région a contribué à circonscrire Daech dans les champs de bataille existants, ce qui a mené à une réduction drastique du territoire de cette organisation extrémiste violente.
Grâce au PRMA, le Canada a apporté son soutien à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques afin d’atténuer les menaces relatives aux armes chimiques en Syrie et d’y répondre, et afin d’identifier les responsables de l’utilisation de ces armes. Le Canada est le principal collaborateur de l’Agence internationale de l’énergie atomique en ce qui concerne la surveillance et la vérification du respect de l’Iran de son engagement en vertu du Plan d’action global conjoint, avec des investissements totalisant 15 millions de dollars depuis 2014.
Multirégion
En plus des programmes spécifiques à des pays et à des régions, le Canada soutient également des initiatives ayant une portée mondiale par le biais de forums multilatéraux.
Le Canada a adhéré à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et le genre est un facteur déterminant en matière d’opérations de paix. Au 31 mars 2019, en vertu de l’arrangement sur la police civile au Canada, Affaires mondiales Canada, avec la GRC et Sécurité publique Canada, a augmenté le nombre de policières canadiennes déployées dans le cadre d’opérations internationales de paix et de stabilisation à 36, sur un total de 75 agents déployés. Au cours de la période 2018-2019, de nouveaux policiers ont été déployés dans le cadre d’opérations de paix en Haïti (21) et au Mali (2), ainsi que pour d’autres opérations multilatérales ou bilatérales de paix et de stabilisation ou dans le cadre d’enquêtes internationales en Ukraine (23), en Irak (11), en Cisjordanie (5), au Mali (1), à La Haye/en République centrafricaine (1) et en Éthiopie (1).
En 2018-2019, des progrès ont été accomplis pour faire avancer l’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, un projet pilote qui a pour but d’accroître la participation significative des femmes en uniforme aux opérations de paix de l’ONU. En septembre 2018, la ministre des Affaires étrangères a annoncé que le Canada a formé des partenariats bilatéraux avec les forces armées ghanéennes et les autorités policières zambiennes pour la mise à l’essai d’approches novatrices visant à évaluer et à vaincre les obstacles à l’intégration et au déploiement des femmes. De plus, le Canada a appuyé la mise en place par les Nations Unies en mars 2019 du Fonds de l’Initiative Elsie pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix. Le Canada y a contribué à hauteur de 15 millions de dollars pour en soutenir les travaux.
Finalement, dans le cadre de l’engagement du Canada à combattre l’exploitation et les abus sexuels, ainsi que la VSFG, Affaires mondiales Canada a financé le bureau de l’exploitation et des abus sexuels de l’OTAN et a soutenu le déploiement de 49 experts de l’initiative d’intervention rapide au service de la justice pour participer aux enquêtes nationales et internationales, notamment celles portant sur la VSFG. Ces experts ont contribué à accroître la sensibilisation aux disparités entre les sexes et l’imputabilité de ces enquêtes afin de faire diminuer l’impunité en lien avec la VSFG. Affaires mondiales Canada continue également de s’assurer que l’exploitation et les abus sexuels, l’égalité des genres et les FPS demeurent au cœur des discussions et de l’engagement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Action pour le maintien de la paix de l’ONU.
En outre, le Canada est l’un des membres fondateurs du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (en anglais), et a récemment été nommé à sa coprésidence avec le Maroc. Au sein du Forum (FMLT), le Canada s’est assuré que les principes des règles de droit, des droits de la personne, des lois humanitaires internationales et de la bonne gouvernance sont au centre des efforts de lutte au terrorisme. Le Canada est un membre actif du conseil d’administration d’institutions inspirées du FMLT, comme le Global Community Engagement and Resilience Fund (en anglais). Afin de combattre l’extrémisme violent à grande échelle, le PARCA soutient les projets de ce Fonds en matière de déradicalisation en prison et de diffusion de messages positifs de rechange à ceux de l’extrémisme. Le Canada soutient également le centre Hedayah, qui formule des stratégies internationales et des initiatives locales de prévention de l’extrémisme violent. En plus de faire partie du FMLT, le Canada est actif au sein de la Coalition mondiale contre Daech (en anglais), du Groupe du G7 Rome-Lyon (en anglais), du Groupe de travail antiterrorisme de l’APEC (en anglais), de divers forums de l’ANASE et d’institutions de l’ONU comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies.
Affaires mondiales Canada soutient aussi la paix et la sécurité par le biais de partenariats avec des organisations de la société civile canadienne. Par exemple, le partenariat du Canada avec KAIROS pour le projet Femmes de courage - Femmes, paix et sécurité a pour but de provoquer une transformation en donnant plus d’autonomie aux femmes qui défendent les droits de la personne et aux organisations de défense des droits des femmes. Ce partenariat développe leurs compétences pour participer efficacement aux processus de paix et promouvoir encore davantage les droits de la personne en Colombie, en RDC, au Soudan du Sud et en Cisjordanie et Gaza.
En 2018-2019, soit la première année de ce projet de KAIROS, 1 052 femmes ayant survécu à la VSFG ont pu recevoir des soins et des conseils psychosociaux et médicaux. Plus de 884 femmes et 494 hommes ont participé à des ateliers portant sur les impacts psychosociaux de la guerre, et un total de 48 séances de formation en matière de droits de la personne, auxquelles 1 111 personnes (dont 878 femmes) ont participé, ont été organisées à l’échelle nationale et internationale. Les partenaires impliqués dans ce projet ont pris part à 109 campagnes de promotion de la réglementation et de la réforme et de la mise en œuvre des lois en matière de droits des femmes, de paix et de sécurité.
Les partenaires du Canada
Le Canada ne pourrait atteindre ses objectifs d’aide au développement international sans de solides partenariats. Ces partenariats rassemblent les capacités techniques, le savoir-faire logistique, les compétences de défense des droits et les réseaux organisationnels nécessaires pour aider efficacement nos pays partenaires à réaliser leurs aspirations en matière de développement. L’approche du Canada repose sur l’idée voulant que l’efficacité de notre aide au développement passe surtout par ses partenariats et la portée de son action internationale.
De nombreux partenariats sont le résultat de décennies de coopération. D’autres, en revanche, sont plus récents, nés d’une évolution notable du contexte en développement international. Une nouvelle conception de la coopération triangulaire, par exemple, offre une approche souple à l’égard des défis du développement et permet de nouer des partenariats efficaces et durables avec de nouveaux acteurs du développement, notamment les acteurs du SudNote de bas de page 16, la société civile et le secteur privé (pour en savoir plus sur les divers types de partenariats, consultez la section « Efficacité et efficience de l’aide »).
Nous travaillons avec un vaste éventail de partenaires, de la société civile canadienne à celles des pays où nous intervenons. Le Canada s’associe également à de nombreux partenaires multilatéraux, notamment des IFI, comme le Fonds monétaire international et diverses banques multilatérales de développement, les Nations Unies, le Commonwealth et l’Organisation internationale de la francophonie. Le Canada soutient aussi plusieurs ONG internationales, des fonds mondiaux et d’autres programmes de nature globale.
En outre, le Canada entretient des relations bilatérales et multilatérales clés par son action diplomatique en matière de développement. Par exemple, le Comité d’aide au développement de l’OCDE et les groupes de travail du G7 et du G20 axés sur l’aide internationale sont d’importants espaces où discuter des priorités du Canada et en faire la promotion auprès de donateurs et d’intervenants principaux.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets d’Affaires mondiales Canada avec ces partenaires, veuillez consulter la Banque de projets.
Coopérer avec la société civile canadienne
Les partenaires de la société civile canadienne jouent un rôle essentiel dans les efforts de développement international du Canada. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a mobilisé des compétences, réseaux et autres ressources grâce au soutien qu’il a apporté à plus de 170 organismes de la société civile canadienne. Parmi ces partenaires, mentionnons les ONG, les collèges et les universités, les municipalités, les coopératives, les associations professionnelles, les organisations du secteur privé, les fondations et les groupes de réflexion. Ces divers partenaires ont offert leur expertise et participé à un large éventail d’activités d’aide internationale et de mobilisation du public. En coopération avec leurs homologues locaux, ils favorisent les changements positifs, qui se traduisent par des résultats sur le terrain grâce aux approches innovantes.
En 2018-2019, le Canada a continué la mise en œuvre de sa Politique des partenariats avec la société civile pour l’aide internationale : une approche féministe, lancée en septembre 2017. Cette politique réitère l’engagement du Canada à collaborer avec la société civile et garantit l’alignement des partenariats entre Affaires mondiales Canada et la société civile sur la Politique d’aide internationale féministe du Canada, une approche fondée sur les droits de la personne, sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et sur les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement des OSC. Les organisations de la société civile participent activement à la mise en œuvre de la Politique. Elles travaillent en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada dans le cadre du groupe consultatif sur la Politique relative à ces organisations qui a pour mandat de fixer des priorités d’intérêt mutuel pour la réalisation d’initiatives.
Dans le cadre de son initiative pilote sur cinq ans Petites et moyennes organisations canadiennes pour l’impact et l’innovation, Affaires mondiales Canada voulait rationaliser et améliorer sa méthode et ses processus de sélection. Le Ministère a aussi noué un dialogue avec de nouveaux partenaires de tous les horizons. Les réponses ont été nombreuses (196) au premier appel de propositions pour les PMO, ce qui démontre l’intérêt, la diversité et l’engagement significatifs des PMO du Canada en matière d’aide internationale.
En 2018, le Canada a engagé 300 millions de dollars et lancé un « appel à l’action » aux organisations de la communauté philanthropique, du secteur privé et de la société civile dans le cadre du Partenariat pour l’égalité des genres, afin de créer une source durable et prévisible de financement pour les organisations et mouvements de femmes des pays en développement. Ce partenariat est la première plateforme mondiale à réunir sous un même toit tout l’éventail de subventions, de dons philanthropiques et d’investissements, y compris des investissements d’impact, pour faire progresser les droits des femmes, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a tenu des tables rondes avec des intervenants du milieu philanthropique, du secteur privé et de la société civile au Canada et à l’étranger, mis sur pied un comité consultatif externe et lancé un appel d’offres pour sélectionner une entité chargée de mettre en œuvre le partenariat. Le Canada a annoncé, le 2 juin 2019, la sélection du consortium Fonds égalité lors de la conférence Women Deliver, qui s’est tenue à Vancouver.
Le Canada finance aussi divers programmes qui aident les organisations à envoyer des jeunes Canadiens contribuer à des projets d’aide internationale dans les pays en développement. En 2018-2019, grâce au programme de coopération volontaire (PCV), 15 organisations partenaires canadiennes ont envoyé 1 420 bénévoles canadiens (dont 62 % étaient des femmes) dans différents domaines professionnels de 40 pays en développement. Les bénévoles ont contribué à renforcer les capacités de 612 partenaires locaux, dont 166 étaient des organisations de femmes. L’évaluation du PCV menée en 2018 a révélé que 86 % des partenaires des pays en développement avaient constaté une amélioration du fonctionnement de leur organisation, et 82 % ont noté un changement positif et bénéfique parmi les personnes et les collectivités bénéficiaires.
Trois projets issus du PCV ont intégré des fonds d’innovation : CUSO International, les CARREFOURs EQWIP et Oxfam-Québec. Ces fonds d’innovation permettent aux partenaires locaux de concevoir et de mettre en œuvre de nouveaux modèles de développement pour les collectivités locales, en particulier dans l’intérêt des femmes et des jeunes. Le projet Accès Innovation d’Oxfam-Québec a permis, en 2018-2019, de produire ou d’adapter 38 innovations. Par exemple, des installations aquaponiques ont été construites dans le sud du Honduras pour répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire, et une monnaie sociale interne a été mise en circulation en Colombie pour diversifier les échanges économiques entre les femmes membres de coopératives.
Le Programme de stages internationaux pour les jeunes offre aux jeunes Canadiens des occasions de participer à des stages internationaux dans des pays en développement. Grâce à ce programme, 12 organismes partenaires canadiens ont pu déployer, en 2018-2019, 322 stagiaires (dont 78 % de femmes) dans 44 pays. De son côté, l’initiative de Stages internationaux pour les jeunes Autochtones a déployé 103 jeunes stagiaires autochtones (dont 69 % de femmes) dans 13 pays en développement, en partenariat avec 8 organismes partenaires canadiens. La plupart des jeunes stagiaires (91 %) et des jeunes stagiaires autochtones (90 %) ont affirmé que leur stage les avait aidés à améliorer leurs compétences professionnelles transférables.
Une formation en santé animale offerte par des bénévoles canadiens au Ghana

Pays : Ghana © Vétérinaires sans frontières
Nima Morady, bénévole pour VSF, montre une technique de vaccination adéquate pour les poules à une éleveuse ghanéenne.
Plus de 10 000 éleveurs ruraux du Ghana ont pu augmenter leurs revenus et améliorer leur alimentation grâce à la formation sur l’élevage d’animaux de Vétérinaires sans frontières (VSF). L’élevage occupe une place majeure dans le secteur agricole du Ghana et est source de revenus, en particulier pour les femmes. Cependant, la production stagne depuis des années, en partie à cause de la pénurie de services vétérinaires adéquats. Pour pallier ce problème, VSF s’est associé à Social Enterprise Development Ghana et au ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana pour donner, dans 50 communautés du nord du Ghana, une formation sur l’élevage d’animaux à des dirigeants communautaires, des agents de vulgarisation vétérinaire et des agents communautaires de santé animale (ACSA). Cette formation a contribué à assurer la pérennité de l’élevage en fournissant aux ACSA et aux dirigeants communautaires les connaissances nécessaires pour poursuivre la formation et parler de santé animale dans les régions où les services vétérinaires sont insuffisants. Constatant les bénéfices de la formation, d’autres membres de ces communautés ont adopté de meilleures pratiques de santé animale, ce qui a permis de réduire les maladies et d’améliorer les revenus et la nutrition des ménages. Selon Purity, une éleveuse ghanéenne, « Le taux de mortalité a diminué. Je contrôle aussi mieux mes volailles et elles ne vagabondent plus [...] Avant, le taux de mortalité de mes animaux était élevé, mais depuis la formation, il a diminué, car je leur donne plus de soins. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Vétérinaires sans Frontières - Envoi de volontaires 2015-2020.
La Semaine du développement international (SDI), qui a lieu en février, est une importante plateforme de mobilisation du public d’Affaires mondiales Canada, des conseils provinciaux et régionaux de coopération internationale et d’autres partenaires. Cet événement annuel attire l’attention sur l’aide internationale du Canada et contribue à informer, inspirer et mobiliser la population canadienne, notamment les jeunes. Sous le thème « Ensemble pour l’égalité des genres », l’édition de 2019 a incarné l’engagement du Canada envers l’effort mondial pour traiter de l’égalité des genres et a encouragé les Canadiens et les Canadiennes à être des artisans de changement dans la promotion de l’égalité des genres. Pendant la SDI, les activités de mobilisation proposées en ligne et en personne par Affaires mondiales Canada et ses partenaires ont permis de rejoindre plus de 50 millions de personnes.
Les conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale du Réseau de coordination des conseils (RCC) ont continué de mobiliser le public canadien grâce à leurs liens avec divers intervenants, notamment des jeunes, des acteurs du développement, des dirigeants politiques, des institutions et des entreprises. Le RCC facilite l’implication des gens à la grandeur du pays envers la Politique d’aide internationale féministe, la Politique relative aux OSC et l’engagement du Canada à l’égard du Programme 2030. En 2018-2019, le RCC a activement mobilisé 668 personnes (dont 61 % de femmes) par l’intermédiaire du programme national de formation sur l’engagement du public, de webinaires nationaux sur le renforcement des capacités et de dialogues s’arrimant à la conférence Women Deliver.
En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a continué de collaborer avec des organisations canadiennes afin de renforcer son engagement à prévenir l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements dans le milieu de l’aide internationale. Faisant fond sur la Déclaration de Whistler sur la protection contre l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements dans le domaine de l’aide internationale, négociée par le Canada en octobre 2018 pendant sa présidence du G7, le Canada et 21 autres donateurs ont approuvé une série d’engagements (en anglais). Affaires mondiales Canada a également dialogué avec ses ONG partenaires du Canada par l’intermédiaire du Comité directeur du Conseil Canadien pour la Coopération Internationale pour combattre et prévenir l’inconduite sexuelle dans l’aide internationale. En septembre 2018, par exemple, 70 représentants d’ONG canadiennes ont participé à un dialogue sur la prévention de l’exploitation sexuelle et des mauvais traitements dans le domaine de l’aide internationale. En novembre 2018, Affaires mondiales Canada a mis à jour ses modalités générales concernant les accords de contribution au développement international pour exiger que les partenaires se dotent d’un Code de conduite accessible au public qui vise à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, à faire enquête et à intervenir si une telle situation survient.
Coopérer avec les partenaires locaux
Le Canada s’efforce de fournir son aide internationale en utilisant des moyens plus efficaces et rationnels pour rejoindre les populations locales. C’est pourquoi le Canada achemine une partie plus importante de son aide vers les organisations locales des pays en développement, qui sont souvent les mieux placées pour répondre rapidement aux défis en matière de développement.
Le Canada renforce son soutien aux organisations et aux mouvements locaux de défense des droits des femmes dans les pays en développement, consolidant ainsi ces partenariats. Ce sont des agents clés du changement qui contribuent à renforcer les droits des femmes et des filles et qui aident les sociétés à réaliser l’égalité des genres. Bon nombre des initiatives décrites dans le présent rapport reposent sur les capacités, l’accès et le dynamisme de partenaires locaux.
Par exemple, le Programme sur la voix et le leadership des femmes, lancé en juin 2017, se fonde sur les priorités déterminées par les organisations et réseaux locaux de femmes qui œuvrent à promouvoir l’égalité des genres et à faire progresser les droits des femmes et des filles. Grâce à ce programme, le Canada est l’un des principaux donateurs à soutenir les organisations de défense des droits des femmes dans les pays en développement. En outre, neuf projets découlant du Programme ont un partenaire local responsable de leur exécution.
Le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) est un autre programme d’envergure ciblant les partenaires locaux. Il permet aux missions canadiennes à l’étranger de travailler directement avec les organismes de la société civile, les établissements d’enseignement et les gouvernements locaux pour réaliser des projets de petite échelle qui génèrent d’importants résultats et répondent aux priorités et aux besoins locaux. En 2018-2019, le FCIL a soutenu 547 projets à hauteur de 14,5 millions de dollars dans plus de 120 pays. Le Fonds a appuyé un large éventail d’initiatives, tout en accordant une attention particulière à celles qui favorisent l’égalité des genres, la protection des droits de la personne et le renforcement de la démocratie. Les OSC ont exécuté environ 83 % de ces projets, traduisant ainsi l’importance accordée par le FCIL aux organisations et aux besoins locaux. En voici quelques exemples : faciliter la conception et l’exécution d’un plan d’action environnemental avec des jeunes du Belize et du Guatemala pour favoriser la coopération transfrontalière, lancer des campagnes de sensibilisation populaire à l’importance de la participation politique des femmes aux Maldives, et utiliser des technologies novatrices pour créer une application de conseils juridiques aux victimes de VSFS en Ouzbékistan.
Grâce au FCIL, le Canada aide les OSC locales – dont beaucoup ne seraient pas autrement admissibles au financement des donateurs internationaux – à prospérer. Ce financement fait en sorte que des voix diverses puissent contribuer à l’édification d’une société civile ouverte, y compris dans les pays où l’espace civique perd du terrain ou est menacé. Les partenariats vont souvent au-delà du projet initial soutenu par le FCIL, car les missions canadiennes mettent régulièrement les OSC en contact avec d’autres donateurs pour qu’elles puissent donner de l’ampleur à leurs projets. Les OSC partenaires offrent aussi au Canada une vision unique et nuancée des réalités complexes et en constante évolution sur le terrain.
Coopérer avec la société civile internationale
Le Canada est résolu à assurer une participation forte et significative de la société civile internationale et à se faire le champion des enjeux concernant l’espace civique par le biais de sa politique et de ses programmes d’aide internationale, de son engagement multilatéral et de ses priorités en matière de politique étrangère. Pour réaliser ses objectifs stratégiques, maximiser la portée et les résultats de son aide internationale et favoriser une société civile forte et vivante, le Canada aide des fonds mondiaux, des ONG internationales et d’autres programmes internationaux.
Ce soutien en faveur d’un environnement favorable à la société civile permet de s’assurer que les OSC locales et internationales puissent fonctionner efficacement et de manière indépendante, complétant ainsi les efforts des gouvernements et d’autres intervenants, et facilitant la réalisation des objectifs du Programme 2030. Par exemple, le soutien du Canada au projet Filles, pas épouses, un partenariat mondial d’organisations de la société civile, a non seulement contribué à réaliser des progrès considérables pour mettre fin au mariage des enfants, mais aussi à mobiliser plus d’acteurs par rapport à cet enjeu et à consolider l’intervention de la société civile dans le monde entier.
Les organisations internationales jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des grands engagements du Canada. Par exemple, en 2018-2019, le Canada a financé plusieurs organisations qui œuvrent en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et de la santé des nouveau-nés, des mères et des enfants, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, GAVI, l’Alliance du Vaccin, le Mécanisme de Financement Mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents et Nutrition international. En outre, le Canada entretient une relation de financement de longue date avec le Partenariat mondial pour l’éducation, faisant de cette organisation l’un des principaux partenaires du Canada en ce qui a trait à la promotion de l’éducation des filles dans le monde entier. Le Partenariat est également une plateforme permettant de coordonner les efforts des donateurs bilatéraux, des pays en développement, des institutions multilatérales et des organisations de la société civile.
L’aide humanitaire est un domaine où il est essentiel de disposer de mécanismes efficaces pour fournir rapidement des fonds aux intervenants dans les situations d’urgence. En 2018-2019, le Canada a fourni un financement de plus de 74 millions de dollars au Comité international de la Croix-Rouge pour ses missions humanitaires. Un soutien a également été apporté aux ONG ayant des réseaux internationaux comme International Medical Corps (en anglais), Mercy Corps (en anglais), le Comité international de secours (en anglais), l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement et Action contre la faim.
Les organisations philanthropiques internationales sont des acteurs de plus en plus importants pour la communauté internationale du développement. Elles fournissent des fonds, contribuent aux objectifs de développement mondiaux et offrent des ressources indispensables et des approches innovantes aux défis actuels du développement. Le Canada travaille avec ces organisations par le truchement de partenariats stratégiques, de financement parallèle à des initiatives communes et de partenariats de mise en œuvre. Par exemple, le Canada coopère avec la Bill & Melinda Gates Foundation (en anglais) autour d’une série d’initiatives visant à améliorer la santé et la nutrition, les droits et le renforcement du pouvoir des femmes, des enfants et des adolescents, en s’attachant particulièrement à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Le Canada a aussi collaboré avec la Bill & Melinda Gates Foundation et la Rockefeller Foundation (en anglais) pour financer et mettre sur pied Convergence (en anglais), une organisation indépendante à but non lucratif qui aide à relier investisseurs privés et investisseurs publics et philanthropiques pour offrir des possibilités de financement mixte sur les marchés émergents.
Cet écosystème diversifié de la société civile internationale offre au Canada une variété de partenaires novateurs proposant des technologies, des solutions et des réseaux divers pour aider à relever les défis du développement mondial.
Coopérer avec des organisations multilatérales
Le Canada reconnaît que la meilleure façon de faire avancer nos objectifs dans le monde est de contribuer à des causes communes avec des partenaires partageant les mêmes idées. Il reconnaît aussi que la plupart des plus grands défis du développement (notamment la lutte contre les changements climatiques, contre les maladies, pour l’égalité des genres et contre les pires formes de pauvreté) nécessitent une action collective et la mise en commun des ressources autour de stratégies conjointes. Les organisations multilatérales ont l’expertise, les ressources, les réseaux et le pouvoir fédérateur nécessaires pour amplifier la portée et les retombées de l’aide internationale du Canada et l’aider à relever des défis de développement mondiaux complexes qu’aucun pays ne peut relever seul.
C’est pourquoi le soutien aux institutions multilatérales et autres partenaires mondiaux occupe une place importante dans tous les aspects de l’aide au développement du Canada. Les organisations internationales spécialisées jouent un rôle dans toutes les priorités et tous les engagements internationaux du Canada. Les partenariats du Canada avec les organismes de développement des Nations Unies, les IFI et d’autres partenaires internationaux spécialisés d’importance fournissent l’expertise nationale requise et permettent d’amplifier l’aide internationale du Canada à l’échelle mondiale.
Pour en savoir plus sur la coopération du Canada avec des organisations et des institutions internationales, visitez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Organisations des Nations Unies
Le Canada est un membre actif au sein des Nations Unies depuis la fondation de l’organisation en 1945. Aujourd’hui, le Canada continue de respecter et d’appuyer les instances et les organismes du système des Nations Unies :
- en s’engageant activement dans les débats politiques et techniques;
- en contribuant à la gouvernance et à l’établissement des programmes;
- en apportant un soutien financier par des quotes-parts et des contributions volontaires.
Grâce au siège que le Canada occupe au sein des organes directeurs des Nations Unies, il aide à guider ses partenaires, veille à ce qu’ils rendent des comptes sur l’exécution de leurs importants mandats et accroît la portée des partenariats des Nations Unies sur ses priorités de développement bilatéral et régional. Le Canada participe activement à divers événements annuels et extraordinaires de haut niveau des Nations Unies pour faire avancer ses priorités en matière d’aide internationale. Parmi ces événements annuels, mentionnons la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale en septembre, qui comprend le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, et le Forum sur le suivi du financement du développement du Conseil économique et social, qui se tient en avril ou en mai. Le Canada est aussi particulièrement actif au sein de la Commission de la condition de la femme.
Le Canada s’associe aux Nations Unies par le biais d’un soutien institutionnel régulier à long terme et de divers projets spécifiques axés sur des priorités communes. Plusieurs exemples de ces projets ponctuent ce rapport. Le soutien institutionnel à long terme du Canada aux organisations du système des Nations Unies a atteint 319 millions de dollars en 2018-2019. Ces contributions ont appuyé les activités essentielles de ces organisations, notamment les efforts qui visent la réduction de la pauvreté, la promotion du développement durable, la promotion de l’inclusion, l’égalité des genres, et le renforcement du pouvoir des femmes.
Le Canada s’associe à diverses organisations des Nations Unies par l’intermédiaire d’un financement par projet ou d’un soutien institutionnel à long terme, notamment avec :
- le Programme alimentaire mondial des Nations Unies;
- le Fonds des Nations Unies pour l’enfance;
- le Fonds des Nations Unies pour la population;
- le Programme des Nations Unies pour le développement;
- l’Organisation mondiale de la Santé;
- le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
- l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;
- ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes;
- le Fonds international de développement agricole;
- l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture;
- le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
L’un des principaux partenaires du Canada aux Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) intervient dans quelque 170 pays et territoires pour éradiquer la pauvreté et atténuer les inégalités. Le PNUD aide ces pays à se doter de politiques, de compétences en leadership, de capacités de partenariat et de capacités institutionnelles et à renforcer leur résilience pour favoriser l’atteinte de résultats de développement et des objectifs de développement durable. Grâce au PNUD, le Canada et d’autres pays ont, par exemple, aidé 97 pays et territoires à harmoniser leurs priorités locales et nationales aux ODD, appuyé les processus électoraux dans 56 pays et aidé 17,2 millions de femmes de 39 pays à s’inscrire sur les listes électorales.
Le Canada appuie également l’UNICEF, la première organisation internationale pour les enfants. L’UNICEF œuvre dans plus de 190 pays et territoires pour sauver la vie des enfants, défendre leurs droits et les aider à réaliser leur plein potentiel. Par exemple, la contribution du Canada a favorisé 27 millions de naissances vivantes dans des établissements de santé et a aidé 12 millions d’enfants non scolarisés à obtenir une éducation préscolaire, primaire ou secondaire. De plus, grâce au soutien du Canada, plusieurs bureaux de l’UNICEF ont pu élargir leurs programmes de santé pour les enfants, les mères et les adolescents en 2018. Ils ont notamment intégré dans leurs programmes des interventions en matière de nutrition, de VIH et de développement de la petite enfance, et ont adopté des plans visant à renforcer les systèmes de santé à Madagascar, au Malawi, au Mali, en République centrafricaine, au Tchad et au Soudan.
Le Canada s’associe à des organisations des Nations Unies pour promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que la santé des enfants, des mères et des adolescents. Par exemple, le soutien institutionnel à long terme accordé par le Canada en 2018 au Fonds des Nations Unies pour la population a contribué à garantir que tous aient accès à une offre complète de contraceptifs et de services de qualité, permettant ainsi à des millions de femmes de décider elles-mêmes si elles souhaitent avoir des enfants, quand elles souhaitent les avoir et combien elles en veulent. On estime ainsi que 13,7 millions de grossesses non désirées ont été évitées.
Le combat pour la santé maternelle et néonatale en Haïti à travers le travail des sages-femmes

Pays : Haïti © UNFPA
Rhode Cyndia, 24 ans, a accompli son rêve d’enfant de devenir sage-femme. Elle travaille à l’Hôpital Notre-Dame de La Paix de Jean Rabel, dans le département du Nord-Ouest d’Haïti. Ce rêve a été réalisé dans le cadre du projet Saj Fanm pou Fanm (projet de renforcement de la profession et de la pratique de sage-femme), mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population. La passion de Rhode pour la profession de sage-femme la porte à passer le plus clair de son temps à accompagner des patientes, même en dehors de ses heures de travail. Seule sage-femme à l’Hôpital Notre-Dame de La Paix de Jean Rabel, elle a toujours un pincement au cœur en constatant quasi-quotidiennement l’écart élevé entre le nombre de femmes en consultation et le nombre d’accouchements. Mais son travail réduit tous les jours cet écart. La jeune sage-femme a réalisé avec succès une quinzaine d’accouchements depuis son arrivée à l’hôpital. Elle se réjouit particulièrement d’avoir pu réanimé à la naissance plusieurs bébés qui ne respiraient pas et dont le cœur ne battait pas.
Là où les difficultés pourraient faire fuir de jeunes professionnels de la santé, Rhode Cyndia voit des opportunités pour mieux comprendre la réalité des femmes vivant en milieu rural. Elle s’assure tous les jours de mettre en pratique ses connaissances afin qu’aucune femme ne meure en donnant la vie et qu’aucun bébé ne meure à la naissance.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Renforcer la profession et les services des sages-femmes en Haïti.
En matière d’agriculture, Affaires mondiales Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada travaillent de concert pour représenter les intérêts du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Les membres de l’Organisation travaillent à l’adoption de normes pour le commerce d’aliments sûrs, fournissent une assistance technique pour les cultures, le bétail, la sylviculture et la pêche, et fournissent une aide d’urgence pour protéger les moyens de subsistance agricoles et améliorer la résilience aux catastrophes.
En 2018-2019, le Canada a aussi contribué à l’action humanitaire par l’intermédiaire des organisations des Nations Unies, dont le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les contributions du Canada ont permis d’apporter aux personnes touchées par des crises humanitaires, dont les femmes vulnérables, les enfants et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, une aide en cas d’urgence majeure comme de l’aide alimentaire et un accès à l’eau, ainsi qu’un soutien à l’assainissement et aux moyens de subsistance. Le Canada appuie également les programmes de repas scolaires du PAM, ainsi qu’un vaste éventail d’autres programmes et activités visant à renforcer la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en particulier des femmes et des filles.
Une autre grande priorité est la protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques. Comme il est mentionné dans le chapitre sur l’environnement et l’action pour le climat, le Fonds vert pour le climat (en anglais) des Nations Unies est un partenaire essentiel qui permet de proposer des solutions novatrices aux pays en développement. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a versé 132 millions de dollars en soutien au fonds mondial pour le climat.
Le G7 et le G20
Le Groupe des Sept (G7) et le Groupe des Vingt (G20) sont des cadres multilatéraux clés pour la coopération économique internationale. Le Canada et les autres membres du G7 et du G20 reconnaissent que leurs perspectives et défis économiques sont liés et ont une incidence sur la prospérité mondiale. Le G7 et le G20 sont d’excellentes plateformes pour le Canada, car elles favorisent l’avancement des priorités nationales et internationales liées à l’aide internationale.
En 2018, le Canada a assumé la présidence du G7 et a accueilli le Sommet du G7 à Charlevoix, au Québec. Pendant sa présidence, le Canada a créé le Conseil consultatif sur l’égalité des genres pour favoriser un programme transformateur du G7 et aider à intégrer l’égalité des genres et l’analyse comparative entre les genres à l’ensemble des thèmes, activités et résultats de la présidence du Canada. La France a conservé le Conseil sous sa présidence en 2019.
Les deux rencontres des ministres du Développement à Whistler sont un autre fait saillant de la présidence du Canada. De jeunes femmes porte-parole ont participé à la première rencontre, permettant ainsi de faire entendre la voix des principales intéressées aux questions débattues. Les ministres ont approuvé quatre déclarations concrètes et ambitieuses axées sur le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et sur des approches novatrices au développement durable :
- Déclaration de Whistler sur le renforcement du pouvoir des adolescentes pour favoriser le développement durable;
- Déclaration de Whistler sur la protection contre l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements dans le domaine de l’aide internationale;
- Déclaration de Whistler sur l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l’action humanitaire;
- Les principes de Whistler pour accélérer l’innovation au service du développement.
La seconde rencontre réunissait pour la première fois les ministres du Développement et des Finances du G7 pour faire avancer des questions prioritaires communes, telles que le renforcement du pouvoir économique des femmes, le financement innovant pour le développement et la résilience devant les événements climatiques extrêmes. Ces réunions ont préparé le terrain pour une série d’annonces, dont le lancement du Défi 2X : financement pour les femmes, et d’autres, importantes, par des investisseurs institutionnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Résumé des coprésidents : Ministres des Finances et du Développement du G7.
Dans le cadre du Défi 2X : financement pour les femmes (en anglais), les institutions financières de développement (IFD) des membres du G7, dont FinDev Canada, l’IFD du Canada, se sont engagés à mobiliser collectivement 3 milliards de dollars américains pour soutenir le renforcement du pouvoir des femmes et l’égalité des genres d’ici la fin de 2020. L’initiative vise à inspirer d’autres IFD et des acteurs privés à agir pour soutenir cet effort. En avril 2019, les partenaires du Défi 2X avaient promis plus de 900 millions de dollars américains pour aider les femmes en tant qu’entrepreneures, chefs d’entreprise, employées et consommatrices de produits et de services. En outre, des investisseurs institutionnels majeurs, dirigés par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la société qui gère les fonds de pension du Québec, et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ont lancé l’initiative de leadership des investisseurs. L’initiative s’attaque au manque de représentation des femmes dans des postes de direction et au déficit infrastructurel mondial, en particulier dans les marchés émergents, en tenant compte des menaces que posent les changements climatiques pour la croissance.
Les réunions ministérielles ont également préparé le terrain à l’adoption de deux documents clés : la Déclaration d’engagement de Charlevoix pour un financement novateur du développement et la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur l’éducation, l’élan donné par la Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité a permis de mobiliser 3,8 milliards de dollars pour faire progresser l’éducation des filles et des femmes dans les États en crise et touchés par des conflits, et d’aller chercher 527 millions de dollars supplémentaires lors de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, plus tard en 2018.
En ce qui a trait à la responsabilisation et à la transparence, le Groupe de travail du G7 sur la responsabilisation (GTR) et le Groupe de travail du G20 sur le développement (GTD) sont les principaux instruments qui suivent les engagements en matière de développement pris par les dirigeants. En 2018, le Canada a publié le Rapport d’étape de Charlevoix sur l’autonomisation économique des femmes. Ce rapport met en lumière les efforts déployés par les pays du G7, l’Union européenne, la société civile, les groupes de défense des droits et le secteur privé pour renforcer l’autonomie des femmes dans les pays en développement. En 2018, le GTD a fait le bilan de la réalisation des engagements pris par les pays du G20 à l’égard du Programme 2030 dans le Rapport annuel de Buenos Aires sur les engagements du G20 en matière de développement (en anglais).
Pour en savoir plus sur la participation du Canada au G7 et au G20, consultez les pages du G7 et du G20 sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Organisation de coopération et de développement économiques
Le Canada est membre du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE depuis sa création en 1960. Le CAD, un forum mondial regroupant les fournisseurs d’aide gouvernementale, est une plateforme pour l’adoption de normes en matière de coopération au développement. En 2018-2019, le Canada a versé 1,2 million de dollars au CAD pour soutenir ses travaux, notamment le financement d’organes subsidiaires œuvrant dans les domaines du genre, de la gouvernance, de l’environnement, des conflits et de la fragilité, de l’innovation et des statistiques. Ce financement a aussi contribué aux travaux de l’OCDE au sein du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), une plateforme mondiale multipartite axée sur la qualité et l’efficacité de la coopération au développement. À titre de membre du comité directeur du PMCED, le Canada a l’occasion unique d’interagir et de dialoguer avec une multitude d’acteurs et de partenaires du développement au-delà de ceux du CAD, notamment des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé, des parlementaires, des gouvernements locaux, des syndicats, des fondations philanthropiques et des organisations internationales.
Au sein du CAD, le Canada joue un rôle de premier plan dans des domaines prioritaires tels que l’égalité des genres, le financement du développement, l’innovation et le financement mixte. Le Canada a aussi participé activement à plusieurs groupes de travail du CAD afin de s’assurer qu’il utilise des mécanismes d’évaluation et des techniques de collecte de données fiables, et des outils exhaustifs pour mieux tenir compte de l’égalité des genres. Pour accroître la pertinence et l’impact des travaux du CAD, le Canada a, dans les dernières années, travaillé en étroite collaboration avec le président et les membres du Comité pour encourager la coopération avec des acteurs du développement externes au CAD, notamment les acteurs du Sud et les partenaires de la société civile.
La Francophonie
Le Canada maintient son engagement à l’égard de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une tribune importante pour mobiliser la communauté internationale autour d’enjeux prioritaires. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a versé plus de 29 millions de dollars aux diverses institutions de la Francophonie, dont plus de 24 millions à l’OIF.
L’appui du Canada à la Francophonie a mené à des résultats concrets sur le terrain. Par exemple, en 2018, l’OIF a déployé des missions de médiation politique au Burundi, au Cameroun, en Guinée, au Mali, au Niger et en RDC. Elle a aussi organisé des séminaires parlementaires sur la promotion des droits de la personne au Bénin, à Madagascar et au Mali, et défendu l’abolition de la peine de mort au Burkina Faso et en Guinée. Le Canada a également soutenu l’OIF dans l’organisation d’une conférence internationale sur la prévention des conflits et la sécurité humaine à l’Université d’Ottawa en mai 2018. L’OIF a par ailleurs poursuivi son excellent travail en matière d’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Grâce aux contributions canadiennes, plus de 20,500 femmes et jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement de l’OIF depuis 2015.
Enfin, le Canada a joué un rôle de chef de file dans l’élaboration et l’adoption, au Sommet d’Erevan de 2018, de la Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que de la première politique de consolidation de la transparence de l’OIF.
Commonwealth
Le gouvernement du Canada finance le Commonwealth et ses institutions (en anglais) au moyen de quotes-parts et de contributions volontaires à titre d’État membre du Commonwealth. Ce soutien contribue à améliorer la vie des groupes vulnérables des pays du Commonwealth, qui représentent plus de 2 milliards de personnes. Il est affecté à des domaines tels que le renforcement du pouvoir des femmes, la diversité et l’inclusion, la gouvernance et la primauté du droit. Le soutien du Canada aide aussi le Commonwealth à répondre aux besoins particuliers des petits États, amplifiant leur voix dans les forums multilatéraux.
En 2018-2019, le Canada a versé des quotes-parts de plus de 7,9 millions de dollars au Secrétariat du Commonwealth, ainsi qu’à la Fondation du Commonwealth. Le Canada a aussi renouvelé son soutien institutionnel au Commonwealth of Learning à concurrence de 7,8 millions de dollars sur trois ans, dont 2,6 millions alloués en 2018-2019. Grâce au soutien du Canada et d’autres pays membres, le Commonwealth of Learning a aidé plus de 115 000 personnes à avoir accès à des apprentissages de qualité en 2018-2019, pour un total de près de 700 000 personnes depuis 2015-2016. En 2018-2019, 156 organisations ont amélioré leur capacité à offrir des modèles d’apprentissage ouvert et d’apprentissage à distance, pour un total de 276 organisations depuis 2015-2016.
Le Canada a également contribué à la prévention des mariages d’enfants et des mariages précoces et forcés par le biais d’un projet d’éducation ouverte et à distance. Au cours de ce projet de trois ans, plus de 5 000 filles ont réintégré le système scolaire au lieu de se marier, près de 30 000 femmes et filles ont suivi des cours de formation professionnelle et 30 000 femmes et filles ont suivi un cours de compétences de vie qui les a informées sur leur santé, leurs droits sociaux et les conséquences des mariages d’enfants et des mariages précoces et forcés. Au total, 1 181 mariages d’enfants et mariages précoces et forcés ont été évités grâce à ce projet.
Coopérer avec les institutions financières internationales
Les IFI diffèrent des banques commerciales. Leurs propriétaires ou actionnaires sont généralement des gouvernements nationaux, et leurs mandats se caractérisent par la poursuite du « bien mondial » plutôt que par la maximisation des profits pour les actionnaires. Les IFI peuvent en outre accorder des prêts à des taux d’intérêt inférieurs au marché (prêts concessionnels) ainsi que des subventions. C’est notamment le cas des banques multilatérales de développement (BMD), et des IFI qui fournissent des fonds et des conseils professionnels aux fins du développement. Les membres des IFI comprennent tant les pays donateurs développés que les pays emprunteurs en développement. Le Canada est membre et actionnaire de plusieurs IFI, dont beaucoup se concentrent sur une région (banques régionales de développement) ou un thème particulier. Parmi les exemples d’IFI axées sur un thème, nommons le Fonds international de développement agricole, le Fonds d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal.
Les IFI fournissent une aide financière et technique aux gouvernements de pays en développement, et dans certains cas aux acteurs du secteur privé, pour favoriser la réduction de la pauvreté et le développement économique à long terme. Ces investissements couvrent un vaste éventail de secteurs : l’éducation, la santé, l’administration publique, les infrastructures, le développement des secteurs financier et privé, l’agriculture et la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Certaines IFI, dont le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale, soutiennent également les pays en développement en offrant des conseils stratégiques, des services de recherche et d’analyse et des activités de développement des capacités.
Le Canada fournit des contributions de base pour soutenir les opérations et les activités des IFI, ainsi que des fonds pour des projets particuliers. Le Canada contribue activement à la formulation des politiques des IFI et en surveille les activités financières grâce à sa participation aux conseils des gouverneurs et aux conseils d’administration, ces derniers étant responsables des décisions quotidiennes. Le Canada participe également aux travaux de divers comités internes et engage un dialogue constructif avec les autres actionnaires.
Pour fixer une orientation stratégique à son engagement auprès des IFI, le Canada adopte des objectifs clés qui s’inspirent de son engagement à l’égard du multilatéralisme, de la politique étrangère et des priorités de développement, ainsi que des principes généraux de bonne gouvernance. Le Volume 2 donne des détails sur les priorités d’engagement du Canada. Par exemple, le Canada préconise la collaboration des IFI sous forme de système pour qu’elles puissent utiliser leurs ressources de la manière la plus efficace et la plus rationnelle possible. Il s’agit notamment de concerter leurs efforts pour accroître l’impact sur le développement, de mobiliser des fonds privés à grande échelle et d’améliorer la coordination en harmonisant les processus et les priorités de gouvernance.
Les sections suivantes donnent un aperçu des principales IFI mondiales et régionales dont le Canada est membre :
| Banque | Paiement annuel |
|---|---|
| Groupe de la Banque mondiale – Association internationale de développement | 441,6 |
| Groupe de la Banque mondiale – Banque internationale pour la reconstruction et le développement | 250,4 |
| Groupe de la Banque africaine de développement | 108,5 |
| Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures | 53,4Note de bas de page 17 |
| Banque asiatique de développement | 33,0 |
| Banque de développement des Caraïbes | 17,6 |
| Société interaméricaine d’investissement | 15,2 |
| Banque interaméricaine de développement | 3,1 |
| Banque européenne pour la reconstruction et le développement | 0,0 |
Institutions de Bretton Woods
Le Fonds monétaire international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM), qui forment ensemble les institutions de Bretton Woods, ont vu le jour en 1944 pour promouvoir la coopération monétaire internationale et la stabilité financière après la Seconde Guerre mondiale. Depuis, le paysage économique mondial a évolué considérablement, et les institutions de Bretton Woods ont dû faire de même pour rendre compte de cette évolution. Elles continuent de jouer un rôle central dans les efforts internationaux visant à favoriser une croissance et une stabilité économiques durables, à réduire la pauvreté et à trouver des solutions novatrices pour répondre aux défis mondiaux communs.
Compte tenu de sa contribution financière et des actions à droit de vote qu’il détient au sein du FMI et du GBM, le Canada joue un rôle important dans leur gouvernance. Le ministre des Finances représente le Canada au conseil des gouverneurs des deux institutions, et les Canadiens représentent un groupe de pays membres au conseil d’administration de chaque institution. Un Canadien ou une Canadienne a toujours occupé le poste d’administrateur représentant le groupe de pays dont le Canada fait partie, lequel comprend l’Irlande et un certain nombre de pays des Caraïbes membres du CommonwealthNote de bas de page 18.
Groupe de la Banque mondiale
Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) est l’une des plus importantes organisations de développement du monde et représente l’une des plus grandes sources de financement pour les pays en développement. Le Canada est membre des cinq institutions du GBM : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ces institutions ont l’objectif double d’éradiquer l’extrême pauvreté et de stimuler la prospérité commune et les trois priorités suivantes : la croissance durable et inclusive, l’investissement dans le capital humain et le renforcement de la résilience. En 2018-2019, le GBM a versé près de 60 milliards de dollars américains en prêts, subventions, placements en actions et garanties à des pays partenaires et à des entreprises privées pour contribuer à un meilleur développement.
La participation actuelle du Canada varie de 2,5 % à 3 % au sein des différentes institutions du GBM. Et son droit de vote se base sur ces parts. En avril 2018, les actionnaires du GBM ont approuvé un ensemble de mesures qui comprenait une hausse de 13 milliards de dollars américains en capital d’apport, une série de réformes internes et d’autres mesures stratégiques. Cette hausse en capital d’apport se répartissait comme suit : 7,5 milliards de dollars américains pour la BIRD et 5,5 milliards de dollars américains pour la SFI. Elle s’accompagnait par ailleurs d’une série de mesures internes, notamment des changements opérationnels et des réformes de l’efficacité, des mesures de tarification des prêts et d’autres mesures stratégiques visant à renforcer la capacité du GBM à accroître ses ressources et à fournir de l’aide dans les régions du monde qui en ont le plus besoin.
En novembre 2018, le GBM a entrepris la 19e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA-19), un processus qui a lieu tous les trois ans pour reconstituer les ressources de l’IDA et revoir ses politiques. Sixième donateur de l’IDA, le Canada est un participant clé des discussions et promeut la viabilité de la dette, l’égalité des genres, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ses effets, l’optimisation des bilans financiers, le soutien accru aux États fragiles et aux petits États insulaires, en plus de prôner l’idée selon laquelle les BMD devraient fonctionner comme un système. L’IDA-19 et la hausse en capital d’apport ont représenté une excellente occasion de faire progresser les objectifs du Canada.
Le Volume 2 fournit des détails sur la participation du Canada aux activités du GBM, dont des informations sur les marchés publics et les communiqués du Comité de développement des conseils des gouverneurs du GBM pour la période de référence. Pour en savoir plus sur la participation du Canada au Groupe de la Banque mondiale, visitez le site Web du ministère des Finances Canada.
Projet de soutien à la gestion économique dans les Caraïbes

Pays : Jamaïque © Banque mondiale
Cette année, la Jamaïque a atteint un jalon important dans ses efforts pour renforcer sa résilience climatique. En effet, la secrétaire financière de la Jamaïque a officiellement approuvé et rendu publique la Directive sur l’exécution du budget après catastrophe. Ce document, dont la création a été dirigée par le ministère des Finances et de la Fonction publique de la Jamaïque, en collaboration avec la Banque mondiale, et financée par le Canada dans le cadre du présent projet, servira de référence aux ministères et aux organismes du pays. Il s’agit du premier document de ce genre.
La Directive d’exécution du budget après catastrophe est un exemple clair de la Politique d’aide internationale féministe du Canada en action. Le Canada aidera les administrations et les fonctionnaires à colliger et à analyser des données et des éléments probants ventilés afin de favoriser une meilleure prise de décision. Le Canada contribuera aussi à la conception et à l’exécution d’initiatives qui répondent aux besoins des femmes et des filles. D’autres pays des Caraïbes ont montré beaucoup d’intérêt pour la formulation de directives similaires, notamment le Belize et Sainte-Lucie. L’application de la Directive à l’échelle régionale se concentrera sur les pratiques de gestion des finances publiques en vue d’informer les administrations des lacunes critiques qui doivent être comblées pour accroître les capacités à intervenir en cas de catastrophes naturelles.
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Gestion économique dans les Caraïbes.
Fonds monétaire international
Le Fonds monétaire international est une organisation de 189 pays membres qui vise à promouvoir la santé de l’économie mondiale. Il œuvre pour favoriser la coopération monétaire mondiale, la stabilité financière, le commerce international, un taux d’emploi élevé, une croissance économique durable et la réduction de la pauvreté dans le monde. Le FMI utilise trois moyens pour atteindre ces objectifs :
- Surveillance et conseils – Le FMI observe l’évolution des secteurs économique, monétaire et financier aux échelles nationale, régionale et mondiale, et conseille ses membres sur les politiques à adopter pour atteindre la stabilité macroéconomique, accélérer une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté.
- Outils et programmes de prêt – Le FMI fournit une aide financière concessionnelle ou non concessionnelle aux membres qui font face à des difficultés ou à des crises économiques ou financières. Le FMI travaille en étroite collaboration avec les pays touchés pour élaborer des programmes d’ajustement destinés à corriger les problèmes macroéconomiques, à stabiliser l’économie et à rétablir une croissance durable, tout en veillant à ce qu’un filet de sécurité sociale adéquat protège les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la population.
- Renforcement des capacités – Le FMI répond aux demandes d’assistance technique et de renforcement des capacités afin de renforcer la capacité des membres à mettre en œuvre des politiques saines, notamment pour favoriser une meilleure gestion des finances publiques, faire reculer la pauvreté et les inégalités et lutter contre les changements climatiques. Ce travail passe principalement par la formation qu’offrent les centres régionaux d’assistance technique et par les fonds en fiducie.
Le Volume 2 fournit des détails sur la participation du Canada aux activités du FMI, dont les communiqués publiés par le Comité monétaire et financier international du FMI pour la période de référence. Pour en savoir plus sur la participation du Canada au FMI, visitez le site Web du ministère des Finances Canada.
Banques régionales de développement
Les banques régionales de développement (BRD) sont des institutions financières multilatérales qui fournissent une aide financière et technique pour le développement des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire d’une région donnée. Le gouvernement du Canada est un actionnaire des BRD suivantes : la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque interaméricaine de développement. Le ministre des Finances représente le Canada aux conseils des gouverneurs de la BAII et de la BERD et le ministre du Développement international représente le Canada aux conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de développement, de la Banque de développement des Caraïbes et de la Banque interaméricaine de développement. La participation du Canada à ces institutions complète ses programmes bilatéraux et son soutien aux institutions et initiatives multilatérales mondiales.
Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la Banque africaine de développement est détenu par 54 pays membres régionaux et 26 pays membres non régionaux. Il se consacre à la réduction de la pauvreté, au développement économique et à l’amélioration de la vie des populations de ses pays membres régionaux. La Banque africaine de développement (BAfD) fournit des prêts non concessionnels et une assistance technique aux pays africains solvables à revenu intermédiaire. Le Fonds africain de développement (FAfD), quant à lui, fournit une assistance technique, des dons et des prêts concessionnels (à faible taux d’intérêt ou sans intérêt) à 38 des pays les plus pauvres d’Afrique, dont près de la moitié sont des États fragiles.
Le Canada est le quatrième actionnaire non africain de la BAfD, avec 3,8 % des actions à droit de vote, et le septième donateur du FAfD. En 2018, la BAfD a approuvé des prêts à hauteur de 13,1 milliards de dollars américains par l’intermédiaire de ses instruments financiers (ligne de crédit, projets, ressources et garanties et participations à risque), et le FAfD a versé 2,5 milliards de dollars américains en prêts et en dons pour soutenir les pays les plus pauvres.
En mai 2018, la BAfD a lancé sa septième augmentation générale du capital (AGC-VII). L’AGC-VII vise à améliorer la capacité financière de la BAfD à contribuer aux efforts en vue d’atteindre les ODD. La BAfD a également lancé, en mars 2019, la 15e reconstitution du FAfD pour reconstituer les ressources du FAfD et revoir ses politiques.
Pour en savoir plus sur la participation du Canada au Groupe de la BAfD, visitez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Banque asiatique de développement
La Banque asiatique de développement (en anglais) est une banque multilatérale de développement qui regroupe 68 pays membres, 49 dans la région et 19 hors-région. Le mandat de la Banque vise à faire reculer la pauvreté, à stimuler une croissance verte et inclusive et à soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables de la région. La Banque asiatique de développement (BAD) fournit du financement sous forme de prêts et de subventions, qui sont financés par des ressources ordinaires en capital et par des fonds spéciaux et des fonds en fiducie.
Détenant 4,47 % des actions à droit de vote de la BAD, le Canada en est actuellement le septième actionnaire global et le deuxième actionnaire non régional. En outre, le Canada contribue à plusieurs fonds fiduciaires à un ou plusieurs donateurs et à des initiatives propres à certains pays, comme le Fonds climatique canadien pour le secteur privé en Asie, le Fonds de préparation des projets de l’Asie-Pacifique et le projet de Résilience aux changements climatiques et aux désastres naturels au Myanmar. Le Canada s’est engagé à verser 132 millions de dollars au Fonds asiatique de développement pour la période 2017-2020. Le Fonds asiatique de développement est le plus important financement à conditions libérales de la BAD; il fournit des fonds aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables d’Asie.
Pour en savoir plus sur la participation du Canada à la BAD, visitez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
Créée en janvier 2016 et basée à Beijing, en Chine, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (en anglais) se concentre sur le financement des infrastructures en Asie. Au 31 mars 2019, la Banque avait approuvé plus de 7,5 milliards de dollars américains pour le financement de 36 projets, principalement dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) se décrit comme une institution « allégée, propre et verte » et a adopté plusieurs politiques et directives pour favoriser des retombées du développement durable sur le plan environnemental et social. En 2018, la BAII a conservé sa cote de crédit AAA et a mis en place des cadres financiers et de gestion des risques sains. Ces facteurs permettent à la BAII de proposer des options de financement à faible coût pour financer des projets de grande envergure.
Entre 2017 et 2018, le nombre de membres de la BAII est passé de 84 à 93, et l’institution a financé 12 projets d’une valeur de 3,3 milliards de dollars américains, principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau. Depuis 2016, certains des projets de la BAII sont cofinancés avec d’autres BMD, notamment la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le cofinancement de projets a permis à la BAII de voir les pratiques exemplaires qu’utilisent les BMD expérimentées.
Le Canada s’est joint à la BAII en mars 2018, et son gouverneur est le ministre des Finances. En juillet 2018, le Canada a obtenu un mandat de deux ans au sein du conseil d’administration, qui compte 12 membres. Comme dans d’autres banques, l’administrateur canadien représente un groupe de pays, qui comptait, au 31 mars 2019, l’Égypte, l’Éthiopie et Madagascar, et qui ne cesse de s’agrandir.
Pour en savoir plus sur la participation du Canada à la BAII, visitez le site Web du ministère des Finances Canada.
Banque de développement des Caraïbes
La Banque de développement des Caraïbes (en anglais) est un catalyseur de premier plan pour la coopération économique et la réduction de la pauvreté dans la région des Caraïbes. Elle finance des initiatives de développement prioritaires et des actions de coopération technique, et la plus grande partie de ce financement est assortie de conditions libérales et de garanties souveraines. Cette Banque est également reconnue pour son expertise et ses approches locales du développement, ainsi que pour son leadership éclairé pour la région. Son plan stratégique 2015-2019 vise à stimuler une croissance et un développement inclusifs et durables et à promouvoir une bonne gouvernance.
La Banque de développement des Caraïbes (BDC) compte 28 pays membres, 19 emprunteurs régionaux, 4 non-emprunteurs régionaux et 5 non-emprunteurs hors-région. Le Canada et le Royaume-Uni sont les premiers actionnaires non régionaux de la BDC, chacun détenant 9,31 % du total des parts. Le Canada est le principal contributeur du Fonds de développement spécial, le plus grand regroupement de fonds assortis de conditions libérales de la Banque, avec une contribution de 70,34 millions de dollars pour la période 2017-2020.
La BDC fournit entre 150 et 300 millions de dollars américains par an sous forme de prêts, de prêts concessionnels et de subventions aux pays membres emprunteurs, aux institutions financières et aux organismes du secteur privé, et offre aussi de l’assistance technique. En 2018, la Banque a approuvé des projets pour un montant total de 352 millions de dollars américains.
Par le biais du Fonds de développement spécial, la BDC accorde des subventions considérables à Haïti (45 millions de dollars américains pour 2017-2020). Le Fonds accorde également un soutien au Fonds d’affectation spéciale pour les besoins fondamentaux, qui vise à améliorer l’accès des collectivités pauvres aux services publics de base et à réduire leur vulnérabilité socioéconomique. Le Canada a promis 70,34 millions de dollars pour la reconstitution de ce fonds (2017-2020), ce qui représente une part de charges estimée à 23,7 %. Le Canada s’est également engagé à verser 20 millions de dollars au Fonds communautaire de réduction des risques de catastrophe (2012-2020) et 5 millions de dollars au secteur énergétique des Caraïbes (2016-2020).
Pour en savoir plus sur la participation du Canada à la BDC, visitez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Créée en 1991, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement favorise la transition vers des économies démocratiques et axées sur le marché et encourage les initiatives privées et entrepreneuriales en Europe centrale, en Europe de l’Est, en Asie centrale et dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen. Dans l’accomplissement de cette mission, la BERD œuvre dans des pays qui mettent en pratique les principes fondamentaux de la démocratie multipartite, du pluralisme et de l’économie de marché. En insistant sur les activités du secteur privé, la BERD démontre que les ressources publiques peuvent être exploitées efficacement pour contribuer à des économies de marché prospères et pour catalyser des capitaux privés à des fins de développement. La BERD reconnaît qu’une économie de marché prospère se doit d’être inclusive, compétitive, respectueuse de l’environnement, intégrée, résiliente et bien gouvernée. En 2018, la BERD a maintenu un niveau de financement élevé, investissant 9,5 milliards d’euros dans 395 projets répartis dans 37 économies.
Le Canada est membre fondateur et huitième actionnaire en importance de la BERD, ses parts représentant 3,4 % du capital de l’institution. Cela équivaut à 1,02 milliard d’euros du capital total de la BERD. De ce montant, 213 millions d’euros constituent du capital d’apport, tandis que le reste constitue du capital exigible. Le ministre des Finances est le gouverneur du Canada auprès de la BERD. Au sein du conseil d’administration, le Canada dirige un groupe de pays qui comprend la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.
Le Volume 2 fournit des détails sur la participation du Canada aux activités de la BERD. Pour en savoir plus sur la participation du Canada à la BERD, visitez le site Web du ministère des Finances Canada.
Banque interaméricaine de développement
Le Groupe de la Banque interaméricaine de développement (en anglais) comprend la BID, son organe du secteur public, BID Invest, responsable des activités du secteur privé, et BID Lab, un fonds en fiducie qui sert de laboratoire d’innovation au groupe et teste des méthodes novatrices qui favorisent une croissance inclusive. La BID est la plus ancienne banque régionale de développement et la plus grande source de financement multilatéral pour le développement de l’Amérique latine et des Caraïbes. Elle compte 48 pays membres, dont 26 emprunteurs régionaux. Le Canada est membre de la BID depuis 1972 et possède 4 % de ses parts.
Le Groupe de la BID cherche à réduire la pauvreté et les inégalités et à stimuler une croissance économique durable dans la région. Il a également deux objectifs stratégiques : répondre aux besoins des pays les moins avancés et des petits pays, et favoriser le développement par le biais du secteur privé.
Le Groupe de la BID fournit des prêts, des subventions, des placements en actions, des garanties et une assistance technique. Le montant total des prêts pour 2018 s’élevait à environ 17 milliards de dollars américains. De ce montant, 13,5 milliards ont été versés à des projets du secteur public. La BID accorde du financement concessionnel à quelques pays, dont la Bolivie, le Guyana, le Honduras et le Nicaragua. Par le biais de son mécanisme de subventions, la BID fournit également 2 milliards de dollars américains sur une période de 10 à 15 ans à Haïti pour la reconstruction après le tremblement de terre de 2010. L’accès à ce mécanisme de subvention a récemment été étendu aux pays et aux communautés qui sont touchés par des flux migratoires intrarégionaux importants et soudains, comme les personnes venant du Venezuela.
Pour en savoir plus sur la participation de Canada au Groupe de la BID, visitez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Innovation et efficacité
Le Canada prend d’importantes mesures afin d’améliorer l’efficacité de son aide internationale et s’efforce de la rendre plus flexible et cohérente. Par exemple, le Canada investit dans l’innovation et la recherche et améliore la communication de ses dépenses, activités et résultats. De plus, le Canada cherche à mieux comprendre son impact et à miser sur une formulation de politiques et une programmation fondées sur des données probantes. Il s’efforce également d’utiliser son aide internationale pour mobiliser des ressources de développement durable supplémentaires par l’entremise de nouveaux partenariats avec divers intervenants et en collaborant avec des capitaux privés.
La Politique d’aide internationale féministe du Canada fait de l’innovation une priorité et reconnaît la nécessité d’encourager les innovateurs du Canada et des pays en développement et de leur donner les moyens de contribuer à résoudre les problèmes les plus tenaces et complexes au monde. Dans le but d’accélérer l’innovation inclusive et locale, et son impact sur le développement, le Canada favorise le changement, notamment à l’aide de ses partenaires, afin de soutenir les solutions pionnières qui remettent en question les modèles, approches et partenariats traditionnels. Cela permet d’améliorer les solutions et modèles actuels ou d’en créer de nouveaux qui peuvent donner de meilleurs résultats.
En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a rédigé des notes d’orientation sur l’innovation et l’efficacité pour appuyer la mise en œuvre de la Politique d’aide internationale féministe. Ces notes décrivent l’approche féministe du Canada et son approche en matière de financement novateur, d’innovation du développement et de transparence.
Atteindre l’efficacité par une approche féministe
Adopter une approche féministe améliore l’efficacité et les répercussions de l’aide internationale. En effet, cette approche oriente les efforts du Canada vers les causes premières de la pauvreté et permet d’atteindre les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés, tout en assurant leur participation. Cela représente un changement considérable dans ce que le Canada fait actuellement, ainsi que dans ses façons de faire. La note d’orientation sur l’approche féministe décrit comment Affaires mondiales Canada adapte ses processus et ses méthodes de travail internes pour défendre de façon cohérente et significative l’égalité des genres et les droits de la personne. La note d’orientation cerne les points d’entrée et les occasions de changements au sein du Ministère lui-même et s’articule autour de cinq voies pour passer de la parole aux actes :
- Données probantes et analyse, pour que les efforts d’aide internationale soient fondés sur de telles données et contribuent à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté, à éliminer la discrimination systémique et à transformer les systèmes de pouvoir inégaux.
- Mobilisation et participation, pour soutenir et amplifier la voix, les occasions d’agir et le pouvoir des femmes et des filles, dans toute leur diversité, ainsi que des autres personnes victimes de discrimination ou de marginalisation.
- Responsabilisation et transparence, pour que nos outils de gestion, de suivi, d’évaluation et d’apprentissage favorisent la réalisation, la quête et la communication de changements véritables.
- Défense des intérêts et communications, pour répondre aux expériences vécues et aux dimensions transversales de l’inégalité et de la discrimination, et y faire écho en créant un espace pour la mobilisation, le dialogue et la constitution d’alliances.
- Renforcement des capacités, afin que le personnel et les partenaires soient bien équipés pour mettre en œuvre les objectifs de la Politique.
Soutien aux initiatives de secours en Indonésie

Pays : Indonésie © Agence spatiale canadienne
L’Agence spatiale canadienne est un membre actif de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures », une initiative internationale visant à mettre les technologies spatiales à la disposition des équipes d’intervention d’urgence lorsqu’une catastrophe majeure se produit. Les agences spatiales qui en sont membres coopèrent sur une base volontaire et consacrent des ressources pour appuyer la Charte. La Charte mobilise des partenaires internationaux pour aider à pallier les effets des catastrophes sur la vie humaine et sur les biens. En mars 2019, des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines et ont entraîné des glissements de terrain en Papouasie, la province la plus à l’est d’Indonésie. Au moins 89 personnes ont perdu la vie et 150 ont été blessées. Quelque 6 800 personnes ont été évacuées dans des abris temporaires. Le Canada a fourni des images RADARSAT-2 pour soutenir les efforts de secours dans la province.
En 2018-2019, le Canada a réalisé des progrès dans la mise en œuvre de son approche féministe parallèlement aux cinq voies énumérées ci-dessus :
- Affaires mondiales Canada a mis sur pied des politiques fondées sur les données probantes pour chaque champ d’action de la Politique d’aide internationale féministe, présentant des instructions concrètes pour parvenir à un changement véritable en matière d’égalité des genres et des droits de la personne dans tous ses efforts d’aide internationale, dans le but de mener des interventions mieux éclairées et plus percutantes.
- Le Canada a cherché des occasions de mobiliser et d’amplifier les voix de ceux et celles qui sont touchés par les problèmes discutés lors de sa présidence du G7, notamment en invitant six jeunes femmes représentant différentes régions du monde à participer à une partie des délibérations des ministres du Développement portant sur les adolescentes. Les ministres ont ensuite déclaré que cette séance avait été parmi les plus évocatrices, enrichissantes et influentes auxquelles ils avaient participé. Les discussions ont mené à une déclaration préconisant des approches intégrées et dirigées par des jeunes filles, afin de remédier aux obstacles qui limitent l’autonomie des adolescentes et de valoriser leur voix et leur leadership.
- Lors du Sommet mondial sur le handicap de 2018 (en anglais) à Londres, au Royaume-Uni, le Canada a annoncé une série d’engagements ambitieux qui avaient pour but de garantir l’inclusion et la participation significatives de personnes ayant une incapacité dans les efforts de développement international. Cela veut notamment dire tenir compte des intérêts et priorités des filles ayant une incapacité lors de la mise sur pied et de l’exécution des engagements pris par le Canada lors du G7 à Charlevoix par rapport à l’éducation des jeunes filles.
- Le Canada joue un rôle de premier plan dans la revendication des droits des personnes marginalisées et vulnérables. Par exemple, en août 2018, à Vancouver, le Canada a organisé la Conférence de la Coalition pour les droits égaux, un influent forum consacré à la protection des droits des personnes LGBTQ2+. Afin de promouvoir les droits de la personne et d’améliorer les résultats socioéconomiques de personnes LGBTQ2+ dans les pays en développement, le Canada a annoncé un financement de 30 millions de dollars sur cinq ans, puis de 10 millions par an par la suite.
- Affaires mondiales Canada a amélioré la formation et l’orientation de son personnel et de ses partenaires locaux en matière d’égalité des genres, afin qu’ils adoptent une approche féministe. Le Ministère a aussi offert, en partenariat avec le Centre international d’éducation aux droits humains Equitas, un atelier pilote sur la mise en œuvre d’une approche fondée sur les droits de la personne lors des initiatives d’aide internationale. Cet atelier a été intégré au parcours d’apprentissage du personnel d’Affaires mondiales Canada.
Favoriser l’innovation dans le travail de développement
L’accent mis par le Canada sur l’innovation dans l’aide internationale s’appuie sur le consensus de la communauté d’aide internationale en ce qui concerne la nécessité de penser et de travailler différemment pour susciter les changements nécessaires en vue d’atteindre les ODD d’ici 2030. Cela signifie encourager l’expérimentation et en mesurer les répercussions en soumettant les anciennes et nouvelles initiatives à des tests rigoureux, et en élargissant la portée des solutions innovantes prometteuses pour qu’un changement systémique se produise.
En juin 2018, lors de la présidence canadienne du G7, les ministres du G7 responsables du développement international et de l’aide humanitaire ont approuvé les Principes de Whistler pour accélérer l’innovation au service du développement. Ces principes soulignent l’importance des partenariats novateurs, de la collaboration et de la cocréation au sein des secteurs public, privé et de la société civile et auprès d’acteurs locaux, dont les femmes et les filles.
Affaires mondiales Canada définit l’innovation dans l’aide internationale comme un processus, une mentalité et un moyen de créer de nouvelles solutions, ou des solutions améliorées à l’échelle locale, pour obtenir de meilleurs résultats et une plus grande incidence. Le Canada appuie les solutions innovantes telles que les modèles opérationnels, pratiques stratégiques, partenariats, technologies, approches, comportements, introspections, mécanismes de financement et moyens de livrer des produits et services aux personnes les plus pauvres, marginalisées et vulnérables, y compris les femmes et les filles. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a ciblé 270 initiatives qui ont mis de l’avant les aspects novateurs de leur conception ou de leur mise en œuvre. Pour encourager et guider les efforts du Canada, Affaires mondiales Canada a rédigé une note d’orientation sur l’approche du Canada relative à l’innovation dans l’aide internationale. La note offre une orientation et des outils pratiques en vue d’intégrer l’innovation, d’en assurer le suivi et d’en mesurer l’incidence. Affaires mondiales Canada encourage également l’apprentissage dans chacun de ses volets (développement, politique, commerce, sécurité et aide humanitaire) et collabore avec des partenaires canadiens et internationaux pour trouver et intégrer des solutions innovantes inclusives.
De plus, le Ministère poursuit sa collaboration avec l’Alliance pour l’innovation dans le développement international (en anglais), qui offre un espace unique pour apprendre et mettre en commun de bonnes pratiques, des tendances et des solutions innovantes auprès des grands intervenants mondiaux. Intégrer des approches innovantes au programme d’aide internationale nécessite des partenariats pour veiller à ce que les femmes et les filles soient impliquées dans le processus d’innovation, autant à titre de bénéficiaires qu’à titre d’innovatrices de plein droit. Afin de soutenir l’égalité des genres et le lien avec l’innovation, Affaires mondiales Canada a présidé le Groupe de travail sur l’égalité des genres dans le cadre de son engagement avec l’Alliance. En octobre 2018, l’Alliance a également publié un nouvel outil (en anglais) pour aider à intégrer des considérations liées au genre dans les initiatives d’innovation. L’outil fournit des conseils pratiques pour appliquer une optique de genre à l’innovation et cibler les obstacles liés au genre.
Affaires mondiales Canada aide également le Manitoba Council for International Cooperation à mettre en œuvre un nouveau projet de Fonds pour l’innovation et la transformation dans le cadre de l’initiative Petites et moyennes organisations (PMO) canadiennes pour l’impact et l’innovation. Ce fonds de cinq ans appuie les PMO canadiennes par l’entremise de financement et de renforcement des capacités pour mettre à l’essai des solutions novatrices et favoriser l’apprentissage de l’innovation. Le Fonds offre de 150 000 $ à 250 000 $ aux candidats retenus sur une période de 6 à 15 mois afin qu’ils mettent à l’essai des solutions novatrices à des problèmes de développement urgents, ce qui permettra la progression de l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, en partenariat avec les organisations locales. Le projet financera de 50 à 70 initiatives à partir de 2019-2020.
Innovations numériques pour améliorer l’apprentissage

Pays : Liban © International Education Association
L’intégration des communautés déplacées par l’entremise de l’éducation a le potentiel de renforcer leur pouvoir et d’encourager une coexistence pacifique avec les communautés d’accueil. En 2018-2019, le Centre de recherches pour le développement international du Canada a appuyé un projet au Liban qui mettait l’accent sur l’apprentissage économique numérique afin de développer des compétences en matière de littératie numérique, de programmation, de pensée critique, de collaboration et de communication chez les étudiants libanais et les étudiants réfugiés syriens par l’entremise de la trousse d’innovations numériques Coder-Maker. Le projet a également renforcé les capacités des enseignants locaux pour que l’approche soit intégrée au système d’éducation général.
Les « lunettes intelligentes » sont un exemple de projet conçu et réalisé par des étudiants libanais et syriens à l’aide de la trousse d’innovations numériques Coder-Maker. Les lunettes, munies d’un petit ordinateur, d’un capteur à ultrasons et d’un moteur qui vibre à différentes intensités pour indiquer les obstacles, ont aidé un camarade malvoyant à se déplacer en toute indépendance. Les notes et le comportement de l’équipe se sont améliorés et les étudiants sont motivés à s’attaquer à la prochaine étape de développement pour parfaire les lunettes.
La programmation a créé des rapprochements entre les étudiants libanais et syriens en réunissant les deux cultures de façon créative et productive. Après un premier succès dans 41 écoles et auprès de 4 170 étudiants, le gouvernement du Liban a exprimé le désir d’élargir la portée du projet à l’échelle du pays.
Le Canada participe à de nombreuses communautés de partage de connaissances pour mettre en commun des pratiques exemplaires et favoriser une culture d’innovation en partenariat avec les OSC canadiennes. Par exemple, Affaires mondiales Canada favorise une communauté de pratique sur l’innovation dans le développement multilatéral auprès d’OSC canadiennes. Les rencontres ont permis d’en arriver à une compréhension commune de l’innovation dans le développement et ont stimulé de nouvelles façons d’aborder le développement. Cette plateforme a également augmenté les collaborations avec le secteur privé canadien en vue d’une mise en commun des pratiques exemplaires et de la diffusion des apprentissages collectifs pour de meilleurs résultats de développement. Cela a permis de favoriser de nouveaux partenariats inclusifs par l’entremise de consultations et d’échanges.
Considérant l’importance des données pour stimuler la prise de décisions fondées sur des données probantes, le Canada a déposé une proposition en juin 2018 visant à mettre en place un marqueur de l’innovation dans le système de notification des pays créanciers du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Cela permettrait aux membres du CAD et aux intervenants internationaux de déterminer et de repérer les composantes novatrices dans les projets d’aide internationale de façon méthodique. Le Canada, l’Australie, la Belgique, la France et la Slovénie mettent présentement à l’essai le marqueur de l’innovation et sa méthodologie.
Changer l’attitude des hommes face aux décisions relatives à la santé sexuelle

Pays : Sénégal © Plan International
L’attitude des hommes face à l’utilisation par les femmes de services de santé sexuelle est primordiale pour améliorer les résultats en matière de santé et la prise de décision sur la santé des femmes. En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a appuyé le projet Amélioration des résultats en santé des femmes et des enfants, mis en œuvre en collaboration avec Plan international Canada. Le projet est une initiative sexotransformatrice visant à augmenter la qualité et la disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive afin de réduire la mortalité maternelle et infantile dans les communautés marginalisées et vulnérables au Bangladesh, au Ghana, en Haïti, au Nigéria et au Sénégal. Cela a été accompli grâce à une formation innovante sur l’implication des hommes et des pères, en partenariat avec Promundo-U.S.
Au Nigéria, grâce au projet, les connaissances qu’ont les hommes des messages clés en matière d’égalité des genres ont connu une amélioration, passant de 60 % en 2016 à 73 % en 2018. Parmi ces connaissances, celles qui touchent les services de planification familiale et l’importance d’épauler sa conjointe pendant et après la grossesse. Dans ce pays, les mères ont perçu une amélioration du soutien de leur conjoint, notamment pour ce qui a trait à la planification familiale et à l’allaitement. En outre, la proportion de femmes nigérianes qui ont déclaré avoir décidé en commun de la gestion des finances du ménage, de l’utilisation de méthodes de planification familiale et de l’achat ou la vente de biens du ménage, a considérablement augmenté. Par exemple, chez les mères adolescentes, la prise de décision commune avec le père de leur enfant est passée de 20 % à 37 % pour les recherches de services médicaux.
Pour avoir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Améliorer les résultats liés à la santé des femmes et des enfants.
Financement novateur pour le développement durable
L’important déficit de financement de 2 500 milliards de dollars pour atteindre les ODD oblige la communauté internationale à mobiliser toutes les sources de financement disponibles pour assurer le développement durable, notamment l’aide publique au développement (APD) et les capitaux privés. Bien que l’APD reste une source importante de financement, le Canada et ses pays partenaires reconnaissent qu’elle est insuffisante pour atteindre les ODD. Le Canada appuie fermement le Programme d’action d’Addis-Abeba 2015 visant à mobiliser toutes les sources de financement possibles pour le développement.
Reconnaissant le rôle important que l’APD peut jouer comme catalyseur des investissements privés, le Canada élargit ses outils de financement du développement afin de soutenir plus efficacement l’engagement du secteur privé et la mobilisation des ressources. Par exemple, en 2018-2019, Affaires mondiales Canada a travaillé sur la concrétisation du Programme d’innovation en aide internationale et du Programme de prêts souverains de 1,59 milliard de dollars sur cinq ans, annoncés dans le budget de 2018. Ces programmes offrent plus de latitude au gouvernement, lui permettant de conclure des accords de financement et des partenariats innovants en appui aux ODD. Grâce à la nouvelle Loi sur l’aide financière internationale, Affaires mondiales Canada a obtenu un nouveau pouvoir législatif lui permettant d’octroyer des prêts souverains, des garanties et des placements en actions. Elle appuie les nouveaux et anciens pouvoirs relatifs aux contributions à remboursement conditionnel ou non conditionnel, qui peuvent être utilisés pour mobiliser les capitaux privés; par exemple, faire en sorte que les investissements privés absorbent les risques qui découragent l’investissement dans les marchés des pays en développement.
En 2018-2019, Affaires mondiales Canada a formulé une orientation stratégique visant à faire avancer l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles grâce au financement novateur. La note d’orientation vise à perturber les relations de pouvoir dans le domaine des finances et à influencer le déploiement de capitaux dans les investissements qui font la promotion de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes, en plus de veiller à ce qu’il y ait un niveau beaucoup plus élevé d’aspirations et d’engagements envers un avenir plus équitable pour les femmes et les filles.
En 2018-2019, le Canada a continué à faire preuve de leadership international en approfondissant la question du financement novateur, en sollicitant l’engagement du secteur privé dans le développement durable et en nouant de nouveaux partenariats innovants. Par exemple, lors de sa présidence du G7, le Canada a fait valoir que le profil mondial de financement novateur était un outil indispensable pour atteindre les ODD. Les dirigeants du G7 ont émis la Déclaration d’engagement de Charlevoix pour un financement novateur du développement. Cette déclaration appuie les approches de financement novateur et favorise une plus grande transparence et une meilleure reddition de compte sur les opérations de financement mixte, ce qui comprend la mise en œuvre des principes de financement mixte du CAD-OCDE (en anglais), adoptés en 2017. Le financement mixte est une utilisation stratégique des fonds publics de développement en vue de mobiliser des fonds supplémentaires, tel que le financement commercial, dans le but d’atteindre un développement durable. La Déclaration s’engage également à favoriser de nouveaux partenariats, à aider les pays en développement vulnérables et à utiliser le capital comme outil de renforcement du pouvoir économique des femmes. D’autres initiatives clés à l’appui des fonds de développement ont été lancées lors de la présidence canadienne du G7, notamment l’initiative de leadership des investisseurs institutionnels du G7 et le Défi 2X : financement pour les femmes. Voir la section « Le G7 et le G20 » dans le chapitre sur les partenaires du Canada pour en savoir plus sur ces initiatives.
En octobre 2018, sous la direction du gouvernement indonésien et de l’OCDE, la feuille de route Tri Hita Karana (THK) pour le financement mixte (en anglais) a été publiée. Cette feuille de route, qui a obtenu un soutien vaste et inclusif, met en place un système de valeurs et un mandat communs pour les partenaires internationaux en ce qui concerne les mesures à prendre pour atteindre les ODD. La feuille de route est fondée sur les principes de financement mixte du CAD-OCDE et vise à accroître la transparence, les preuves et les données, les pratiques exemplaires, et les recommandations stratégiques en matière de transactions de financement mixte. Le Canada a joué un rôle actif dans le perfectionnement de la feuille de route en préconisant une plus grande attention sur les femmes et les filles à titre de bénéficiaires d’initiatives de financement mixte. L’OCDE a convoqué cinq groupes de travail THK pour qu’ils adoptent une orientation et formulent des recommandations en matière de financement mixte. Affaires mondiales Canada copréside le groupe de travail THK sur la transparence, aux côtés du secrétariat de l’OCDE et de la Société financière internationale, dans le but de sensibiliser les partenaires au fait que le partage de l’information peut étendre la pratique du financement mixte et en faire un outil de développement significatif.
Aux Nations Unies, on a demandé au représentant permanent du Canada de coanimer le 7e Dialogue de haut niveau sur le financement du développement (en anglais) en septembre 2019. Cette rencontre, qui a eu lieu lors de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, a rassemblé des dirigeants mondiaux pour qu’ils discutent des enjeux et des prochaines étapes en vue de combler l’écart dans le financement du développement.
Contributions de FinDev Canada au développement durable
FinDev Canada, l’IFD du Canada, cherche à combler le fossé entre l’aide traditionnelle au développement et l’aide financière commerciale. En harmonie avec la Politique d’aide internationale féministe, FinDev Canada appuie le développement durable, l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes, ainsi que les mesures d’atténuation et d’adaptation en matière de changements climatiques, en offrant des services financiers au secteur privé dans les pays en développement.
En 2018-2019, FinDev Canada a noué des partenariats avec d’autres IFD et IFI, dont la Netherlands Development Finance Company, le CDC Group (l’IFD du Royaume-Uni), Finnfund (une IFD en Finlande), l’Association of bilateral European Development Finance Institutions, la Banque interaméricaine de développement et la Banque africaine de développement. Grâce à ces partenariats, FinDev Canada recherche des débouchés d’investissement conjoints et partage des pratiques exemplaires pour atteindre les ODD. FinDev Canada s’engage également envers le Défi 2X, un effort des IFD du G7 à mobiliser collectivement 3 milliards de dollars américains d’ici la fin 2020 pour investir dans les entreprises et les fonds qui contribuent à l’égalité des genres dans les pays en développement.
En décembre 2018, FinDev Canada a annoncé sa deuxième entente, un investissement de 20 millions de dollars américains dans Climate Investissement One (CIO), afin d’appuyer la transition vers des énergies renouvelables dans les pays en développement. CIO est une initiative de financement mixte novatrice qui aide à la dotation accélérée de quelque 1 100 MW d’énergie renouvelable, au profit de 8 millions de personnes, et mobilisant jusqu’à 3 milliards de dollars américains en capitaux privés. En plus d’aider à réduire les émissions de CO2 d’environ 1,2 tonne métrique, les projets appuyés par CIO devraient créer plus de 25 000 emplois temporaires et permanents.
Expérimentation
L’expérimentation consiste à mettre à l’essai des activités, des projets, des programmes ou des approches en utilisant des méthodes solides et appropriées, et à en comparer les effets et les incidences. Elle aide le Canada et ses partenaires à apprendre ce qui fonctionne le mieux, aidant ainsi à éclairer les décisions pour offrir un impact plus significatif. L’expérimentation est utilisée pour tester à la fois les innovations et les initiatives actuelles de développement. Il s’agit de l’un des nombreux instruments dans la boîte à outils de la prise de décisions fondée sur des données probantes.
L’expérimentation éthique et rigoureuse est au cœur des priorités du Canada, qui entend élaborer des politiques fondées sur des données probantes et mettre l’accent sur les résultats et la prestation (voir les Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux – décembre 2016). Affaires mondiales Canada a approuvé une déclaration d’expérimentation en 2018 qui souligne le rôle joué par l’expérimentation pour aider le Ministère à remplir son mandat, à mesurer les incidences de son action et à fournir les meilleurs résultats de leur catégorie aux Canadiens. De plus, la Politique d’aide internationale féministe s’engage à encourager une expérimentation plus vaste dans les initiatives d’aide internationale du Canada.
À cette fin, Affaires mondiales Canada cherche à augmenter la sensibilisation et les connaissances sur l’expérimentation et la disponibilité de conseils d’experts pour la conception et la mise en œuvre d’expérimentations. En 2018-2019, les mesures principales étaient les suivantes : recueillir des données sur les expérimentations planifiées ou en cours, intégrer l’expérimentation aux organismes de gouvernance du Ministère et aux processus décisionnels, poursuivre la création d’une communauté de pratique interne sur l’expérimentation, et accroître l’allocation de ressources humaines et financières à l’expérimentation. L’un des exemples d’expérimentation, un projet de sécurité alimentaire en Afrique de l’Est, appuyé par la Banque canadienne de grains et financé par Affaires mondiales Canada, compare la santé des sols dans les divers champs agricoles. Ce projet jumelle les champs qui utilisent l’agriculture de conservation avec ceux qui utilisent des méthodes existantes, afin de déterminer les retombées de l’agriculture de conservation. Ce genre d’expérimentations aide à générer de meilleures données afin d’améliorer l’efficacité de l’aide internationale du Canada.
Efficacité et efficience de l’aide
Dans la Politique d’aide internationale féministe, le Canada s’engage à améliorer l’efficacité de son aide internationale, notamment l’efficacité de ses partenariats avec la société civile, les organisations multilatérales et internationales, les fondations philanthropiques, les gouvernements de pays en développement à tous les échelons, le secteur privé et les donateurs officiels en émergence.
Dans le cadre de cet engagement, le Canada siège depuis 2017 au comité directeur du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCESD). II s’agit de la seule plateforme internationale qui met exclusivement l’accent sur l’amélioration de la qualité et de l’incidence de la coopération au service du développement.
En 2018-2019, le Canada a contribué à la création d’outils et d’approches pour aider les acteurs du développement à travailler au sein de partenariats transparents, responsables et axés sur les résultats, de plus en plus inclusifs et mettant l’accent sur les pays en développement.
Parmi les réalisations spécifiques au cours de cette période, mentionnons l’approbation d’un quatrième coprésident par le comité directeur du PMCESD, un poste qui alterne entre les membres ne faisant pas partie de la haute direction du PMCESD et ceux actuellement occupés par une OSC. Il s’agit d’une disposition novatrice et inclusive de gouvernance pour une plateforme mondiale. Voici certaines autres réalisations : les principes de Kampala, un effort pionnier mis en œuvre par un groupe d’acteurs du développement visant à réconcilier les points de vue divergents sur la façon de créer des partenariats de coopération du développement dans le secteur privé, et l’approche adaptée du partenariat mondial pour la surveillance de l’efficacité dans des contextes fragiles (en anglais), qui devrait être en mesure de fournir des données susceptibles d’aider les donateurs à être plus efficaces dans les régions fragiles et touchées par des conflits.
En 2018-2019, le Canada a également joué un rôle clé dans deux initiatives du partenariat mondial (IPM), qui sont des communautés de pratique sur l’efficacité placées sous l’égide du PMCESD. Cofondateur de l’IPM sur la coopération triangulaire efficace, le Canada a aidé à redéfinir la « coopération triangulaire » au sein du contexte actuel et a aidé à élaborer les lignes directrices volontaires pour une coopération triangulaire efficace (en anglais). Le Canada copréside également le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, qui aspire à augmenter l’engagement efficace des acteurs du développement dans les régions fragiles et touchées par des conflits.
À l’échelle nationale, au cours de la période visée par ce rapport, le Groupe d’action pour une efficacité accrue a continué de chercher à simplifier et à rationaliser les processus et les mécanismes de collaboration entre Affaires mondiales Canada et ses partenaires pour offrir des programmes d’aide internationale. En 2018-2019, trois équipes des solutions se sont attaquées aux enjeux associés au processus de négociation pour les accords de contribution, les rapports et les projets de faible valeur monétaire. Ces équipes ont présenté 25 recommandations à Affaires mondiales Canada.
Affaires mondiales Canada continue de déployer ses efforts à l’interne pour améliorer l’efficacité de son programme d’aide internationale. En 2018-2019, les domaines prioritaires étaient la gestion du risque, la planification et l’établissement de rapports à l’échelle du programme, ainsi que la simplification des exigences d’accord de contribution. Le Ministère a également poursuivi ses efforts de simplification des processus et d’essai des nouvelles approches. Par exemple, une nouvelle approche en deux étapes a été mise sur pied pour les propositions spontanées de projets d’aide internationale afin de réduire considérablement les efforts et les dépenses de nos partenaires pour présenter une demande de financement initiale. De plus, Affaires mondiales Canada a lancé une Politique sur le partage des coûts pour les accords de subventions et de contributions non remboursables, qui a fourni plus de précisions au personnel, aux demandeurs et aux bénéficiaires. Un Guide de rapport des résultats en matière d’aide internationale pour les partenaires a été publié en 2018 et un webinaire connexe a été offert à 86 membres du personnel de 65 organisations afin d’aider nos partenaires de mise en œuvre à assurer une gestion axée sur les résultats. Ce nouveau Guide est le résultat direct du travail des partenaires de mise en œuvre et du Groupe de travail sur l’amélioration de l’efficacité d’Affaires mondiales Canada, qui ont proposé plusieurs recommandations visant à améliorer les rapports sur les projets. En outre, plus de 325 membres du personnel d’Affaires mondiales Canada travaillant à l’administration centrale et sur le terrain ont participé aux séances de formation sur la gestion axée sur les résultats.
Services d’accès au marché canadien et de renforcement des capacités

Pays : Canada © TFO Canada
Affaires mondiales Canada appuie, en collaboration avec le CRDI, l’initiative Artisan Hub de TFO Canada, qui contribue au renforcement du pouvoir économique des femmes en faisant la promotion de petites ou moyennes entreprises (PME) dirigées et détenues par des femmes de pays en développement dans le secteur spécialisé du textile et des vêtements.
En 2018-2019, l’initiative a aidé les PME de huit pays sous-développés (Bangladesh, Cambodge, Éthiopie, Haïti, Lesotho, Madagascar, Népal et Ouganda) à augmenter leurs exportations et à surmonter les obstacles associés au développement de l’exportation vers le Canada. Après des missions sur place et des expositions dans trois villes canadiennes, 30 entreprises offrant des produits artisanaux de décor intérieur, des vêtements et des accessoires ont été sélectionnées pour participer au salon Apparel Textile Sourcing Canada à Toronto en août 2018. Ce projet novateur a aidé les artisans à dépasser les marchés locaux en nouant des liens avec de nouveaux marchés canadiens pour leurs produits. Les entrepreneures constituaient la majorité des bénéficiaires du projet. En effet, 19 entreprises (63 %) étaient détenues ou gérées par des femmes. Après le salon, les entreprises de six pays ont déclaré 225 898 $ en nouvelles recettes d’exportation et neuf entreprises ont créé près de 250 nouveaux emplois, principalement pour des femmes.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce projet, veuillez consulter le profil connexe dans la Banque de projets d’Affaires mondiales Canada : Services d'accès au marché canadien et de renforcement des capacités.
Transparence de l’aide
La transparence de l’aide est indispensable à l’efficacité du développement. Elle facilite la coordination de l’aide à l’échelle nationale et permet aux citoyens de demander des comptes à leur gouvernement. Affaires mondiales Canada mène les efforts pour renforcer la transparence du Canada dans son aide internationale et permettre aux citoyens de voir comment le financement du Canada est mise en œuvre par l’entremise de ses partenaires pour offrir des activités de développement et des résultats sur le terrain.
Comme le mentionnent les budgets de 2018 et de 2019, le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer la production de ses rapports sur l’aide internationale et à veiller à ce que les renseignements sur les activités d’aide internationale du Canada soient accessibles et transparents. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement a mis de l’avant des réformes au financement et à la structure hiérarchique de l’EAI détaillées dans le chapitre sur l’enveloppe de l’aide internationale. Le présent rapport fait également partie des efforts du gouvernement du Canada pour améliorer la déclaration des résultats en fusionnant les rapports sur l’aide internationale au Parlement en un seul et même document.
Affaires mondiales Canada a travaillé avec des intervenants en 2018-2019 pour mettre en place une approche qui améliorera la transparence de l’aide internationale du Canada et favorisera l’adoption mondiale des principes de gouvernement ouvert. La note d’orientation qui en découle, L’approche du Canada en matière de transparence et de dialogue ouvert dans l’aide internationale canadienne, encourage le personnel et les partenaires à accroître la transparence de leurs activités et à entamer le dialogue par rapport à l’aide internationale au Canada et sur la scène mondiale. Cette approche s’appuie sur les efforts du Canada, à titre de coprésident de l’Open Government Partnership en 2018-2019, pour bâtir des démocraties plus responsables et réactives.
Le Canada est également un membre actif de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), une initiative multilatérale internationale qui favorise la publication et l’utilisation de données ouvertes et normalisées en matière de financement du développement. La Banque de projets d’Affaires mondiales Canada donne accès aux données de l’IITA du Ministère, mises à jour quotidiennement. Le site Web du gouvernement fournit également des rapports et statistiques interactifs consultables concernant l’aide internationale du Canada. Une transparence et une accessibilité accrues des renseignements d’Affaires mondiales Canada ont permis au Ministère d’obtenir une cote de 79,6 % dans l’Indice de transparence de l’aide de 2018 (en anglais), comparativement à une cote de 76,3 % en 2016.
Organisations fédérales qui fournissent de l’aide internationale
Affaires mondiales Canada
Affaires mondiales Canada est le principal ministère responsable de la coordination de la politique et des programmes d’aide internationale du Canada. Il assure notamment la prestation de programmes liés au développement, à l’aide humanitaire, à la paix et à la sécurité. Le Ministère collabore avec des pays partenaires, des organisations multilatérales, des partenaires de la société civile du Canada, des acteurs du secteur privé et d’autres institutions fédérales à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et d’initiatives pour le développement innovants et durables dans le monde entier. En conformité avec la Politique d’aide internationale féministe, Affaires mondiales Canada défend l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans tous les efforts d’aide internationale du Canada visant à éradiquer la pauvreté et à bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Il s’agit notamment de fournir une aide internationale inclusive et fondée sur les droits de la personne par le biais des six champs d’action interdépendants de la Politique. Affaires mondiales Canada montre également la voie en matière d’amélioration de l’efficacité de l’aide internationale du Canada grâce à une aide plus intégrée et adaptée, à des investissements dans l’innovation et la recherche, à de meilleurs rapports sur les résultats, à la conclusion de partenariats plus efficaces et à une attention accordée aux régions du monde où le Canada peut faire la plus grande différence, en particulier pour les femmes et les filles.
Ministère des Finances Canada
Le ministère des Finances Canada octroie des fonds au Groupe de la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à d’autres banques régionales de développement en vue d’obtenir des résultats dans tous les domaines de priorité liés à l’aide internationale du Canada. Le Ministère appuie également l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale pour réduire les paiements au titre du service de la dette dans les pays en développement, soutient la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures afin de combler les importantes lacunes d’infrastructure en Asie, et gère l’adhésion du Canada à la BERD afin de catalyser les capitaux privés pour le développement.
Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada joue un rôle fondamental dans le respect des obligations internationales et de la tradition humanitaire du Canada en mobilisant des intervenants nationaux et internationaux en vue de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des programmes opportuns, efficients et efficaces pour la protection des réfugiés. Le Canada est également reconnu à travers le monde pour son modèle d’immigration et sa promotion d’une gestion ordonnée des voies de migration.
Centre de recherches pour le développement international
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer le niveau de vie et les moyens de subsistance dans les pays en développement. En réunissant les bons partenaires autour d’occasions à saisir qui sont porteuses d’impacts, le CRDI aide à forger les chefs de file d’aujourd’hui et de demain et à susciter des changements au profit de ceux qui en ont le plus besoin. La recherche financée par le CRDI permet de recueillir des données probantes, d’éclairer les décisions et de créer des possibilités qui favorisent un monde équitable, diversifié et prospère.
Environnement et Changement climatique Canada
Environnement et Changement climatique Canada aide les pays en développement dans leur transition vers des économies à faibles émissions de carbone, durables et résilientes devant les changements climatiques. L’aide du Ministère est fournie par le biais d’un certain nombre d’initiatives multilatérales, régionales et bilatérales. Le Ministère oriente son action sur des domaines comme la réduction des risques de catastrophes, les technologies propres, la gestion des déchets et le renforcement des capacités. Il s’efforce particulièrement d’aider les populations les plus pauvres et les plus vulnérables à atténuer les conséquences du changement climatique et à s’y adapter.
Gendarmerie royale du Canada
La Gendarmerie royale du Canada déploie des policiers canadiens dans le cadre d’opérations de paix partout dans le monde. Les policiers canadiens aident à l’acquisition et au renforcement des capacités d’application de la loi dans les pays fragiles et touchés par des conflits. En renforçant la capacité de la police étrangère de faire régner la paix et l’ordre, la police canadienne contribue à la paix et à la sécurité mondiales en créant des environnements locaux plus sécuritaires et plus stables.
Agence du revenu du Canada
L’Agence du revenu du Canada est un membre important des organisations fiscales internationales. L’Agence échange des connaissances et des services de soutien technique avec les administrations fiscales des pays en développement, sur le plan bilatéral et multilatéral. Les efforts de l’Agence aident les pays en développement à accroître leur capacité à mieux mobiliser les ressources nationales et à atteindre l’autonomie et le développement durable. Grâce à de meilleures connaissances et à une plus grande expertise, les pays en développement peuvent participer à part entière aux discussions fiscales mondiales et contribuer à la lutte contre la fraude fiscale et l’évitement fiscal par l’adoption de normes fiscales internationales.
Ministère de la Défense nationale
Le ministère de la Défense nationale apporte un certain soutien aux pays développement, notamment par des activités de renforcement des capacités et par ses interventions en cas de crise humanitaire. Le Ministère est notamment intervenu au lendemain du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé l’Indonésie en septembre 2018. En outre, les Forces armées canadiennes ont maintenu l’opération PROTEUS, qui soutient les efforts visant à mettre en place les conditions de sécurité nécessaires à une solution binationale éventuelle entre Israël et l’Autorité palestinienne. Les forces déployées fournissent de la formation et de l’assistance technique en vue de développer la capacité de l’Autorité palestinienne à fournir un environnement sûr et sécurisé à ses citoyens et de promouvoir la paix dans la région.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada est le représentant officiel du Canada à l’Union internationale des télécommunications (UIT), la principale agence des Nations Unies pour les télécommunications et les technologies de l’information et des communications. Par l’intermédiaire du secteur du développement de l’UIT, l’organisation donne l’occasion, en particulier aux pays en développement, d’acquérir les connaissances et les compétences spécialisées nécessaires pour utiliser les technologies de télécommunication et en profiter. Elle est une source importante d’information, d’éducation et de formation dans ce domaine.
Emploi et Développement social Canada
Le Programme du travail d’EDSC, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, veille à ce que le Canada joue un rôle de premier plan au sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans la conception et le maintien de normes internationales du travail saines. Le Programme fournit également de l’assistance technique en appui aux projets de renforcement des capacités lancés par des organisations internationales et des ONG régionales au nom du Canada. L’assistance technique est réservée aux projets qui soutiennent la modernisation des politiques et de l’administration du travail en vue de renforcer la gouvernance démocratique, de promouvoir les droits des travailleurs et d’améliorer la qualité des conditions de travail dans les pays partenaires. Le Programme du travail collabore étroitement avec l’OIT pour mettre en œuvre un grand nombre de ces initiatives d’assistance technique.
Parcs Canada
Parcs Canada joue un rôle important en soutenant les efforts mondiaux de conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. L’Agence participe à diverses activités internationales axées sur la mise en commun d’informations et de pratiques exemplaires liées à la gestion des aires protégées et des lieux patrimoniaux. En plus de collaborer avec divers partenaires internationaux, l’Agence fournit un apport financier annuel à plusieurs organisations internationales en guise de soutien multilatéral à la conservation du patrimoine naturel et culturel, notamment à l’Union internationale pour la conservation de la nature, au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels et au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui administre le Fonds du patrimoine mondial.
Agence de la santé publique du Canada
L’Agence de la santé publique du Canada représente le Canada auprès de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). L’OPS agit à titre de bureau régional de l’OMS et d’organisme sanitaire spécialisé du Système interaméricain. Au chapitre de l’aide internationale, l’Agence apporte un soutien financier et non financier aux initiatives de l’OPS et de l’OMS visant à renforcer les systèmes de santé des pays en développement.
Postes Canada
Postes Canada verse la cotisation du Canada à l’Union postale universelle (UPU). Une partie de cette contribution va aux programmes de coopération technique de l’UPU, qui visent à combler le fossé dans le domaine postal entre les pays industrialisés et les pays en développement. Cette aide comprend, entre autres, le soutien à la mise en œuvre de plans de réforme postale basés sur des analyses nationales, la formation et l’achat d’équipements.
Agence canadienne d’inspection des aliments
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) fournit une assistance technique aux pays en développement et émergents pour les aider à améliorer les processus sanitaires et phytosanitaires dans leurs systèmes alimentaires. Cette assistance les aide dans leurs efforts pour adhérer à l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. Elle vise principalement à faciliter l’élaboration et la mise en œuvre par ces pays de mesures et de processus fondés sur la science et les risques. Cet engagement démontre le leadership mondial de l’ACIA en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de protection des végétaux et contribue à garantir la salubrité des aliments que consomme la population canadienne.
Statistique Canada
Les initiatives de développement de Statistique Canada mettent l’accent sur le soutien au renforcement des capacités des institutions publiques responsables, plus précisément les bureaux statistiques nationaux et d’autres acteurs clés des systèmes statistiques nationaux des pays en développement. L’organisation apporte une expertise statistique canadienne à la conception d’indicateurs mondiaux sains pour mesurer les objectifs de développement durable et pour aider les autres pays à mesurer leurs progrès vers ces objectifs, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la croissance économique durable et de l’environnement.
Agence spatiale canadienne
L’Agence spatiale canadienne est membre de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures ». Cette charte est une collaboration à l’échelle mondiale entre les agences spatiales afin de fournir un accès uniforme aux données de télédétection spatiales à l’appui des opérations de secours en cas de catastrophe, sans frais pour l’utilisateur final. Le Canada y contribue en offrant des données précieuses recueillies par RADARSAT-2 et fournit partout dans le monde un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de catastrophe. Ces services contribuent à atténuer l’impact des catastrophes naturelles ou technologiques sur les vies humaines et les biens.
Office de la propriété intellectuelle du Canada
La contribution de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada en matière d’aide internationale consiste principalement en la prestation d’assistance technique sur la gestion de la propriété intellectuelle aux pays en développement. En 2018-2019, cette assistance a pris la forme d’un atelier annuel sur les services en matière de propriété intellectuelle offert à 12 cadres responsables de la propriété intellectuelle de pays en développement et de pays parmi les moins avancés.
Musée canadien de la nature
Le Musée canadien de la nature est une institution scientifique et éducative qui aide les Canadiennes et Canadiens, et autres personnes, à établir un lien avec le monde naturel. Les activités d’aide internationale du Musée prennent la forme de sa contribution institutionnelle à titre de membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature. L’Union permet de nouer des partenariats et des réseaux, et facilite la mise en commun des connaissances et le renforcement des capacités en vue de la conservation et de l’utilisation durable des ressources de la planète. Le programme d’activités mondial de l’Union contribue à la conservation de l’habitat, à l’intégrité écologique et à la conservation d’une grande diversité biologique. Ses activités mettent l’accent sur l’engagement des jeunes et l’importance de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes.
Commission de la fonction publique du Canada
La Commission de la fonction publique (CFP) est chargée de promouvoir et de maintenir une fonction publique fédérale non partisane, fondée sur le mérite et représentative. L’aide internationale de la CFP consiste en des rencontres avec des représentants de la fonction publique de pays en développement pour mettre en commun leurs connaissances. Ces séances portent notamment sur le processus de recrutement, l’évaluation du personnel et les fonctions de contrôle et d’audit. Le dialogue avec des homologues d’autres pays favorise le renforcement des capacités dans la fonction publique.
Volume 2 : Engagements du Canada envers les institutions financières internationales
Introduction
Cette section représente le volume 2 du Rapport au Parlement sur l’aide internationale du gouvernement du Canada 2018-2019. Il donne de l’information sur les engagements du Canada envers les institutions financières internationales (IFI), en mettant l’accent sur les engagements et les activités visant le Groupe de la Banque mondiale (section B), le Fonds monétaire international (section C) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (section D) puisqu’ils répondent à diverses exigences en vertu de la Loi de Bretton Woods et de la Loi sur la BERD.
Les IFI fournissent une aide financière et technique aux gouvernements de pays en développement, et dans certains cas aux acteurs du secteur privé, pour favoriser la réduction de la pauvreté et le développement économique à long terme. Ces investissements couvrent un vaste éventail de secteurs : l’éducation, la santé, l’administration publique, les infrastructures, le développement des secteurs financier et privé, l’agriculture et la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Certaines IFI, dont le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale, soutiennent également les pays en développement en offrant des conseils stratégiques, des services de recherche et d’analyse et des activités de développement des capacités.
Le Canada fournit des contributions de base pour soutenir les opérations et les activités des IFI, ainsi que des fonds pour des projets particuliers. Le Canada contribue activement à la formulation des politiques des IFI et en surveille les activités financières grâce à sa participation aux conseils des gouverneurs et aux conseils d’administration, ces derniers étant responsables des décisions quotidiennes. Le Canada participe également aux travaux de divers comités internes et engage un dialogue constructif avec les autres actionnaires.
Pour fixer une orientation stratégique à son engagement auprès des IFI, le Canada adopte des objectifs clés qui s’inspirent de son engagement à l’égard du multilatéralisme, de la politique étrangère et des priorités de développement, ainsi que des principes généraux de bonne gouvernance. Des renseignements supplémentaires sur les priorités du Canada en matière d’engagements sont présentés à la section A.
Section A : Les objectifs d’engagement stratégique du Canada envers les institutions financières internationales
Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux objectifs d’engagement du Canada pour chacune des principales institutions financières internationales (IFI) qu’il appuie. Ces objectifs fournissent une orientation stratégique pour faire progresser les valeurs et les priorités du Canada au sein de ces IFI.
Groupe de la Banque mondiale (GBM)
1. Encourager la mise au point d’instruments financiers et de partenariats inclusifs qui renforcent la capacité du GBM à produire des résultats en matière de développement, notamment en travaillant comme système avec d’autres banques multilatérales de développement (BMD) pour accroître l’incidence du développement
Le Canada continue d’explorer la mise au point d’instruments financiers, les mesures d’optimisation des bilans et la collaboration accrue entre les BMD pour maximiser l’incidence du développement.
Le Canada est un ardent défenseur de la nouvelle approche programmatique à plusieurs phases du GBM, qui offre un moyen agile et souple de relever des défis complexes en matière de développement. En 2018, le Canada a également appuyé la recommandation visant à supprimer la limite d’engagement de l’instrument du programme axé sur les résultats, qui a été introduit pour la première fois à titre expérimental en 2012 pour faciliter la construction de systèmes clients, mettre davantage l’accent sur les résultats et harmoniser les plateformes nationales. Cet instrument financier a permis d’améliorer la qualité, la durabilité et l’accès aux services de base, surtout dans les pays à faible revenu.
Grâce à la reconstitution des fonds de l’Association internationale de développement (IDA) en 2019, le Canada, de concert avec d’autres actionnaires, étudie la mise en place de programmes pour les régions fragiles et l’utilisation d’opérations de politiques de développement régional pour appuyer des réformes stratégiques coordonnées dans l’ensemble des pays.
En collaboration avec d’autres donateurs, le Canada participe également aux efforts de réforme des fonds fiduciaires du GBM. L’objectif est d’orienter le portefeuille de fonds fiduciaires vers des programmes moins nombreux, plus étendus et plus stratégiquement harmonisés, afin d’accroître leur efficacité.
Enfin, le Canada a encouragé le GBM à collaborer avec les BMD pour examiner la méthodologie conjointe des BMD et faire le suivi du financement lié au climat, ce qui permettra la formulation d’une approche plus globale pour obtenir des résultats.
2. Promouvoir l’amélioration de l’efficacité institutionnelle et de la capacité financière du GBM au moyen de réformes continues, de mécanismes de responsabilisation et de structures de gouvernance
Le Canada s’est engagé à prendre des mesures d’efficience et à renforcer la productivité pour assurer la viabilité financière de l’institution. Un important résultat de la politique de l’ensemble de capital a été la formulation d’un cadre de viabilité financière de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui prévoit un plafond annuel durable pour les prêts (niveau de prêt pouvant être maintenu en termes réels sur une période excédant 10 ans) et un tampon d’urgence pour les événements imprévus, ce qui atténuera la probabilité de futures augmentations de capital. En outre, le GBM a respecté son engagement à réaliser des économies de 340 millions de dollars américains dans le cadre de l’examen de ses dépenses. Sur cette base, dans le cadre de l’augmentation de capital de la BIRD et de la Société financière internationale (SFI), la Banque a convenu de réaliser des économies supplémentaires d’ici l’exercice 2029-2030 grâce aux gains d’efficience et à l’économie d’échelle. D’autres mesures d’efficacité et des économies d’échelle sont envisagées et intégrées dans les budgets annuels de certains domaines, comme l’approvisionnement, les ressources humaines, l’immobilier et le portefeuille de projets.
3. Veiller à ce que les priorités du Canada soient reflétées dans les politiques et les programmes du GBM, en mettant l’accent sur l’égalité des genres, les changements climatiques, la transparence et la viabilité de la dette, et la rentabilité du capital
Le Canada continue de jouer un rôle de chef de file pour renforcer la Stratégie du GBM en matière d’égalité des genres en intensifiant les travaux sur l’autonomisation économique, l’emploi, les actifs et le capital humain des femmes, ainsi que sur la prévention et la lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre. L’augmentation de capital de la BIRD et de la SFI comprend de nombreux engagements visant à aider à combler les écarts entre les genres, notamment en ce qui concerne l’emploi, les actifs et l’entrepreneuriat. Le Canada appuie également les changements apportés aux politiques de financement de l’IDA afin d’inciter les pays emprunteurs à adopter de meilleures politiques de gestion et de déclaration de la dette. Le Canada a également demandé à l’IDA de trouver des moyens d’accroître l’efficacité de ses opérations de développement dans les petits États insulaires fragiles, qui sont de plus en plus vulnérables aux conflits, à la violence et aux changements climatiques.
Fonds monétaire international (FMI)
1. Amélioration continue et influence accrue de la surveillance et des conseils stratégiques du FMI, avec un accent particulier sur l’ouverture, la croissance inclusive et le renforcement du pouvoir des femmes
Le Canada appuie cet objectif en mettant l’accent sur la coopération internationale fondée sur des principes et en déterminant rapidement les vulnérabilités macroéconomiques qui posent des risques pour une croissance équitable et productrice d’emplois et une réduction de la pauvreté. Au cours de la période de rapport, les travaux de recherche du FMI ont éclairé la manière dont le libre-échange peut stimuler les revenus et le niveau de vie en favorisant les possibilités de croissance et de développement inclusifs. Le FMI s’est également efforcé de réorienter ses conseils de politique nationale et internationale afin de mieux évaluer l’incidence des inégalités sur les résultats de la croissance, d’examiner les effets distributifs des politiques et des réformes, et d’atténuer les conséquences néfastes possibles de l’intégration économique mondiale sur les groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes.
Les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dépendent de la capacité d’un pays à augmenter ses dépenses dans des domaines comme l’éducation, la santé et les infrastructures, tout en veillant à ce que sa dette extérieure reste viable. Pour les gouvernements, les paiements d’une dette publique élevée peuvent empêcher les dépenses dans des domaines importants qui favorisent une croissance plus durable et plus équitable. À ce titre, le FMI s’est engagé à travailler pour déterminer et réduire la vulnérabilité liée à la dette afin de s’assurer que les pays conservent la capacité d’investir dans l’avenir de leurs citoyens. Au cours de la période du présent rapport, le FMI a introduit le cadre de viabilité de la dette des pays à faible revenu qui tient compte des défis importants auxquels ces pays sont confrontés.
2. Octroi de ressources suffisantes permettant au FMI d’utiliser des mécanismes de prêt efficaces et appropriés afin de faciliter l’ajustement macroéconomique et la stabilité financière, s’il y a lieu
Le Canada joue un rôle important en préconisant l’utilisation efficace des ressources du FMI, en particulier celles qui visent à améliorer la résilience des membres les plus pauvres et les plus vulnérables. Depuis la fin des années 1980, le Canada et quelques autres pays donateurs ont engagé des ressources importantes pour appuyer les travaux du FMI dans les pays membres les plus pauvres au moyen de son guichet de prêts concessionnels : le Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FFRPC).
Pendant la période du présent rapport, le FMI a consenti des prêts concessionnels de plus de 428 millions de dollars canadiens aux membres à faible revenu dans le cadre de programmes appuyés par le FFRPC et a achevé d’importants travaux concernant l’examen des mécanismes pour les pays à faible revenu en 2018-2019. L’examen s’inscrit dans l’évaluation continue et complète de la pertinence de la trousse d’outils du FMI pour répondre aux besoins changeants de ses membres en matière de développement économique et de stabilité financière.
Les pays à faible revenu qui ne veulent pas d’un prêt du FMI peuvent accéder à l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE) pour obtenir le soutien du FMI. Cet outil flexible est un complément précieux aux mécanismes de prêt du FMI dans le cadre du FFRPC. L’ISPE fournit aux donateurs, aux banques multilatérales de développement et aux marchés un signal clair indiquant que le FMI appuie la force des politiques d’un membre donné. En 2018-2019, le FMI a achevé les examens de l’ISPE pour le Sénégal et le Rwanda.
3. Prestation d’une assistance technique et renforcement de la capacité de grande qualité qui sont adéquatement intégrés aux secteurs d’activités fondamentaux du FMI
Le Canada a longtemps été un partenaire clé dans les efforts du FMI pour fournir une assistance technique efficace et renforcer la capacité en mettant récemment l’accent sur l’importance du renforcement du pouvoir économique des femmes et sur la nécessité de renforcer la capacité de mise en œuvre des bénéficiaires. En 2018-2019, le Canada s’est engagé à verser 20 millions de dollars de fonds supplémentaires pour accroître l’assistance technique et renforcer la capacité des petits États insulaires en développement et des pays à faible revenu, et a joué un rôle important dans la promotion de la conception d’instruments de dettes résilients pour les petits États insulaires en développement qui sont vulnérables aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.
Pendant la période couverte par le présent rapport, l’assistance technique et le renforcement de la capacité ont représenté près d’un tiers des dépenses administratives du FMI. Les pays en développement à faible revenu, en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne, ont reçu les conseils et la formation les plus techniques. En 2018, l’examen de la Stratégie de développement de la capacité du FMI a principalement porté sur l’amélioration de l’intégration de l’assistance technique et du renforcement de la capacité au moyen de conseils et de prêts en vue de mieux adapter les stratégies aux capacités institutionnelles et aux besoins spécifiques de chaque pays.
Un fonds fiduciaire récemment lancé, Data for Decisions (D4D), fournit de l’aide principalement aux pays membres à revenu faible ou moyen inférieur pour renforcer les systèmes statistiques nationaux, afin d’améliorer les politiques fondées sur des données factuelles et d’appuyer la réalisation des ODD. Pendant la période du présent rapport, le sondage sur l’accès financier administré par D4D a commencé à intégrer la collecte de données ventilées selon les genres afin de mieux comprendre les incidences de l’inclusion financière sur les femmes et les filles.
4. Évolution continue des voix et de la représentation des membres pour mieux tenir compte de l’importance croissante des économies émergentes dynamiques et de la modernisation des structures de gouvernance d’entreprise et de responsabilisation du FMI
À mesure que le paysage économique et financier mondial évolue, il en va de même pour le FMI. En 2018-2019, le Canada a promu le réalignement des quotes-parts (proportionnelles au pouvoir de vote d’un pays au FMI) afin d’accroître la voix des États membres sous-représentés. Le Canada demeure déterminé à faire en sorte que le FMI devienne une institution plus représentative à l’échelle mondiale.
Le Canada a également joué un rôle constructif dans les efforts continus du FMI pour renforcer ses structures de gouvernance et de responsabilisation internes, et ce, en favorisant une institution plus représentative, inclusive et efficace qui assure une représentation égale des femmes dans tous ses rôles et postes de direction.
Banque africaine de développement (BAfD)
En tant que l’un des principaux actionnaires de la BAfD, le Canada a participé activement à des discussions avec elle sur les moyens d’améliorer ses efforts en matière d’égalité des genres, d’action climatique et de soutien aux pays fragiles. De plus, le Canada cherche à s’assurer que la BAfD gère les répercussions sur le développement. Comme pour toutes les IFI, le Canada se concentre également sur la viabilité de la dette des pays emprunteurs.
En 2018-2019, le Canada s’est engagé avec d’autres pays partageant les mêmes idées sur des thèmes précis afin de faire progresser les priorités canadiennes suivantes : l’intégration de l’égalité des genres, l’efficacité opérationnelle et les résultats, et l’appui aux États fragiles. La BAfD a entamé le processus de négociation d’une augmentation générale du capital ainsi que de la reconstitution du Fonds africain de développement, qui s’est achevée en 2019-2020. Le Canada a également accueilli le président de la BAfD pour une visite officielle à Montréal et à Ottawa en septembre 2018, où il a rencontré le ministre des Finances, la ministre du Développement international et le ministre de la Diversification du commerce international.
Banque asiatique de développement (BAD)
En 2018-2019, le Canada a continué à encourager la BAD à en faire davantage dans certains domaines, comme l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir économique des femmes, le changement climatique, les petits États insulaires en développement et les États fragiles, le développement du secteur privé, et le financement mixte. La stratégie 2030 de la Banque, publiée en juillet 2018, est étroitement harmonisée avec les objectifs de défense des intérêts et les priorités de la Politique d’aide internationale féministe du Canada. Par exemple, la BAD s’est engagée à ce qu’au moins 75 % de ses opérations soient axées sur l’égalité des genres d’ici 2030, à ce qu’au moins 75 % de ses opérations appuient l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation, et à ce que le nombre d’opérations liées au secteur privé atteigne un tiers des opérations de la Banque d’ici 2024.
Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII)
Les objectifs du Canada à la BAII, une organisation en émergence, diffèrent de ceux aux autres BMD. En 2018-2019, le Canada a eu pour principaux objectifs de se joindre à la BAII et de contribuer à la mise en place d’une banque solide et moderne, en tirant parti des forces des BMD et du secteur privé. En outre, le Canada a accordé une attention particulière à la façon dont la BAII peut contribuer à faire progresser la croissance inclusive, particulièrement l’égalité des genres, et à mobiliser des capitaux privés. Le Canada a contribué avec succès à façonner et à influencer l’orientation de la BAII.
La BAII s’est engagée à adopter un modèle opérationnel allégé. Par exemple, elle s’est éloignée d’éléments plus onéreux, comme des sièges permanents. La BAII a réalisé des progrès importants en matière de gouvernance institutionnelle, notamment en mettant en œuvre sa politique d’information publique, qui définit la manière dont le public accède à l’information de la BAII, et un mécanisme de traitement des plaintes des personnes affectées par les projets financés. De telles politiques donnent une assise solide aux BMD pour investir à long terme de façon transparente afin de promouvoir l’inclusion et d’attirer des investisseurs privés. Grâce à ses discussions avec la BAII, et en s’appuyant sur son expertise en matière de gouvernance, le Canada a contribué au façonnement des deux politiques.
En 2018, la BAII a renforcé l’élan donné par ses stratégies de secteur principal en introduisant de nouvelles stratégies, notamment en matière de villes durables et de transports. Le Canada a influencé l’orientation de ces stratégies en soulignant l’importance de la croissance inclusive, de l’égalité des genres et de la mobilisation de capitaux du secteur privé.
Le Canada est d’avis que, compte tenu des relations qu’elles entretiennent avec le secteur privé, les BMD ont naturellement l’occasion d’attirer des capitaux privés. Ce faisant, les BMD aident non seulement à puiser dans de nouvelles sources de capitaux, en particulier auprès d’investisseurs institutionnels, mais également à développer les marchés des capitaux. Pour une organisation émergente, la BAII a fait des progrès considérables dans la mobilisation de capitaux privés, notamment dans le cadre du projet AIIB ESG Enhanced Credit Managed Portfolio (en anglais). Le Canada continue de recommander à la BAII de poursuivre ses efforts par l’entremise de son siège au conseil d’administration.
À l’avenir, le Canada continuera de travailler sur ces questions, tout en mettant la BAII au défi de s’attaquer à d’autres questions stratégiques transversales, comme la viabilité de la dette et la résilience climatique.
Banque de développement des Caraïbes (BDC)
En 2018-2019, le Canada a continué de collaborer étroitement avec la BDC pour veiller à ce que toutes ses stratégies, politiques et opérations tiennent compte de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles, de la réduction de la pauvreté, et de l’accélération de ses travaux relatifs à l’adaptation au changement climatique. Étant donné le rôle prépondérant joué par la BDC dans la région des Caraïbes et le fait qu’elle est l’une des institutions régionales parmi les plus fortes, les résultats obtenus dans le cadre des programmes d’aide internationale du Canada dans la région dépendront beaucoup de la capacité de la BDC à appuyer le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
L’évaluation récente de la stratégie en faveur de l’égalité des genres par la Banque indique des progrès dans l’intégration de la perspective de genre. La Banque a récemment formulé une nouvelle stratégie en faveur de l’égalité des genres et l’a intégrée en tant que thème transversal dans les récents documents de planification stratégique pour la période 2020-2024. Pour ce qui est de l’efficacité de l’organisation, le Fonds de développement spécial a obtenu de meilleurs résultats en 2018, avec un taux plus élevé de rapports d’achèvement de projets et un délai moyen plus court entre l’approbation des prêts et le premier décaissement.
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
1. Promouvoir des opérations qui font progresser l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et établir une solide base de données probantes à l’appui des mesures en faveur de l’égalité des genres, en s’appuyant sur la Stratégie pour la promotion de l’égalité des genres et la Stratégie d’inclusion économique de la BERD
Solidement appuyée par le Canada, la BERD renforce sa capacité institutionnelle à intégrer les considérations liées à l’égalité des genres dans ses opérations. La Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa Stratégie de 2016-2020 pour la promotion de l’égalité des genres, qui intègre les objectifs en matière d’égalité des genres dans ses opérations, et préconise l’accès des femmes au soutien pour le financement et les entreprises, aux possibilités d’emploi et de perfectionnement des compétences, et enfin, aux services. La BERD tient également compte des genres dans les diagnostics, les stratégies de pays et les stratégies sectorielles.
2. Collaborer de plus en plus avec d’autres BMD en tant que système pour élaborer des approches novatrices qui ne pourraient autrement être mises en œuvre par la BERD ou d’autres organisations agissant seules, par exemple la mobilisation de capitaux privés et la transition vers l’économie verte
Au cours des dernières années, le Canada a plaidé pour que la BERD et d’autres BMD fonctionnent de plus en plus comme un système, afin d’atteindre des résultats qui dépassent la capacité des institutions agissant seules. Voici quelques exemples importants de collaboration de la BERD avec d’autres BMD en 2018 : 1) plateforme de collaboration des BMD en matière d’infrastructures pour faire progresser le programme du G20 sur les infrastructures en tant que catégorie d’actifs, 2) Multilateral Development Banks’ Harmonized Framework for Additionality in Private Sector Operations [Cadre harmonisé pour l’additionnalité dans les opérations du secteur privé des banques multilatérales de développement], 3) approche commune des BMD en matière de financement du climat, alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris, 4) déclaration commune des BMD les engageant à respecter des normes élevées en matière de prévention du harcèlement sexuel, de l’exploitation et des abus sexuels, et de la violence sexuelle et fondée sur le genre, tant en leur sein que dans le cadre de leurs opérations, et 5) plateforme pour renforcer la collaboration des BMD en matière de migration économique et de déplacement forcé.
3. Accorder en priorité les ressources aux régions qui en ont le plus besoin, en particulier l’Ukraine et les pays de la région du sud et de l’est de la Méditerranée, tout en soulignant l’importance de poursuivre les réformes politiques, économiques et institutionnelles comme condition de l’appui
La BERD est le plus grand investisseur financier international en Ukraine. Solidement soutenue par le Canada, la BERD a continué d’investir massivement en Ukraine, consacrant 543 millions d’euros à des prêts pour de nouveaux projets, ce qui a fait de l’Ukraine le cinquième plus grand bénéficiaire du financement la BERD en 2018. Plus de la moitié des investissements en Ukraine en 2018 ont soutenu des projets verts.
La BERD a fourni une forte réponse à la crise ukrainienne qui a débuté fin 2013. En réponse à l’annexion de la Crimée par la Russie et à son rôle dans la déstabilisation de l’est et du sud de l’Ukraine, le Canada et d’autres actionnaires clés se sont opposés aux prêts de la BERD pour de nouveaux projets russes depuis 2014. En conséquence, la Banque n’a pas investi dans de nouveaux projets en Russie depuis près de cinq ans. Toutefois, elle continue de maintenir ses investissements au besoin.
De plus, le Canada a été un ardent défenseur du renforcement des investissements dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée (SEMED). Les investissements de la Banque dans la région ont atteint près de 2 milliards d’euros en 2018. En 2018, la BERD a commencé ses opérations au Liban, en Cisjordanie et à Gaza. Les investissements en Égypte ont également atteint un niveau record, soit 1,15 milliard d’euros, faisant de l’Égypte le plus grand bénéficiaire des investissements de la BERD en 2018. La BERD a fourni un appui solide aux petites entreprises et a investi massivement dans des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. La Banque a continué de fournir un appui aux pays qui ont été gravement touchés par la crise des réfugiés syriens, comme la Jordanie, le Liban et la Turquie. Le Canada a également été un ardent défenseur d’une voix accrue pour la région du SEMED au sein de la BERD. En 2018, l’assemblée annuelle de la BERD s’est tenue pour la première fois dans la région du SEMED, en Jordanie.
Banque interaméricaine de développement (BID)
En 2018-2019, le Canada a continué de collaborer avec le Groupe de la BID (qui comprend la BID, son organe du secteur public, BID Invest, responsable des activités du secteur privé, et BID Lab, un fonds en fiducie qui sert de laboratoire d’innovation et teste des méthodes novatrices favorisant une croissance inclusive) pour : 1) promouvoir la pleine intégration des considérations relatives à l’égalité des genres et à la diversité dans ses stratégies, politiques et opérations; 2) poursuivre les progrès à l’égard de l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets; et 3) améliorer sa gestion axée sur les résultats.
Avec l’appui d’autres actionnaires, le Canada a réussi à obtenir du Groupe de la BID un engagement pour accélérer les progrès en matière d’égalité des genres et de diversité dans la mise à jour de sa stratégie institutionnelle pour 2020-2023.
Conformément à son engagement de 2015 de doubler le volume de son financement total lié au climat d’ici à 2030, le Groupe de la BID a augmenté son financement total lié au climat à 27 % de ses opérations en 2018, contre 16 % en 2015. Outre un dialogue sur les politiques, le Canada discute avec la BID de lutte contre les changements climatiques au moyen de programmes conjoints, notamment le Fonds canadien pour le climat destiné au secteur privé dans les Amériques (C2F), qui appuie des projets du secteur privé dans toute la région pour aider les pays à réduire leur empreinte carbone et à s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques.
Section B : Participation du Canada aux opérations du Groupe de la Banque mondiale
Exigences en matière de rapports
La Loi de Bretton Woods, qui est entrée en vigueur en 1985, régit la participation du Canada auprès des institutions créées en application des Accords de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (SFI) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Les institutions de Bretton Woods sont, pour le Canada, d’importants intermédiaires de prestation de l’aide internationale et de soutien à la stabilité économique et financière mondiale.
En vertu des articles 13 et 14 de la Loi de Bretton Woods, le ministre des Finances doit déposer au Parlement un rapport annuel contenant un résumé général des opérations visées par cette loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, ainsi que les communiqués publiés par le comité directeur de chaque institution. Les sections B et C du présent volume du rapport répondent à ces exigences en matière de rapport.
Pour en savoir plus, consultez la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sur le site du ministère de la Justice Canada : Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.
Gouvernance et représentation
Souscriptions du Canada au capital et actions détenues
Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) est régi par ses pays membres. Chacun d’eux détient des actions d’organismes qui constituent le Groupe. Les pays exercent leur pouvoir décisionnel principalement par l’entremise de leurs représentants au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.
Le Canada est au nombre des 10 plus importants actionnaires du GBM. Depuis la création de la Banque mondiale en 1945, le Canada a souscrit 8,6 milliards de dollars américains au capital de la BIRD, de la Société financière internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI); il a en outre contribué 12,3 milliards à l’IDA (voir le tableau 1).
Cela confère actuellement au Canada de 2,5 % à 3,0 % des voix au sein des différentes institutions de la Banque. À la Banque, le nombre de voix d’un pays est fonction du nombre d’actions qu’il détient. Un petit nombre de voix de base est aussi réparti également entre tous les membres.
| Description | BIRD | IDA | SFI | AMGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 Il s’agit des contributions cumulatives du Canada à l’IDA et des engagements pris dans le cadre de notre engagement au titre de la 18e reconstitution des ressources de l’IDA. Nota : Données tirées des états financiers et des rapports annuels de 2019 du GBM, de la SFI et de l’AMGI. | ||||
| Souscriptions au capital et contributions | 8 499,3 | 12 250,21 | 81,3 | 56,5 |
| Montant versé | 619,5 | 12 250,2 | 81,3 | 10,7 |
| Montant non versé, mais tributaire des besoins futurs en capital | 7 879,8 | – | – | 45,8 |
| Part des souscriptions ou des contributions (%) | 3,04 | 4,57 | 3,17 | 2,95 |
| Part des voix (%) | 2,90 | 2,65 | 3,02 | 2,50 |
Des renseignements sur l’exercice 2018-2019 du GBM (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) sont fournis dans les états financiers de chaque entité (en anglais). Pour en savoir plus sur le rendement du GBM, consultez sa page Web des résultats.
Le Canada au Conseil des gouverneurs
Les pays membres nomment chacun un gouverneur pour les représenter au Conseil des gouverneurs, qui constitue la plus haute instance du GBM. Les gouverneurs sont responsables des grandes décisions institutionnelles comme l’adhésion et la suspension de membres, le relèvement ou la réduction du capital-actions autorisé de la Banque, la détermination de la distribution du revenu net, de même que l’examen des états financiers et des budgets. Le gouverneur du Canada au GBM est le ministre des Finances, l’honorable Bill Morneau, et la gouverneure suppléante du GBM, au cours de la période visée par ce rapport, était Diane Jacovella, sous-ministre du Développement international du Canada.
Le Canada au Conseil d’administration
Les gouverneurs délèguent la gestion courante à 25 administrateurs à temps plein, en poste au siège du GBM, à Washington. Les administrateurs sont nommés pour deux ans. Ils représentent chacun un groupe de pays, lequel peut inclure plus d’un membre. Le Canada détient l’un de ces 25 sièges; il représente un groupe composé de l’Irlande et de 11 pays des Caraïbes. L’administrateur reçoit des conseils de représentants des gouvernements du groupe de pays au sujet des questions abordées par le Conseil d’administration. En 2018-2019, l’administratrice représentant le Canada au GBM était Mme Christine Hogan. Pendant son mandat de trois ans, Mme Hogan a été l’une des rares femmes à siéger au Conseil d’administration. Elle y a attiré avec succès l’attention sur le manque de représentation des femmes, notamment en étant la première présidente du groupe de travail sur la diversité des genres.
Les décisions du Conseil d’administration sont habituellement le fruit d’un consensus. Lors des votes officiels, le nombre relatif de voix de chaque administrateur dépend du nombre d’actions détenues par le groupe de pays qu’il représente. D’autres renseignements sur le bureau de l’administratrice représentant le Canada se trouvent sur le site Web de la Banque mondiale (en anglais).
Pour en savoir plus sur la gouvernance du Conseil d’administration, veuillez consulter la page Web du Conseil des administrateurs du GBM.
Le Canada au Comité du développement
Vu l’ampleur de la participation du Canada au capital-actions, le gouverneur canadien siège également au Comité du développement des conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Ce comité se réunit deux fois par année, soit lors des assemblées du printemps et des assemblées annuelles à l’automne. Le Comité du développement est un forum de niveau ministériel du GBM et du FMI chargé de la recherche de consensus intergouvernementaux sur les questions liées au développement et les ressources financières nécessaires à la promotion du développement économique dans les pays en développement.
En 2018-2019, le gouverneur canadien a déposé deux déclarations du Comité du développement pour le compte du groupe de pays dont fait partie le Canada, le 13 octobre 2018 (en anglais) à Bali, en Indonésie, et le 13 avril 2018 (en anglais) à Washington. Les gouverneurs ont notamment souligné la nécessité d’agir pour contrer les changements climatiques, de s’attaquer à la gestion durable de la dette, de renforcer le pouvoir des femmes et des filles, et de mettre en place des instruments de financement novateurs.
Contributions financières du Canada au Groupe de la Banque mondiale en 2018-2019
Le Canada est un important donateur au GBM. En 2018-2019, il a versé les contributions suivantes déclarées à titre de l’aide au développement officielle du Canada :
Augmentation au capital de la BIRD : 250,4 millions de dollars canadiens en capital versé et 1 273,4 millions de dollars américains en capital exigible
L’augmentation au capital de la BIRD a été officiellement adoptée en octobre 2018. Elle devrait permettre à l’institution d’augmenter considérablement son financement du développement pour appuyer les ODD des Nations Unies et le double objectif du GBM, à savoir mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. L’augmentation du capital comprenait également un important programme de réforme, notamment des objectifs ambitieux visant à améliorer l’appui à l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes, ainsi que des mesures d’efficacité visant à optimiser davantage les ressources du GBM.
Dans le cadre de l’augmentation du capital, le Canada a souscrit 12 101 actions supplémentaires pour un montant de 250,4 millions de dollars canadiens en capital versé et 1 273,4 millions de dollars américains en capital exigibleNote de bas de page 19.
Contribution de l’IDA : 441,6 millions de dollars
L’IDA est l’une des plus importantes sources d’aide pour les 75 pays les plus pauvres du monde, dont 39 en Afrique. Conformément aux priorités du Canada en matière d’aide internationale, les opérations financées par l’IDA portent sur l’éducation primaire, les services de santé de base, l’eau potable et l’assainissement, les garanties environnementales, les améliorations au climat des affaires, l’infrastructure et les réformes institutionnelles. L’IDA offre aux pays des prêts à faible taux d’intérêt, des prêts sans intérêt et des subventions en fonction du niveau de revenu de chaque pays et des résultats obtenus dans la gestion de leur économie et de leurs projets actuels avec l’IDA.
Au cours de la période visée par le rapport, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le Canada a versé 441,6 millions de dollars, conformément au montant convenu à la 18e reconstitution des ressources de l’IDA (IDA-18). Cette contribution appuie les efforts de l’IDA visant à accroître l’efficacité de l’aide, à financer de grands projets régionaux comme des projets d’infrastructure, et à fournir une aide spéciale à des États fragiles comme l’Afghanistan et Haïti, tout en veillant à éviter que l’endettement des pays atteigne un niveau insoutenable.
Allègement de la dette multilatérale par l’intermédiaire de la Banque mondiale : 51,2 millions de dollars
Dans le cadre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), la Banque mondiale, le FMI et le Fonds africain de développement (FAD) ont accepté d’annuler la totalité de la dette admissible des pays pauvres très endettés. Au sommet du G8 tenu en 2005 à Gleneagles, au Royaume-Uni, le Canada et d’autres pays donateurs ont convenu de dédommager intégralement, pour le compte de pays pauvres, la Banque mondiale, le FMI et le FAD pour les dettes qu’ils ont annulées, de façon à ne pas nuire à la capacité de ces institutions de fournir une nouvelle aide financière aux pays à faible revenu. L’engagement total du Canada pour la période de 50 ans de l’IADM se chiffre à 2,5 milliards de dollars répartis en paiements annuels. L’allègement de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’IADM a considérablement réduit le fardeau de la dette dans les pays bénéficiaires. Au cours de la période du présent rapport (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), le Canada a versé 51,2 millions de dollars au GBM aux fins de l’IADM.
Fonds fiduciaires du Groupe de la Banque mondiale : 365,5 millions de dollars
Les fonds fiduciaires du GBM constituent un instrument important de transmission du financement accordé par les donateurs afin de s’attaquer aux grands problèmes stratégiques de développement à l’échelle nationale, régionale ou mondiale. Plus particulièrement, ces fonds mobilisent du financement bancaire pour la réalisation de programmes de développement, en particulier à la suite de catastrophes et de conflits. Ils permettent aussi aux donateurs et aux bailleurs de fonds du secteur privé qui financent des opérations de développement de s’associer à la Banque conformément aux objectifs d’harmonisation. Ils renforcent la capacité de travailler dans des domaines novateurs et permettent à leur personnel de collaborer avec les organisations de la société civile. Les fonds fiduciaires peuvent compter un ou plusieurs donateurs. Le Canada contribue à ces deux types de fonds en privilégiant ceux à donateurs multiples.
La participation du Canada au GBM repose fermement sur :
- la Politique d’aide internationale féministe, qui place le renforcement du pouvoir des femmes et des filles au centre de ses efforts de développement;
- les pays les plus pauvres et ceux en situation de fragilité et de conflits, par l’entremise de l’IDA et du portefeuille de fonds fiduciaires de l’IDA et de la BIRD;
- des biens publics mondiaux tels que la santé, y compris la santé maternelle et infantile, et l’atténuation des changements climatiques, par l’intermédiaire des fonds fiduciaires de la BIRD et de l’IDA et des fonds intermédiaires financiers (FIF);
- le développement du secteur privé, ce dont témoigne le financement des services de conseils et d’investissements de la SFI et les FIF (comme le Mécanisme mondial de financement des infrastructures);
- les opérations effectuées dans les pays, la majorité des accords de fonds fiduciaires de la BIRD et de l’IDA visant un seul pays ou une seule région. Une proportion élevée (85 %) de l’appui des fonds fiduciaires de la BIRD et de l’IDA est consacrée à des projets exécutés par les bénéficiaires.
Affaires mondiales Canada gère la relation du Canada avec le Groupe de la Banque mondiale en matière de fonds fiduciaires. Le tableau 2 répertorie les décaissements d’Affaires mondiales Canada en faveur des fonds fiduciaires en 2018-2019.
| Fonds fiduciaires | Décaissements effectués entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (millions de dollars) |
|---|---|
| 1 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Sources : Affaires mondiales Canada; statistiques du dirigeant principal des finances. | |
| Afrique | |
| Appui aux énergies renouvelables en Afrique – Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (IAER) | 89,0 |
| Renforcement du contrôle régional des maladies (Afrique de l’Ouest) | 5,0 |
| Soutien à la phase II du Programme de soutien agricole de l’Éthiopie | 4,0 |
| Renforcement des services nationaux de soins de santé sexuelle et procréative (Mozambique) | 15,0 |
| Répartition améliorée des bénéfices tirés du secteur extractif (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Kenya) | 3,2 |
| Amériques | |
| Amélioration de l’accès des filles à l’enseignement secondaire (Haïti) | 4,0 |
| Mécanisme mondial de financement concessionnel – Migrants vénézuéliens (Colombie) | 18,0 |
| Asie | |
| Initiative d’évaluation et de financement des risques de catastrophe dans le Pacifique (Pacifique Sud) | 0,6 |
| Programme de ressources naturelles pour le développement (Indonésie) | 2,3 |
| Accélération des investissements public-privé pour le renouvellement de l’infrastructure (Indonésie) | 1,8 |
| Renforcement des systèmes et des services de santé (Bangladesh) | 7,0 |
| Appui au Fonds fiduciaire pour la reconstruction de l’Afghanistan (2017-2020) | 55,0 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
| Mécanisme d’appui au programme de la Jordanie (Moyen-Orient) | 0,2 |
| Mécanisme mondial de financement concessionnel pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Jordanie et Liban) | 5,5 |
| Services municipaux et résilience sociale (Jordanie) | 5,0 |
| Protection sociale et égalité des genres en Irak : Vers l’autonomisation économique des femmes | 1,3 |
| Appui à une feuille de route analytique pour la Syrie et la région (Irak, Jordanie, Liban et Syrie) | 0,6 |
| Mécanisme d’assistance technique pour l’égalité des genres au Machreq (Irak, Liban et Jordanie) | 8,1 |
| Initiatives de portée mondiale et politique stratégique | |
| Appui au Mécanisme de financement mondial – MFM (mondial) | 40,0 |
| Partenariat mondial pour l’éducation – Appui institutionnel (2018-2020) (mondial) | 30,0 |
| Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale – Appui institutionnel (2018) (mondial) | 10,0 |
| MFM : Amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs (Burkina Faso et Côte d’Ivoire) | 10,0 |
| Élimination des obstacles à l’éducation (Afrique) | 50,0 |
| Total1 | 365,5 |
Objectifs et résultats des fonds fiduciaires du Canada au Groupe de la Banque mondiale
Alors que le Canada continue de participer aux opérations du GBM par l’intermédiaire d’accords de fonds fiduciaires, l’efficacité de ces partenariats est évaluée afin de veiller à ce que les résultats voulus au chapitre du développement soient obtenus. Voici les principaux secteurs où des progrès ont été accomplis :
Partenariat mondial pour l’éducation (PME)
Le Canada a versé 30 millions de dollars au PME en 2018-2019, soit le premier décaissement de 150 millions de dollars sur trois ans (2018-2019 à 2020-2021). Lors de la reconstitution des ressources du PME à Dakar, au Sénégal, en février 2018, le Canada a annoncé qu’il verserait 180 millions de dollars, dont 150 millions de dollars en nouveaux fonds. Le Canada se classe au 10e rang parmi les donateurs au PME.
En 2018, les subventions au PME ont aidé quelque 22,2 millions étudiants, dont 20,2 millions au primaire et 2 millions au premier cycle du secondaire. De ce nombre, 16,6 millions se trouvaient dans des États fragiles et touchés par des conflits, dépassant de plus de 45 % l’objectif du PME consistant à soutenir les pays touchés par la fragilité et les conflits. Les filles représentaient près de la moitié de ces étudiants, soit 10,6 millions.
Le Mécanisme de financement mondial (MFM) à l’appui de l’initiative Chaque femme, chaque enfant
En tant que donateur initial du MFM, le Canada a engagé un total de 290 millions de dollars canadiens dans le MFM entre 2015 et 2023. Le MFM a tenu sa première reconstitution en novembre 2018, au cours de laquelle il a collecté 1 milliard de dollars américains de 15 donateurs, dont 10 nouveaux. Lors de la reconstitution, le Canada a annoncé un engagement de 50 millions de dollars canadiens pour l’éducation des filles dans les États fragiles (2018-2023).
Le MFM collabore actuellement avec 27 pays. Dans les 16 pays d’origine, le MFM a mobilisé 3,5 milliards de dollars américains en financements concessionnels de la Banque mondiale, en utilisant 492 millions de dollars américains de subventions du Fonds fiduciaire du MFM.
Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (IAER)
Le Canada, de concert avec d’autres partenaires du G7, appuie les objectifs de l’IAER. Cette plateforme africaine est dirigée par un conseil d’administration constitué de chefs d’État africains.
L’IAER vise à atteindre au moins 10 gigawatts (GW) de capacité de production d’énergie renouvelable nouvelle et supplémentaire d’ici 2020 et à mobiliser le potentiel africain pour générer au moins 300 GW d’ici 2030. En fin de compte, l’Initiative permettra de réduire ou d’éviter la production de 340 000 tonnes métriques de CO2 par an, ce qui profitera à 930 000 personnes grâce à un meilleur accès à l’énergie propre. L’Initiative adoptera une approche de mise en œuvre tenant compte de l’égalité des genres.
La contribution de 150 millions de dollars canadiens du Canada à l’appui de ce plan d’action dirigé par les Africains s’inscrit dans le cadre d’un fonds d’emprunt géré par la SFI du Groupe de la Banque mondiale. Le fonds d’emprunt accélérera les efforts des pays africains pour passer à des formes d’énergie plus efficaces, moins coûteuses et plus propres. Cette contribution devrait permettre d’attirer 350 millions de dollars américains en investissements publics et privés supplémentaires.
Acquisitions de la Banque mondiale au Canada
Le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) collabore étroitement avec les entreprises canadiennes pour rehausser la connaissance et la recherche de possibilités d’approvisionnement multi-sectorielles auprès des IFI. Le SDC a des Bureaux de liaison avec les institutions financières internationales (BLIFI). Le BLIFI de Washington D.C. aide les entreprises à accéder aux possibilités d’approvisionnement du GBM.
| Exercice de la Banque mondiale (1er juillet-30 juin) | Montant |
|---|---|
| Nota : D’après les données du Groupe de la Banque mondiale en date du 31 juillet 2019. | |
| 2007-2008 | 61,4 |
| 2008-2009 | 51,6 |
| 2009-2010 | 80,0 |
| 2010-2011 | 49,8 |
| 2011-2012 | 31,2 |
| 2012-2013 | 177,6 |
| 2013-2014 | 105,5 |
| 2014-2015 | 47,1 |
| 2015-2016 | 27,1 |
| 2016-2017 | 19,6 |
| 2017-2018 | 37,1 |
| 2018-2019 | 53,0 |
| Fournisseur | Secteur | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| Nota : D’après les données du Groupe de la Banque mondiale en date du 31 juillet 2019. | |||
| WNL Development Solutions | Agriculture, pêche et foresterie | Services-conseils | 4 130 478 |
| Acacia Consulting | Agriculture, pêche et foresterie | Services-conseils | 452 005 |
| Dillon Consulting ltée | Agriculture, pêche et foresterie | Services-conseils | 452 005 |
| Turcotte Paul André | Agriculture, pêche et foresterie | Services-conseils | 24 104 |
| Groupement Spatial Dimension (chef de file) et Hi-Tech | Éducation | Services-conseils | 483 550 |
| Geotech ltée | Énergie et industries extractives | Services autres que de consultation | 5 316 687 |
| Hatch Limited | Énergie et industries extractives | Services-conseils | 3 405 911 |
| WSP Canada inc. | Énergie et industries extractives | Services-conseils | 801 264 |
| Artelia | Énergie et industries extractives | Services-conseils | 602 481 |
| Bleakburn Capital L.P. | Santé | Biens | 289 745 |
| Socodevi | Industrie et commerce | Services-conseils | 1 654 070 |
| Jv Sogema Technologies inc. (chef de file) et Cowatersogema Interna | Administration publique | Biens | 6 089 372 |
| Cowater International inc. | Administration publique | Services-conseils | 1 568 595 |
| Setym International | Administration publique | Services-conseils | 622 943 |
| C2d Services | Administration publique | Services-conseils | 199 876 |
| Lea Consulting ltée | Transports | Services-conseils | 1 646 814 |
| Expert-conseil individuel | Transports | Services-conseils | 655 501 |
| Canadian Leader International | Transports | Services-conseils | 576 149 |
| Morrison Hershfield International inc., en association avec AR | Eau, assainissement et gestion des déchets | Services-conseils | 1 100 000 |
| Exp. International Services inc. | Eau, assainissement et gestion des déchets | Services-conseils | 858 647 |
| Jv Aecom Artelia | Non attribué | Services-conseils | 12 027 520 |
| Freebalance inc. | Non attribué | Biens | 6 200 120 |
| Grand Défis Canada | Non attribué | Services autres que de consultation | 2 000 000 |
| Groupement Ceci-Socodevi-Aecom | Non attribué | Services-conseils | 1 129 242 |
| Ciedd/Fokabs/Arbonaut | Non attribué | Services-conseils | 357 497 |
| Expert-conseil individuel | Non attribué | Services-conseils | 189 100 |
| Expert-conseil individuel | Non attribué | Services-conseils | 76 260 |
| Expert-conseil individuel | Non attribué | Services-conseils | 75 460 |
Communiqués du Comité du développement des conseils des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI (conformément à la Loi de Bretton Woods)
Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI 2018 : Communiqué du Comité du développement
Le 13 octobre 2018
1. Le Comité du développement s’est réuni aujourd’hui, 13 octobre, à Bali (Indonésie).
2. La croissance de l’économie mondiale reste vigoureuse, mais inégale et caractérisée, entre autres, par un ralentissement de l’expansion de l’industrie manufacturière et des échanges commerciaux. Le risque d’une détérioration de la croissance mondiale s’est intensifié pour de multiples raisons : incertitude pesant sur les politiques publiques, évolution de la situation géopolitique, resserrement progressif des conditions de financement dans le monde, hausse des niveaux d’endettement et instabilité croissante des taux de change. Nous soulignons le rôle essentiel du commerce international dans la croissance économique, la création d’emplois et le développement durable. Nous appelons les pays membres à mettre en œuvre, avec le soutien du GBM et du FMI, des politiques propices à une croissance économique robuste et solidaire, à la réduction des risques et à la promotion de la compétitivité ainsi qu’au renforcement de la viabilité des finances publiques et de la résilience financière.
3. Nous demeurons préoccupés par l’aggravation des facteurs de vulnérabilité liés à la dette dans certaines économies émergentes et certains pays à faible revenu : elle risque de réduire à néant le fruit d’initiatives d’allègement de la dette mises en œuvre dans le passé. La détérioration des perspectives d’endettement accentue la vulnérabilité de ces pays tandis que s’intensifient les risques économiques à l’échelle mondiale. Cette situation exige de solides cadres de politique publique, des réserves budgétaires et extérieures adéquates ainsi que des pratiques durables et transparentes en matière de prêts. Nous demandons au GBM et au FMI d’aider, en vertu de leurs mandats respectifs, les pays membres à fortifier leur situation budgétaire en améliorant leur capacité de gestion de la dette, en mobilisant davantage de ressources nationales et en développant les marchés financiers locaux. Nous soutenons la démarche pluridimensionnelle adoptée par le GBM et le FMI pour œuvrer avec les emprunteurs et les créanciers à l’amélioration de l’enregistrement, du suivi et de la déclaration en toute transparence des charges du service de la dette publique et privée. Nous encourageons aussi les efforts engagés pour optimiser la coordination des activités des créanciers dans le domaine de la restructuration de la dette en s’inspirant des travaux de forums existants.
4. Nos réunions ont porté en grande partie sur le développement du capital humain, en raison notamment des répercussions du progrès technologique sur l’emploi, le secteur financier et d’autres aspects du développement. De nouveaux emplois, inexistants il y a dix ans, ont fait leur apparition, tandis que des compétences naguère utiles deviennent obsolètes. Nous avons évoqué la nécessité de faire en sorte que tout un chacun dispose des compétences et des capacités nécessaires pour s’adapter aux bouleversements numériques et en tirer profit. Les pressions qui s’exercent sur les systèmes de finances publiques rendent indispensable l’adoption de nouvelles démarches.
5. Nous accueillons avec intérêt le Rapport sur le développement dans le monde 2019 portant sur « l’évolution de la nature du travail » ainsi que la démarche qu’il propose pour aider les responsables de l’action publique à comprendre les défis auxquels ils sont confrontés tant à court terme qu’à plus longue échéance. Le développement du capital humain demande d’importants investissements et l’élaboration de politiques ancrées dans la réalité, qui nécessiteront des stratégies et des méthodes nouvelles et efficaces de mobilisation de recettes, au profit notamment de systèmes de protection sociale, de santé et d’éducation offrant une couverture universelle. Nous invitons instamment le GBM à fournir des conseils et des financements ciblés à ses clients pour les aider à relever ces défis tout en prenant des mesures d’incitation au travail. Afin d’aider les pays à privilégier l’investissement dans le capital humain, nous appelons le GBM et le FMI à leur fournir un soutien et un renforcement des capacités adaptés pour mobiliser davantage de ressources nationales, combattre les flux financiers illicites, lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, encourager les investisseurs et créer des instruments novateurs de financement du développement.
6. Nous approuvons l’attention portée par le GBM à la nécessité d’accroître les investissements – tout en les rendant plus efficaces et plus solidaires – dans l’amélioration des résultats en matière de santé et d’acquisition des connaissances. Nous accueillons favorablement le Projet sur le capital humain et le lancement de l’Indice du capital humain, ainsi que le programme d’appui qui aidera les pays à améliorer leur position au regard de l’indice. Ces initiatives peuvent offrir une plateforme de soutien aux efforts que les clients déploient à long terme en faveur de l’investissement dans les systèmes nationaux et internationaux de santé et d’apprentissage, en les aidant à se préparer à un avenir économique qui sera profondément façonné par les mutations technologiques. Nous appelons le GBM à poursuivre ces travaux, étant entendu qu’il est possible d’en améliorer la méthodologie, y compris grâce à la compilation de données désagrégées et exhaustives sur la santé et l’éducation en coopération avec les organismes multilatéraux compétents.
7. La technologie offre de nouvelles possibilités pour accélérer les progrès vers la réalisation du double objectif consistant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Simultanément, toutefois, elle engendre de nouveaux risques, notamment l’aggravation des inégalités à l’intérieur des pays et entre eux. Il est urgent d’agir pour optimiser les retombées bénéfiques potentielles et atténuer les risques. Nous sommes favorables à l’action que le GBM peut exercer pour aider les pays à se frayer de nouvelles voies d’accès à une croissance durable et inclusive en jetant les bases de l’économie numérique, en stimulant les capacités des individus, des entreprises et des institutions, et en promouvant des solutions technologiques. Nous demandons à la direction du GBM de formuler une démarche pour placer le programme au centre des préoccupations d’ici au printemps 2019 – en tenant compte de la nécessité de travailler de manière stratégique avec les pays clients et les partenaires concernés, notamment le secteur privé et les banques multilatérales de développement.
8. La technologie financière (désignée parfois par l’abréviation « fintech » en anglais) est l’un des principaux axes des activités que le GBM mène plus largement dans le domaine des technologies de rupture. La « fintech » peut contribuer à la promotion d’une croissance durable et solidaire et à la réduction de la pauvreté en renforçant le développement du secteur financier et l’inclusion financière au profit des ménages et des entreprises, mais aussi en améliorant l’efficience du secteur et en avivant la concurrence en son sein. Toutefois, la technologie financière peut aussi mettre en péril la stabilité et l’intégrité financières et poser des risques pour la protection des consommateurs et des investisseurs. Nous apprécions l’élaboration, par le GBM et le FMI, du Programme de technologie financière (ou « Programme Fintech ») de Bali qui regroupe les principales questions demandant à être examinées par les responsables de l’action publique et la communauté internationale. Dans le cadre de leurs mandats respectifs et en collaboration étroite avec d’autres partenaires, les institutions devraient contribuer à exploiter le potentiel de la technologie financière pour développer les marchés de capitaux, promouvoir l’accès responsable aux services financiers, faciliter les paiements transfrontaliers, renforcer les systèmes d’envois de fonds et mieux gérer les risques liés à l’utilisation de cette technologie. Dans ce domaine, il convient d’axer les efforts sur les pays à faible revenu, les petits États et les populations marginalisées, afin notamment de combler le déficit d’accès des femmes et des microentreprises et petites et moyennes entreprises aux financements.
9. Le secteur privé joue un rôle particulièrement important dans la création d’emplois et le bon fonctionnement des économies, en particulier dans les pays admis à bénéficier des ressources de l’IDA ainsi que dans les États fragiles et/ou touchés par un conflit. Nous invitons instamment le GBM à poursuivre les efforts qu’il a engagés pour mettre en application l’initiative « Optimisation des financements au profit du développement » selon la démarche de la « cascade ». L’objectif est que la Banque mondiale, la SFI et l’AMGI travaillent conjointement à l’uniformisation des règles du jeu et à l’adoption de solutions faisant appel au secteur privé pour faciliter la réalisation des objectifs de développement tout en destinant les ressources publiques aux projets que les entreprises privées ne peuvent pas financer. Nous saluons l’activité stratégique menée par la SFI pour créer des marchés, soutenir les investissements pionniers et offrir des possibilités d’activité économique là où elles font le plus défaut. La SFI a la capacité de contribuer à la réussite des investissements grâce à ses services de contrôle préalable, de mobilisation de ressources, de renforcement des capacités et de conseil. Nous félicitons aussi l’AMGI de contribuer à l’augmentation des investissements dans les pays en développement en rendant possible un accès à moindre coût aux financements à long terme. Nous pensons que cette institution jouera un rôle accru dans le cadre de l’optimisation des financements au profit du développement.
10. Nous réitérons notre soutien à l’IDA en notant le rôle essentiel qu’elle joue dans la réalisation du double objectif du GBM et sa contribution à l’accomplissement des ODD. Nous nous réjouissons des progrès considérables accomplis dans la mise en œuvre d’IDA-18, s’agissant notamment des programmes régionaux, de l’aide aux réfugiés, de l’ouverture du nouveau Guichet de promotion du secteur privé et du lancement de la première émission d’obligations de l’IDA. Nous invitons l’IDA à continuer d’innover, de se concentrer sur les résultats sur le plan du développement et de donner la priorité aux thèmes d’IDA-18 : emploi et transformation économique; parité hommes-femmes; climat; situations de fragilité, de conflit et de violence; gouvernance et institutions. Enfin, nous attendons avec intérêt les résultats de l’examen à mi-parcours de l’IDA.
11. Les populations les plus vulnérables sont touchées de façon disproportionnée par les problèmes de fragilité, les pandémies, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Or, elles n’ont souvent pas accès aux infrastructures élémentaires d’accès à la nourriture, à l’énergie et à l’eau. Nous appelons le GBM à continuer, en collaboration avec ses partenaires publics et privés, d’étudier des solutions novatrices, de mettre à profit les nouvelles technologies et d’élargir la coopération Sud-Sud dans le domaine de la gestion des risques de crise. Nous l’encourageons aussi à continuer de prendre systématiquement en compte la problématique de la préparation, la prévention, la réaction et la résilience face aux crises en travaillant au point de jonction entre l’aide humanitaire et l’aide au développement. Le GBM doit aussi fournir à ses clients – en particulier aux pays à faible revenu et aux petits États – des financements et des conseils sur l’action à mener qui leur permettent de recourir davantage aux instruments de financement du risque et de réaliser des infrastructures et des investissements de qualité à l’épreuve du changement climatique et des catastrophes naturelles.
12. Nous remercions les Conseils et la direction du GBM d’avoir communiqué aux Gouverneurs les projets de résolutions relatives aux augmentations de capital de la BIRD et de la SFI. Nous nous réjouissons de l’adoption des résolutions portant sur l’augmentation du capital de la BIRD, première étape essentielle vers une mise en œuvre effective. Nous trouvons encourageante la rapidité du processus d’approbation des résolutions relatives à la SFI et nous saluons les efforts actuellement déployés par les actionnaires pour assurer l’adoption des résolutions en suspens. Nous attendons avec intérêt la présentation aux Réunions de printemps 2019 d’un rapport d’étape sur la mise en œuvre des engagements pris au titre du train de mesures relatives à l’augmentation de capital.
13. Le Comité tient à remercier le Gouvernement indonésien d’avoir accueilli les Assemblées annuelles. Nous exprimons nos profondes condoléances pour les pertes tragiques de vies humaines et les destructions survenues dans les Célèbes centrales et l’île de Lombok. Nous remercions Madame Sri Mulyani Indrawati, ministre indonésienne des Finances, pour les précieuses orientations qu’elle a formulées et pour le rôle prédominant qu’elle a joué comme présidente du Comité au cours des deux dernières années. Nous souhaitons la bienvenue à son successeur, Monsieur Ken Ofori-Atta, ministre ghanéen des Finances.
14. La prochaine réunion du Comité du développement se déroulera le 13 avril 2019 à Washington.
Réunions printanières de 2019 de la Banque mondiale et du FMI : Communiqué du Comité du développement
Le 3 avril 2019
1. Le Comité du développement s’est réuni aujourd’hui, 13 avril, à Washington.
2. Les perspectives mondiales prévoient un ralentissement modéré de l’activité économique, tandis que les risques de ralentissement persistant demeurent. La croissance du commerce mondial s’est affaiblie, les perspectives d’investissement ont fléchi, la vulnérabilité de la dette persiste et l’incertitude politique pèse sur la confiance. Nous réaffirmons le rôle important du commerce international et de l’investissement en tant que moteurs de la croissance, de la productivité, de l’innovation, de la création d’emplois et du développement durable. Nous continuons d’appuyer le GBM et le FMI dans leur approche à multiples volets, avec les emprunteurs et les créanciers, pour améliorer l’enregistrement, le suivi et l’établissement de rapports sur la dette publique et privée, ainsi que les efforts visant à renforcer la coordination des créanciers dans les situations de restructuration de la dette, en s’appuyant sur les forums existants. Nous insistons sur l’importance d’adopter des politiques favorables à la croissance tout en limitant les risques et en protégeant les plus vulnérables. Nous demandons aux deux institutions de collaborer avec les décideurs pour trouver le juste équilibre, compte tenu de la situation des pays, entre l’appui à la demande et la reconstruction de l’espace budgétaire; d’aider les pays à améliorer leur capacité de gestion de la dette, leur viabilité et leur transparence; et de renforcer la mobilisation des ressources intérieures.
3. Il y a un an, nous avons approuvé un train de mesures visant à transformer le capital de la BIRD et de la SFI. Ces mesures et la Vision d’avenir guident l’orientation stratégique du GBM jusqu’en 2030. Nous nous félicitons de la mise à jour du document : la Vision d’avenir et la mise en œuvre des mesures relatives à l’augmentation du capital de la BIRD et de la SFI, et les importantes réformes stratégiques mises en œuvre, notamment : le prix des prêts de la BIRD et la différenciation de la limite pour un emprunteur unique, le cadre pour l’additionnalité de la SFI, le cadre de viabilité financière de la BIRD et la méthode révisée de rémunération du personnel. Nous notons également que l’engagement du GBM dans les pays qui se trouvent au-dessus de la graduation des revenus tirée des discussions est fort, mais sélectif, comme le montrent les directives révisées concernant les cadres de partenariat de pays. Nous encourageons le Groupe de la Banque à continuer de mettre en œuvre et de suivre les mesures d’efficacité convenues. Nous demandons à la direction de continuer à suivre les progrès accomplis par rapport aux engagements pris dans le cadre de l’initiative Vision d’avenir et des mesures relatives à l’augmentation du capital, ainsi que de mettre à jour les gouverneurs dans un an.
4. Nous nous félicitons du travail en cours des actionnaires visant à commencer la documentation de la souscription et le processus de paiement pour l’augmentation du capital de la BIRD lancée le 2 octobre 2018. Nous demandons instamment que toutes les adoptions en suspens des résolutions de la SFI soient obtenues d’ici le 18 septembre 2019.
5. Nous demeurons déterminés à atteindre les deux objectifs suivants : mettre fin à l’extrême pauvreté et stimuler la prospérité commune ainsi que le rôle mondial du GBM et les objectifs énoncés dans le document Vision d’avenir : (i) servir tous les clients; (ii) donner la priorité au programme mondial de biens publics; (iii) créer des marchés; et (iv) améliorer continuellement le modèle commercial et opérationnel. Une mise en œuvre efficace nécessitera un partenariat solide avec les pays, avec les clients de la BIRD et de l’IDA, en mettant l’accent sur des résultats mesurables en matière de développement. Le programme d’augmentation et de réforme du capital renforcera le leadership du GBM dans les domaines clés de la préparation, de la prévention et de la gestion des crises; les situations de fragilité, de conflit et de violence (FCV); les changements climatiques; l’égalité des genres; les connaissances et les pouvoirs; et l’intégration régionale.
6. Le fonds de la Banque pour les pays les plus pauvres, l’IDA, est essentiel pour atteindre les objectifs du GBM et les ODD. Nous nous félicitons de la mise en œuvre énergique du plan stratégique et financier ambitieux et novateur d’IDA-18 et nous appuyons les ajustements récemment proposés, en particulier la réaffectation des crédits entre les guichets de l’IDA. Nous demandons au Groupe de la Banque de mettre davantage l’accent sur l’emploi et la transformation économique dans les pays de l’IDA, l’un des thèmes spéciaux de l’IDA-19. Nous soutenons également les autres thèmes spéciaux – gouvernance et institutions, genre, changement climatique et FCV – ainsi que les secteurs transversaux de la dette, du handicap, du capital humain et de la technologie. Nous observons l’augmentation des niveaux d’endettement dans les pays de l’IDA et encourageons les mesures visant à accroître la viabilité de leur dette. Nous attendons avec intérêt les résultats de la prochaine réunion des délégués à l’IDA et leurs conseils sur les orientations stratégiques et la feuille de route de l’IDA-19.
7. Nous nous félicitons de l’intégration de l’approche des technologies perturbatrices et transformatrices dans le document du GBM et des efforts déployés par ce dernier pour rendre ces technologies abordables et accessibles aux pays en développement. Nous encourageons le GBM à créer des possibilités pour les pauvres et à atténuer les risques associés à la technologie. Nous demandons au Groupe de la Banque de continuer à travailler avec les pays ainsi qu’avec les partenaires des secteurs privé et public pour intégrer ce programme dans tous les secteurs. Nous nous félicitons tout particulièrement des travaux du GBM sur la compétitivité, l’innovation et la protection des consommateurs par le soutien d’une réglementation souple. Nous demandons également au GBM et au FMI de poursuivre leurs travaux sur les questions liées à la technologie financière, en s’appuyant sur l’élan créé par le programme d’action de Bali sur les technologies financières.
8. Les investissements dans le capital humain qui produisent de meilleurs résultats en matière d’apprentissage et de santé sont essentiels à la productivité et au bien-être économique. Nous nous félicitons du bon début du projet de capital humain et du fait que près de 60 pays y ont adhéré jusqu’à présent. Nous demandons que l’on continue de mettre au point des données ventilées, de perfectionner les indicateurs de l’indice du capital humain et que l’on mette l’accent sur les réformes politiques qui donnent des résultats tangibles. Nous attendons avec intérêt une mise à jour du Projet pour le capital humain en octobre 2019.
9. Le secteur privé joue un rôle clé dans la fourniture de solutions durables aux défis liés au développement, à la création de marchés, à la mobilisation des investissements et à la création d’emplois. Nous encourageons le GBM à favoriser des environnements commerciaux favorables, à mobiliser des capitaux et à mettre en œuvre la démarche de la cascade afin de maximiser le financement pour le développement. Nous appuyons la stratégie 3,0 de l’IFC visant à catalyser les investissements du secteur privé. Nous reconnaissons les efforts de la SFI et de l’AMGI pour accroître les investissements dans les pays de l’IDA et dans les situations fragiles, et nous appuyons l’utilisation du guichet du secteur privé de l’IDA pour atteindre les plus vulnérables, en reconnaissant que de tels projets comportent des risques plus élevés. Nous demandons à la Banque mondiale, à la SFI et à l’AMGI d’innover et de travailler ensemble à mobiliser des solutions et des ressources du secteur privé, à tirer parti des réformes sectorielles et à atténuer les risques d’investissement.
10. Les situations de FCV sont à l’origine de souffrances humaines, de vulnérabilité et de déplacements de population, ainsi que de stress économique – tous des défis qui entravent la mise en œuvre du Programme de 2030. En outre, les crises économiques, les catastrophes naturelles et les pandémies peuvent mettre à l’épreuve la résilience des pays et menacer les avancées du développement. Le renforcement des capacités institutionnelles, le développement de la résilience face aux catastrophes et l’encouragement du partage des connaissances et de la coopération Sud-Sud sont également des priorités essentielles, en particulier pour les petits États. Nous appuyons le renforcement de la mobilisation des ressources nationales, la lutte contre les flux financiers illicites et la corruption, ainsi que l’investissement dans des infrastructures de qualité et l’amélioration de la sécurité énergétique afin d’améliorer la réponse aux crises. Nous réitérons l’importance de mettre en œuvre le Plan d’action sur le changement climatique du GBM. Nous attendons avec intérêt l’élaboration d’une stratégie pour les situations de FCV.
11. À mesure que le GBM intensifie ses travaux dans des scénarios à haut risque, où les capacités institutionnelles sont souvent faibles, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de protection et de responsabilisation environnementale et sociale solides, et nous appuyons l’engagement continu du GBM dans ces domaines. Nous reconnaissons le rôle important que jouent le Panel d’inspection de la Banque mondiale et le conseiller-médiateur de la SFI et de l’AMGI pour ce qui est de la responsabilisation, des leçons apprises et de l’atténuation des risques de manière efficace et efficiente.
12. Nous exhortons le GBM à continuer de travailler en étroite collaboration avec des partenaires publics et privés, y compris les institutions financières internationales et l’Organisation des Nations Unies (ONU), sur les défis de développement les plus pressants. Nous notons que les chefs d’État se réuniront en septembre pour le sommet de l’ONU sur le climat, la couverture santé universelle, les ODD, le financement du développement et les petits États insulaires en développement. Nous soulignons également qu’il importe de poursuivre la collaboration entre le GBM et le FMI dans l’exécution de leurs mandats respectifs, ainsi que la possibilité pour les banques multilatérales de développement de travailler en tant que système pour améliorer leur réponse aux défis communs, notamment par une approche concertée de plateforme nationale.
13. Nous nous réjouissons des progrès réalisés en matière de diversité et d’inclusion parmi le personnel et l’administration du GBM, et nous continuons d’appuyer le Conseil dans ses travaux visant à améliorer et à promouvoir la diversité des genres au sein des conseils d’administration du GBM. Réduire les écarts entre les genres est une économie intelligente, tandis qu’une représentation équilibrée et une égalité totale entre les genres sont au cœur de la mission de la Banque. Nous recommandons avec insistance la poursuite des travaux sur ce front.
14. Nous félicitons M. David Malpass pour sa nomination à la présidence du GBM et nous attendons avec intérêt de travailler en étroite collaboration avec lui. Nous apprécions son engagement ferme envers le Groupe de la Banque, sa mission et sa stratégie. Nous remercions Dr Jim Yong Kim pour le leadership qu’il a exercé au sein du GBM et pour les réalisations importantes qu’il a accomplies pendant son mandat. Nous remercions également Mme Kristalina Georgieva pour son leadership et sa gestion efficace des affaires du GBM en tant que présidente par intérim.
15. La prochaine réunion du Comité du développement se déroulera le 19 octobre 2019 à Washington.
Section C : Participation du Canada aux opérations du Fonds monétaire international
Depuis 1945, le Canada, l’un des 29 signataires des statuts initiaux du FMI, est un membre central et influent de cette institution. Le Canada participe à tous les aspects de la gouvernance et des opérations du FMI et collabore avec ses partenaires internationaux pour s’assurer que le FMI s’acquitte efficacement de son mandat. Une économie mondiale saine et stable crée plus d’emplois pour les Canadiens, favorise la stabilité des prix des biens et des services et rehausse notre niveau de vie.
Gouvernance et représentation
Part des voix détenue par le Canada
Les parts des voix détenues par les pays membres sont en grande partie basées sur leur poids économique global relatif et leur ouverture au commerce international. Le Canada détient une part appréciable des voix du FMI, soit 2,22 %, ce qui le classe au 11e rang des membres pour la période visée par le présent rapport.
| Rang | Pays | Part (%) |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16,5 |
| 2 | Japon | 6,2 |
| 3 | Chine | 6,1 |
| 4 | Allemagne | 5,3 |
| 5 | France | 4,0 |
| 6 | Royaume-Uni | 4,0 |
| 7 | Italie | 3,0 |
| 8 | Inde | 2,6 |
| 9 | Fédération de Russie | 2,6 |
| 10 | Brésil | 2,2 |
| 11 | Canada | 2,2 |
| 12 | Arabie saoudite | 2,0 |
| 13 | Espagne | 1,9 |
| 14 | Mexique | 1,8 |
| 15 | Pays-Bas | 1,8 |
| 16 | Corée | 1,7 |
| 17 | Australie | 1,3 |
| 18 | Belgique | 1,3 |
| 19 | Suisse | 1,2 |
| 20 | Turquie | 1,0 |
Le Canada au Conseil des gouverneurs
Le FMI rend compte à ses pays membres par l’intermédiaire de nombreux mécanismes. Le Conseil des gouverneurs, composé d’un gouverneur et d’un gouverneur suppléant nommés par chaque pays membre, est le plus haut organe de décision du FMI. Le Conseil des gouverneurs est responsable des décisions institutionnelles les plus importantes requises en vertu des statuts (par exemple approuver l’augmentation des quotes-parts, admettre de nouveaux membres et modifier les statuts et les règlements). Le ministre des Finances du Canada, l’honorable Bill Morneau, est actuellement le gouverneur canadien au FMI, et le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, est le gouverneur suppléant canadien.
Le Canada au Conseil d’administration
Le Conseil des gouverneurs délègue les pouvoirs sur les activités courantes du FMI au Conseil d’administration de 24 membres, qui est présidé par la directrice générale du Fonds. Le système de groupes de pays permet aux 24 membres du Conseil d’administration de représenter les 189 pays membres, ce qui facilite les activités quotidiennes.
Le Canada détient l’un de ces 24 sièges et représente un groupe de 12 paysNote de bas de page 20. En combinant tous les membres du groupe de pays qu’elle représente, l’administratrice du Canada exerce 3,38 % des voix, ce qui place notre groupe de pays au 12e rang. Vu les contributions financières du Canada et le degré de participation du FMI, c’est un Canadien ou une Canadienne qui a toujours occupé le poste d’administrateur représentant le groupe de pays dont il fait partie. L’administratrice actuelle représentant le Canada est Louise Levonian. Mme Levonian est appuyée par une petite équipe composée de personnel en détachement des pays représentés dans le groupe.
Puisque les décisions du Conseil d’administration sont habituellement le fruit d’un consensus, il est rare que ses membres soient appelés à voter. Le Canada s’efforce de contribuer à la formulation des propositions stratégiques avant qu’elles soient soumises au Conseil, au moyen de discussions non officielles avec le personnel et la direction ou encore au moyen de consultations avec d’autres administrateurs.
Pour en savoir davantage sur les structures de gouvernance, de représentation et de reddition de comptes du FMI, veuillez consulter le site Web du FMI traitant de la structure de gouvernance (en anglais).
Le Canada au Comité monétaire et financier international (CMFI)
Le CMFI fournit des conseils et fait rapport au Conseil des gouverneurs sur les questions monétaires et financières internationales ainsi que sur les réponses apportées aux nouveaux problèmes d’importance mondiale. Bien qu’il ne dispose pas de pouvoir décisionnel officiel, il joue un rôle important dans l’orientation stratégique du Fonds. La composition du CMFI reflète celle du Conseil d’administration. Par conséquent, le ministre des Finances du Canada occupe l’un des 24 sièges à la table du CMFI. Les membres du CMFI se réunissent habituellement deux fois par année, soit pendant les assemblées annuelles et printanières du FMI et de la Banque mondiale. Le CMFI produit des communiqués visant à fournir une orientation stratégique et politique à la directrice générale et au Conseil d’administration du FMI. Le ministre des Finances dépose également, lors des assemblées annuelles et printanières, et au nom des paysNote de bas de page 21 qu’il représente, des déclarations écrites qui décrivent nos points de vue collectifs sur les activités particulières du Fonds en matière de gouvernance, de surveillance et de prêt. Ces déclarations sont affichées sur le site Web du ministère des Finances Canada et sur celui du FMI.
Ressources, prêts et développement des capacités du FMI
Ressources financières du FMI
Les ressources financières du FMI sont composées de ressources permanentes et de ressources temporaires. Les quotes-partsNote de bas de page 22 permanentes souscrites par les membres constituent la principale source de ressources financières du FMI. Elles sont complétées par les nouveaux accords d’emprunt (NAE), un accord d’emprunt multilatéral renouvelable représentant une deuxième ligne de défense auquel le Canada participe. De plus, le FMI a actuellement des accords d’emprunt bilatéraux temporaires avec 40 membres (y compris le Canada). Ces accords servent de troisième mécanisme de protection. Le FMI peut recourir à ces marges de crédit multilatérales et bilatérales dans l’éventualité d’une nouvelle grande crise économique mondiale après que toutes les autres ressources ont effectivement été épuisées. Pour en savoir plus, consultez le site Web sur les emprunts multilatéraux et bilatéraux du FMI.
Bien que les ressources décrites ci-dessus puissent servir à répondre aux besoins en matière d’ajustement de tout pays membre, le FMI tient également un fonds fiduciaire spécial destiné aux prêts concessionnels aux membres les plus pauvres et les plus vulnérablesNote de bas de page 23. Le Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FFRPC) est financé à l’aide de contributions sous forme de prêts et de subventions de la part de pays membres comme le Canada, ainsi qu’au moyen du transfert de ressources à même les revenus nets du FMI.
Les opérations financières du FMI se transigent en droits de tirage spéciaux (DTS)Note de bas de page 24, un instrument de réserve international créé par le FMI pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres. Le tableau 2 résume les ressources financières du FMI, de même que les engagements et la position financière du Canada au Fonds en date du 30 avril 2019. Pour de plus amples renseignements sur les finances du FMI, veuillez consulter le Rapport annuel du Conseil d’administration de 2019 du FMI.
| Description | Total (DTS) | Contribution du Canada (DTS) | Contribution du Canada (dollars canadiens1) | Prélevé de la contribution du Canada (DTS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estimation à partir du taux de change dollar canadien par DTS au 30 avril 2019. 2 Au 30 avril 2019, l’encours s’établissait à 0,14 milliard de DTS. Sources : FMI, Position financière du Canada au Fonds (en anglais); calculs du ministère des Finances Canada | ||||
| Compte des ressources générales | ||||
| Quote-part | 477 | 11,0 | 20,5 | 1,8 |
| Nouveaux accords d’emprunt | 182 | 3,9 | 7,2 | 0,3 |
| Accords d’emprunt bilatéraux | 317 | 8,2 | 15,2 | 0 |
| Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance | ||||
| Engagements de prêts en vigueur | 1,0 | 1,9 | 0,21 | |
Programmes de prêts du FMI
Le FMI met ses ressources à la disposition de ses membres pour les aider à régler des problèmes provisoires au titre de la balance des paiements pendant qu’ils mettent en œuvre des ajustements à la politique économique. Le FMI fournit cette assistance par le biais de deux genres d’accords de prêt : les prêts non concessionnels, qui sont consentis à tous les membres, et les prêts concessionnels consentis aux pays membres à faible revenu admissibles. Les prêts non concessionnels sont financés à même les ressources ordinaires du Fonds, qui sont regroupées dans le Compte des ressources générales, tandis que les prêts concessionnels sont financés à même le FFRPC. Des détails concernant le processus et les mécanismes de prêt se trouvent sur le site Web sur les prêts du FMI.
Accords de prêt
Au cours de son exercice 2018-2019 (du 1er mai 2018 au 30 avril 2019), le FMI a approuvé sept nouveaux accords de prêt non concessionnel, ainsi qu’une augmentation et une diminution de deux accords existants, totalisant 50,5 milliards de DTS (environ 93,9 milliards de dollars). On compte actuellement 21 accords de prêts non concessionnels actifs au Fonds, totalisant 132,1 milliards de DTS (environ 245,7 milliards de dollars).
Le FMI a également approuvé deux nouveaux accords de prêts concessionnels et deux augmentations aux accords existants dans le cadre du FFRPC, totalisant 0,2 milliard de DTS (environ 0,4 milliard de dollars). Dans l’ensemble, on compte 16 accords actifs au FFRPC totalisant 2,4 milliards de DTS (environ 4,5 milliards de dollars).
Le tableau 3 présente un résumé des nouveaux accords de prêt du FMI qui ont été approuvés en 2018-2019. Le graphique 1 donne un aperçu des accords de prêt en vigueur du FMI. Une liste complète des mécanismes de prêt actifs du FMI est disponible dans son rapport annuel et sur le site Web sur les accords de prêt du FMI (en anglais).
| Description | Nombre de nouveaux accords | Taille (milliards de DTS) | Taille (milliards de dollars canadiens) |
|---|---|---|---|
| Sources : FMI, calculs du ministère des Finances Canada. | |||
| Prêts non concessionnels | 9 | 50,5 | 93,9 |
| Programme de prêts | 5 | 44,1 | 82,0 |
| Prêts de précaution | 2 | 10 | 18,6 |
| Augmentation des accords existants | 2 | -3,6 | -6,7 |
| Prêts concessionnels (FFRPC) | 4 | 0,2 | 0,4 |
| Programme de prêts | 2 | 0,2 | 0,4 |
| Augmentation des accords existants | 2 | >0,1 | >0,1 |
| Total des prêts | 13 | 50,7 | 94,3 |
Graphique 1 : Accords de prêt en vigueur du FMI
(en milliards de DTS)
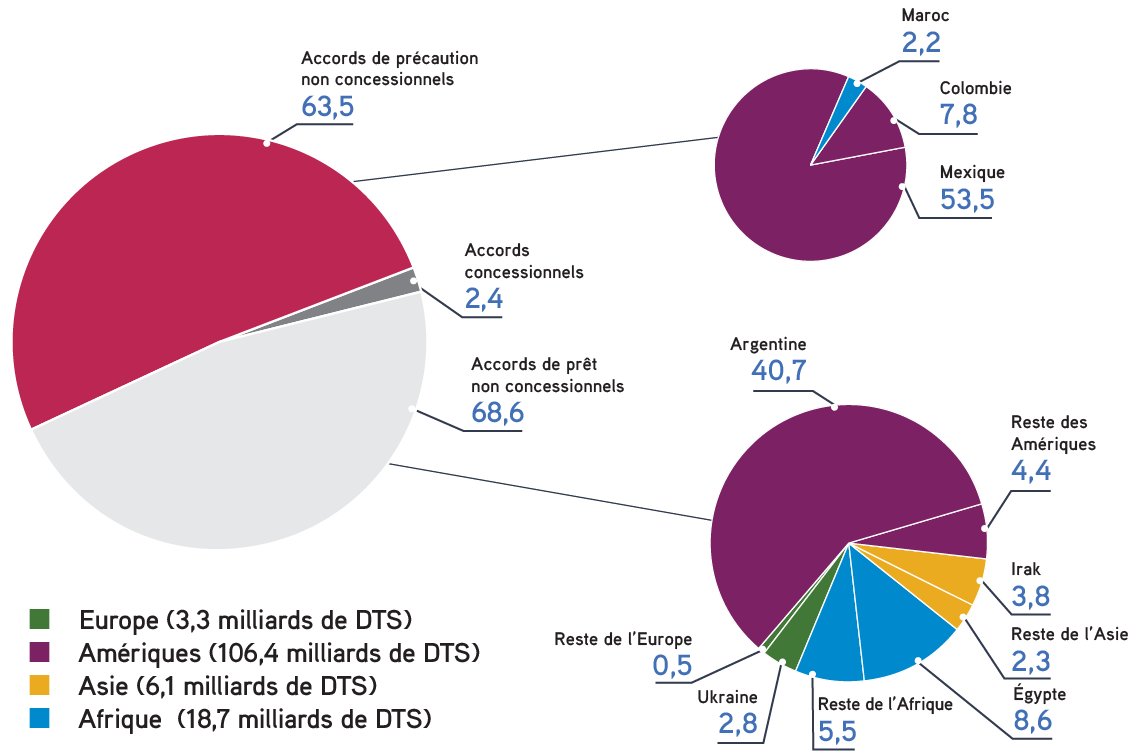
| Accords de prêt en vigueur du FMI | Taille |
|---|---|
| Europe | 3,3 M$ |
| Amériques | 106,4 M$ |
| Asie | 6,1 M$ |
| Afrique | 18,7 M$ |
| Accords de prêt en vigueur du FMI | Taille |
|---|---|
| Sources : FMI; calculs du ministère des Finances Canada. | |
| Accords de précaution non concessionnels | 63.5 M$ |
| Maroc | 2.2 M$ |
| Colombie | 7.8 M$ |
| Mexique | 53.5 M$ |
| Accords de prêt non concessionnels | 68.6 M$ |
| Argentine | 40.7 M$ |
| Reste des Amériques | 4.4 M$ |
| Irak | 3.8 M$ |
| Reste de l’Asie | 2.3 M$ |
| Égypte | 8.6 M$ |
| Reste de l’Afrique | 5.5 M$ |
| Ukraine | 2.8 M$ |
| Reste de l’Europe | 0.5 M$ |
| Accords concessionnels | 2.4 M$ |
Développement des capacités
Depuis plus de 50 ans, le FMI fournit de l’assistance technique (AT) et de l’aide au développement des capacités (DC) aux pays membres afin de renforcer la capacité de leurs institutions nationales à favoriser des politiques efficaces qui conduisent à une plus grande stabilité et croissance économiques. Les activités du FMI en matière d’AT et de DC sont financées à la fois sur le plan interne et sur le plan externe en proportions égales. Elles représentaient près d’un tiers de son budget en 2018-2019. Les dépenses consacrées à l’AT et au DC totalisaient 306 millions de dollars américains, dont 168 millions financés sur le plan externe. Pour en savoir plus, consultez la page Web sur le développement des capacités du FMI (en anglais).
Contributions du Canada au développement des capacités
Les partenariats externes permettent au FMI d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités pour les membres dans le besoin. Le Canada a toujours été l’un des plus importants contributeurs externes pour les activités d’AT et de DC du FMI, ayant octroyé environ 127,3 millions de dollars américains (soit environ 170,5 millions de dollars canadiens) depuis 2010 (voir le tableau 4 pour plus de détails). Ce soutien a aidé les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à renforcer leur capacité de gouvernance dans des domaines tels que les fonctions des banques centrales, la gestion des finances publiques, le développement et la surveillance du secteur financier. L’AT et le DC financés au Canada sont généralement offerts de trois façons distinctes :
1. Centres régionaux d’assistance technique (CRAT) : Le FMI a mis en place une approche régionale en matière de prestation d’AT et de DC. Outre la formation offerte à l’Institut pour le développement des capacités du FMI à Washington, le FMI gère sept instituts régionaux de formation et neuf CRAT situés en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, dans la région du Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, consulter la page Web du FMI sur les initiatives régionales de développement des capacités.
2. Initiatives dirigées par les pays : Les pays membres, les autres IFI et les mécanismes de financement des projets du FMI (par exemple les CRAT, les fonds fiduciaires à donateurs multiples et les fiducies propres à chaque pays) peuvent tenir des « sous-comptes » pour les initiatives ciblées d’assistance technique ou conserver une réserve stratégique pour répondre rapidement aux nouvelles priorités. Le Canada tient un sous-compte pour appuyer diverses activités d’AT et de DC dans les Caraïbes, en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2018, le Canada l’a accru de plus de 20 millions de dollars pour des activités d’AT et de DC du FMI à l’intention des petits États insulaires en développement et d’autres pays à faible revenu.
3. Fonds fiduciaires à donateurs multiples : Le FMI gère plusieurs fonds thématiques, notamment le Fonds de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes (BA/FAT), et d’autres fonds visant à améliorer l’accessibilité des données et la gestion de la dette publique, et d’autres dossiers liés à la gestion financière publique. En outre, deux fonds pour États fragiles visent précisément à soutenir le Soudan du Sud et la Somalie. Le Canada a auparavant soutenu des fonds à donateurs multiples, y compris le fonds BA/FAT, le fonds fiduciaire pour la Somalie pour le DC, et la participation du FMI au projet de la Banque mondiale sur le soutien à la Gestion économique dans les Caraïbes (GEC). Pour en savoir plus, consulter la page Web des Fonds thématiques pour le développement des capacités.
| Description | Total des décaissements de 2010-2011 à 2017-2018 | Décaissements en 2018-2019 |
|---|---|---|
| Nota : Le financement du FMI en matière de renforcement des capacités est indiqué en dollars américains, au taux de 1,33955 dollar canadien pour un dollar américain en date du 30 avril 2019. Le tableau ne comprend que les initiatives auxquelles le Canada a contribué. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Source : FMI. | ||
| Centres régionaux d’assistance technique | ||
| Centres régionaux d’assistance technique des Caraïbes | 23,3 | 6,3 |
| Centres régionaux d’assistance technique pour l’Amérique centrale, le Panama et la République dominicaine | 11,0 | 1,6 |
| Centres régionaux d’assistance technique en Afrique | 10,4 | 0 |
| Initiatives dirigées par les pays | ||
| Sous-compte du Canada pour l’assistance technique mondiale | 16,7 | 6,8 |
| Activités de développement des capacités de l’Ukraine | 21,7 | 0 |
| Projet Canada-Caraïbes de gestion améliorée des finances publiques | 12,1 | 4,5 |
| BA/FAT et certaines autres activités du Fonds | 2,2 | 0,2 |
| Fonds fiduciaires à donateurs multiples | ||
| Fonds fiduciaires pour le développement des capacités en Somalie | 2,5 | 0 |
| Fonds thématique BA/FAT | 2,3 | 0 |
| Sous-compte de la Banque mondiale pour certaines activités du Fonds | 5,9 | (0,2) |
| Initiative pour le renforcement et la réforme du secteur financier | 0,1 | 0 |
| Montant total | 108,1 | 19,2 |
D’autres détails concernant les opérations du FMI, y compris sur ses activités de surveillance, de prêt, de développement des capacités et de gouvernance institutionnelle, se trouvent sur le site Web du FMI.
Communiqués du Comité monétaire et financier international du Conseil des gouverneurs du FMI (conformément à la Loi de Bretton Woods)
Communiqué de la trente-huitième réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI)
Le 13 octobre 2019
Présidée par M. Lesetja Kganyago, Gouverneur de la Banque de réserve d’Afrique du Sud
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la population et aux autorités indonésiennes après les événements tragiques qui ont frappé le pays récemment. Nous les remercions de l’organisation de l’assemblée annuelle 2018 à Bali et de leur hospitalité chaleureuse.
Perspectives mondiales et priorités
1. L’expansion mondiale reste vigoureuse. La croissance devrait être régulière à court terme et modérée par la suite. Cependant, la reprise est de plus en plus inégale, et certains des risques qui avaient été mentionnés précédemment se sont matérialisés en partie. Globalement, les perspectives ont de plus en plus de chances d’être révisées à la baisse du fait des fortes tensions commerciales et des préoccupations géopolitiques persistantes, qui s’accompagnent d’un durcissement des conditions financières affectant tout particulièrement de nombreux pays émergents et pays en développement. L’incertitude quant aux politiques à mener, les dettes élevées au regard du passé, les vulnérabilités financières croissantes et les marges de manœuvre réduites pourraient affaiblir davantage la confiance et les perspectives de croissance.
2. Étant donné que la fenêtre de tir se réduit, nous agirons promptement pour promouvoir des politiques et des réformes visant à protéger l’expansion, à atténuer les risques, à reconstituer des marges de manœuvre, à accroître la résilience et à rehausser les perspectives de croissance à moyen terme au profit de tous. La politique budgétaire doit reconstituer les amortisseurs, selon les besoins; être souple et propice à la croissance; éviter la procyclicité; et accroître la qualité des infrastructures et des qualifications de la main-d’œuvre, tout en veillant à ce que la dette publique se trouve sur une trajectoire viable. En accord avec leurs mandats et compte tenu des risques pesant sur la stabilité financière, les banques centrales doivent maintenir une politique monétaire accommodante dans les pays où l’inflation est inférieure à l’objectif fixé, et la retirer progressivement, en s’appuyant sur une bonne communication et sur les données disponibles, dans les pays où l’inflation est supérieure à l’objectif fixé ou s’en approche.
3. Des paramètres fondamentaux sains, des politiques bien conçues et un système monétaire international robuste sont nécessaires à la stabilité des taux de change, contribuant à une croissance et à un investissement vigoureux et durables. Un taux de change flexible peut amortir les chocs, dans les pays qui peuvent appliquer un tel régime. Nous reconnaissons qu’une volatilité excessive ou des mouvements désordonnés des taux de change peuvent avoir des implications négatives pour la stabilité économique et financière. Nous nous abstiendrons de procéder à des dévaluations compétitives et nous n’établirons pas de cible de taux de change à des fins de concurrence.
4. Il est essentiel de faire avancer les réformes financières et structurelles pour élever la croissance potentielle et l’emploi, ainsi que pour renforcer la résilience, tout en apportant une aide concrète à ceux qui supportent le coût de l’ajustement. Nous soulignons qu’il importe d’achever et de mettre en œuvre les réformes du secteur financier dans les meilleurs délais, dans leur intégralité et de manière systématique, ainsi que d’en évaluer les effets. Nous surveillerons et combattrons, si nécessaire, les vulnérabilités financières et les risques qui voient le jour; et, grâce à une coopération constante sur le plan de la réglementation, nous éviterons la fragmentation. Nous continuerons aussi d’adapter la réglementation aux changements structurels et de combler les déficits de données. Nous nous efforcerons de faire face aux difficultés liées aux changements démographiques et d’accroître l’inclusion afin de partager largement les gains tirés des progrès technologiques et de l’intégration économique. Nous nous emploierons ensemble à réduire les déséquilibres mondiaux de manière à favoriser une croissance mondiale durable.
5. Nous intensifierons notre coopération pour relever les défis communs. Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de continuer à renforcer le dialogue et l’action afin d’atténuer les risques et d’améliorer la confiance dans le commerce international, notamment en ce qui concerne les moyens de mieux équiper l’Organisation mondiale du commerce (OMC) face aux défis d’aujourd’hui et de demain. Nous reconnaissons qu’il est essentiel, pour favoriser la croissance et l’emploi, de veiller à ce que les échanges de biens et de services et les investissements soient ouverts et équitables, et bénéficient à toutes les parties. Nous réaffirmons qu’il importe de mettre en pratique les conclusions du sommet du G20 à Hambourg sur le commerce. Nous encouragerons une plus grande ouverture au commerce, notamment dans les services et le commerce électronique. Nous continuerons d’œuvrer à l’établissement d’un système fiscal international équitable et moderne, et, le cas échéant, de nous attaquer aux questions de fiscalité et de concurrence soulevées notamment par la numérisation. Nous renforcerons notre collaboration pour exploiter les technologies financières de manière à accroître l’efficience et l’inclusion, tout en remédiant aux risques connexes, ainsi que pour nous attaquer aux sources et aux réseaux de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, au financement de la prolifération, à la corruption et aux autres flux financiers illicites.
6. Nous soutenons les efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 2030. Étant donné la vulnérabilité croissante des pays à faible revenu liée à leur dette, nous œuvrons ensemble pour accroître la transparence de la dette, promouvoir des pratiques de financement viables de la part des débiteurs et des créanciers, tant publics que privés, et renforcer la coordination des créanciers dans les restructurations de dette, en nous appuyant sur les forums existants. Nous continuerons d’appuyer les efforts déployés par les pays pour accroître leur résilience face aux conséquences macroéconomiques des pandémies, de la cybercriminalité, du changement climatique, des catastrophes naturelles, des pénuries énergétiques, des conflits, des migrations, de l’afflux de réfugiés et d’autres crises humanitaires, ainsi que pour gérer ces conséquences.
Activités du FMI
7. Nous saluons le plan d’action mondial présenté par la directrice générale. Conformément à son mandat, le FMI continuera d’apporter son aide à ses pays membres et de collaborer avec d’autres entités aux fins suivantes :
- Promouvoir un système monétaire et financier international résilient. Nous saluons les efforts qui continuent d’être déployés pour mener une évaluation rigoureuse, impartiale, franche et transparente des positions extérieures sur la base de méthodologies mises à jour. Nous saluons aussi les conseils du FMI pour aider les pays membres à faire face au volume et à l’instabilité des flux de capitaux, et nous appelons de nos vœux des efforts supplémentaires pour renforcer le dispositif mondial de sécurité financière, notamment en approfondissant la collaboration avec les arrangements financiers régionaux.
- Faciliter la recherche de solutions multilatérales aux problèmes mondiaux. Nous appelons le FMI à appuyer les efforts déployés pour atténuer les risques et renforcer la confiance dans le commerce, notamment par le biais de ses analyses macroéconomiques portant sur le commerce. Nous souhaitons que le FMI continue de jouer son rôle dans les questions relatives à la fiscalité internationale et à la mobilisation des ressources intérieures, notamment en participant à la plateforme de collaboration sur les questions fiscales et en mettant en pratique son expérience relative aux stratégies de recettes à moyen terme. Nous notons avec satisfaction que les conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont avalisé le programme d’action de Bali sur les technologies financières qui rassemble des considérations importantes pour les dirigeants et la communauté internationale. Nous demandons au FMI d’appuyer les efforts visant à donner suite à ce programme, notamment en poursuivant les travaux sur les technologies financières, dont les cryptoactifs. Dans les limites de son mandat, le FMI fournira des orientations sur la mise en œuvre, par ses pays membres, des stratégies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
- Aider les pays membres à accroître leur résilience et à améliorer leurs perspectives de croissance. Nous saluons l’engagement accru en matière de gouvernance, y compris la corruption, et la mise en œuvre du nouveau dispositif de gouvernance; l’établissement d’un cadre stratégique pour l’action en matière de dépenses sociales; ainsi que les travaux sur la puissance commerciale des entreprises, l’économie numérique, la gouvernance des infrastructures, l’évolution démographique, les questions de genre et les inégalités. Nous notons avec satisfaction que le FMI continue d’aider les pays touchés par les conflits et les crises liées aux réfugiés, et nous avons hâte de prendre connaissance de propositions visant à aider les pays vulnérables à accroître leur résilience aux catastrophes naturelles.
- Adapter les outils à l’évolution des besoins des pays membres. Nous attendons avec intérêt l’examen détaillé de la surveillance, prévu en 2020, de même que les examens de la conditionnalité des programmes, du programme d’évaluation du secteur financier, de la stratégie de lutte contre le BA/FAT, ainsi que de la politique relative aux pratiques de change multiples. Nous soutenons la poursuite des efforts visant à s’attaquer aux causes et aux conséquences de la baisse du nombre de relations de correspondants bancaires, ainsi qu’à aider les pays à traiter ces questions. Nous attendons également avec intérêt un renforcement de l’efficacité et de la responsabilisation de l’assistance technique et des formations offertes par le FMI, dans le contexte de l’examen en cours de la stratégie de développement des capacités.
- Renforcer la viabilité et la transparence de la dette. Nous attendons avec intérêt les examens du cadre de viabilité de la dette pour les pays ayant accès aux marchés et de la politique relative aux plafonds d’endettement. Nous demandons au FMI de continuer de collaborer avec ses pays membres pour renforcer les cadres budgétaires, améliorer les capacités de gestion de la dette et mettre en œuvre le nouveau cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu. Nous souscrivons à l’approche pluridimensionnelle du FMI et de la Banque mondiale qui consiste à collaborer avec les emprunteurs et les créanciers de manière à améliorer l’enregistrement, le suivi et la déclaration transparente des obligations relatives aux dettes publiques et privées, ainsi qu’aux efforts déployés pour renforcer la coordination des créanciers dans les restructurations de dette, en s’appuyant sur les forums existants.
- Aider les pays à faible revenu, ainsi que les pays fragiles et les pays de petite taille. Nous saluons l’examen des mécanismes en faveur des pays à faible revenu et les travaux en cours concernant les pays de petite taille. Nous adhérons à la déclaration de la directrice générale relative aux relations entre le FMI et les pays fragiles, et nous appelons à mettre en œuvre le plan de la direction dans son intégralité et en temps voulu, à la suite de l’évaluation menée récemment par le Bureau indépendant d’évaluation (BIE). Nous sommes favorables à la poursuite des travaux et des analyses visant à aider les pays à atteindre les ODD.
Ressources et gouvernance du FMI
8. Nous réaffirmons notre volonté de faire en sorte que le FMI reste une institution solide, reposant sur un système de quotes-parts et disposant de ressources adéquates, afin de préserver son rôle central au sein du dispositif mondial de sécurité financière. Nous sommes déterminés à achever la quinzième révision générale des quotes-parts et à arrêter une nouvelle formule de calcul en vue d’un réalignement des quotes-parts relatives qui conduira à une augmentation des parts des pays dynamiques conformément à leur poids relatif dans l’économie mondiale et donc, probablement, de la part des pays émergents et des pays en développement dans leur ensemble, tout en protégeant la participation et la représentation des pays membres les plus pauvres. Nous prenons note du rapport d’avancement qui a été soumis récemment au conseil des gouverneurs et nous appelons le conseil d’administration à avancer rapidement de manière à achever la quinzième révision générale des quotes-parts, conformément aux objectifs ci-dessus, d’ici les réunions de printemps de 2019 et au plus tard d’ici l’assemblée annuelle de 2019. Nous appelons à mettre en œuvre intégralement les réformes de la gouvernance de 2010.
9. Nous appelons le FMI à maintenir la haute qualité de son personnel et à redoubler d’efforts pour atteindre les repères fixés en matière de diversité pour 2020. Nous attendons avec intérêt l’achèvement en temps voulu de l’examen détaillé de la rémunération et des prestations. Nous souscrivons à un meilleur équilibre hommes-femmes au conseil d’administration.
10. Notre prochaine réunion aura lieu à Washington le 13 avril 2019.
Communiqué de la trente-neuvième réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI)
Le 13 avril 2011
Présidée par M. Lesetja Kganyago, Gouverneur de la Banque de réserve d’Afrique du Sud
Nous tenons à faire part de notre compassion pour les pertes humaines et les conséquences dévastatrices des récentes catastrophes naturelles en Iran, au Malawi, Mozambique et au Zimbabwe.
Perspectives mondiales et priorités
L’expansion mondiale se poursuit, mais à un rythme plus lent que prévu en octobre dernier. La croissance devrait s’affermir en 2020, mais des risques de dégradation persistent. Il s’agit notamment des tensions commerciales, de l’incertitude entourant les politiques économiques, des risques géopolitiques et d’un soudain net durcissement des conditions financières dans un contexte de marges de manœuvre limitées, de niveaux de dette élevés par rapport au passé et d’aggravation de la vulnérabilité financière. D’autres problèmes existant de longue date restent également à résoudre.
Pour faire en sorte que l’expansion se poursuive, nous continuerons d’atténuer les risques, d’accroître la résilience et, si nécessaire, d’agir rapidement afin de soutenir la croissance pour le bien de tous. La politique budgétaire devrait recréer des marges de manœuvre si nécessaire, être souple et propice à la croissance, et trouver le bon équilibre entre les nécessités de garantir la viabilité de la dette, de soutenir la demande tout en évitant la procyclicité et de préserver les objectifs sociaux. Conformément aux mandats des banques centrales, la politique monétaire devrait faire en sorte que l’inflation reste sur la trajectoire des objectifs fixés ou se stabilise autour de ces objectifs, et que les anticipations inflationnistes demeurent ancrées. Les décisions des banques centrales doivent continuer d’être bien communiquées et fondées sur des données. Nous surveillerons les facteurs de vulnérabilité financière et les nouveaux risques qui pèsent sur la stabilité financière, et, si nécessaire, y remédierons, y compris à l’aide d’outils macroprudentiels.
Des paramètres fondamentaux sains, des politiques bien conçues et un système monétaire international robuste sont nécessaires à la stabilité des taux de change, contribuant à une croissance et à un investissement vigoureux et durables. Un taux de change flexible peut amortir les chocs, dans les pays qui peuvent appliquer un tel régime. Nous reconnaissons qu’une volatilité excessive ou des mouvements désordonnés des taux de change peuvent avoir des implications négatives pour la stabilité économique et financière. Nous nous abstiendrons de procéder à des dévaluations compétitives et nous n’établirons pas de cible de taux de change à des fins de concurrence.
Il est indispensable d’avancer dans la mise en œuvre des réformes financières et structurelles pour stimuler la croissance potentielle et l’emploi, accroître la résilience et promouvoir l’inclusion. À cette fin :
- Nous soulignons qu’il importe de mettre en œuvre le programme de réforme du secteur financier dans les meilleurs délais, dans son intégralité et de manière systématique, et de mener à terme l’évaluation en cours des effets de ces réformes. Nous nous attaquerons également à la fragmentation dans le cadre d’une coopération constante sur le plan de la réglementation et du contrôle, nous adapterons la réglementation à l’évolution structurelle et nous comblerons les déficits de données.
- Nous nous engageons à renforcer la gouvernance, notamment en luttant contre la corruption. Nous mettrons en œuvre des politiques qui favorisent l’innovation et la concurrence équitable sur les marchés. Nous nous efforcerons de relever les défis liés à l’évolution démographique, de veiller à ce que les bienfaits des avancées technologiques et de l’intégration économique profitent au plus grand nombre, et d’apporter une aide concrète à ceux qui assument le coût de l’ajustement.
Nous continuerons d’agir ensemble pour renforcer la coopération et les cadres internationaux.
- Nous collaborerons pour réduire les déséquilibres excessifs à l’échelle mondiale au moyen de politiques macroéconomiques et structurelles favorisant une croissance mondiale durable.
- Les échanges libres, équitables et mutuellement bénéfiques de biens et de services ainsi que les investissements sont des moteurs essentiels de la croissance et de la création d’emplois. À cet égard, nous reconnaissons la nécessité de résoudre les tensions commerciales et d’appuyer la nécessaire réforme de l’Organisation mondiale du commerce pour en améliorer le fonctionnement.
- Nous accélérerons nos travaux en vue de l’établissement d’un système fiscal international équitable et moderne, et lutterons contre une concurrence fiscale dommageable, le transfert artificiel de bénéfices et d’autres problèmes fiscaux, notamment ceux liés à la numérisation. Nous espérons obtenir des résultats le plus tôt possible. Nous nous attaquerons aux sources et aux réseaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au financement de la prolifération des armes de destruction massive et à d’autres flux financiers illicites. Nous traiterons également la question de la diminution des relations de correspondants bancaires et de ses conséquences néfastes.
- Nous œuvrons ensemble à l’amélioration de la transparence en matière de dette et à la promotion de pratiques financières durables pour les débiteurs et les créanciers, publics et privés, ainsi qu’au renforcement de la coordination entre les créanciers dans les situations de restructuration de la dette, sur la base des instances déjà en place.
Nous reconnaissons qu’une action conjointe est également essentielle pour relever les grands défis mondiaux. Nous continuerons d’aider les pays, notamment par l’intermédiaire d’initiatives internationales, à accroître leur résilience et à faire face aux conséquences macroéconomiques des pandémies, de la cybercriminalité, du changement climatique, des catastrophes naturelles, des pénuries énergétiques, des conflits, des migrations, de l’afflux de réfugiés et d’autres crises humanitaires. Nous poursuivrons également notre collaboration pour stimuler les technologies financières tout en réglant les problèmes qu’elles soulèvent, y compris ceux liés à la sécurité de la vie privée et des données et à la fragmentation. Nous soutenons les efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 2030.
Activités du FMI
Nous saluons la mise à jour du Plan d’action mondial de la directrice générale. Conformément à son mandat, le FMI continuera d’apporter son aide à ses pays membres et de collaborer avec d’autres entités aux fins suivantes :
- Aider les pays membres à accroître leur résilience et à réaliser une croissance durable et plus forte. Nous soutenons les efforts déployés par le FMI pour fournir des conseils adaptés et, si nécessaire, une aide financière pour répondre aux besoins de financement de la balance des paiements. Nous attendons avec intérêt d’examiner les travaux du FMI sur un cadre d’action plus intégré, qui prend davantage en considération les interactions entre les politiques monétaires, de change, macroprudentielles et de gestion des flux de capitaux. Nous saluons le renforcement de l’action du FMI en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance, y compris la corruption, conformément au nouveau cadre de gouvernance, ses travaux sur la gouvernance des banques centrales et la poursuite de ses activités sur la gouvernance des infrastructures et les réformes structurelles, notamment en ce qui concerne les questions de concurrence sur les marchés.
- Renforcer la viabilité et la transparence de la dette : Nous souscrivons à la poursuite de l’approche pluridimensionnelle du FMI et de la Banque mondiale qui consiste à collaborer avec les emprunteurs et les créanciers de manière à améliorer l’enregistrement, le suivi et la déclaration transparente des obligations relatives aux dettes publiques et privées. Nous demandons au FMI de continuer de collaborer avec ses pays membres pour renforcer les cadres budgétaires, améliorer les capacités de gestion de la dette et mettre en œuvre le cadre actualisé de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu. Nous attendons avec intérêt les examens du cadre de viabilité de la dette pour les pays ayant accès aux marchés et de la politique du FMI relative aux plafonds d’endettement.
- Promouvoir des politiques encourageant l’inclusion et développant les opportunités : Nous attendons avec intérêt que le FMI propose une stratégie visant à se préoccuper plus systématiquement des questions de dépenses sociales. Nous saluons les analyses macroéconomiques sur les questions de genre et les inégalités. Nous accueillons avec satisfaction les efforts supplémentaires menés pour renforcer l’efficacité de la coopération avec les pays fragiles et touchés par des conflits, ainsi que pour fournir des analyses et des conseils aux pays en développement afin de les aider à atteindre les ODD. Nous appelons le FMI à aider ses membres à accroître leurs recettes intérieures, notamment en collaborant avec ses partenaires au sein de la plateforme de collaboration sur les questions fiscales, en appliquant l’expérience acquise sur les stratégies en matière de recettes à moyen terme, et en prenant des mesures adaptées pour faciliter la collecte des recettes intérieures dans les pays disposant de capacités limitées. Nous nous félicitons de ce que le FMI continue d’appuyer le Pacte avec l’Afrique, initiative du G-20 visant à améliorer les cadres d’investissement.
- Moderniser la coopération mondiale : Nous apprécions les efforts déployés par le FMI pour atténuer les risques et renforcer la confiance dans le commerce en fournissant des conseils et des analyses macroéconomiques portant sur le commerce. Nous saluons la poursuite des efforts visant à mener une évaluation des positions extérieures qui soit rigoureuse, impartiale et cohérente sur le plan multilatéral, et attendons avec intérêt les prochaines analyses de l’influence des taux de change sur les processus d’ajustement extérieur. S’agissant de la collaboration avec d’autres institutions, nous notons avec satisfaction la contribution du FMI à la réforme de la réglementation mondiale, le rôle qu’il continue de jouer sur les questions de fiscalité internationale, et ses travaux sur la mesure et la réduction des flux financiers illicites. Nous souhaitons que des efforts supplémentaires soient menés pour renforcer le dispositif mondial de sécurité financière et promouvoir un système monétaire et financier international résilient, notamment en revoyant certains éléments des instruments de prêt du FMI et en approfondissant la collaboration avec les arrangements financiers régionaux.
- Faciliter l’établissement de solutions mondiales aux problèmes mondiaux en fournissant analyses macroéconomiques et conseils : Nous notons avec satisfaction le travail mené par le FMI sur les implications des technologies financières pour les flux transfrontières et la stabilité, l’inclusion et l’intégrité financières, dans le cadre du programme d’action de Bali sur les technologies financières; son appui aux efforts consentis par les pays pour accroître leur résilience face aux cyberrisques en améliorant la surveillance financière et en encourageant les bonnes pratiques; et ses travaux sur les causes et conséquences de la réduction des relations de correspondants bancaires, ainsi que l’aide apportée aux pays pour y faire face. Nous attendons avec intérêt la poursuite des travaux sur les défis auxquels sont confrontés les pays en transition démographique. Conformément à son mandat, le FMI continuera de fournir des orientations sur la mise en œuvre, par ses pays membres, des stratégies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Nous sommes favorables à ce que le FMI continue de contribuer au renforcement de la résilience dans les pays exposés aux catastrophes naturelles, en particulier les petits pays et les pays à faible revenu, en collaboration avec d’autres institutions. Nous souhaitons également que le FMI continue d’aider les pays touchés par les conflits et les crises liées aux réfugiés.
- Adopter des instruments pour mener et accompagner le changement : Nous saluons les efforts que le FMI déploie en vue d’améliorer ses activités de surveillance, au moyen de la revue exhaustive de la surveillance 2020, du réexamen du programme d’évaluation du secteur financier et de la politique relative aux pratiques de taux de change multiples, et de travaux sur les initiatives en matière de normalisation des données et sur la fourniture de données au FMI aux fins de surveillance. Nous appelons de nos vœux l’amélioration des politiques de prêt, notamment par le réexamen de la conception et de la conditionnalité des programmes ainsi que des mécanismes concessionnels, et nous appuyons l’intégration du développement des capacités aux activités de surveillance et de prêt.
Ressources et gouvernance du FMI
Nous réaffirmons notre volonté de faire en sorte que le FMI reste une institution solide, reposant sur un système de quotes-parts et disposant de ressources adéquates, afin de préserver son rôle central au sein du dispositif mondial de sécurité financière. Nous prenons note du rapport d’avancement de la 15e révision générale des quotes-parts qui a été présenté récemment au conseil des gouverneurs. Nous demandons au conseil d’administration de poursuivre ses travaux sur la réforme des ressources et de la gouvernance du FMI, en y accordant la plus haute priorité, et de faire part de ses conclusions lorsqu’il achèvera ses travaux sur la 15e révision générale des quotes-parts, au plus tard d’ici l’assemblée annuelle de 2019. Nous appelons à mettre en œuvre intégralement les réformes de la gouvernance de 2010.
Pour que le FMI continue d’apporter à ses membres une aide à forte valeur ajoutée, nous l’appelons à maintenir la haute qualité de son personnel et à redoubler d’efforts pour atteindre les repères fixés en matière de diversité pour 2020, et nous attendons avec intérêt ses initiatives en vue de moderniser son fonctionnement, dont l’achèvement en temps voulu de l’examen détaillé des rémunérations et des prestations. Nous souscrivons à un meilleur équilibre hommes-femmes au conseil d’administration.
Notre prochaine réunion aura lieu à Washington le 19 octobre 2019.
Section D : Les engagements du Canada à la Banque européenne pour les activités de reconstruction et de développement
Exigences en matière de rapports
La Loi sur la BERD est entrée en vigueur en 1991 et constitue le cadre juridique à la participation du Canada à la BERD. Membre fondateur et huitième actionnaire en importance de la Banque, le Canada contribue activement à l’élaboration des politiques de la BERD et surveille les activités financières de cette dernière. Il le fait principalement grâce à ses sièges au sein du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration.
Comme précisé à l’article 7 de la Loi sur la BERD, le ministre des Finances doit déposer au Parlement un rapport d’activité annuel contenant un résumé général de toutes les opérations effectuées sous le régime de la loi, y compris les éléments concernant le développement durable et les droits de la personne. La présente section du rapport répond à ces exigences en matière de rapport.
Pour en savoir plus, consulter le texte de la Loi sur la BERD affiché sur le site du ministère de la Justice Canada.
Gouvernance et représentation
Souscriptions du Canada au capital et actions détenues
Au 31 décembre 2018, la BERD comptait 69 actionnaires, dont 67 pays, en plus de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement. L’Inde a rejoint la Banque en juillet 2018. La BERD est active dans 38 pays d’Europe centrale et orientale, d’Asie centrale et de la région de la Méditerranée méridionale et orientale.
Le capital social de la BERD est fourni par les pays membres, qui ont un droit de vote proportionnel. Les pays exercent leur pouvoir décisionnel principalement par l’entremise de leurs représentants au Conseil des gouverneurs et au Conseil des administrateurs.
Le Canada est le huitième actionnaire en importance de la BERD, ses actions représentant 3,4 % ou 1,02 milliard d’euros du capital de la Banque. De ce montant détenu par le Canada, 213 millions d’euros représentent du capital versé, le reste étant des capitaux exigibles.
| Description | Total |
|---|---|
| Nota : Données tirées des états financiers de 2018 de la BERD. | |
| Souscriptions au capital et contributions | 1 020,49 |
| Montant versé | 212,85 |
| Montant non versé, mais tributaire des besoins futurs en capital | 807,64 |
| Part des souscriptions ou des contributions (%) | 3,43 |
| Part des voix (%) | 3,43 |
Des renseignements sur l’exercice 2018 de la BERD (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) sont fournis dans son examen annuel (en anglais) et son rapport financier (en anglais). De plus amples renseignements sur le rendement de la BERD se trouvent dans le Rapport de viabilité (en anglais) et le Rapport de transition (en anglais). La Banque diffuse une quantité considérable de renseignements sur ses diverses activités. Les publications de la Banque comprennent des guides d’information (comme le Guide des financements de la BERD), des rapports d’évaluation, des rapports spéciaux, des stratégies des pays et diverses fiches de renseignements. Il est possible d’obtenir les renseignements sur le site Web de la Banque.
Les demandes de renseignements sur la BERD peuvent être adressées au :
Bureau des publications
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
One Exchange Square
Londres EC2A 2JN
Royaume-Uni
Le Canada au Conseil des gouverneurs
La plus haute autorité de la BERD est le Conseil des gouverneurs. Le Conseil se réunit chaque année et approuve l’examen annuel de la BERD, l’allocation nette des revenus et les états financiers, le rapport du vérificateur indépendant, l’élection du président et du vice-président pour la prochaine assemblée annuelle, ainsi que d’autres questions qui nécessitent l’approbation des gouverneurs. Les gouverneurs font une déclaration écrite lors des assemblées annuelles de la BERD. La déclaration du Canada (en anglais) énonce ses priorités à la Banque.
Un gouverneur et un gouverneur suppléant représentent chacun des 69 actionnaires. L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, est le gouverneur du Canada. M. Ian Shugart, sous-ministre des Affaires étrangères, a été gouverneur suppléant en 2018-2019. Mme Marta Morgan est l’actuelle gouverneure suppléante du Canada, à compter de mai 2019.
Pour en savoir plus sur la gouvernance du Conseil des gouverneurs, veuillez visiter la page Web du Conseil des gouverneurs de la BERD (en anglais).
Le Canada au Conseil d’administration
Le Conseil des administrateurs est responsable des activités générales de la Banque. Il comprend 23 membres, chacun représentant soit un membre, soit un groupe de pays membres. Le Conseil d’administration aide à fixer l’orientation stratégique et financière de la Banque, en consultation avec sa direction. Depuis novembre 2016, le Canada est représenté au Conseil des administrateurs de la BERD par M. Douglas Nevison. L’administrateur du Canada représente également le Maroc, la Jordanie et la Tunisie au Conseil des administrateurs de la BERD.
Pour en savoir plus sur la gouvernance du Conseil d’administration, veuillez visiter le site Web de la BERD (en anglais). Le bureau de l’administrateur représentant le Canada, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie peut être joint par courriel à canadaoffice@ebrd.com.
Le Canada aux comités du Conseil
Le Conseil des administrateurs a créé quatre comités qui supervisent les activités de la Banque : le Comité de direction du Conseil, le Comité d’audit, le Comité du budget et des affaires administratives et le Comité des politiques financières et opérationnelles. Cette division du travail est conforme aux bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise et fournit un système approprié de contrôles, d’équilibre et d’incitations. De plus, la structure assure une discussion plus efficace par le Conseil, une fois que les initiatives sont prêtes à être approuvées.
Le Comité de direction du Conseil est chargé de coordonner les programmes de travail des comités afin d’éviter les chevauchements et d’assurer l’achèvement des travaux en temps opportun. Outre certaines fonctions administratives, le président du Comité est le principal agent de liaison entre le Conseil et la direction. En 2018, le Comité était présidé par l’administrateur représentant l’Union européenne.
L’objectif principal du Comité d’audit est de s’assurer que l’information financière est communiquée par la Banque de manière complète, exacte et pertinente, et en temps opportun. Le Comité veille à l’intégrité des états financiers de la Banque et à la conformité de ses méthodes comptables et de communication de l’information avec les exigences énoncées dans le Système international d’information financière. Il examine également le système de contrôle interne de la BERD et sa mise en œuvre, ainsi que les fonctions des équipes d’audit interne, d’évaluation, de conformité et de gestion des risques. En 2018, le Comité était présidé par l’administrateur représentant le Canada, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie.
Le Comité du budget et des affaires administratives est chargé de veiller à ce que les ressources budgétaires, humaines et administratives de la Banque soient alignées sur ses priorités stratégiques. À cette fin, le Comité examine le cadre de ressources à moyen terme, les budgets annuels et le plan d’activités. Il supervise également les politiques de la Banque en matière de ressources humaines, y compris l’éthique et le Code de conduite. En 2018, le Comité était présidé par l’administrateur représentant la Bulgarie, l’Albanie et la Pologne.
Le Comité des politiques financières et opérationnelles supervise les politiques financières et opérationnelles de la Banque, y compris le plan d’emprunt annuel préparé par le Département du Trésor. Le Comité est responsable de la transparence et de la responsabilité des activités de la Banque, telles qu’elles sont énoncées dans la Politique de diffusion de l’information au public et le Mécanisme de plainte pour les projets. Depuis 2007, le Comité est également chargé de superviser le processus de répartition du revenu net. Enfin, il est responsable de la politique environnementale et sociale de la Banque et des stratégies sectorielles de la BERD. En 2018, le Comité était présidé par l’administrateur représentant la Belgique, la Slovénie et le Luxembourg.
Avantages de l’adhésion à la BERD
L’adhésion du Canada à la BERD et sa participation active aux discussions sur les questions stratégiques et opérationnelles constituent un moyen important d’aider à influencer le développement économique et social dans les pays où intervient la BERD. Le Canada appuie vigoureusement l’objectif primordial qui consiste à développer un secteur privé fort dans ces pays en mobilisant du financement pour des projets à fort impact sur la transition et en fournissant des conseils et une AT aux entreprises et aux gouvernements. La Banque fournit au Canada un moyen de contribuer au développement dans les pays en transition qui ne font pas partie de nos programmes bilatéraux d’aide au développement. De plus, les Canadiens sont bien représentés au sein du personnel de la BERD. À la fin de 2018, 36 Canadiens étaient membres du personnel de la BERD, ce qui représente 1,05 % du total des postes.
Enfin, l’engagement du Canada contribue à sensibiliser les entreprises canadiennes aux possibilités offertes par la BERD. Les entreprises canadiennes peuvent profiter de financement pour des projets entrepris dans les pays d’opérations de la Banque. La Banque s’appuie souvent sur l’acquisition de biens et de services auprès du secteur privé pour mettre en œuvre des projets de transition. En 2018, 30 contrats d’une valeur de 0,9 million d’euros ont été attribués à des consultants canadiens. Les institutions financières canadiennes ont également joué un rôle actif dans la gestion des émissions d’obligations internationales de la BERD.


