Ministre du Développement international - Cahier de breffage
Juillet 2023
Publié : le 19 octobre 2023
A. Principales responsabilités du portefeuille
Aperçu stratégique
Enjeu
- L'aide internationale du Canada constitue une composante essentielle des objectifs et de la boîte à outils internationaux du Canada.
- Malgré les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté au cours des 20 dernières années, l'impact de la pandémie de COVID-19 et les crises mondiales et régionales qui se chevauchent, ont contribué à une situation dans laquelle la réalisation des objectifs de développement durable est devenue de plus en plus difficile.
Contexte
En tant que ministre du développement international, vous êtes le principal responsable de la fourniture de l'aide au développement international du Canada dans un ministère qui rassemble les capacités du Canada en matière de politique étrangère, de commerce et d'aide internationale de manière intégrée sous la rubrique de la politique étrangère féministe du Canada. Vous vous concentrerez sur la mise en œuvre de la politique d'aide internationale féministe afin que l'aide internationale du Canada favorise le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Vous êtes également responsable de la réponse du Canada aux crises humanitaires.
L'aide internationale canadienne est orientée par le Programme 2030 pour le développement durable, un accord mondial historique axé sur 17 Objectifs de développement durable. L'année 2023 se situe à mi-parcours du Programme 2030, et un sommet au niveau des dirigeants est prévu cet automne à New York pour faire le point sur les progrès accomplis et évaluer les ajustements nécessaires à la réalisation des objectifs.
La majeure partie de l'aide internationale canadienne est composée d'aide publique au développement (APD) et est soumise à la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'aide publique au développement (2008). Cette loi exige que l'aide canadienne soutienne les efforts de réduction de la pauvreté, réponde aux perspectives des pauvres et s'aligne sur les normes internationales en matière de droits de l'homme.
L'aide internationale permet au Canada d'apporter des changements transformateurs à long terme dans les pays qui peuvent bénéficier d'une aide au développement en raison de leur faible PIB par habitant. Le Canada est un donateur international actif et engagé depuis les années 1950. Nos contributions au cours des dernières décennies ont permis d'allonger l'espérance de vie, de réduire la pauvreté, d'accroître l'égalité entre les hommes et les femmes, d'améliorer les résultats en matière de santé et d'éducation, de mettre en place de meilleurs systèmes de gouvernement et de renforcer la résistance des pays en développement aux chocs extérieurs.
La programmation de l'aide internationale du Canada comprend des initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité et la gouvernance, ce qui nécessite une étroite collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. L'aide internationale du Canada complète également le travail du ministre du Commerce international en renforçant et en stabilisant les économies des pays à revenu faible et intermédiaire, en créant des opportunités de partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques et en contribuant à un partage plus large des avantages commerciaux.
L'aide internationale du Canada
En juin 2017, le Canada a adopté une Politique d'aide internationale féministe, qui oriente la prestation de son aide internationale. Cette politique vise à éradiquer la pauvreté et souligne que la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles constituent le moyen le plus efficace de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère (voir la brève sur la Politique d'aide internationale féministe pour plus de détails).
Le Canada collabore avec les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales et les entités du secteur privé pour la mise en œuvre de son aide internationale. Votre engagement régulier auprès d'organisations locales, internationales et canadiennes de la société civile vous donnera l'occasion de façonner le programme de développement international et de faire progresser les priorités du Canada en matière d'aide internationale et de politique étrangère.
Le Canada s'engage, par le biais de son aide internationale, auprès des économies émergentes d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine, et des Caraïbes. Le Canada a déboursé 7,9 milliards de dollars en 2021-2022 pour répondre aux besoins mondiaux par le biais de divers canaux et partenaires. Au cours des dernières années, l'aide du Canada a été orientée par plusieurs objectifs et engagements, tous découlant de la Politique d'aide internationale féministe :
- Au moins 95 % des initiatives bilatérales d'aide au développement international du Canada viseront ou intégreront l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.
- 15 % de tous les investissements bilatéraux d'aide au développement international seront spécifiquement consacrés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles.
- Pas moins de 50 % de son aide bilatérale au développement international sera dirigée vers les pays d'Afrique subsaharienne.
Des progrès importants ont été réalisés en vue d'atteindre les objectifs. Par exemple, le ministère a dépassé l'objectif de 95 % en matière d'égalité des sexes (programmes ciblés et intégrés combinés en matière d'égalité des sexes) en 2021-2022, atteignant 99 %. Cet objectif a été atteint à plusieurs reprises. À l'heure actuelle, le Canada s'oriente vers un modèle de partenariat plus réactif, dans lequel les programmes sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques et aux opportunités dans les pays partenaires, avec un élan vers un développement mené localement.
En plus de se concentrer sur la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, l'aide internationale du Canada contribue à la protection des « biens publics mondiaux » (tels que la réduction des émissions de carbone, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la prise en charge des urgences sanitaires), qui présentent des avantages à long terme pour les Canadiens. L'aide internationale constitue un outil important, qui contribue à renforcer les relations du Canada avec ses partenaires bilatéraux et facilite la collaboration avec les parties prenantes dans les principaux forums multilatéraux, tels que le système des Nations unies, le G7/G20, le Commonwealth et la Francophonie.
En mettant l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, l'aide internationale du Canada soutient la santé mondiale, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs et la nutrition, l'éducation et la formation professionnelle, la promotion de la gouvernance inclusive et des droits de l'homme, l'amélioration des systèmes alimentaires, ainsi que les questions liées à l'environnement, à la biodiversité et au changement climatique. Le Canada est également reconnu pour son leadership et son engagement en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.
En 2019, le Canada s'est engagé à augmenter son financement pour la santé mondiale et la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris la nutrition dans le monde, à 1,4 milliard de dollars par an pendant 10 ans jusqu'en 2030. Il a également reconnu publiquement qu'une action urgente est nécessaire pour faire face aux crises interconnectées du changement climatique et de la perte de biodiversité, qui affectent de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables, et a également doublé son engagement de financement international pour le climat, qui est passé de 2,65 milliards de dollars à 5,3 milliards de dollars sur une période de 5 ans, de 2021 à 2026, afin de soutenir la transition des pays en développement vers un développement durable à faible émission de carbone, résilient au changement climatique, positif pour la nature et inclusif. Conformément à la Politique d'aide internationale féministe, au moins 80 % des projets de financement climatique intégreront des considérations relatives à l'égalité des sexes, en reconnaissance du fait que les femmes et les filles sont de puissants agents de changement.
Outre ses investissements dans le développement durable à long terme, le Canada contribue de manière significative à l'action humanitaire mondiale. Le Canada est considéré comme un partenaire engagé et constructif dans le système humanitaire international et a joué un rôle dans l'élaboration d'accords internationaux clés qui visaient à renforcer la réponse humanitaire mondiale aux crises, notamment le « Grand Bargain » (un accord entre les plus grands donateurs et les organisations d'aide qui vise à mettre davantage de moyens à la disposition des personnes dans le besoin) et le Pacte mondial sur les réfugiés. Le Canada a été le cinquième plus grand donateur d'aide humanitaire en 2022, fournissant plus d'un milliard de dollars d'aide humanitaire, dont 400 millions de dollars pour répondre à l'Afrique subsaharienne, 277 millions de dollars pour l'Ukraine et plus de 143 millions de dollars pour l'Afghanistan et la région. Les contributions du Canada ont également permis de fournir une aide humanitaire et une protection à plus de 100 millions de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par l'intermédiaire de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.
Certaines régions du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ont connu des conflits armés prolongés qui ont entraîné d'importantes crises humanitaires et des déplacements de populations. Ces conflits pèsent sur les efforts d'assistance internationale, car les organisations humanitaires ont du mal à accéder aux zones touchées et à fournir de l'aide aux communautés vulnérables. La fragilité, les conflits et l'instabilité en Afghanistan, en Haïti, en Éthiopie et au Soudan ont mis en évidence le fait que les efforts d'aide internationale au développement ne suffisent pas à eux seuls à assurer la stabilité, la paix et la prospérité. Les efforts de développement doivent être bien coordonnés avec l'aide humanitaire et les activités de consolidation de la paix dans le cadre d'une approche « triple nexus » afin de stabiliser les États fragiles et touchés par des conflits, de renforcer la résilience et de préserver les acquis du développement au fil du temps.
L'évolution du paysage mondial du développement
Outre les donateurs traditionnels et les acteurs du secteur privé et de la philanthropie, les nouveaux donateurs remettent en question la manière dont l'aide internationale est fournie. Des pays comme la Chine, le Brésil et l'Inde apportent leurs propres perspectives et approches qui ne sont pas toujours alignées sur les valeurs et les intérêts du Canada. Ce paysage de plus en plus dynamique présente des défis, mais aussi, à l'occasion, des possibilités de continuer à faire évoluer notre engagement et de trouver un terrain d'entente avec un éventail plus large de partenaires du développement.
Les nombreuses actions de sensibilisation menées par la Chine dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », de l'initiative pour le développement mondial et de l'initiative pour la sécurité mondiale en ont fait un partenaire économique bienvenu pour de nombreux États. En particulier, la Chine a acquis une solide expérience au cours de la dernière décennie en répondant aux priorités des pays en développement en matière d'infrastructures, y compris numériques. Cela dit, certains ont critiqué le fait que ces projets ont exacerbé la corruption dans des endroits déjà corrompus et ont considérablement alourdi le fardeau de la dette des pays en développement. Le Canada et les donateurs similaires ont été plus lents à réagir, en partie parce que nos outils sont moins bien adaptés à cet objectif. Toutefois, de nouvelles initiatives telles que la passerelle mondiale de l'UE et le partenariat du G7 pour l'infrastructure et l'investissement (PGII) visent à remédier à ce déséquilibre et à réduire le déficit d'investissement dans l'infrastructure dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Par le biais du PGII, par exemple, le G7 vise à mobiliser collectivement 600 milliards d'US$ d'investissements publics et privés en mettant l'accent sur des infrastructures de qualité au cours des 5 prochaines années (2022-2027).
Pour répondre aux besoins nouveaux et émergents des partenaires, l'aide internationale du Canada se concentre de plus en plus sur les besoins en matière de santé, de climat, d'éducation et de sécurité alimentaire. Les travaux politiques en cours renforcent la capacité du Canada en matière de planification stratégique, d'approches féministes de la prestation de l'aide et de développement mené localement, tout en intégrant les priorités plus larges du gouvernement du Canada, telles que la réconciliation et la décolonisation.
Le Canada fournit son aide internationale conformément aux principes d'efficacité du développement reconnus au niveau international. Plusieurs nouveaux mécanismes ont été créés ces dernières années, notamment l'institution financière de développement du Canada, FinDev Canada et 2 nouveaux mécanismes qui utilisent le financement mixte et les contributions remboursables pour mobiliser les investissements du secteur privé dans le développement durable (le Programme d'innovation en matière d'aide internationale et le Programme de prêts souverains).
Les Nations unies estiment que les pays en développement sont confrontés à un déficit d'investissement annuel de 4 000 milliards de dollars au titre des ODD, contre 2 500 milliards de dollars en 2015 lors de l'adoption de l'Agenda 2030. L'APD seule est loin d'être suffisante pour combler ce déficit, ce qui signifie que le financement devra être mobilisé à partir de toutes les sources publiques et privées, en plus de la réforme de l'architecture financière internationale pour gagner en efficacité.
Le Canada reconnaît que les réformes du système multilatéral et la modernisation de l'APD sont également nécessaires pour répondre aux appels à une plus grande inclusion et à une voix plus forte pour le Sud, y compris les réformes des institutions financières internationales et du Conseil de sécurité de l'ONU. L'incapacité à répondre aux priorités des pays en développement à grande échelle pourrait alimenter le ressentiment mondial croissant et contribuer à une communauté mondiale de plus en plus fracturée, ce qui saperait les efforts d'action collective sur une série de questions prioritaires pour le Canada.
Face à l'évolution des défis mondiaux, le Canada actualise et renforce sa capacité à s'engager à l'échelle mondiale en mettant en œuvre l'initiative « L'avenir de la diplomatie » lancée en mai 2023. Le Canada va également de l'avant avec une initiative de transformation des subventions et des contributions d'une durée de 5 ans, de 2023 à 2028. Cette transformation réduira le fardeau administratif des organisations partenaires en mettant en place des systèmes modernes de gestion des relations avec les clients, plus efficaces, plus transparents et plus réactifs.
Conclusion
L'aide internationale du Canada est essentielle pour promouvoir les intérêts, les priorités et l'influence du Canada à l'étranger, tout en améliorant la vie des pauvres et des plus marginalisés dans les pays en développement. Les objectifs généraux de l'aide internationale sont conformes aux valeurs canadiennes telles que le respect de l'État de droit, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la diversité et l'inclusion, la sécurité économique et la durabilité environnementale. Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement défende ces valeurs, tant au niveau national qu'international, et s'accordent généralement à dire que l'aide aux plus pauvres et aux plus marginalisés est la bonne chose à faire.
L'expérience du Canada démontre la valeur de l'aide internationale en termes d'impact sur le développement et d'influence sur la scène mondiale. L'aide internationale permet au Canada de s'engager et de soutenir un large éventail de partenaires de manière à compléter les atouts commerciaux et diplomatiques, à instaurer la confiance, le respect et la collaboration avec les pays partenaires sur diverses questions de politique étrangère, ce qui se traduit par des gains stratégiques pour le Canada sur le plan international, tout en favorisant un monde plus équitable, plus sûr et plus prospère pour tous.
Principales responsabilités du portefeuille
Enjeu
- La loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (2013) précise que le rôle du ministre du Développement international est de « favoriser le développement international durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement et de fournir une assistance humanitaire en cas de crise ».
- Vous travaillerez avec d'autres ministres, sous-ministres et hauts fonctionnaires du ministère, y compris le ministre des affaires étrangères, qui a la responsabilité globale de la conduite des affaires extérieures du Canada, y compris le commerce international et le développement international, comme le prévoit la loi.
Contexte
L'aide internationale constitue un élément clé de l'engagement du Canada dans le monde, ainsi qu’un élément essentiel de notre boîte à outils pour les affaires mondiales. En tant que ministre du Développement international, votre rôle consiste à superviser les investissements du Canada en matière de développement et d'aide humanitaire, au sein d'une équipe élargie de ministres qui se concentrent sur le rôle et l'influence du Canada dans un contexte mondial dynamique.
Avec une croissance continue du financement du développement international à long terme, le Canada a maintenu son attention sur des engagements clés tels que le climat, la santé mondiale, l'égalité des sexes et la finance innovante. Les ressources de base d'Affaires mondiales Canada pour le développement et l'aide humanitaire - qui excluent les ressources limitées dans le temps et exceptionnelles pour la pandémie de COVID-19 et l'Ukraine - suivent une tendance à la hausse depuis 2018-2019, passant de 3,66 milliards de dollars à 4,84 milliards de dollars en 2023-2024, l'enveloppe d'aide internationale du Canada devrait s'élever à 6,88 milliards de dollars en 2023-2024. Affaires mondiales Canada reçoit la plus grande partie de l'enveloppe d'aide internationale en 2023-2024. 88 milliards de dollars en 2023-2024. Affaires mondiales Canada reçoit la majorité de l'enveloppe de l'aide internationale (87 % en 2023-2024), avec des allocations supplémentaires au ministère des Finances, au Centre de recherches pour le développement international, à Environnement et Changement climatique Canada, à Sécurité publique et à Ressources naturelles Canada.
Soutenu par le sous-ministre du développement international, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Fournir une orientation stratégique pour la politique et la programmation en matière de développement international et d'action humanitaire, et travailler en étroite collaboration avec d'autres ministres pour soutenir l'action cohérente du Canada dans le domaine du développement, de l'action humanitaire, de la paix et de la sécurité et du commerce.
- Cogérer l'enveloppe d'aide internationale (EAI) du Canada avec les ministres des affaires étrangères et des finances, en veillant notamment à l'efficacité et aux résultats.
- Rendre compte des activités, des résultats et des dépenses du Canada en matière d'aide internationale par le biais de rapports annuels solides, notamment le Rapport au Parlement sur l'aide internationale du gouvernement du Canada, le Rapport ministériel sur les résultats, le Rapport statistique sur l'aide internationale et le Plan ministériel.
- Assurer le contrôle de la gouvernance du Centre de recherche pour le développement international et présenter ses rapports annuels au Parlement.
Vous travaillerez avec les ministres, les sous-ministres et d'autres hauts fonctionnaires du ministère pour mettre en œuvre la politique d'aide internationale féministe du Canada et promouvoir les valeurs canadiennes, notamment la démocratie et l'inclusion, l'efficacité du développement et l'innovation, et vous vous engagerez activement auprès des parties prenantes canadiennes, internationales, régionales et locales.
Vous travaillerez également avec d'autres collègues du Cabinet pour faire progresser les responsabilités des portefeuilles conjoints, comme la ministre des Familles, des Enfants et du Développement social sur la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable, le ministre des Finances sur les institutions financières internationales, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'action climatique internationale, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et le ministre des Affaires étrangères pour développer les efforts du Canada afin de faire progresser l'égalité des genres à l'étranger.
Vous interagirez également avec les partenaires d'aide internationale du Canada dans les pays en développement et rencontrerez des représentants du gouvernement, des membres de la communauté du développement, des organisations de la société civile, ainsi que des parties prenantes du secteur privé. Dans votre pays, vous jouerez un rôle de premier plan en incitant les Canadiens à s'intéresser aux questions mondiales et en mobilisant leur participation aux initiatives de développement international.
Enveloppe d'assistance internationale
L' Enveloppe d'assistance internationale (EAI) est la réserve de ressources dédiée du gouvernement du Canada et le principal outil de planification budgétaire pour soutenir les objectifs de l'aide internationale. L'EAI finance la majeure partie de l'aide publique au développement (APD) du Canada et des activités de sécurité et de stabilisation non liées au combat à l'appui du Programme de développement durable à l'horizon 2030.
Conformément à son cadre de gestion approuvé par le Cabinet, l'EAI est cogérée par les ministres des affaires étrangères, du développement international et des finances. Avec vos collègues, vous jouerez un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un consensus sur l'orientation politique de l'EAI, en consultation avec les organismes centraux. Les ministres de l'EAI disposent d'autorisations de dépenses spécifiques liées aux bassins de l'EAI dont ils sont (ou vous êtes) responsables.
Responsabilités en matière de programmation
En tant que ministre du Développement international, vous jouerez un rôle important en orientant l'affectation des fonds d'aide internationale du Canada à des programmes et à des initiatives spécifiques, sur la base des décisions du Cabinet et des priorités du gouvernement.
Lors de la préparation des projets, Affaires mondiales Canada suit un processus rigoureux d'évaluation de la diligence raisonnable qui comprend une analyse comparative entre les sexes (Gender-Based Analysis Plus) et veille à ce que les projets soient conformes à la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle (2008). Cette loi exige que, à l'exception de l'aide humanitaire, les projets contribuent à la réduction de la pauvreté, tiennent compte des perspectives des pauvres et soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Les projets doivent également être conformes à la loi sur l'évaluation de l'impact (2019) et à la directive du Cabinet sur les évaluations environnementales stratégiques afin de garantir qu'ils protègent l'environnement et n'entraînent pas d'effets négatifs sur l'environnement.
Gouvernance des banques de développement
Le ministre du développement international est le gouverneur du Canada auprès de l'Union européenne :
- Banque africaine de développement (BAfD)
- Banque asiatique de développement (BAsD)
- Banque de développement des Caraïbes (CDB)
- Banque interaméricaine de développement (BID).
Ces institutions financières internationales (IFI) régionales ont été créées pour soutenir la coopération internationale et aider à gérer le système financier mondial, en particulier les financements innovants. Pour d'autres IFI comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), le ministre des finances est le gouverneur canadien.
Les programmes et projets des IFI visent à réduire la pauvreté, à soutenir le développement économique et social durable et à promouvoir la coopération et l'intégration régionales, par le biais de prêts aux pays à revenu intermédiaire et de prêts concessionnels et de subventions aux pays les plus pauvres, y compris les États fragiles.
En tant que gouverneur, vous êtes responsable de la surveillance et de la gouvernance globale de ces institutions par le Canada, y compris de leur orientation stratégique, de leur responsabilité, de leur efficacité institutionnelle et de leurs décisions en matière de finances et de programmation. Les directeurs exécutifs représentent le Canada au sein des conseils d'administration de ces institutions, qui sont chargés de superviser leurs activités générales.
Centre de recherches pour le développement international
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est une société d'État créée par une loi du Parlement canadien en 1970 (la loi sur le CRDI). Il a pour mission « d'entreprendre, d'encourager, de soutenir et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et sur les moyens d'appliquer et d'adapter les connaissances scientifiques, techniques et autres au progrès économique et social de ces régions », l'égalité entre les hommes et les femmes étant un thème transversal.
Le CRDI est dirigé par un conseil d'administration composé de 14 gouverneurs au maximum, dont le président rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Développement international. Conformément à la loi sur le CRDI, vous recevez le rapport d'audit annuel de l'auditeur général sur le CRDI, que vous déposez ensuite au Parlement dans le cadre du rapport annuel du Centre. Vous êtes également chargé de présenter le rapport annuel sur l'application par le CRDI de la loi sur l'accès à l'information et de la loi sur la protection de la vie privée, et de faire des recommandations au gouverneur en conseil sur les nominations au Conseil des gouverneurs.
FinDev Canada
L’Institution financière de développement du Canada (FinDev Canada), lancée en février 2018, est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). FinDev Canada élargit la boîte à outils du Canada en matière de financement du développement en investissant dans le secteur privé des pays en développement à l'aide d'une approche axée sur l'égalité des sexes afin de promouvoir la croissance économique et de réduire la pauvreté. La prise en compte et l'atténuation des effets du changement climatique constituent également une priorité essentielle.
En avril 2023, FinDev Canada a signé des engagements pour 39 investissements d'une valeur de plus de 768 millions de dollars américains (environ 1 milliard de dollars canadiens). À partir de 2023-2024, FinDev Canada recevra une recapitalisation de 300 millions de dollars sur une période de 3 ans, telle qu’annoncé dans le budget 2021. En novembre 2022, le Canada a lancé sa stratégie indo-pacifique et a annoncé un capital supplémentaire de 750 millions de dollars pour FinDev Canada. Ces augmentations de capital seront financées par les bénéfices non distribués d'EDC.
Conformément à la Loi sur le développement des exportations, le ministre du Commerce international est responsable d'EDC, mais il travaille en consultation avec le ministre du Développement international sur les questions liées au mandat de FinDev Canada. À ce titre, vous examinerez et fournirez des conseils sur les priorités stratégiques de FinDev, la planification d'entreprise et les rapports annuels, ainsi que sur les questions législatives et réglementaires.
Événements ministériels de haut niveau
Août 2023
- 7e Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) – Vancouver, Canada – Du 21 au 30 août
Autres événements de l’année
- Rencontre annuelle Grand Challenges – Dakar, Sénégal – Du 8 au 11 octobre
- Conseil Canadien pour l’entreprise autochtone – Forum des entreprises de la côte ouest – Vancouver, Canada – 19 octobre *Comme alternative à MINT
- 2023 Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) - Marrakech, Maroc du 9 au 15 octobre
- Sommet Canada-EU – Canada (Ville à déterminer) – octobre/automne
- Conférence canadienne sur la santé mondiale – Ottawa, Canada – 16 octobre
- Session de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique (FIP) avec les partenaires du dialogue – Rarotonga, îles Cook – Du 8 au 10 novembre
- [CAVIARDÉ]
- Forum mondial sur les réfugiés – Genève, Suisse – Du 13 au 15 décembre
- Sommet des dirigeants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), (ÀÊC)
Septembre 2023
- Semaine de haut niveau des Nations Unies (UNGA 78) – Ville de New York, États-Unis – Du 17 au 25 septembre
- [CAVIARDÉ]
Événements de niveau PM
Les ministres d’Affaires mondiales Canada peuvent être invités à participer aux événements avec le Premier ministre
- 3e Plateforme de Crimée – ÀÊC – août (ÀÊC)
- Sommet des dirigeants du G20 – New Delhi, Inde – du 9 au 10 septembre
- Sommet des objectifs de développement durable (ODD) – Ville de New York, États-Unis – Du 19 au 20 septembre
- Sommet de l’ASEAN – Indonésie – novembre (ÀÊC)
- Sommet des dirigeants économiques de l’APEC – San Francisco, États-Unis – Semaine du 12 novembre (ÀÊC)
- Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2023 – Dubai, United Arab Emirates – Du 30 novembre au 12 décembre
- Sommet des leaders nord-américains 2023 – Canada – Les mois de novembre et décembre sont les plus probables, mais janvier 2024 reste possible.
B. Le ministère
Vue d’ensemble du Ministère
Enjeu
- Affaires mondiales Canada est chargé de définir et de promouvoir les objectifs intégrés du Canada en matière de politique étrangère, de commerce et d’aide internationale, et de soutenir les intérêts consulaires et commerciaux du Canada. Nous sommes un ministère en réseau qui compte environ 13 900 employés actifs travaillant au Canada et dans 110 pays (dans 178 missions), avec un budget total de 7,6 milliards de dollars.
Contexte
Ce que nous faisons
Affaires mondiales Canada gère les relations du Canada avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, en mobilisant et en influençant les acteurs internationaux afin de promouvoir la sécurité et la prospérité des Canadiens. Il propose une approche cohérente à l’égard des objectifs politiques (c’est-à-dire diplomatiques), commerciaux et d’aide internationale du Canada. Le travail du Ministère est axé sur les cinq responsabilités essentielles suivantes :
- Diplomatie et défense des intérêts à l’échelle internationale : promouvoir les intérêts et valeurs du Canada par l’élaboration de politiques, la diplomatie, la défense des intérêts et l’engagement auprès de divers intervenants. Cela inclut notamment d’établir et d’entretenir des relations bilatérales et multilatérales constructives à l’avantage du Canada; d’assumer un leadership diplomatique sur certaines questions et négociations mondiales; et de soutenir les efforts visant à mettre en place des institutions internationales solides et à faire respecter le droit international, y compris par le recours judicieux aux sanctions.
- Commerce et investissement : soutenir l’accroissement du commerce et de l’investissement afin d’améliorer le niveau de vie de tous les Canadiens. Cela comprend notamment de mettre en place et de préserver un système commercial mondial ouvert et inclusif, fondé sur des règles; de soutenir les exportateurs et les innovateurs canadiens dans leurs efforts de développement commercial international; de négocier des accords commerciaux bilatéraux, plurilatéraux et multilatéraux; d’administrer les contrôles des exportations et des importations; de gérer les différends commerciaux internationaux; de faciliter et d’accroître les investissements étrangers directs; et de soutenir l’innovation, la science et la technologie à l’échelle internationale.
- Programmes en matière de développement, d’aide humanitaire, de paix et de sécurité : contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’augmentation des possibilités pour les populations du monde entier. Cela comprend notamment d’atténuer les souffrances lors des crises humanitaires; de renforcer les possibilités de croissance économique inclusive, durable et équitable; de promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes; d’améliorer les résultats en matière de santé et d’éducation; et de renforcer la paix et la sécurité par des programmes de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, de soutien au renforcement des capacités de lutte contre la criminalité, d’opérations de paix et de gestion des conflits.
- Aide aux Canadiens à l’étranger : fournir en temps utile des informations sur les voyages et des services consulaires appropriés aux Canadiens à l’étranger afin de contribuer à leur sécurité. Ces services comprennent des visites dans les lieux de détention, le déploiement de personnel pour évacuer les Canadiens en cas de crise et la fourniture de documents d’urgence.
- Soutien à la présence du Canada à l’étranger : fournir des ressources, des infrastructures et des services pour permettre une présence de l’ensemble du gouvernement et du Canada à l’étranger. Cela comprend la gestion de nos missions à l’étranger et la mise en œuvre d’une initiative majeure de devoir de diligence pour assurer la protection du personnel du gouvernement du Canada, des infrastructures à l’étranger et de l’information.
Responsabilités juridiques
Le Ministère est la principale source de conseils sur le droit international public ainsi que sur le commerce international et le droit de l’investissement pour le gouvernement du Canada. Les avocats d’Affaires mondiales Canada conseillent le gouvernement sur ses obligations juridiques internationales ainsi que sur la négociation et l’interprétation des traités, et interviennent dans les litiges internationaux. En outre, les juristes du ministère de la Justice fournissent des services juridiques au Ministère en ce qui concerne les questions de droit interne, notamment en matière de litiges et de réglementation.
Effectifs
Le Ministère compte environ 13 900 employés actifs; 8 300 d’entre eux sont des employés canadiens (EC), qui travaillent soit au Canada, soit dans nos missions à l’étrangerNote de bas de page 1. Les 5 600 employés restants sont des employés recrutés sur place (ERP), généralement des citoyens étrangers embauchés dans leur propre pays pour fournir des services de soutien dans nos missions. Environ 56 % des EC sont des femmes (contre 59 % des ERP), et 61 % des EC ont l’anglais comme première langue officielle (39 % le français).
Le personnel d’Affaires mondiales Canada travaille dans certains des endroits les plus difficiles de la planète, y compris dans des zones de conflit actif. L’effectif canadien comprend un groupe d’employés permutants (environ 26 % de l’effectif) qui contribuent à l’exécution du mandat du Ministère par le biais d’affectations allant généralement de deux à quatre ans, alternant entre les missions à l’étranger et l’administration centrale ou les bureaux régionaux du Canada. Les chefs de mission sont responsables de l’engagement « pangouvernemental » du Canada dans leur pays d’accréditation et de la supervision de tous les programmes fédéraux présents dans la mission. Ce travail important ne serait pas possible sans la contribution de la main-d’œuvre traditionnelle (environ 74 % de la main-d’œuvre) située à l’administration centrale, qui fournit des orientations en matière de politiques, des conseils, des outils et un soutien aux services internes afin de remplir le mandat du Ministère.
Finances
Le financement total demandé par le Ministère dans le Budget principal des dépenses 2023-2024 était de 7,6 milliards de dollars. Ce montant comprend :
- Crédit 1 (fonctionnement) : 1 960,8 millions de dollars
- Crédit 5 (capital) : 197,4 millions de dollars
- Crédit 10 (subventions et contributions) : 4 946,7 millions de dollars
- Crédit 15 (régimes de retraite, d’assurance et de sécurité sociale des ERP) : 102,5 millions de dollars
- Postes législatifs (p. ex. paiements directs aux institutions financières internationales; contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés) : 369,2 millions de dollars.
La répartition du budget par responsabilité essentielle du Ministère dans le Budget principal des dépenses 2023-2024 a été communiquée comme suit :
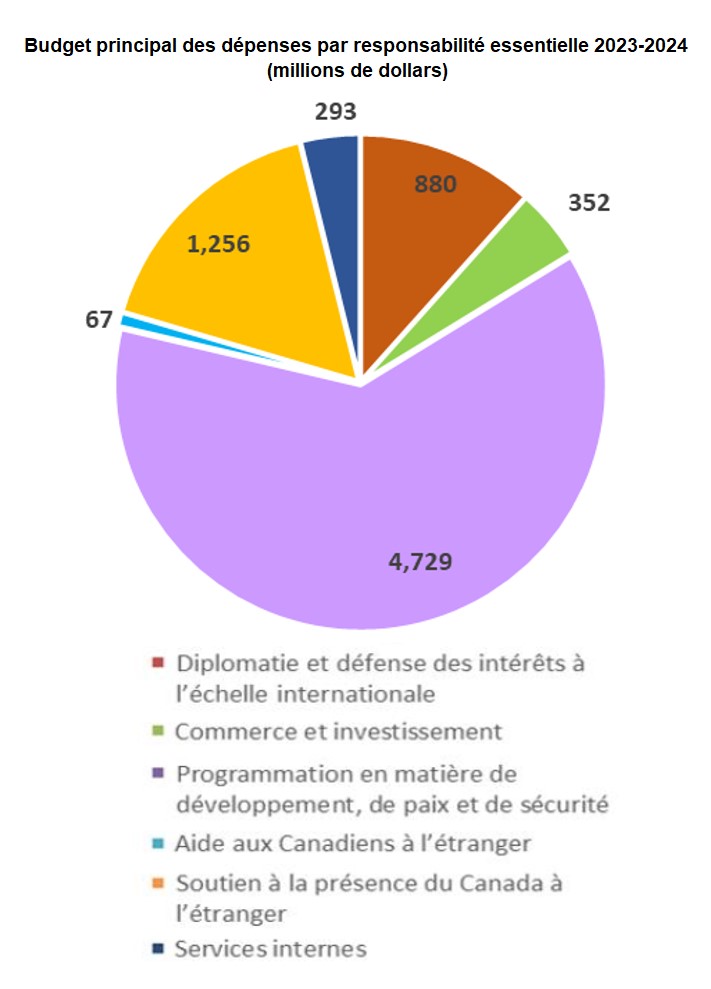
Version texte
Tableau résumant les dépenses prévues en 2023-2024, par responsabilité essentielle :
Diplomatie et défense des intérêts à l’échelle internationale : 880 millions de dollars
Commerce et investissement : 352 millions de dollars
Programmation en matière de développement, de paix et de sécurité : 4729 millions de dollars
Aide aux Canadiens à l’étranger : 67 millions de dollars
Soutien à la présence du Canada à l’étranger : 1256 millions de dollars
Services internes : 293 millions de dollars
Réseau
Le vaste réseau du Ministère à l’étranger compte 178 missions dans 110 pays. Le type et le statut de ces missions varient, allant des grandes ambassades aux petits bureaux de représentation et aux consulats. Ce réseau soutient également les activités internationales des ministères, des organismes et des sociétés d’État ainsi que des provinces.
Le Ministère dispose de six bureaux régionaux au Canada, notamment pour établir le contact avec les entreprises canadiennes, situés à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax.
Haute direction et gouvernance ministérielle
En appui aux ministres, les plus hauts fonctionnaires du Ministère sont le sous-ministre des Affaires étrangères (USS), le sous-ministre du Commerce international (DMT), le sous-ministre du Développement international (DME) et la sous-ministre déléguée des Affaires étrangères (DMA). Seize secteurs, dirigés par des sous-ministres adjoints, rendent compte aux sous-ministres et sont chargés de fournir des conseils intégrés pour tous les portefeuilles, qu’il s’agisse de régions géographiques ou d’enjeux fonctionnels ou institutionnels.
Le cadre de gouvernance ministérielle du Ministère comprend des comités spécialisés dans l’audit, l’évaluation, la sécurité, les opérations financières, la gestion ministérielle, les politiques et les programmes, ainsi que la diversité et l’inclusion.
Planification et rapports
Le processus de planification et de rapport annuel du Ministère est structuré autour de son Cadre des résultats ministériels, qui s’articule lui-même autour des cinq responsabilités essentielles décrites ci-dessus dans la présente note.
Un plan ministériel fournit ensuite une vue d’ensemble des priorités liées aux politiques, des résultats prévus et des besoins en ressources connexes pour l’exercice financier à venir. Ce document est approuvé par les ministres et présenté au Parlement (généralement en février ou mars). Le plan présente également les objectifs de rendement au regard desquels le Ministère rendra compte des résultats à la fin de l’exercice financier dans le cadre d’un Rapport sur les résultats ministériels, présenté au Parlement à l’automne.
Sous-ministres
Sous-ministre des Affaires étrangères, David Morrison

Le 12 octobre 2022, le premier ministre a nommé David Morrison au poste de sous-ministre des Affaires étrangères.
Avant d’occuper ce poste, M. Morrison a assumé les fonctions de sous-ministre du Commerce international, et de conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre. Il a également été représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G7.
À Affaires mondiales Canada, M. Morrison a auparavant occupé les postes de sous-ministre délégué des Affaires étrangères de 2017 à 2018, et de sous-ministre adjoint du Secteur des Amériques de 2013 à 2017. En 2012 et en 2013, il a été vice-président principal à l’Agence canadienne de développement international.
M. Morrison a également été secrétaire exécutif du Fonds d’équipement des Nations Unies de 2008 à 2012, et porte-parole et directeur des communications du Programme des Nations Unies pour le développement de 2004 à 2008. Il a également été président fondateur de NetAid, un partenariat entre les Nations Unies et Cisco Systems afin d’utiliser Internet pour lutter contre la pauvreté dans le monde, de 2000 à 2004.
M. Morrison a commencé sa carrière au sein du Programme des Nations Unies pour le développement en Corée du Nord à la fin des années 1980. Il a été agent politique à l’ambassade du Canada à La Havane de 1991 à 1994, et directeur et membre du conseil de direction du Forum économique mondial à Genève, où il était responsable du programme du sommet annuel à Davos de 1995 à 1999.
M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en philosophie (relations internationales) de l’Université d’Oxford et d’un baccalauréat en histoire de l’Université Yale.
Sous-ministre du Commerce international, Rob Stewart

M. Rob Stewart a été nommé sous-ministre du commerce international à compter du 17 octobre 2022.
Avant sa nomination, M. Stewart a occupé le poste de sous-ministre de la sécurité publique pendant trois ans. Au cours de cette période, il a assuré le leadership sur une variété d’enjeux liés à la sécurité nationale, à la sécurité communautaire et à la lutte contre la criminalité, aux services de police autochtones, aux armes à feu, à la sécurité frontalière et à la gestion des urgences, y compris les demandes d’aide fédérale relatives à la pandémie et aux catastrophes naturelles majeures.
M. Stewart a consacré la majeure partie de sa carrière à la fonction publique au ministère des Finances Canada, où il travaillait depuis 1993. Il a occupé, de 2016 à 2019, le poste de sous-ministre délégué et représentant du gouvernement du Canada en matière de finances auprès du G7 et du G20, et du Conseil de stabilité financière. Il a fait preuve de leadership et donné des conseils stratégiques au gouvernement sur un large éventail de questions touchant le secteur financier, le commerce international et les finances. Auparavant, il a été sous-ministre adjoint de la politique du secteur financier pendant deux ans, avant quoi il occupait le poste de sous-ministre adjoint des finances et des échanges internationaux pendant quatre ans. Avant de se joindre au ministère des Finances du Canada, Rob a travaillé à Exportation et développement Canada et dans le système sportif canadien.
Il détient un baccalauréat ès arts de l’Université Carleton (1981) et un MBA de l’Université d’Ottawa (1987).
Sous-ministre du Développement international, Christopher MacLennan

Depuis janvier 2022, Christopher MacLennan occupe le poste de sous-ministre du Développement international, dans le cadre duquel il est à la tête du mandat en matière d’aide internationale et de réponse humanitaire du gouvernement du Canada. Il est également représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G20, un poste qu’il occupe depuis 2020.
Avant d’occuper son poste actuel, M. MacLennan était sous-ministre délégué des Affaires étrangères, où il appuyait la sous-ministre et la ministre des Affaires étrangères. Auparavant, à titre de sous-ministre adjoint (SMA) à Affaires mondiales Canada, il a dirigé les efforts du Canada concernant l’aide internationale au développement par l’entremise de partenaires multilatéraux et mondiaux, de l’aide humanitaire et de relations prioritaires en matière de politique étrangère avec les Nations Unies, le Commonwealth et la Francophonie. En plus d’assumer ce rôle, il occupait simultanément le poste de sous-sherpa des Affaires étrangères du Canada au sein du G7.
- MacLennan a également occupé diverses fonctions au Bureau du Conseil privé du Canada (secrétariat du Cabinet), notamment secrétaire adjoint par intérim pour les priorités et la planification et sous-ministre adjoint de l’innovation en matière de politiques. Auparavant, M. MacLennan a assuré plusieurs fonctions au niveau de la direction à l’ancienne Agence canadienne de développement international, en grande partie axées sur la santé mondiale, la gouvernance démocratique et la sécurité alimentaire.
- MacLennan est titulaire d’un doctorat de l’Université Western, avec spécialisation en développement constitutionnel et en droits internationaux de la personne. De 2012 à 2013, il a été chercheur invité Fullbright au Center on Democracy, Development and the Rule of Law de l’Université Stanford. M. MacLennan est l’auteur de nombreux ouvrages, y compris : Toward the Charter: Canadians and the Demand for a National Bill of Rights, 1929–1960.
Sous-ministre déléguée des Affaires étrangères et sherpa du G7, Cindy Termorshuizen

Le 5 janvier 2022, le premier ministre Justin Trudeau a nommé Cynthia (Cindy) Termorshuizen au poste de sous-ministre déléguée des Affaires étrangères. Depuis le 31 mai 2023, elle exerce en parallèle le poste de représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour le sommet du G7.
D’octobre 2020 à janvier 2022, Mme Termorshuizen était sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences, à Affaires mondiales Canada.
Mme Termorshuizen a auparavant occupé divers postes à Affaires mondiales Canada, y compris ceux de directrice générale, Politique de sécurité internationale, de chef de mission adjointe à l’ambassade du Canada en Chine et de chef de mission adjointe à l’ambassade du Canada en Afghanistan.
Au début de sa carrière, Mme Termorshuizen a également occupé divers postes au Bureau du Conseil privé et au ministère de la Défense nationale.
Mme Termorshuizen est titulaire d’une maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université Carleton et d’un baccalauréat en développement international et en français de l’Université de Guelph.
Structure organisationnelle
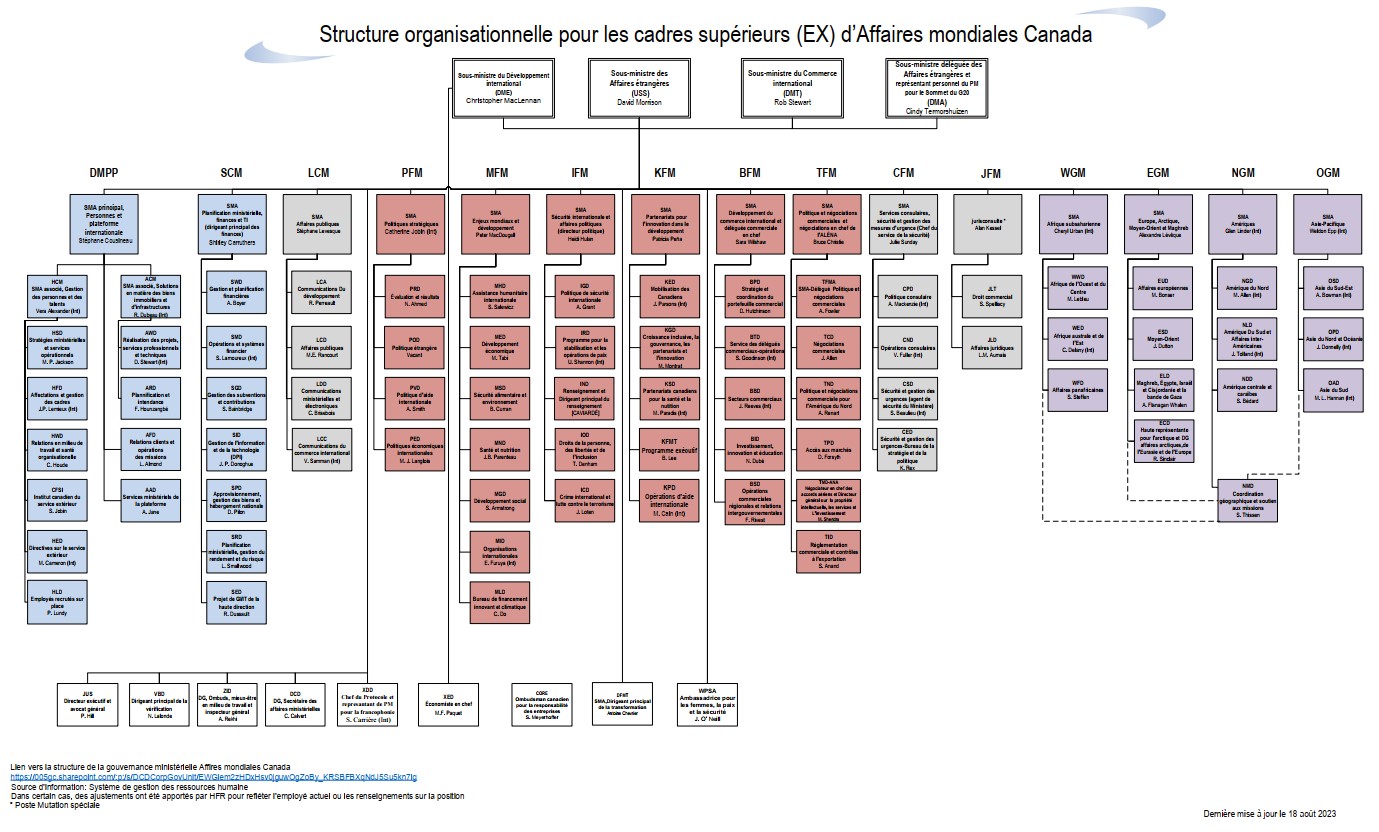
Version texte
Structure organisationnelle de la direction (EX) d’Affaires mondiales Canada
Niveau 1 – Sous-ministres et coordonnateur
Sous-ministre du Développement international – Christopher MacLennan (DME)
Sous-ministre des Affaires étrangères – David Morrison (USS)
Sous-ministre délégué des Affaires étrangères – Cindy Termorshuizen (DMA)
Sous-ministre du Commerce international – Rob Stewart (DMT)
Niveau 2 – Sous-ministres adjoints et directeurs généraux
Relevant du sous-ministre, Développement international :
Économiste en Chef – M.F. Paquet (XED)
Relevant de tous les sous-ministres:
Sous-ministre adjoint principal, Personnes et plateforme internationale – Stéphane Cousineau (DMPP)
Sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (agent principal des finances) – Shirley Carruthers (SCM)
Sous-ministre adjoint, Affaires publiques – Stéphane Levesque (LCM)
Sous-ministre adjointe, Politique et planification stratégique – Catherine Jobin (Int) (PFM)
Sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement – Peter MacDougall (MFM)
Sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique) – Heidi Hulan (IFM)
Sous-ministre adjointe, Partenariats pour l’innovation dans le développement – Patricia Pena (KFM)
Sous-ministre adjointe, Développement du commerce international, et déléguée commerciale en chef – Sara Wilshaw (BFM)
Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique et des négociations commerciales et négociateur en chef pour l’ALENA – Bruce Christie (TFM)
Sous-ministre adjointe, Secteur des services consulaires, de la sécurité et de la gestion des urgences (chef de la sécurité) – Julie Sunday (CFM)
Conseiller juridique – Alan Kessel (JFM) – Affectation spéciale
Sous-ministre adjointe, Secteur de l’Afrique subsaharienne – Cheryl Urban (Int) (WGM)
Sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb – Alexandre Lévêque (EGM)
Sous-ministre adjoint, Amériques – Glen Linder (Int) (NGM)
Sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique – Weldon Epp (Int) (OGM)
Directeur général et avocat général – P. Hill (JUS)
Dirigeant principal de la vérification – N. Lalonde (Int) (VBD)
Directeur général, Ombuds, mieux-être en milieu de travail et inspecteur général – A. Rekhi (ZID)
Secrétaire ministérielle et directrice générale – C. Calvert (DCD)
Chef du Protocole – S. Carrière (Int) (XDD)
Ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité – Jacqueline O’Neil (WPSA)
Relevant du sous-ministre adjoint principal, Personnes et plateforme internationale:
Sous-ministre adjoint associé, Gestion des personnes et des talents – Vera Alexander (HCM)
Sous-ministre adjoint associé, Solutions en matière des biens immobiliers et d’infrastructure – R. Dubeau (Int) (ACM)
Niveau 3 – Directeurs généraux
Sous-ministre adjoint associé, Gestion des personnes et des talents
Ressources humaines, stratégies ministérielles et services opérationnels – M. P. Jackson (HSD)
Affectations et gestion des cadres – J.P. Lemieux (Int) (HFD)
Direction générale des relations en milieu de travail et santé organisationnelle – C. Houde (HWD)
Institut canadien du service extérieur – S. Jobin (CFSI)
Directives sur le service extérieur – M. Cameron (Int) (HED)
Employés recrutés sur place – P. Lundy (HLD)
Sous-ministre adjoint associé, Solutions en matière des biens immobiliers et d’infrastructure
Relations avec les clients et opérations des missions – L. Almond (AFD)
Planification et intendance – F. Hounzangbé (ARD)
Services ministériels de la Plateforme – A. Jane (AAD)
Réalisation de projets, services professionnels et techniques – D. Stewart (Int) (AWD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Planification ministérielle, finances et technologies de l’information (dirigeant principal des finances)
Planification et gestion financières – A. Boyer (SWD)
Opérations et systèmes financiers – Lamoureux (Int) (SMD)
Gestion des subventions et des contributions – S. Bainsbridge (SGD)
Gestion de l’information et de la technologie (DPI) – J.P. Donoghue (SID)
Directeur général, Approvisionnement corporatif, gestion de l’actif et locaux nationaux – D. Pilon (SPD)
Planification ministérielle et gestion du rendement et du risque – L. Smallwood (SRD)
Chef de projet principal de la GI-TI – R. Dussault (SED)
Relevant du sous-ministre adjoint, Affaires publiques
Communications sur le développement – R. Perreault (LCA)
Affaires publiques – M.E. Rancourt (LCD)
Communications ministérielles et électroniques – C. Brisebois (LDD)
Communications sur le commerce – V. Samaan (Int) (LCC)
Relevant du sous-ministre adjoint, Politique stratégique
Évaluation et résultats – N. Ahmad (PRD)
Politique étrangère – Vacant (POD)
Politique d’aide internationale – A. Smith (PVD)
Politiques économiques internationales – M. J. Langois (PED)
Relevant du sous-ministre adjoint, Enjeux mondiaux et développement
Assistance humanitaire internationale – S. Salewicz (MHD)
Développement économique – M. Tabi (MED)
Sécurité alimentaire et Environnement – B. Curran (MSD)
Santé et Nutrition – J.B. Parenteau (MND)
Développement social – S. Armstrong (MGD)
Organisations internationales – E. Furuya (Int) (MID)
Bureau de financement innovant et climatique – C. Do (MLD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Sécurité internationale et affaires politiques (directeur politique)
Politique de sécurité internationale – A. Grant (IGD)
Programme pour la stabilisation et les opérations de paix – U. Shannon (Int) (IRD)
Renseignement et Dirigeant principal du renseignement – [CAVIARDÉ] (IND)
Droits de la personne, libertés et inclusion – T. Denham (IOD)
Crime international et lutte contre le terrorisme – J. Loten (ICD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Partenariats pour l’innovation dans le développement
Mobilisation des Canadiens – J. Parsons (Int) (KED)
Partenariats pour la croissance économique durable – M. Montrat (KGD)
Partenariat canadien pour la santé et le développement social – M. Paradis (KSD)
Programme exécutif – B. Lee (KFMT)
Opérations d’aide internationale – M. Cain (Int) (KPD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Développement du commerce international, et délégué commercial en chef
Stratégie du portefeuille commercial et de la coordination – D. Hutchinson (BPD)
Service des délégués commerciaux – Opérations – S. Goodinson (Int) (BTD)
Secteurs commerciaux – J. Reeves (Int) (BBD)
Investissement, innovation et éducation – N. Dubé (BID)
Opérations commerciales régionales et relations intergouvernementales – F. Rivest (BSD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales, et négociateur en chef pour l’ALENA
Sous-ministre adjoint délégué, Politique et négociations commerciales – A. Fowler (TFMA)
Négociations commerciales – J. Allen (TCD)
Politique et négociations commerciales en Amérique du Nord – A. Renart (TND)
Accès aux marchés – D. Forsyth (TPD)
Négociateur en chef des services aériens et directeur général pour les services, la propriété intellectuelle et les investissements – M. Shendra (TMD)
Réglementation commerciale et contrôles à l’exportation – S. Anand (TID)
Relevant du sous-ministre adjoint, Services consulaires, Sécurité et Gestion des urgences
Politique consulaire – A. Mackenzie (Int) (CPD)
Opérations consulaires – V. Fuller (Int) (CND)
Sécurité et gestion des urgences (agent de sécurité du Ministère) – S. Beaulieu (Int) (CSD)
Sécurité et gestion des urgences-Bureau de la stratégie et de la politique – K. Rex (CED)
Relevant du conseiller juridique
Droit commercial – S. Spelliscy (JLT)
Affaires juridiques – L.M. Aumais (JLD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Afrique subsaharienne
Afrique de l’Ouest et du Centre – M. Lebleu (WWD)
Afrique australe et de l’Est – C. Delany (Int) (WED)
Direction générale panafricaine – S. Steffen (WFD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb
Affaires européennes – M. Bonser (EUD)
Moyen-Orient – J. Dutton (ESD)
Maghreb, Égypte, Israël, Cisjordanie et Gaza – A. Flanagan Whalen (ELD)
Haut représentant de l’Arctique et directeur général, Affaires de l’Arctique, de l’Eurasie et de l’Europe – R. Sinclair (ECD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Amériques
Stratégie pour l’Amérique du Nord – M. Allen (Int) (NGD)
Amérique du Sud et Affaires interaméricaines – J. Tolland (Int) (NLD)
Amérique centrale et Caraïbes – S. Bédard (NDD)
Coordination géographique et appui aux missions – S. Thissen (NMD)
Relevant du sous-ministre adjoint, Asie-Pacifique
Asie du Sud-Est – A. Bowman (Int) (OSD)
Asie du Nord et Océanie – J. Donnelly (Int) (OPD)
Asie du Sud – M.L. Hannan (Int) (OAD)
Niveau 4 – À l’extérieur de la structure organisationnelle principale
Ombudsman canadienne pour la responsabilité sociale des entreprises – S. Meyerhoffer (CORE)
Source de renseignements : Système de gestion des ressources humaines (SGRH)
Dans certains cas, des corrections ont été apportées par HFR pour tenir compte de l’information la plus récente sur les employés ou les postes.
Lien vers la structure de gouvernance ministérielle d’Affaires mondiales Canada
https://005gc.sharepoint.com/:p:/s/DCDCorpGovUnit/EWGlem2zHDxHsv0jguwOgZoBy_KRSBFBXqNdJ5Su5kn7Ig
Carte du réseau
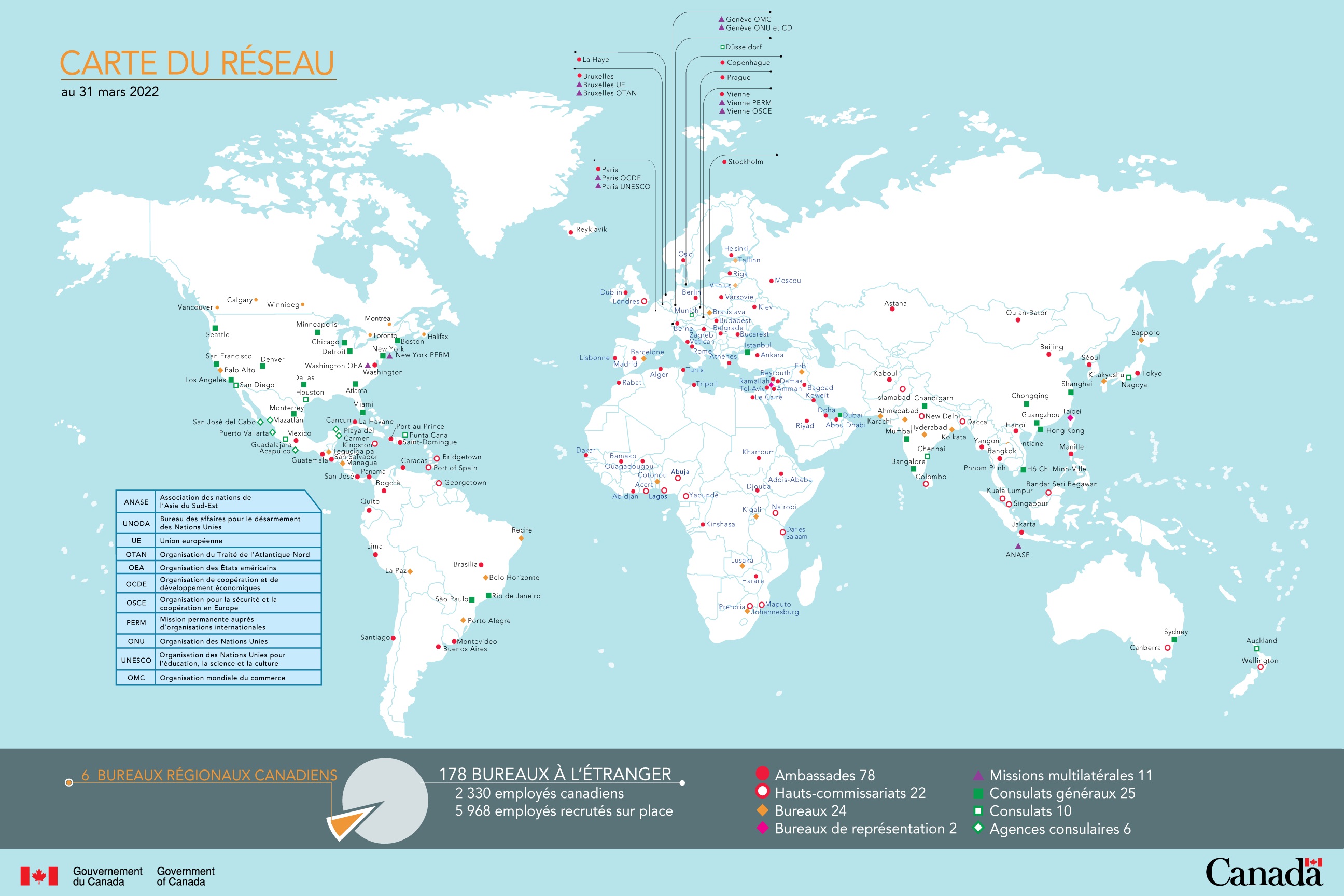
Version texte
Missions et points de service par portefeuille géographique et catégorie
Europe et Moyen-Orient
| Mission | Désignation - titre |
|---|---|
Ambassades | |
Abou Dhabi | Ambassade du Canada aux Émirats arabes unis |
Alger | Ambassade du Canada en Algérie |
Amman | Ambassade du Canada en Jordanie |
Ankara | |
Astana | |
Athènes | Ambassade du Canada en Grèce |
Bagdad | Ambassade du Canada en Irak |
Beyrouth | Ambassade du Canada au Liban |
Belgrade | Ambassade du Canada en République de Serbie |
Berlin | Ambassade du Canada en Allemagne |
Berne | Ambassade du Canada en Suisse |
Bruxelles | |
Bucarest | Ambassade du Canada en Roumanie |
Budapest | |
Le Caire | Ambassade du Canada en Égypte |
Copenhague | |
Damas | Ambassade du Canada en Syrie |
Doha | Ambassade du Canada au Qatar |
Dublin | |
La Haye | Ambassade du Canada aux Pays-Bas |
Helsinki | Ambassade du Canada en Finlande |
Koweït | Ambassade du Canada au Koweït |
Kiev | Ambassade du Canada en Ukraine |
Lisbonne | Ambassade du Canada au Portugal |
Madrid | Ambassade du Canada en Espagne |
Moscou | Ambassade du Canada en Russie |
Oslo | Ambassade du Canada en Norvège |
Paris | Ambassade du Canada en France |
Prague | Ambassade du Canada auprès de la République tchèque |
Rabat | Ambassade du Canada au Maroc |
Reykjavik | Ambassade du Canada en Islande |
Riga | Ambassade du Canada en Lettonie |
Riyad | Ambassade du Canada en Arabie saoudite |
Rome | Ambassade du Canada en Italie |
Stockholm | Ambassade du Canada en Suède |
Tel-Aviv | Ambassade du Canada en Israël |
Tripoli | Ambassade du Canada en Libye |
Tunis | Ambassade du Canada en Tunisie |
Vatican (Cité du) | Ambassade du Canada auprès du Saint-Siège |
Vienne | Ambassade du Canada en Autriche |
Varsovie | Ambassade du Canada en Pologne |
Zagreb | Ambassade du Canada en Croatie |
Hauts-commissariats | |
Londres | Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni |
Bureaux | |
Bratislava | Bureau de l'ambassade du Canada, Bratislava |
Tallinn | Bureau de l'ambassade du Canada, Tallinn |
Vilnius | Bureau de l'ambassade du Canada, Vilnius |
Barcelone | Consulat et bureau commercial du Canada, Barcelone |
Erbil | Bureau de l'ambassade du Canada, Erbil |
Bureaux de représentation | |
Ramallah | Bureau de représentation du Canada, Ramallah |
Missions multilatérales | |
Bruxelles UE | Mission du Canada auprès de l'Union européenne |
Bruxelles OTAN | Délégation canadienne conjointe auprès du Conseil de l'Atlantique Nord |
Genève ONU et CD | Mission permanente du Canada auprès du Bureau des Nations Unies et de la Conférence sur le désarmement |
Genève OMC | Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce |
Paris OCDE | Délégation permanente du Canada à l’Organisation de coopération et de développement économiques |
Paris UNESCO | Délégation permanente du Canada à l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture |
Vienne OSCE | Délégation canadienne à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
Vienne PERM | Mission permanente auprès des organisations internationales (AIEA, OTICE, ONUDC/ONUV) |
Consulats généraux | |
Istanbul | Consulat général du Canada, Istanbul |
Dubaï | Consulat général du Canada, Émirats arabes unis |
Consulats | |
Düsseldorf | Consulat du Canada, Düsseldorf |
Munich | Consulat du Canada, Munich |
Asie-Pacifique
| Mission | Désignation - titre |
|---|---|
Ambassades | |
Bangkok | Ambassade du Canada en Thaïlande |
Beijing | Ambassade du Canada en Chine |
Hanoï | Ambassade du Canada au Vietnam |
Jakarta | Ambassade du Canada en Indonésie |
Kaboul | Ambassade du Canada en Afghanistan |
Manille | Ambassade du Canada aux Philippines |
Séoul | Ambassade du Canada en République de Corée |
Tokyo | Ambassade du Canada au Japon |
Oulan-Bator | Ambassade du Canada en Mongolie |
Yangon | Ambassade du Canada au Myanmar |
Hauts-commissariats | |
Bandar Seri Begawan | Haut-commissariat du Canada à Brunéi Darussalam |
Canberra | Haut-commissariat du Canada en Australie |
Colombo | Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka |
Dhaka | Haut-commissariat du Canada au Bangladesh |
Islamabad | Haut-commissariat du Canada au Pakistan |
Kuala Lumpur | Haut-commissariat du Canada en Malaisie |
New Delhi | Haut-commissariat du Canada en Inde |
Singapour | Haut-commissariat du Canada à Singapour |
Wellington | Haut-commissariat du Canada en Nouvelle-Zélande |
Bureaux | |
Phnom Penh (1er sept 2015) | Bureau de l'ambassade du Canada, Thaïlande |
Vientiane (1er sept 2015) | Bureau de l'ambassade du Canada, Laos |
Ahmedabad | Bureau commercial du Canada, Ahmedabad |
Hyderabad | Bureau commercial du Canada, Hyderabad |
Karachi | Bureau commercial du Canada, Karachi |
Kitakyushu | Bureau commercial du Canada, Kitakyushu |
Kolkata | Bureau commercial du Canada, Kolkata |
Sapporo | Bureau commercial du Canada, Sapporo |
Bureaux de représentation | |
Taïpei | Bureau commercial du Canada à Taïpei |
Missions multilatérales | |
ANASE (1er août 2015) | Association des nations de l'Asie du Sud-Est |
Consulats généraux | |
Bangalore | Consulat général du Canada, Bangalore |
Chandigarh | Consulat général du Canada, Chandigarh |
Chongqing | Consulat général du Canada, Chongqing |
Guangzhou | Consulat général du Canada, Guangzhou |
Ho Chi Minh-Ville | Consulat général du Canada, Ho Chi Minh-Ville |
Hong Kong | Consulat général du Canada, Hong Kong |
Mumbai | Consulat général du Canada, Mumbai |
Shanghai | Consulat général du Canada, Shanghai |
Sydney | Consulat général du Canada, Sydney |
Consulats | |
Auckland | Consulat et bureau commercial du Canada, Auckland |
Chennai | Consulat du Canada, Chennai |
Nagoya | Consulat du Canada, Nagoya |
Afrique
| Mission | Désignation - titre |
|---|---|
Ambassades | |
Abidjan | Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire |
Addis-Abeba | Ambassade du Canada en Éthiopie |
Bamako | Ambassade du Canada au Mali |
Dakar | Ambassade du Canada au Sénégal |
Harare | Ambassade du Canada au Zimbabwe |
Djouba | Ambassade du Canada au Soudan du Sud |
Khartoum | Ambassade du Canada au Soudan |
Kinshasa | Ambassade du Canada en République démocratique du Congo |
Ouagadougou | Ambassade du Canada au Burkina Faso |
Hauts-commissariats | |
Abuja | Haut-Commissariat du Canada au Nigéria |
Accra | Haut-Commissariat du Canada au Ghana |
Dar es Salaam | Haut-Commissariat du Canada en Tanzanie |
Lagos | Haut-commissariat auxiliaire du Canada au Nigéria |
Maputo | Haut-Commissariat du Canada au Mozambique |
Nairobi | Haut-Commissariat du Canada au Kenya |
Pretoria | Haut-Commissariat du Canada en Afrique du Sud |
Yaoundé | Haut-Commissariat du Canada au Cameroun |
Bureaux | |
Cotonou | Bureau de l'ambassade du Canada au Bénin |
Kigali | Bureau du Haut-commissariat du Canada en République du Rwanda |
Lusaka | Bureau du Haut-commissariat du Canada en Zambie |
Johannesburg | Bureau commercial du Haut-commissariat du Canada à Johannesburg |
Amériques
| Mission | Désignation - titre |
|---|---|
Ambassades | |
Bogota | Ambassade du Canada en Colombie |
Brasilia | Ambassade du Canada au Brésil |
Buenos Aires | Ambassade du Canada en Argentine |
Caracas | Ambassade du Canada en République bolivarienne du Venezuela |
Guatemala | Ambassade du Canada au Guatemala |
La Havane | Ambassade du Canada à Cuba |
Lima | Ambassade du Canada au Pérou |
Mexico | Ambassade du Canada au Mexique, à Mexico |
Montevideo | Ambassade du Canada en Uruguay |
Panama | Ambassade du Canada au Panama |
Port-au-Prince | Ambassade du Canada en Haïti |
Quito | Ambassade du Canada en Équateur |
San José | Ambassade du Canada au Costa Rica |
San Salvador | Ambassade du Canada au Salvador |
Santiago | Ambassade du Canada au Chili |
Santo Domingo | Ambassade du Canada en République dominicaine |
Washington | Ambassade du Canada aux États-Unis d'Amérique, à Washington |
Hauts-commissariats | |
Bridgetown | Haut-commissariat du Canada à la Barbade |
Georgetown | Haut-commissariat du Canada au Guyana |
Kingston | Haut-commissariat du Canada en Jamaïque |
Port of Spain | Haut-commissariat du Canada à Trinité-et-Tobago |
Bureaux | |
La Paz | Bureau de l'ambassade du Canada, La Paz |
Managua | Bureau de l'ambassade du Canada, Managua |
Tegucigalpa | Bureau de l'ambassade du Canada, Tegucigalpa |
Belo Horizonte | Bureau commercial du Canada, Belo Horizonte |
Palo Alto (Californie) | Bureau commercial du Canada, Palo Alto |
Porto Alegre | Bureau commercial du Canada, Porto Alegre |
Recife | Bureau commercial du Canada, Recife |
Missions multilatérales | |
New York PERM | Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies |
Washington OEA | Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des États américains |
Consulats généraux | |
Atlanta (Georgie) | Consulat général du Canada, Atlanta |
Boston (Massachusetts) | Consulat général du Canada, Boston |
Chicago (Illinois) | Consulat général du Canada, Chicago |
Dallas (Texas) | Consulat général du Canada, Dallas |
Denver (Colorado) | Consulat général du Canada, Denver |
Detroit (Michigan) | Consulat général du Canada, Detroit |
Los Angeles (Californie) | Consulat général du Canada, Los Angeles |
Miami (Floride) | Consulat général du Canada, Miami |
Minneapolis (Minnesota) | Consulat général du Canada, Minneapolis |
Monterrey | Consulat général du Canada, Monterrey |
New York (New York) | Consulat général du Canada, New York |
Rio de Janeiro | Consulat général du Canada, Rio de Janeiro |
San Francisco (Californie) | Consulat général du Canada, San Francisco |
Sao Paulo | Consulat général du Canada, Sao Paulo |
Seattle (Washington) | Consulat général du Canada, Seattle |
Consulats | |
Guadalajara | Consulat du Canada, Guadalajara |
Houston (Texas) | Consulat du Canada, Houston |
Punta Cana | Consulat du Canada, Punta Cana |
San Diego (Californie) | Consulat du Canada, San Diego |
Acapulco | Agence consulaire du Canada, Acapulco |
Cancun | Agence consulaire du Canada, Cancun |
Mazatlan | Agence consulaire du Canada, Mazatlan |
Playa del Carmen | Agence consulaire du Canada, Playa del Carmen |
Puerto Vallarta | Agence consulaire du Canada, Puerto Vallarta |
San José del Cabo | Agence consulaire du Canada, San José del Cabo |
Canada
| Mission | Désignation - titre |
|---|---|
Bureaux régionaux canadiens | |
Calgary | Bureau régional du Service des délégués commerciaux (SDC) pour l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest |
Halifax | Bureau régional Atlantique |
Montréal | Bureau régional Québec et Nunavut |
Toronto | Bureau régional Ontario |
Vancouver | Bureau régional Pacifique |
Winnipeg | Bureau régional du Service des délégués commerciaux (SDC) pour le Manitoba et la Saskatchewan |
La Transformation d’Affaires mondiales Canada
Enjeu
- Affaires mondiales Canada (AMC) met en œuvre une transformation organisationnelle pluriannuelle afin de s'assurer qu'il sera bien équipé pour servir les Canadiens en relevant les défis de l'avenir.
Contexte
- Le Canada connaît un réalignement du pouvoir économique et politique mondial, un retour de la concurrence entre grandes puissances, une vulnérabilité croissante face aux menaces transnationales, ainsi qu’une évolution technologique rapide. Les Canadiens sont bien plus connectés dans le monde que dans le passé, et attendent davantage de leur gouvernement qu'il promeuve et protège leurs intérêts à l'étranger.
- Affaires mondiales Canada doit s'adapter à ce milieu qui évolue rapidement. De nombreux alliés et partenaires du Canada réinvestissent dans leurs capacités diplomatiques. Le Canada doit faire de même, faute de quoi il risque de perdre du terrain par rapport à ses partenaires et à ses concurrents à l'échelle internationale.
- L'initiative « L'avenir de la diplomatie : Transformer Affaires mondiales Canada » a été lancée en mai 2022 par la ministre Joly et le sous-ministre des Affaires étrangères.
- Après un an de consultations approfondies, d'analyses et d'établissement de priorités, les ministres Joly, Sajjan et Ng, ainsi que le sous-ministre David Morrison, ont présenté les principales conclusions de la première phase de l'initiative lors de la réunion des chefs de mission mondiaux en juin 2023.
- Une phase de mise en œuvre de 3 ans a été lancée à la mi-juin, avec la nomination d'Antoine Chevrier au poste de directeur général de la transformation.
- Parallèlement, en février 2022, le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international (AEFA) a lancé une étude qui visait à examiner le service extérieur canadien, ainsi que certains éléments de l'appareil de politique étrangère d'Affaires mondiales Canada et à en faire rapport. Après avoir entendu plus de 50 témoins, dont tous les ministres et les sous-ministres d'AMC, elle devrait présenter son rapport final d'ici décembre 2023.
Résultats
La première phase de l'initiative a permis d'identifier 4 domaines d'action principaux pour transformer le ministère en fournissant des services dans les 4 secteurs d'activité du ministère :
- Mettre en place une nouvelle expertise politique dans des domaines essentiels pour l'avenir du Canada : une nouvelle capacité à façonner les débats internationaux autour du changement climatique, de l'énergie, de la sécurité et des minéraux essentiels, ainsi que des questions cybernétiques et numériques ; et une plus grande capacité à anticiper et à gérer des réponses pangouvernementales à des crises prolongées (humanitaires, sécuritaires, consulaires et diplomatiques).
- Accroître notre présence à l'étranger : dans les missions multilatérales clés, où de nouvelles règles sont en cours d'élaboration ; dans les pays du G20 et d'autres pays stratégiquement importants ; par des moyens non traditionnels, y compris virtuels ; et par des communications stratégiques et une présence numérique.
- Investir dans son personnel : réorganisation du recrutement, de la formation et de la gestion des carrières ; diversité accrue grâce à l'entrée latérale et au nouveau recrutement ; renforcement du bilinguisme et des compétences en langues étrangères ; amélioration des conditions et du soutien pour le personnel recruté localement ; meilleure reconnaissance du fait que des familles entières (et pas seulement des employés) sont envoyées à l'étranger ; et plus grand soutien lors des périodes de crise.
- Investir dans les outils, les processus et la culture ministérielle : les fondamentaux de la gestion numérique, des données et des connaissances ; la modernisation des subventions et des contributions afin de fournir une assistance internationale plus efficace et efficiente ; et des incitations à prendre des risques intelligents afin d’accroître l'innovation et l'efficacité.
Mise en œuvre
- En tant que responsable de la transformation, le sous-ministre adjoint Antoine Chevrier est chargé de mener le processus de transformation et rend compte au sous-ministre des affaires étrangères, par le biais des rapports matriciels aux sous-ministres du commerce international et du développement international.
- Un plan de mise en œuvre de la transformation concernant tous les portefeuilles ministériels et les secteurs d'activité du ministère est en cours d'élaboration pour septembre 2023. Ce plan indiquera comment le ministère réaffectera les ressources existantes pour atteindre les résultats de la transformation, comment la transformation générera des gains d'efficacité et où de nouvelles ressources pourraient être nécessaires pour la mise en œuvre.
Réponse aux urgences internationales
Enjeu
- En réponse à un contexte mondial de plus en plus complexe et instable, le Canada a mis en place un cadre d’outils et de stratégies de réponse aux crises internationales.
- Le Canada fournit des services consulaires aux Canadiens touchés par des urgences internationales à l’étranger ainsi qu’un soutien technique et financier aux pays en développement dans le cadre d’efforts internationaux plus vastes afin de sauver des vies.
- Ces dernières années, les besoins mondiaux en aide humanitaire ont considérablement augmenté en raison du climat, de la prolongation des situations de conflit, de l’insécurité alimentaire croissante et des déplacements forcés.
Contexte
Le contexte international actuel est marqué par la violence politique, les conflits armés et les risques naturels. Lorsque les situations les plus graves exigent une réponse mondiale complète, notamment dans le cas de catastrophes ou lorsque les répercussions touchent plusieurs pays, le Canada doit être prêt à réagir et à apporter sa contribution.
De 2010 à 2019, le nombre de conflits violents actifs dans des contextes fragiles a augmenté de 128 %. En l’absence de solutions politiques, bon nombre de ces conflits se prolongent et ont des conséquences sociales, économiques et sécuritaires importantes. Par ailleurs, les catastrophes naturelles, qui touchent quelque 350 millions de personnes chaque année, augmentent en ampleur et en fréquence en raison des changements climatiques. En 2020, les pertes financières de ces catastrophes se sont élevées à 210 milliards de dollars. Ce type d’urgence, qui a une grande visibilité et nécessite une réponse rapide, a d’ailleurs presque fait tripler les besoins humanitaires au cours de la dernière décennie – et les besoins continuent d’augmenter. Les Nations Unies estiment que 54,2 milliards de dollars américains sont nécessaires pour venir en aide à 240 millions de personnes dans le besoin en 2023. Il s’agit de l’appel global le plus élevé à ce jour.
En même temps, les Canadiens sont de plus en plus mobiles, et vivent et voyagent dans des régions du monde où l’instabilité civile et politique ou la menace de catastrophes naturelles sont plus répandues. Les demandes de services consulaires d’urgence augmentent, tout comme les attentes des Canadiens.
Coordination des crises internationales
Le Canada s’appuie sur une gamme d’outils pour répondre aux urgences internationales, y compris le réseau de bureaux canadiens à l’étranger; le déploiement de ressources financières; ou ses capacités et son expertise techniques de pointe, selon les besoins. Dans l’exercice de son mandat de coordination de l’intervention du gouvernement du Canada en cas de crise internationale, Affaires mondiales Canada est en mesure de fournir, grâce à ses nombreuses installations et à son personnel, une approche « tous risques » solide pour ce qui est de se préparer aux répercussions sur les intérêts canadiens à l’étranger et d’en atténuer les effets.
Affaires mondiales Canada surveille les incidents internationaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de planifier et de préparer les interventions d’urgence internationales. En cas d’urgence, Affaires mondiales Canada dirige la coordination des groupes de travail interministériels et coopère avec les entités internationales et non gouvernementales, les alliés et les partenaires.
Affaires mondiales Canada soutient les Canadiens à l’étranger en leur offrant des services consulaires, notamment en leur fournissant des conseils aux voyageurs et des avertissements à jour pour plus de 230 destinations afin de s’assurer que les Canadiens sont prêts à effectuer des voyages internationaux sûrs et responsables. Le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence offre pour sa part un soutien après les heures de travail aux missions et aux clients des services consulaires en fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de crise, le Centre peut servir de première ligne de communication avec les Canadiens à l’étranger ou avec leurs familles au Canada. Les équipes permanentes de déploiement rapide sont formées et prêtes à se déployer à court terme pour fournir une capacité de pointe au réseau de missions canadiennes à l’étranger.
La prestation d’une aide d’urgence, y compris le rapatriement ou l’évacuation de Canadiens, est une fonction de la prérogative royale sur les relations internationales et est exercée par le ministre des Affaires étrangères en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la gestion des urgences (2007), le Ministère est chargé de coordonner la réponse du Canada aux situations d’urgence internationales et de soutenir la continuité des activités. Le ministre du Développement international joue un rôle important dans les interventions qui font appel aux programmes d’aide humanitaire.
En 2022 et 2023, les opérations consulaires d’urgence critiques comprenaient :
- l’évacuation des citoyens canadiens, des résidents permanents et des employés recrutés sur place de l’Afghanistan après la chute du gouvernement aux mains des talibans en août 2021;
- le soutien aux citoyens canadiens et aux résidents permanents en Ukraine à la suite de l’invasion militaire russe en janvier 2022; et
- l’évacuation des citoyens canadiens, des résidents permanents et des employés recrutés sur place du Soudan après l’éclatement du conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide en avril 2023.
Le Canada peut également fournir une aide humanitaire internationale en réponse à des situations d’urgence complexes et prolongées et à des catastrophes naturelles. Il figure parmi les 10 premiers contributeurs mondiaux, fournissant plus de 985 millions de dollars canadiens par an ces dernières années. Cette aide est en grande partie dispensée sous forme de financement humanitaire à des partenaires expérimentés des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et du Mouvement de la CroixRouge et du CroissantRouge. L’aide humanitaire représente une part importante du total de l’aide publique au développement du Canada.
Pour déterminer le niveau et la répartition du financement du Canada en réponse à une urgence, on tient compte de la gravité des répercussions ou de la crise, du nombre de personnes touchées et de la capacité des autorités locales ou nationales à réagir.
L’aide humanitaire du Canada est centrée sur les personnes et s’inscrit dans le cadre d’une approche inclusive, adaptée au genre et fondée sur les droits de la personne. Le Canada fournit son aide humanitaire au sein d’un système mondial qui a fait ses preuves. Cela permet ainsi d’éviter les doubles emplois et d’apporter une réponse proportionnelle, opportune, coordonnée et fondée sur les besoins, conformément aux appels groupés et classés par ordre de priorité.
L’aide humanitaire est régie par les quatre principes fondamentaux suivants :
- Humanité : Il faut remédier à la souffrance humaine partout où elle existe.
- Neutralité : Les acteurs humanitaires doivent s’abstenir de prendre parti dans des situations de conflit ou de s’engager dans des activités de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.
- Impartialité : L’aide doit être fournie uniquement en réponse aux besoins, sans distinction fondée sur la nationalité, la race, le genre, la religion, la classe sociale ou les opinions politiques.
- Indépendance : L’aide humanitaire doit être distincte des objectifs politiques, économiques, militaires ou autres.
L’application de ces principes aide les organismes à bâtir un climat de confiance et à faire accepter leurs activités, en particulier dans des situations de conflit armé. Il s’agit d’une condition essentielle à l’établissement et au maintien de l’accès aux populations touchées.
En cas de catastrophe naturelle, l’intervention du Canada pour soutenir la population touchée est dirigée par des civils, coordonnée, fondée sur les besoins et fournie à la demande du ou des pays touchés. Une approche pangouvernementale bien établie existe pour répondre aux catastrophes naturelles à l’étranger.
Selon l’ampleur de la catastrophe, il se peut que le Canada doive déployer une aide supplémentaire ou ciblée, au-delà de l’aide financière, auprès de partenaires expérimentés.
Le Canada est ainsi en mesure de :
- fournir du matériel de secours en nature et des hôpitaux de campagne, en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne;
- déployer une expertise humanitaire; et
- recourir à un fonds de contrepartie comme outil d’engagement public.
Par exemple, en réponse aux récents tremblements de terre en Syrie et en Türkiye (février 2023), le Canada a fourni 50 millions de dollars canadiens pour soutenir les efforts de secours humanitaire. Cette somme comprenait un soutien financier aux efforts de réponses des partenaires humanitaires, ainsi que le déploiement d’experts et la distribution de matériel de santé et de secours. En outre, des fonds de contrepartie ont été lancés avec la Croix-Rouge canadienne et la Coalition humanitaire afin d’accroître l’engagement du public et de soutenir les efforts de collecte de fonds des organisations non gouvernementales. Les Forces armées canadiennes ont aussi collaboré avec l’OTAN pour fournir l’assistance nécessaire en matière de transport aérien stratégique. Cette réponse globale s’est appuyée sur l’Équipe canadienne d’évaluation des catastrophes, qui a été déployée après les tremblements de terre.
À la suite de catastrophes naturelles de grande ampleur, en dernier recours, lorsque la capacité d’intervention dépasse la capacité civile, les capacités uniques des Forces armées canadiennes, comme l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC), peuvent également être mobilisées. Depuis 1998, le Canada a envoyé l’EICC pour apporter son aide lorsque des catastrophes naturelles et des crises ont frappé d’autres pays et lorsque les intervenants locaux sont débordés.
L’EICC a notamment été déployée :
- au Népal (tremblement de terre, en 2015) ;
- aux Philippines (typhon Haiyan, en 2013); et
- en Haïti (tremblement de terre, en 2010).
Au-delà des réponses opérationnelles, le Canada participe activement, à l’échelle mondiale, à des forums multilatéraux et multipartites afin d’améliorer l’efficacité du système international d’aide humanitaire. Le Canada s’emploie à préserver l’accès à l’aide humanitaire et à faire respecter le droit international humanitaire par l’action diplomatique et la défense des droits dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux, et il a aussi contribué à établir des normes internationales pour la protection des civils.
C. Vue d'ensemble des politiques
Tendances mondiales
Enjeu
- Cette note examine les principales tendances géostratégiques et la manière dont elles affectent l'engagement international du Canada.
Contexte
Le monde traverse une période de profonds changements. Trois grandes tendances géostratégiques ont un impact sur l'engagement international du Canada. Premièrement, la concurrence entre grandes puissances continue de s'intensifier, avec un élément de sécurité de plus en plus important. Deuxièmement, l'autoritarisme et le populisme réactionnaire constituent des forces puissantes sur la scène internationale, alors que le monde assiste à des actions délibérées qui visent à faire reculer les progrès en matière de droits de l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes. Troisièmement, les impacts sociaux et économiques des multiples crises internationales poussent les États émergents et en développement à réclamer une plus grande voix et une réforme plus approfondie des institutions multilatérales et des relations de pouvoir au niveau mondial. Au-delà de ces 3 tendances, 2 facteurs transversaux one une incidence sur la conduite des relations internationales. Tout d'abord, dans de nombreux pays, les efforts déployés pour faire face à la crise climatique et mener à bien les transitions énergétiques sont devenus un élément central de tous les aspects de la politique économique et de sécurité nationale. Deuxièmement, la technologie, ainsi que ceux qui la développent et la déploient, a une incidence sur la conduite des affaires internationales.
- Renforcement de la concurrence géopolitique
Outre l'impact dévastateur sur l'Ukraine, l'invasion russe a provoqué une volatilité des prix des matières premières, menacé la sécurité alimentaire mondiale, perturbé les chaînes d'approvisionnement et ébranlé les marchés mondiaux. L'invasion a entraîné des changements dans les politiques étrangères et de défense européennes, les États réexaminant leurs dépenses de défense, le contrôle des exportations d'armes, la sécurité énergétique et les relations avec la Russie et l'OTAN.
Parallèlement, la concurrence entre la Chine et les États-Unis s'est intensifiée. Alors que les échanges commerciaux se poursuivent, les États-Unis et la Chine sont à la recherche d’un certain découplage stratégique, en particulier dans le domaine des technologies de pointe, mettant le monde sur la voie d'une moindre interopérabilité numérique et technologique.
La Chine constitue un acteur systémique dans certains domaines, notamment la technologie, l'espace, le climat et l'énergie, et un "trouble-fête" dans d'autres domaines, tels que les droits de l'homme et la démocratie. Dans le même temps, la Chine est confrontée à un déclin démographique, à un ralentissement de la croissance économique, à une dépendance à l'égard des liens économiques et technologiques avec ses principaux concurrents et à une dépendance à l'égard de la répression pour assurer son contrôle interne.
La rivalité entre les États-Unis et la Chine a accru la pression sur les pays tiers pour qu'ils s'alignent sur des questions clés. De nombreux pays émergents et en développement, y compris des pays influents comme l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la Turquie, cherchent toutefois à protéger leurs relations et à maintenir des politiques étrangères multisectorielles.
Cette dynamique de concurrence entrave l'action multilatérale sur les défis de la sécurité régionale. Cette situation s'inscrit dans un contexte de crises prolongées en Syrie, en Libye, en Éthiopie, au Yémen, en République démocratique du Congo, au Liban, au Venezuela, en Irak, en Afghanistan, en Haïti, au Soudan et au Sahel, qui détruisent des vies et des moyens de subsistance et ont des répercussions régionales et internationales. Le système consulaire canadien a été soumis à des pressions importantes dues à des situations d'urgence complexes, qui se chevauchent et durent longtemps (par exemple, PS752, COVID, Liban, Afghanistan, Éthiopie, Soudan, Ukraine), ce qui met en évidence sa complexité et son importance.
Des régions et des questions plus pacifiques sont également vulnérables à une contestation accrue, notamment l'Arctique, qui évolue rapidement en raison du changement climatique et de la technologie. Le cyberespace est également un domaine de plus en plus actif pour les rivalités géopolitiques, avec une prolifération d'activités cybernétiques parrainées par des États, notamment des campagnes de désinformation sophistiquées et de l'espionnage industriel.
La concurrence géopolitique affecte également l'économie. Alors que le commerce mondial et les investissements directs étrangers sont restés soutenus en 2022, de nombreux États réexaminent leur exposition aux risques et la résilience de leurs principales chaînes d'approvisionnement (par exemple, la délocalisation des alliés), notamment pour l'énergie, les minéraux critiques, la biofabrication (produits pharmaceutiques, vaccins), l'alimentation et les services et les produits de haute technologie tels que les semi-conducteurs. Le système commercial multilatéral, étayé par l'OMC, a eu du mal à gérer ces complications.
Dans le même temps, le multilatéralisme se poursuit et les institutions du système international fondé sur des règles continuent de faciliter les discussions et l'action collective, avec des succès variables, tout comme elles l'ont fait pendant la guerre froide, la guerre mondiale contre le terrorisme et la pandémie de COVID-19. Toutefois, l'action multilatérale est de plus en plus façonnée par la contestation géopolitique et les demandes croissantes des pays en développement.
- Autoritarisme, démocratie et droits de l'homme
Parvenir à un plus grand respect des droits de l'homme, à l'égalité des sexes et à l'inclusion est un défi de taille face à l'érosion des droits de l'homme et de la démocratie à l'échelle mondiale. En 2022, Freedom House a enregistré, la 17e année consécutive, un recul de la démocratie dans le monde. Dans les démocraties comme dans les autocraties, des segments de la population se sentent exclus de la prise de décision ou des opportunités économiques. Ces tendances ont été accélérées par les technologies numériques, qui permettent aux régimes autoritaires de diffuser de la désinformation à l'échelle mondiale et de violer les droits de l'homme, tout en permettant aux acteurs non étatiques de commettre des abus et de saper les démocraties. Avec d'autres autoritaires affirmés, notamment l'Iran, la Russie et la Chine interfèrent dans les processus démocratiques à l'étranger et cherchent à affaiblir le travail multilatéral sur la démocratie, les droits de l'homme et la liberté des médias. Dans le même temps, les populistes illibéraux en Hongrie, en Turquie et dans d'autres États affaiblissent les institutions démocratiques, sans pour autant agir en tant qu'États adversaires.
Dans le même temps, les mouvements féministes, les 2SLGBTQI+ et les droits des femmes font l'objet d'une réaction délibérée contre les droits de l'homme et l'égalité entre les sexes. Les femmes et les filles sont confrontées à des menaces sanitaires et socio-économiques particulières, exacerbées par des formes croisées de discrimination et de violence, et restent systématiquement sous-représentées dans les postes de décision et de direction.
- Perturbations économiques et exigences accrues de la part des pays en développement
À la moitié de l'année 2023, l'économie résiste globalement aux chocs de la pandémie de COVID-19 et de l'agression de la Russie en Ukraine, bien que cela masque des conditions inégales selon les régions. Les augmentations des prix de l'énergie et des denrées alimentaires de 2022 se sont largement résorbées, bien que des pics de prix puissent réapparaître. Dans ce contexte, de nombreux pays en développement et émergents ont fait part de leur difficulté à assurer une croissance économique solide à leurs populations, en particulier dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de surendettement. Ils cherchent à réformer les organismes multilatéraux pour permettre aux États émergents d'avoir plus d'influence sur la prise de décision, en particulier les banques multilatérales de développement, à augmenter le financement de la lutte contre le changement climatique et à accroître les investissements en fonction de leurs priorités.
Dans ce contexte, le développement international devient de plus en plus un instrument de mesure de l'influence géopolitique. Les modèles de développement concurrents et les nouveaux acteurs du développement, des philanthropes aux partenaires du secteur privé et aux donateurs émergents tels que l'Inde et la Chine, modifient les approches du développement. L'efficacité de l'aide a également fait l'objet d'un regain d'attention, avec notamment des appels à la modernisation de l'aide au développement d'outre-mer, à la « localisation » ou au développement mené localement afin de favoriser l'appropriation locale et de déplacer les relations de pouvoir des donateurs vers les bénéficiaires, conformément à l'intérêt croissant pour la décolonisation et la lutte contre le racisme dans le secteur du développement. Une plus grande cohérence des efforts humanitaires, de développement et de paix (« triple nexus ») reste une priorité, en particulier dans les contextes les plus fragiles où la crise de la malnutrition est énorme. En outre, les effets inégaux du changement climatique ont une incidence négative sur le développement, notamment en Afrique et en Asie du Sud.
État de l’économie mondiale
Enjeu
- L’économie mondiale fait actuellement l’objet d’une fragmentation économique croissante, d’un ralentissement de la croissance et d’une inflation persistante.
- Un réarrangement des schémas de commerce et d’investissement internationaux a été provoqué par un mélange de restrictions commerciales accrues, de concurrence géopolitique continue et d’impacts économiques liés à la guerre de la Russie en Ukraine.
- Dans certaines économies, le resserrement de la politique monétaire a lentement ramené l’inflation vers les objectifs fixés, mais les fortes hausses de taux ont également eu de graves effets secondaires sur le secteur financier.
- De nombreux pays en développement restent marqués sur le plan économique par la pandémie et sont vulnérables face à la hausse des taux d’intérêt. Cette situation aggrave la menace que posent les niveaux d’endettement déjà records. Les souffrances humaines associées à l’effondrement des économies menacent d’accroître l’instabilité politique.
Contexte
Tendances de la croissance mondiale : Les Perspectives économiques mondiales de juillet 2023 du FMINote de bas de page 5 prévoient que la croissance économique mondiale passera de 3,5 % en 2022 à 3,0 % en 2023 et 2024. L’essentiel du ralentissement devrait provenir des économies avancées (1,5 % en 2023 contre 2,7 % en 2022). Les taux de croissance des marchés émergents et des économies en développement devraient rester identiques à ceux de l’année dernière (4,0 % en 2023 comme en 2022). Les prévisions du FMI concernant la croissance mondiale pour 2023 et 2024 (3,0 %) sont nettement inférieures à la moyenne historique de 3,8 % enregistrée entre 2000 et 2019. La croissance américaine devrait ralentir, passant de 2,1 % en 2022 à 1,8 % en 2023, puis ralentir encore pour atteindre 1,0 % en 2024. La croissance dans la zone euro devrait tomber à 0,9 % en 2023, contre 3,5 % en 2022. L’une des principales évolutions de l’économie chinoise est que la reprise post-COVID-19 tant attendue ne se produit pas aussi rapidement que prévu. Sur une base trimestrielle, la croissance du PIB a ralenti par rapport au trimestre précédent, atteignant seulement 0,8 % d’avril à juin. La croissance d’année en année pour le deuxième trimestre a été de 6,3 %, bien en deçà de la prévision précédente d’une croissance de 7,3 %Note de bas de page 6 . Cette situation est attribuée à un mélange d’investissements privés plus faibles et de ralentissement de la croissance dans les économies avancées à mesure que les effets des taux d’intérêt élevés se font sentir. L’abandon par les économies avancées des dépenses de consommation pour les biens manufacturés au profit des services (tels que les restaurants et les voyages) a également entraîné une baisse de la demande pour la production manufacturière chinoise.
Commerce mondial : le FMI prévoit une baisse du volume de la croissance du commerce mondial (biens et services) de 5,2 % en 2022 à 2,0 % en 2023, avant de remonter à 3,7 % en 2024, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 4,9 % enregistrée entre 2000 et 2019. Cette évolution reflète le ralentissement de la demande mondiale après deux années de croissance de rattrapage rapide à la suite de la récession due à la pandémie. L’augmentation des obstacles commerciaux et les effets décalés de l’appréciation du dollar américain en 2022 devraient continuer à peser sur la croissance du commerce en 2023.
Énergie, alimentation et inflation : Bien qu’encore élevés, les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont connu une baisse généralisée au cours de l’année écoulée, ce qui a soulagé les consommateurs et les importateurs de produits de base. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de la COVID-19 s’estompent, et certaines des perturbations des marchés de l’énergie et des denrées alimentaires causées par la guerre en Russie se sont atténuées. Si l’inflation mondiale diminue, elle le fait plus lentement que ne l’avait initialement prévu le FMI, et il subsiste un risque que l’activité économique plus forte que prévu oblige la politique monétaire à se resserrer davantage ou à rester plus longtemps restrictive. L’inflation globale mondiale devrait passer de 8,7 % en 2022 à 6,8 % en 2023 et à 5,2 % en 2024.
Les perspectives énergétiques continuent de dépendre des développements liés à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Le ralentissement de l’économie mondiale a continué à réduire les pressions sur les prix de l’énergie pour le moment, mais le maintien de la baisse des prix dépendra de l’absence de nouveaux chocs négatifs au niveau de l’offre. Les prix mondiaux des denrées alimentaires se sont modérés au cours de l’année écoulée, mais restent très élevés par rapport aux prix des denrées alimentaires avant l’invasion. Le FMI a souligné en avril que les prix des denrées alimentaires restent supérieurs de 22,3 % à la moyenne des cinq dernières années et de 39,1 % aux niveaux d’avant la pandémie. De nouvelles perturbations de l’approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais en provenance de la Russie et de l’Ukraine (principaux exportateurs de blé, de maïs, d’huile de tournesol et d’engrais) pourraient à nouveau entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et une aggravation de l’insécurité alimentaire dans le monde.
Conditions financières : Les banques centrales de nombreuses grandes économies continuent de resserrer leur politique monétaire pour contrôler l’inflation. Le FMI souligne que pour la plupart des pays du G20, en particulier les économies avancées, l’inflation reste bien supérieure aux objectifs des banques centrales. La forte augmentation des taux d’intérêt au cours de l’année écoulée a également eu des effets secondaires négatifs sur le secteur financier, ce qui a entraîné des pressions sur le marché du crédit dans de nombreux marchés, notamment des défaillances de promoteurs immobiliers en Corée et en Chine, ainsi que la faillite de certaines banques régionales américaines et la perte de confiance du marché à l’égard du Credit Suisse, une banque d’importance systémique mondiale. Ce qui semblait isolé du secteur bancaire américain s’est rapidement propagé aux banques et aux marchés financiers du monde entier, provoquant une liquidation d’actifs à risque. Une réponse énergique a permis d’endiguer les risques systémiques et de réduire l’anxiété des marchés lorsque les régulateurs américains ont garanti les dépôts non assurés des banques touchées et fourni des liquidités par le biais d’un nouveau programme de financement à terme des banques (Bank Term Funding Program). La Banque nationale suisse a également fourni des liquidités d’urgence au Credit Suisse, qui a ensuite été racheté par UBS dans le cadre d’une acquisition soutenue par l’État.
Endettement : La combinaison de coûts d’emprunt plus élevés et d’une croissance plus faible pourrait provoquer un surendettement systémique dans les marchés émergents et les économies en développement. Le FMI estime que 56 % des pays en développement à faible revenu sont déjà en situation de surendettement ou présentent un risque élevé, et qu’environ 25 % des économies de marché émergentes présentent un risque élevé. Les conditions de crédit de plus en plus restrictives à l’échelle mondiale signifient qu’un marché émergent et une économie en développement sur quatre ont effectivement perdu l’accès aux marchés obligataires internationaux. Le FMI a rappelé qu’il est nécessaire de s’accorder sur les besoins de restructuration de la dette d’un nombre élargi d’économies, y compris les économies à revenu intermédiaire qui ne sont pas admissibles au titre de l’actuel Cadre commun du G20.
Préoccupations en matière de sécurité économique et fragmentation de l’économie mondiale : Les économies avancées cherchent à réorienter leurs investissements pour que les chaînes d’approvisionnement soient moins vulnérables aux tensions géopolitiques, en favorisant une réorientation vers des pays amis. Dans le même temps, les grands marchés émergents envisagent des moyens de réduire la vulnérabilité perçue de leurs économies face à la domination des États-Unis et de l’Europe sur les marchés financiers. Le FMI met en garde contre le risque d’une fragmentation financière induite par les politiques, entraînant des changements dans les flux de capitaux transfrontaliers. Les stratégies d’investissement des entreprises, telles que la relocalisation, la délocalisation dans un pays proche et la délocalisation dans des pays alliés, sont discutées dans l’arène publique afin de réduire les risques et d’accroître la résilience de la chaîne de valeur mondiale. Toutefois, la délocalisation des filiales étrangères n’a pas encore été observée au-delà de cas anecdotiques. La conception des politiques industrielles, y compris les politiques climatiques et les incitations à promouvoir les chaînes d’approvisionnement nationales en énergie propre, pourrait conduire à une fragmentation économique coûteuse dans des secteurs clés.
Perspectives pour 2023-2024 : Les risques à court terme pour l’économie mondiale demeurent. La persistance de l’inflation pourrait nécessiter un nouveau resserrement monétaire; la reprise de la Chine après la crise du COVID-19 pourrait s’essouffler encore davantage; et la guerre de la Russie en Ukraine pourrait entraîner de nouveaux chocs économiques. Les tensions géopolitiques et la fragmentation économique peuvent entraver les efforts multilatéraux visant à relever les défis économiques et réduire notre capacité à fournir des biens publics mondiaux vitaux, tels que les mesures de lutte contre les changements climatiques, et à réaliser des progrès dans l’élimination de la pauvreté.
Paysage du développement et défis mondiaux
Enjeu
- La confluence croissante de la géopolitique et des questions de développement international contribue à rendre le paysage du développement mondial plus volatile et plus complexe.
- La reconnaissance croissante d’un déficit de confiance entre le Sud et le Nord est exacerbée par les inégalités qui sont apparues lors de la réponse à la pandémie de COVID-19 et par le soutien important apporté à l’Ukraine.
- Les appels à s’attaquer aux inégalités structurelles se multiplient au sein du système multilatéral mondial, en particulier en ce qui concerne le financement du développement.
Contexte
Le paysage du développement mondial évolue rapidement. L’intensification de la concurrence entre grandes puissances a un impact croissant sur la coopération internationale au développement, les relations bilatérales de développement et la stabilité du système multilatéral.
Après trois décennies de progrès sans précédent en matière de développement mondial, les effets conjugués de la pandémie de COVID-19, du changement climatique et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont bloqué ou inversé les progrès réalisés en matière de développement, entraînant des crises sanitaires, éducatives et économiques dans le monde entier. Plus de 680 millions de personnes, soit 9,2 % de la population mondiale, vivent actuellement dans l’extrême pauvreté, la majorité d’entre elles se trouvant dans des pays à revenu intermédiaire. L’extrême pauvreté est la plus répandue en Afrique subsaharienne, où 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les niveaux mondiaux d’extrême pauvreté augmentent dans les États fragiles et touchés par des conflits, où la Banque mondiale prévoit que jusqu’à deux tiers des personnes en situation d’extrême pauvreté dans le monde vivront d’ici 2030.
La prévalence des conflits prolongés dans le monde met à rude épreuve les efforts d’aide internationale. Des régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de certaines parties de l’Asie connaissent des conflits armés prolongés, qui entraînent d’importantes crises humanitaires et d’importants déplacements de populations. Le Canada reconnaît que la prévention des conflits est essentielle à la mise en œuvre réussie du Programme 2030, et que les efforts de réduction de la pauvreté ne suffisent pas à eux seuls à instaurer une paix durable. Une approche cohésive de la triple articulation (humanitaire-développement-paix) qui intègre également des considérations commerciales est essentielle.
Pression en faveur d’une réforme
Le système multilatéral est sous pression. Il existe un déficit de confiance largement reconnu entre les pays du Nord et de l’Ouest et les pays du Sud et intermédiaires.
De nombreux pays du Sud soulignent les inégalités structurelles de longue date qui ont perpétué l’influence indue des pays donateurs et la faible contribution des pays du Sud dans les structures internationales. En particulier, l’architecture financière internationale – les accords de gouvernance qui garantissent la stabilité des systèmes monétaires et financiers mondiaux – est de plus en plus critiquée pour son incapacité à répondre de manière adéquate aux besoins financiers croissants des pays en développement.
Donateurs émergents
Les donateurs émergents tels que la Chine, le Brésil et l’Inde, ainsi que les nouvelles institutions régionales et multilatérales telles que la Nouvelle Banque de développement et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures ont également un impact sur le paysage du développement. Pour de nombreux pays du Sud, l’affirmation de la Chine selon laquelle elle respecte les principes de non-ingérence est une alternative séduisante à l’aide conditionnelle et axée sur les valeurs des donateurs occidentaux. Dans la pratique, les projets bilatéraux de la Chine ont été critiqués pour avoir créé un endettement insoutenable, alimenté la corruption, maintenu un bilan environnemental médiocre et manqué d’engagement auprès des communautés locales et de la société civile. De nouvelles initiatives, telles que le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l’investissement, cherchent en partie à contrer l’attrait du modèle de développement de la Chine. Néanmoins, les pays donateurs du Nord et de l’Ouest continuent à se demander comment concurrencer le modèle de développement de la Chine tout en promouvant les valeurs démocratiques libérales et en respectant les normes d’aide au développement fondées sur la transparence, le respect des droits de la personne et les priorités locales.
Défis et occasions en cours et à venir
Les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui sont de plus en plus globaux; les changements climatiques et les pandémies mondiales affectent à la fois le Nord et le Sud. Alors que l’aide publique au développement (APD) traditionnelle est axée sur la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, la pression se fait de plus en plus forte pour déployer davantage de fonds en réponse à ces défis mondiaux, pour investir dans des projets publics mondiaux tels que les mesures de santé publique mondiale et l’atténuation des changements climatiques.
Pour de nombreux pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, les changements climatiques et la perte de biodiversité représentent une menace existentielle. Environ 42 % de l’humanité vit dans des contextes extrêmement précaires. Les efforts d’aide internationale sont de plus en plus orientés vers la prise en compte des impacts des changements climatiques, y compris ses impacts multidimensionnels sur les communautés touchées par les conflits, afin de renforcer la résilience future.
La crise climatique contribue à la crise alimentaire mondiale. Les niveaux de faim dans le monde sont encore bien supérieurs à ceux d’avant la pandémie, avec des estimations de 691 à 783 millions de personnes souffrant de la faim en 2022, soit 122 millions de plus qu’avant la pandémie de COVID-19. Les systèmes agroalimentaires sont très vulnérables au changement climatique, aux conflits et aux chocs économiques, ce qui a entraîné des difficultés croissantes dans la capacité des systèmes agroalimentaires à fournir des régimes alimentaires nutritifs, sûrs et abordables pour tous.
L’évolution du contexte géopolitique a de profondes répercussions sur l’égalité des genres et les droits de la personne. L’affaiblissement des démocraties et l’augmentation du nombre de régimes autoritaires entraînent un rétrécissement des espaces civils et une polarisation politique croissante. Il est de plus en plus évident que nous assistons à un renversement progressif des acquis générationnels en ce qui concerne les droits fondamentaux des femmes et des filles. La crise mondiale de l’éducation, causée par la pandémie de COVID-19, les conflits et les changements climatiques, a conduit 222 millions d’apprenants à avoir besoin d’un soutien à l’éducation. Les apprenants réfugiés et déplacés, en particulier les filles, sont touchés de manière disproportionnée par cette crise. On assiste également à un élan croissant en faveur de la reconnaissance des services en matière de sexualité et de reproduction comme services de santé essentiels, en réponse à la montée des groupes d’opposition qui sont de plus en plus financés, bien organisés et efficaces pour communiquer des informations erronées et des messages anti-droits à un public plus large. La reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, obtenue de haute lutte, est soumise à de fortes pressions dans le monde entier.
Malgré ces défis, la révolution numérique a le potentiel d’augmenter les niveaux de revenus mondiaux et d’améliorer la qualité de vie. Elle offre de nouveaux outils de développement, permettant de tirer davantage parti des données, de la science et de la technologie pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté. Mais les progrès de l’intelligence artificielle et de l’automatisation auront un impact majeur sur la nature du travail dans les années à venir et risquent d’exacerber les inégalités. L’aide internationale sera de plus en plus sollicitée pour combler le fossé numérique entre hommes et femmes, mettre en place des infrastructures et des compétences numériques, et renforcer les écosystèmes numériques fondés sur les droits dans les pays en développement.
S’attaquer à la dette insoutenable
Les pays en développement sont confrontés à des niveaux d’endettement croissants et à un rétrécissement de leur marge de manœuvre budgétaire, ce qui limite leur capacité à investir dans le développement durable. L’aide publique au développement (APD) ne suffit pas à répondre aux demandes croissantes. La demande de leadership international et d’actions concrètes en matière de financement nouveau et novateur innovant en matière de développement continuera d’augmenter, et plusieurs pays, dont le Canada, intensifient leurs activités de plaidoyer et d’action en faveur d’un meilleur accès au financement pour les pays du Sud.
Approches et modèles de partenariat dans le domaine du développement
Les efforts visant à promouvoir l’antiracisme et à décoloniser l’aide ont conduit les gouvernements et les institutions à examiner les approches de partenariat et les paradigmes de développement en vigueur. Des pressions de plus en plus fortes s’exercent pour que l’on s’éloigne des modèles caritatifs dépassés, fondés sur une conception coloniale des « besoins » en matière de développement, et que l’on s’oriente vers des partenariats plus équitables, fondés sur le respect des priorités propres à chaque contexte et sur un développement mené au niveau local.
La complexité des défis mondiaux actuels exige une coordination mondiale renforcée et des synergies améliorées entre les acteurs du développement, de l’aide humanitaire, de la paix et de la sécurité et du commerce, ainsi qu’une approche renouvelée à l’égard de partenariats respectueux et équitables avec les pays du Sud.
La politique étrangère féministe du Canada et la politique d'aide internationale
Enjeu
- Depuis son adoption en 2017, la Politique d'aide internationale féministe du Canada a orienté la prestation de l'aide internationale du Canada.
- La Politique d'aide internationale féministe constitue un pilier essentiel de la Politique étrangère féministe du Canada - les efforts continus, coordonnés et pangouvernementaux qui visent à promouvoir les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion, dans le cadre de tous les engagements internationaux, y compris la diplomatie, le commerce, la sécurité, le développement et les services consulaires.
- La Politique d'aide internationale féministe a renforcé la réputation du Canada en tant que donateur féministe. Pour la quatrième année consécutive, le Canada est en tête de la liste des donateurs bilatéraux qui soutiennent proportionnellement les investissements en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles.
Contexte
La politique étrangère féministe du Canada est l'expression internationale des efforts continus, coordonnés et pangouvernementaux qui visent à promouvoir les droits de l'homme, la diversité, l'inclusion et l'égalité des sexes. Elle est mise en œuvre par le biais d'une série de politiques internationales complémentaires, notamment la politique d'aide internationale féministe, le plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que la stratégie de diversification des échanges commerciaux, avec son approche inclusive du commerce.
Lancé en juin 2017, la Politique d'aide internationale féministe se concentre sur la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles en tant que domaine d'action central et dans l'ensemble des 5 autres domaines d'action : la dignité humaine (santé, éducation et humanitaire), une croissance qui fonctionne pour tous, l'environnement et le climat, la gouvernance inclusive, et la paix et la sécurité.
L'approche féministe, intersectionnelle et fondée sur les droits de l'homme de cette politique en matière d'aide internationale fournit un cadre qui guide la prestation de l'aide internationale du Canada dans le but de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l'inégalité et répondre aux nouveaux défis du développement mondial, en se fondant sur la preuve évidente que l'égalité des sexes est un prédicteur de paix plus fiable que le PIB d'un pays ou son niveau de démocratie.
Les pays où l'égalité des sexes est la plus marquée sont moins susceptibles de recourir à la force militaire, et il est démontré que l'autonomisation des femmes et des filles contribue à la croissance économique. En comblant les écarts entre les sexes, il est possible d'augmenter le PIB par habitant de près de 20 %. Des études estiment que les gains économiques pourraient être de l'ordre de 5 à 6 000 milliards de dollars si les femmes avaient la possibilité de créer et de développer de nouvelles entreprises au même rythme que les hommes.
La Politique d'aide internationale féministe engage le Canada à améliorer continuellement sa prestation d'aide internationale en intégrant les principes de participation, d'inclusion, d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de responsabilité dans l'ensemble de son portefeuille. Le Canada soutient les organisations de défense des droits des femmes dans le monde entier, en tant que principaux moteurs de changement pour lutter contre l'inégalité entre les sexes dans leurs communautés. Par l'entremise de la Politique d'aide internationale féministe, Affaires mondiales Canada a lancé plusieurs initiatives clés depuis 2017 pour faire avancer l'égalité des sexes et réduire la pauvreté. Par exemple, le Canada a soutenu :
Plus de 1500 organisations et mouvements locaux de défense des droits des femmes dans plus de 30 pays grâce au programme Women's Voice and Leadership (150 millions de dollars de 2017 à 2023, 195 millions de dollars de 2023 à 2028, et 43,2 millions de dollars par an en continu), y compris des groupes représentant des organisations LGBTQI+, des femmes handicapées, des femmes autochtones, des migrants, des travailleurs du sexe et des survivants de la violence sexuelle et sexiste.
- La création du Fonds pour l'égalité (300 millions de dollars) et de l'Alliance pour les mouvements féministes.
- Un engagement décennal en faveur de la santé et des droits dans le monde, comprenant 700 millions de dollars par an pour la santé et les droits sexuels et reproductifs dans le monde jusqu'en 2030.
- Un engagement catalytique de 100 millions de dollars pris par le Premier ministre Trudeau lors du Forum sur l'égalité des générations pour remédier à la répartition inégale du travail de soins rémunéré et non rémunéré dans les pays à revenu faible et intermédiaire par le biais d'une programmation autonome du travail de soins (2021-2026).
- Un engagement en faveur d'une éducation sûre, inclusive et de qualité, en particulier pour les filles, les enfants et les jeunes réfugiés, déplacés et issus des communautés d'accueil, par le biais de l'Initiative de Charlevoix pour l'éducation 2018, qui génère des promesses historiques de 4,3 milliards de dollars (400 millions de dollars canadiens) en faveur de l'accès à une éducation de qualité pour les filles et les adolescentes dans les contextes touchés par les conflits et les crises, de la part du G7 et de ses partenaires, et de la campagne « Ensemble pour apprendre » visant à promouvoir une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les réfugiés, les autres enfants et les jeunes déplacés de force et issus des communautés d'accueil, tout en particulier pour les filles.
- Leadership dans le domaine des femmes, de la paix et de la sécurité en nommant la première ambassadrice au monde pour les femmes, la paix et la sécurité en 2019, en étendant l'Initiative Elsie pour les femmes dans les opérations de paix afin d'accroître la participation significative des femmes en uniforme dans les rôles de maintien de la paix, et en élaborant le troisième plan d'action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité en 2023.
Objectifs de la Politique d'aide internationale féministe
La Politique d'aide internationale féministe a établi des priorités et des engagements afin d’orienter la prestation de l'aide internationale et en maximiser son impact. Il comprend une série d'objectifs ambitieux :
- Pas moins de 95 % de l'aide internationale bilatérale intégrera l'égalité entre les hommes et les femmes.
- 15 % de l'aide bilatérale sera spécifiquement consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes.
- Pas moins de 50 % de l'aide bilatérale sera destinée à l'Afrique subsaharienne.
AMC a fait un effort déterminé pour soutenir les initiatives qui répondent à l'ambition des objectifs de la Politique d'aide internationale féministe, générant des résultats concrets. Par exemple, en 2022-23 :
- 99 % (objectif de 95 %) de l'aide internationale bilatérale intègre l'égalité entre les femmes et les hommes.
- 9 % (objectif de 15 %) de l'aide bilatérale ont été spécifiquement consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes.
- 40 % (objectif de 50 %) de l'aide bilatérale destinée à l'Afrique subsaharienne.
Par conséquent, en 2023, pour la quatrième année consécutive, le CAD de l'OCDE a classé le Canada parmi les meilleurs donateurs bilatéraux pour le soutien à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que parmi les meilleurs donateurs pour le soutien aux organisations de défense des droits des femmes et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.
Prochaines étapes
Même si la réalisation des objectifs de la Politique d'aide internationale féministe continuera d'être affectée par l'évolution du paysage du développement mondial, la Politique d'aide internationale féministe continue de fournir un cadre politique solide pour orienter l'aide internationale du Canada. Les crises récentes en Iran, en Afghanistan et en Ukraine ont mis en évidence la nécessité de poursuivre les efforts pour contrer le recul croissant de l'égalité des sexes et des droits des femmes et des personnes LGBTQI+.
Les initiatives « L'avenir de la diplomatie » et « Transformation d'Affaires mondiales Canada » offrent au Canada une nouvelle occasion de continuer à mener et à innover pour promouvoir l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion, la localisation et les approches intersectionnelles et fondées sur les droits de l'homme à l'échelle mondiale.
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Enjeu
- Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est une feuille de route collective pour une reprise inclusive et résiliente après la pandémie et les crises simultanées, et une occasion de construire un monde plus pacifique, plus juste, plus prospère et plus durable pour les générations actuelles et futures.
- Le Canada s’est engagé à mettre pleinement en œuvre le Programme 2030 et à accélérer les progrès sur les Objectifs de développement durable (ODD) tout au long de la Décennie d’action (2019-2029).
Contexte
Le Programme 2030 pour le développement durable a été adopté par tous les États membres des Nations Unies, y compris le Canada, en septembre 2015. Il s’agit d’un cadre mondial ambitieux d’une durée de 15 ans centré sur un ensemble de 17 Objectifs de développement durable (ODD) interdépendants et indivisibles, qui couvrent les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable et intègrent des éléments de paix, de gouvernance et de justice.
Le Programme 2030 est universel par nature, ce qui signifie que les pays en développement et les pays développés sont appelés à mettre en œuvre les ODD, dans le but d’éradiquer la pauvreté et de ne laisser personne de côté. Il est axé sur les personnes et fondé sur les instruments relatifs aux droits de la personne.
La pandémie de COVID-19 et les crises simultanées, telles que la guerre en Ukraine, les changements climatiques, l’insécurité alimentaire, la hausse de l’inflation et l’endettement ont eu un impact significatif sur la réalisation des ODD, en particulier dans les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires en développement et les États fragiles et touchés par un conflit. Ces crises ont érodé les progrès réalisés à ce jour en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et de la faim et l’égalité des genres.
Mise en œuvre du Programme 2030 par le Canada
Le Canada adopte une approche intersectionnelle et sensible au genre pour sa mise en œuvre du Programme 2030. Afin de maximiser l’efficacité et l’impact pour l’ensemble des 17 ODD, le Canada place l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir de toutes les femmes et les filles au centre de ses efforts en matière de développement durable.
Cadre national
Aller de l’avant ensemble, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, fournit des orientations générales sur la mise en œuvre des ODD par le Canada. Sous la direction de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, la Stratégie nationale vise à soutenir la participation de l’ensemble de la société aux ODD, en reconnaissant que chacun a un rôle à jouer dans la réalisation du développement durable.
La Stratégie nationale est soutenue par un cadre d’indicateurs canadiens permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale, et par un plan de mise en œuvre fédéral définissant les rôles et responsabilités clés des ministères et organismes du gouvernement du Canada.
Mise en œuvre internationale
La Stratégie nationale et la Politique étrangère féministe du Canada guident la mise en œuvre internationale du Programme 2030 par le Canada. Affaires mondiales Canada adopte une approche ministérielle globale à l’égard des ODD, conscient que le Programme 2030 ne concerne pas uniquement le développement. Le Canada tire parti du commerce, de la diplomatie et des efforts de plaidoyer pour contribuer à la réalisation des Objectifs et au renforcement d’un système international fondé sur des règles.
- La Politique d’aide internationale féministe se concentre sur l’éradication de la pauvreté et sur la prestation de l’aide aux plus pauvres et aux personnes en situation de vulnérabilité par le biais de ses six champs d’action : l’égalité des genres, la dignité humaine, la croissance au service de tous, l’action pour le climat, la gouvernance inclusive et la paix et la sécurité. En plaçant l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir de toutes les femmes et les filles au centre de ses efforts, la Politique d’aide internationale féministe contribue à faire progresser les 17 ODD.
- Le Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité complète le travail de la Politique d’aide internationale féministe dans la réalisation de l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et de l’ODD 16 (sociétés pacifiques, justes et inclusives), en reconnaissant qu’il ne peut y avoir de développement durable sans paix, et de paix sans développement durable.
- L’approche inclusive du Canada en matière de commerce vise à garantir que les avantages et les possibilités qui découlent du commerce sont plus largement partagés, y compris avec les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les PME. Elle soutient la croissance économique durable et la création d’emplois décents (ODD 8) et contribue à son tour à l’éradication de la pauvreté (ODD 1).
- La Politique étrangère féministe du Canada s’emploie à défendre les droits de la personne et la démocratie (catalyseur des ODD), à promouvoir la diplomatie climatique (ODD 13), à soutenir une croissance durable et inclusive (ODD 8) et à favoriser une paix et une sécurité durables (ODD 16).
Financement des ODD
Le Canada soutient le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement en tant que principal cadre de financement pour la mise en œuvre du Programme 2030. Pour aider à mobiliser toutes les sources de financement du développement, le Canada a accru son engagement sur les questions clés du financement du développement durable, notamment en collaborant avec les banques multilatérales de développement et le secteur privé sur les infrastructures économiques et sociales, en pilotant des mécanismes de financement novateurs et en remédiant aux vulnérabilités causées par l’endettement.
Développements les plus récents/événements à venir
Examen national volontaire
Le Canada a présenté son plan lors du deuxième Examen national volontaire (ENV) en juillet 2023 au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. L’objectif principal de l’ENV est de fournir un mécanisme de suivi et d’examen pour le Programme 2030, en offrant aux pays un forum pour rendre compte des progrès et des défis dans la mise en œuvre du Programme 2030.
Défenseurs des ODD
En avril 2022, le secrétaire général des Nations unies a demandé au premier ministre Trudeau et à la première ministre Mottley de la Barbade de devenir les nouveaux coprésidents de son groupe de défenseurs des ODD. Les défenseurs des ODD sont 17 personnes inspirantes et influentes qui sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d’une action accélérée. Ce rôle offre au Canada une occasion importante de souligner son leadership en matière d’ODD et d’accroître la sensibilisation et le soutien au Programme 2030.
En tant que coprésident des défenseurs des ODD, le premier ministre Trudeau accorde la priorité à la promotion de l’égalité des genres et au renforcement du pouvoir de toutes les femmes et les filles, à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de la planète, à l’accès à une éducation de qualité pour tous et à la promotion de partenariats diversifiés et inclusifs pour le financement des ODD. Les défenseurs des ODD se réuniront à nouveau en marge de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre.
Sommet sur les ODD
Cette année marque la mi-parcours du Programme 2030. Un sommet sur les ODD au niveau des dirigeants aura lieu aux Nations Unies du 18 au 19 septembre. Le secrétaire général des Nations Unies espère que le Sommet sur les ODD de 2023 cristallisera la volonté politique d’agir sur les recommandations de son plan de relance des ODD. Ce plan vise à compenser la détérioration des conditions auxquelles sont confrontés les pays en développement. Il appelle à une augmentation substantielle du financement du développement d’au moins 500 milliards de dollars par an, à une augmentation des prêts des banques multilatérales de développement (BMD) et à de meilleures conditions d’emprunt pour les pays en développement. Le Sommet sera la pièce maîtresse d’une série d’événements de haut niveau qui auront lieu en septembre, notamment un dialogue de haut niveau sur le financement du développement, un sommet sur l’ambition climatique, trois réunions sur la santé et un événement marquant la mi-parcours de l’initiative Génération Égalité.
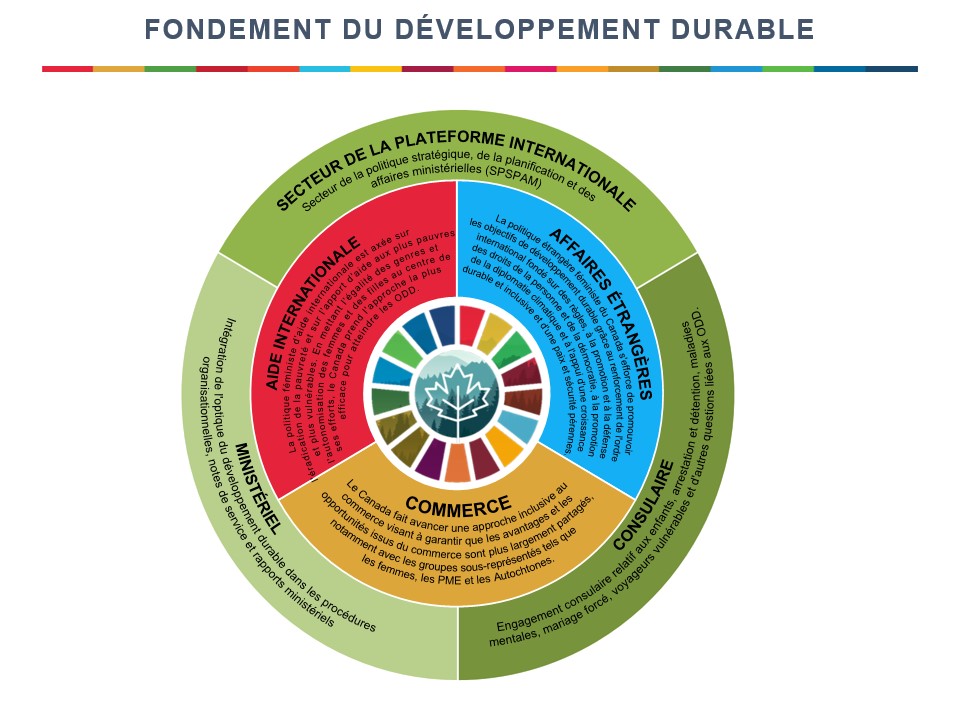
Version texte
Fondement du développement durable
Secteur de la plateforme internationale
Secteur de la politique stratégique, de la planification et des affaires ministérielles (SPSPAM)
Consulaire
Engagement consulaire relatif aux enfants, arrestation et détention, maladies mentales, mariage forcé, voyageurs vulnérables et d'autres questions liées aux ODD.
Ministériel
Intégration de l'optique du développement durable dans les procédures organisationnelles, notes de service et rapports ministériels
Aide internationale
La politique féministe d'aide internationale est axée sur l'éradication de la pauvreté et sur l'apport d'aide aux plus pauvres et plus vulnérables. En mettant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles au centre de ses efforts, le Canada prend l'approche la plus efficace pour atteindre les ODD.
Affaires étrangères
La politique étrangère féministe du Canada s'efforce de promouvoir les objectifs de développement durable grâce au renforcement de l'ordre international fondé sur des règles, à la promotion et à la défense des droits de la personne et de la démocratie, à la promotion de la diplomatie climatique et à l'appui d'une croissance durable et inclusive et d'une paix et sécurité pérennes.
Commerce
Le Canada fait avancer une approche inclusive au commerce visant à garantir que les avantages et les opportunités issus du commerce sont plus largement partagés, notamment avec les groupes sous-représentés tels que les femmes, les PME et les Autochtones.
D. Géographique - Aperçus régionaux intégrés
Indo-Pacifique
Enjeu
- Englobant 40 pays et économies, plus de 4 milliards de personnes et 47,19 billions de dollars d'activité économique, la région indo-pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde et abrite 6 des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada.
- Toutes les questions importantes pour le Canada - y compris la sécurité nationale, la prospérité économique, l'environnement, les droits des femmes et des filles et les droits de l'homme - seront influencées par la trajectoire future de la région.
- La stratégie indo-pacifique du Canada, annoncée en novembre 2022, propose un cadre politique ambitieux, complet et intégré aux fins de l'engagement du Canada dans la région. Elle est soutenue par près de 2,3 milliards de dollars de nouveaux investissements.
Contexte
La stratégie indo-pacifique du Canada
La stratégie indo-pacifique du Canada présente un ensemble complet et intégré de priorités stratégiques pour la décennie à venir, dans les domaines de la défense et la sécurité, de la coopération commerciale et économique, des liens entre les peuples, de l'aide internationale, ainsi que de l'environnement et du changement climatique. Cette stratégie repose sur la reconnaissance du fait que le Canada doit étendre sa présence et renforcer ses partenariats dans la région afin de protéger et de promouvoir efficacement les intérêts canadiens.
La stratégie poursuit 5 objectifs stratégiques interconnectés :
- Promouvoir la paix, la résilience et la sécurité (720,6 millions de dollars au total)
- Développement du commerce, des investissements et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement (244,4 millions de dollars au total)
- Investir dans les personnes et les mettre en relation (261,7 millions de dollars au total)
- Créer un avenir durable et vert (913,2 millions de dollars au total)
- Le Canada en tant que partenaire actif, engagé et fiable dans la région indo-pacifique (147 millions de dollars au total)
Ce cadre a été élaboré dans le cadre d'un processus consultatif d'élaboration des politiques mené par Affaires mondiales Canada, qui comprend les recommandations d'un comité consultatif national sur l'Indo-Pacifique (IPAC) lancé en juin 2022. La stratégie comprend de nouveaux investissements dédiés et un capital versé totalisant 2,3 milliards de dollars et comprend 24 initiatives réparties entre 17 ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que FinDev Canada et la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Collectivement, ces initiatives soutiendront la diversification et l'expansion des partenariats régionaux du Canada, renforceront la crédibilité du Canada en tant qu'acteur régional fiable et engagé, et positionneront ainsi le Canada pour renforcer l'ordre fondé sur des règles et soutenir un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et durable.
L'aide internationale du Canada dans la région indo-pacifique
L'Indo-Pacifique représente plus d'un tiers de l'activité économique mondiale et, d'ici 2040, la région représentera plus de la moitié de l'économie mondiale, soit plus du double de la part des États-Unis. D'ici 2030, elle abritera les deux tiers de la classe moyenne mondiale. Cependant, elle abrite toujours les deux tiers des pauvres de la planète, dont on estime qu'ils sont 1,7 milliard à vivre avec moins de 2 dollars par jour. Le paysage de la gouvernance demeure diversifié et contesté, ce qui souligne l'importance constante de l'engagement du Canada afin de compléter les objectifs communs en matière d'économie et de développement.
Les divers défis de développement profondément ancrés dans la région indo-pacifique s'inscrivent dans un contexte de dynamique géopolitique et d'interconnexion sociale, économique et politique croissante. La région abrite de nombreux points chauds (détroit de Taïwan, Corée du Nord, mers de Chine orientale et méridionale), d'importants différends frontaliers et un nombre croissant de menaces pour les intérêts canadiens, y compris des remises en cause de l'ordre international fondé sur des règles. Les risques posés par la pauvreté régionale persistante, les inégalités, le changement climatique et la dégradation de l'environnement ne font qu'exacerber ces défis. Les catastrophes naturelles et les migrations forcées constituent des réalités constantes. Le COVID-19 a aggravé ces risques et mis en évidence la fragilité des progrès réalisés par la région en matière de développement, en particulier pour les femmes, les enfants, les minorités ethniques et d'autres groupes marginalisés.
L'aide internationale du Canada dans la région indo-pacifique vise à promouvoir sa politique d'aide internationale féministe (PAIF) et à maintenir l'accent sur l'égalité des sexes et à atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables, grâce à une approche féministe intersectionnelle fondée sur les droits de l'homme, afin de remédier aux inégalités économiques, politiques et sociales qui empêchent les individus de réaliser pleinement leur potentiel. Grâce à des politiques et des programmes inclusifs et sensibles à la dimension de genre, le Canada s'efforce de fournir une aide visible et concrète dans les États fragiles et touchés par des conflits, et de s'engager dans la défense des droits de l'homme.
Le Canada dispose de neuf programmes bilatéraux et de deux programmes régionaux d'aide au développement : Afghanistan, ANASE, Bangladesh, Indonésie, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Pan Asie, Philippines, Sri Lanka et Vietnam. (À noter que bien que l'Afghanistan ne soit pas couvert par la stratégie indo-pacifique du Canada, la branche indo-pacifique d'Affaires mondiales Canada met en œuvre un programme d'aide internationale bilatérale à l'intention des bénéficiaires afghans).
En outre, le Canada dispose d'un programme modeste dans la région des îles du Pacifique et, comme il s'y est engagé dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, il renforcera ces investissements et mettra en place son premier programme d'aide internationale pour la région des îles du Pacifique.
En 2021/2022, le Canada a fourni une aide internationale de 1,7 milliard de dollars à la région indo-pacifique, principalement par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada (1,4 milliard de dollars). Les 300 millions de dollars qui restaient ont été fournis par d'autres ministères et organismes gouvernementaux, tels que Finances Canada et Environnement et Changement climatique Canada.
La stratégie indo-pacifique récemment annoncée par le Canada s'appuie sur les investissements passés et actuels, et prévoit près d'un milliard de dollars de nouveaux engagements financiers au titre de l'aide internationale à la région, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada et de FinDev Canada.
Graphique 1. L'aide internationale historique bilatérale et multilatérale d’AMC à la région Asie-Pacifique (en millions de dollars) entre 2017-2018 et 2021-2022 avec un total de 1,4 milliard de dollars en 2021-2022.
Note pour le graphique 1 : Le financement de l'Afghanistan est mentionné, car il relève de la responsabilité de l'OGM. Le financement d'autres ministères n'est pas indiqué.
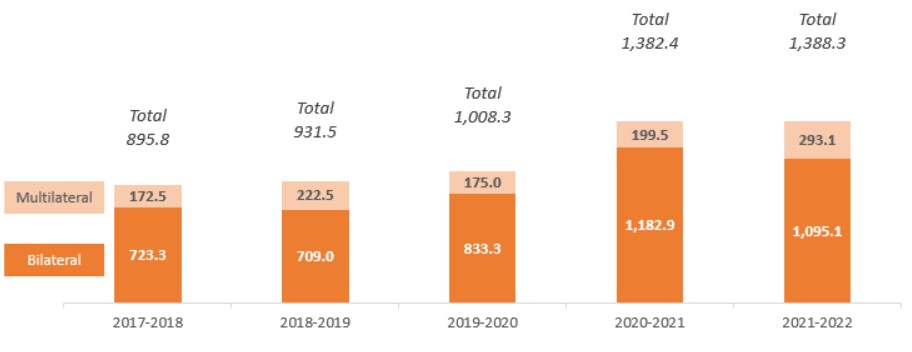
Version texte
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Multilatéral | 172,5 | 222,5 | 175 | 199,5 | 293,1 |
Bilatéral | 723,3 | 709 | 833,3 | 1182,9 | 1095,1 |
Total | 895,8 | 931,5 | 1008,3 | 1382,4 | 1388,3 |
Intérêts commerciaux et économiques du Canada dans la région indo-pacifique
Le dynamisme économique et la croissance démographique de la région stimulent la demande en matière d'éducation, de services de santé, d'alimentation, d'agriculture et de pêche, de ressources naturelles et de minéraux essentiels, d'énergie, de services financiers, de fabrication de pointe et d'infrastructures vertes. Il s'agit de secteurs où le Canada se montre fort et où il jouit d'une réputation d'excellence à l'échelle mondiale. Rien que dans le secteur des infrastructures, on estime à 2 100 milliards de dollars les possibilités d'investissements et de partenariats stratégiques dans la région indo-pacifique.
La stratégie indo-pacifique vise à diversifier les liens commerciaux et d'investissement vers et au sein de la région, à élargir l'accès au marché et le commerce fondé sur des règles, à renforcer la coopération économique avec les partenaires stratégiques et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement essentielles. Elle élargira l'accès au marché et les échanges fondés sur des règles grâce à de nouveaux accords de libre-échange, à des APIE élargis et à une participation active aux cadres émergents, notamment l'accord de partenariat économique numérique (DEPA) et le cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF). Il favorisera les débouchés commerciaux et la compétitivité du Canada en établissant une passerelle commerciale canadienne en Asie du Sud-Est, en lançant une nouvelle série de missions commerciales à grande échelle d'Équipe Canada, en renforçant la promotion commerciale et les partenariats sectoriels (par exemple, dans les domaines de l'agriculture, des ressources naturelles, des technologies propres et des infrastructures) et en améliorant la capacité du Service des délégués commerciaux. Il contribuera également à façonner les normes commerciales et technologiques, grâce à de nouveaux partenariats dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu’à une plus grande coopération en matière de normes, d'infrastructure numérique et de chaînes d'approvisionnement.
L'empreinte de la mission du Canada dans la région indo-pacifique
Le Canada compte désormais 55 missions, points de prestation de services communs et bureaux commerciaux dans la région, dont un nouveau haut-commissariat à Suva (Fidji), dont l'ouverture officielle est prévue dans le courant de l'année. (Ce chiffre n'inclut ni l'Afghanistan, ni le Bureau du représentant spécial du Canada pour l'Afghanistan à Doha). Ces missions comptent 365 employés canadiens et 1 920 employés recrutés localement dans 22 pays et économies.
Tableau 1. Empreinte de la mission (CBS et LES) dans l'Indo-Pacifique en juillet 2023.
| Pays/économie | CBS | LES | Tota |
|---|---|---|---|
Inde | 43 | 410 | 453 |
Chine | 80 | 367 | 447 |
Philippines | 18 | 190 | 208 |
Japon | 33 | 113 | 146 |
Pakistan | 22 | 123 | 145 |
Hong Kong | 14 | 102 | 116 |
Vietnam | 18 | 85 | 103 |
Indonésie | 25 | 64 | 89 |
Australie | 15 | 72 | 87 |
Singapour | 11 | 75 | 86 |
Thaïlande | 16 | 53 | 71 |
République de Corée | 11 | 63 | 74 |
Sri Lanka | 8 | 51 | 59 |
Bangladesh | 16 | 39 | 55 |
Taïwan | 8 | 37 | 45 |
Malaisie | 9 | 32 | 41 |
Myanmar | 7 | 12 | 19 |
Nouvelle-Zélande | 5 | 12 | 17 |
Mongolie | 3 | 10 | 13 |
Brunei Darussalam | 1 | 5 | 6 |
Cambodge | 1 | 3 | 5 |
Laos | 1 | 2 | 3 |
Total général | 365 | 1,920 | 2,285 |
Europe et Eurasie
Enjeu
Les relations du Canada en Europe et en Eurasie sont importantes par leur profondeur, leur complexité et leur richesse. Elles comprennent des partenariats avec des alliés clés et des engagements avec des acteurs géopolitiques majeurs. La guerre de la Russie en Ukraine, les relations étroites avec l'Union européenne et les partenaires du G7, ainsi que l'engagement actif dans l'Arctique, sont les principaux points d'attention pour la région.
Contexte
L'Europe, tout comme les États-Unis, est un partenaire clé du Canada pour l'ensemble de ses intérêts en matière de politique étrangère, de sécurité, d'économie et de commerce. Les relations clés du Canada avec les États membres de l'Union européenne (UE) et les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sont d'une importance primordiale. Ces partenaires sont généralement alignés sur les intérêts fondamentaux du Canada et sont des acteurs importants sur la scène internationale. Des interactions régulières ont lieu entre les ministres et les hauts fonctionnaires canadiens et leurs homologues européens à tous les niveaux.
Le marché unique de l'UE, la zone de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et le Royaume-Uni offrent aux entreprises canadiennes un marché prospère et stable de plus de 500 millions de personnes. Les relations commerciales du Canada avec l'Europe couvrent toute la gamme des échanges de biens et de services, des investissements bilatéraux et des partenariats dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. L'UE est le deuxième marché d'exportation le plus large pour le Canada, après les États-Unis, en termes d'exportations de biens et de services. En 2022, le Canada a effectué des exportations de biens d'une valeur de 36,4 milliards de dollars et de services d'une valeur de 18,7 milliards de dollars vers l'UE. Plus de 8 200 entreprises canadiennes sont en activité sur le marché de l'UE.
L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, provisoirement en vigueur depuis septembre 2017, englobe des comités spécialisés pour traiter du commerce des biens et des services, de la coopération réglementaire et du développement durable. En 2022, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE était supérieur de plus de 53 % à son niveau précédent l'entrée en vigueur du AECG. L'AECG restera appliqué, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit ratifié par les parlements nationaux de tous les États membres. À ce jour, 17 États membres ont ratifié l'AECG, l'Allemagne étant le dernier pays à l'avoir fait en janvier 2023.
L'UE est également un partenaire clé, de même sensibilité, pour le Canada dans ses efforts visant à renforcer la sécurité et la prospérité mondiales, ainsi qu’à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et le multilatéralisme. L'émergence d'une UE forte, unie et engagée fait de Bruxelles le centre de gravité de l'engagement du Canada en Europe, la France et l'Allemagne figurant parmi les États membres les plus influents. Le Canada bénéficie d'un cadre de coopération bilatérale d'une ampleur unique, l'accord de partenariat stratégique (APS). La capacité de développement international de l'UE est l'une des plus importantes au monde. Depuis décembre 2021, une grande partie de son aide au développement est fournie dans le cadre de l'initiative « Global Gateway » de l'UE. Cette dernière mobilisera jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds d'investissement entre 2021 et 2027 pour des projets de développement durable dans le monde entier.
Le Royaume-Uni reste le principal partenaire commercial du Canada en Europe, avec 46,5 milliards de dollars d'échanges combinés de biens et de services en 2022. Un accord de continuité commerciale, basé sur l'AECG, est entré en vigueur en avril 2021, après le retrait du Royaume-Uni de l'UE. En mars 2022, le Canada a entamé des négociations en vue d'un accord bilatéral de libre-échange avec le Royaume-Uni, qui se poursuivent actuellement. La relation bilatérale avec le Royaume-Uni en matière de politique étrangère et de développement est également forte, y compris dans le contexte des alliances transatlantiques. Le Royaume-Uni est un allié particulièrement important en matière de sécurité et de défense, notamment sur le plan multilatéral au sein de l'OTAN et par l'intermédiaire de la communauté du renseignement Five Eyes.
Le soutien du Canada à l'Ukraine après l'invasion totale de la Russie en février 2022 est d'une importance capitale dans la région. La guerre illégale menée par la Russie a déplacé des millions de personnes et en a tué des dizaines de milliers, a endommagé des économies déjà mises à rude épreuve et a exacerbé l'insécurité alimentaire et énergétique, l'Ukraine et la Russie représentant un tiers du commerce mondial du blé. L'unité de l'OTAN s'est renforcée en réponse, et la Russie n'a pas réussi à remporter une victoire rapide. Elle s'efforce désormais de durer et de démoraliser l'Ukraine et ses partenaires en menant des attaques de grande envergure contre les infrastructures civiles. Une évaluation réalisée en mars 2023 par l'Ukraine, la Banque mondiale et la Commission européenne estime les coûts de redressement et de reconstruction de l'Ukraine à 411 milliards de dollars américains. Ce montant augmentera au fur et à mesure que le conflit se poursuivra.
Le Canada a été un partenaire et un allié fiable de l'Ukraine, s'engageant à lui fournir une aide de plus de 8,8 milliards de dollars. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une approche coordonnée avec des partenaires clés. L'aide du Canada comprend une aide financière (5,015 milliards de dollars), une aide militaire (2,089 milliards de dollars), une aide humanitaire (352,5 millions de dollars), une aide au développement (147 millions de dollars), ainsi qu’une aide à la sécurité et à la stabilisation (102,4 millions de dollars). Le Canada a également renforcé son soutien militaire aux forces de sécurité de l'Ukraine, notamment en prolongeant et en élargissant l'opération UNIFIER. En outre, le Canada a entrepris un engagement diplomatique global en faveur de l'Ukraine. Il a notamment mené des actions de plaidoyer bilatérales, rallié des soutiens en faveur des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies et défendu la cause de l'Ukraine dans les forums multilatéraux. Après l'invasion, le Canada a ouvert 2 nouvelles filières d'immigration pour aider les Ukrainiens fuyant le conflit. De plus, le Canada a imposé plus de 2 600 sanctions et mesures économiques supplémentaires pour soutenir l'Ukraine.
En Europe de l'Est et en Eurasie, les pays post-soviétiques s'efforcent de se détacher de la sphère d'influence de la Russie : qu'il s'agisse de choisir une orientation euro-atlantique, d'établir un équilibre entre la Russie et l'Occident, ou de rechercher des partenariats avec la Chine en matière d'investissement et de relations commerciales. Bien que la stabilité de cette région soit directement liée aux objectifs sécuritaires, politiques et économiques du Canada, notre présence diplomatique demeure limitée. La Turquie, alliée de l'OTAN, partenaire du G20, marché émergent et aspirant à l'UE, constitue une épreuve différente. Le Canada demeure vigilant quant à la tournure autoritaire que prend la Turquie sous la présidence d'Erdogan, mais s'engage à veiller à ce qu'Ankara reste dans la sphère euro-atlantique. Dans l'ensemble, en tant que partenaire clé de l'OTAN, la Turquie a joué un rôle actif dans le soutien à l'Ukraine, notamment en négociant l'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui a contribué à l'exportation des céréales ukrainiennes sur le marché mondial, une priorité importante pour les pays du Sud.
Tous les pays nordiques sont membres du Conseil de l'Arctique et de l'OTAN, à l'exception de la Suède dont le processus d'adhésion est en cours. Il y a eu récemment une augmentation significative des engagements de haut niveau (PM et ministres), en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Premier ministre Trudeau était l'invité d'honneur de la réunion des Premiers ministres des pays nordiques qui s'est tenue en Islande en juin 2023. La ministre Joly a rencontré bilatéralement chacun de ses homologues et a l'intention d'organiser un tout premier dialogue stratégique Canada-Nord en novembre 2023 (dates à confirmer). Ensemble, les pays nordiques constituent la 12e économie mondiale (PIB de 2,42 billions de dollars) et la 7e économie la plus prospère. Le commerce de marchandises entre le Canada et les pays nordiques s'est élevé à 13,6 milliards de dollars en 2022. Le total des échanges, y compris les services, s'élevait à 17,3 milliards de dollars.
Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (ANPF), lancé en 2019, est une autre priorité essentielle pour la région. Au sein de la Direction générale de l'Europe, de l'Arctique, du Moyen-Orient et du Maghreb (EGM), le haut fonctionnaire chargé de l'Arctique est responsable de l'engagement international dans le cadre du CPNA, ainsi que des travaux du Conseil de l'Arctique. La présidence du Conseil de l'Arctique est passée de la Russie à la Norvège en mai. Avec la Russie comme membre du Conseil, les travaux de ce dernier ne se déroulent pas comme d'habitude, mais le forum reste important pour faire avancer les intérêts prioritaires du Canada dans l'Arctique.
Amérique latine et Caraïbes
Enjeu
- Protéger 91,7 milliards de dollars d’actifs miniers canadiens dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, notamment au Chili, au Panama, au Brésil, au Pérou, au Mexique, en Argentine et en République dominicaine.
- L’érosion démocratique, l’absence de croissance économique, le crime organisé, les changements climatiques, l’insécurité alimentaire et les migrations irrégulières figurent parmi les défis à relever dans la région. Les crises au Nicaragua, au Venezuela et en Haïti nécessitent une réponse coordonnée avec les partenaires régionaux.
- L’influence croissante de la Chine dans la région (et le réengagement de la Russie à Cuba)
Contexte
Intérêts économiques du Canada
- Comme la région de l’Amérique latine et des Caraïbes représente 46,8 % du total des actifs miniers canadiens à l’étranger, la région se distingue des autres parties du monde à cet égard. Ces actifs sont évalués à 91,7 milliards de dollars dans cette région et sont principalement situés au Chili, au Panama, au Brésil, au Pérou, au Mexique, en Argentine et en République dominicaine.
Démocratie et gouvernance inclusive
Les principales menaces qui pèsent sur la démocratie en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC) sont les restrictions à la liberté d’expression, la désinformation, l’inégalité, la corruption et les irrégularités électorales. Si l’on constate une certaine érosion de la démocratie dans l’ensemble de la région, les régressions observées au Salvador, au Guatemala, au Nicaragua, au Venezuela, à Cuba et en Haïti sont les plus préoccupantes.
Le Canada s’engage en faveur de la démocratie et de la gouvernance inclusive par le biais de l’aide internationale, du dialogue politique et de la participation à des forums multilatéraux. Le premier ministre Trudeau a signé des initiatives communes d’une valeur de 50 millions de dollars lors du Sommet de mars pour la démocratie, y compris quatre projets dans les Amériques sur la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. Le Canada collabore avec ses partenaires de l’Organisation des États américains (OEA) pour protéger et promouvoir la démocratie, notamment par l’observation électorale, le soutien à la liberté des médias et l’assistance technique aux processus électoraux.
Croissance inclusive
Le Canada a conclu huit accords de libre-échange dans les Amériques. La région représentait 2,8 % des exportations et 8,7 % des importations du Canada en 2022, ce qui est resté relativement stable au cours de la dernière décennie. La région de l’Amérique latine et des Caraïbes est bien positionnée en termes de croissance démographique, avec des ressources naturelles et des produits agricoles disponibles pour soutenir la croissance économique à moyen terme.
Le Canada est un pays membre du Partenariat des Amériques pour la prospérité économique (PAPE), qui vise à mieux tirer parti des possibilités de croissance durable et partagée entre des démocraties aux vues similaires. Le Canada s’efforce de façonner cette initiative de manière à promouvoir le commerce inclusif, à soutenir la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à préserver la prospérité économique des pays membres.
Crime organisé
Environ un tiers des meurtres commis dans le monde se produisent chaque année en Amérique latine, et les autorités nationales en attribuent une grande partie, voire la majorité, au crime organisé.
Comptant trois des plus grands pays producteurs de cocaïne au monde – la Colombie, le Pérou et la Bolivie – ainsi que les principaux points de sortie des exportations de cocaïne vers l’Europe et les États-Unis, la région joue un rôle clé dans les marchés illicites de la drogue depuis plus de quarante ans. Alors que la violence liée à la drogue continue de sévir en Amérique centrale, en Colombie et au Mexique, les modifications apportées aux itinéraires et aux réseaux de la drogue ont provoqué des flambées en Équateur et au Costa Rica – pays traditionnellement considérés comme sûrs et pacifiques.
Changements climatiques et perte de biodiversité
Le Canada fait appel à des partenaires pour mettre en œuvre l’Accord de Paris et le Cadre mondial pour la biodiversité, développer la résilience climatique, promouvoir l’énergie propre et soutenir la préparation, la réponse et le rétablissement en cas de catastrophe. En 2012, le Canada a contribué à hauteur de 250 millions de dollars à la création du Fonds climatique canadien pour le secteur privé dans les Amériques à la Banque interaméricaine de développement. Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris en 2015, le Canada a fourni 223,5 millions de dollars supplémentaires pour sa deuxième phase. En juin 2021, le Canada a doublé son précédent engagement quinquennal en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques pour le porter à 5,3 milliards de dollars (2021-2026). Lors de la COP15, le Canada s’est engagé à verser 350 millions de dollars sur trois ans (2023-2026) pour aider les pays en développement à stopper et à inverser la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
Insécurité alimentaire et malnutrition
Le Canada a augmenté son aide alimentaire mondiale et continue de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents par le biais de l’aide humanitaire, et à aborder les faiblesses et inégalités sous-jacentes des systèmes alimentaires par l’entremise de l’aide au développement. En s’appuyant sur les efforts actuels en matière d’agriculture et de systèmes alimentaires durables, la programmation future se concentrera sur le renforcement de la résilience des systèmes agroalimentaires par le biais d’une agriculture adaptée au climat, de chaînes de valeur agroalimentaires durables, d’une gouvernance inclusive des systèmes alimentaires et de filets de sécurité alimentaire productifs.
Migration irrégulière
Le Canada soutient les pays des Amériques qui accueillent des réfugiés et des migrants vénézuéliens. Le Canada a coorganisé la Conférence internationale de 2023 en solidarité avec les réfugiés et migrants vénézuéliens et avec leurs pays et communautés d’accueil, et a permis de recueillir 1,2 milliard de dollars de promesses de dons.
Le Canada participe à différents mécanismes et forums multilatéraux visant à renforcer les pratiques en matière de migration et de protection dans la région, tels que le Sommet des leaders nord-américains, la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection, le Pacte mondial pour les migrations et le Pacte mondial pour les réfugiés, la plateforme de soutien du Cadre global de protection et de solutions régionales (MIRPS), la Conférence régionale sur les migrations et le Groupe des Amis du Processus de Quito.
Crises prolongées
Le Canada reste préoccupé par la crise politique et les violations persistantes des droits de la personne au Nicaragua. Le Canada a imposé plusieurs séries de sanctions en coordination avec des États aux vues similaires (États-Unis, Royaume-Uni, UE, Suisse) et continue d’exercer des pressions multilatérales et de jouer un rôle de premier plan à l’OEA et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne la détérioration de la situation au Nicaragua.
Le Canada joue un rôle de premier plan dans la coordination de l’aide internationale à la sécurité en Haïti (c’est-à-dire l’équipement et le soutien financier à la Police nationale d’Haïti), notamment par la mise en place d’un mécanisme conjoint de coordination des civils, des militaires et des forces policières dirigé par le Canada. Le Canada soutient les solutions menées par les Haïtiens en encourageant un dialogue politique national, en adoptant des sanctions et des mesures juridiques, et en poursuivant le développement et l’aide humanitaire.
Le Canada s’est engagé à trouver une solution négociée qui conduise à un retour à la démocratie au Venezuela. Des concessions démocratiques de la part du régime de Maduro sont essentielles à cet objectif. Depuis 2019, le Canada a fourni plus de 180 millions de dollars en aide internationale en réponse à la crise au Venezuela. Un financement supplémentaire de 58,55 millions de dollars en aide internationale a été annoncé lors de la Conférence de mars 2023.
Le Pérou, et plus récemment l’Équateur, ont été confrontés à une instabilité politique qui a conduit à la tenue d’élections. Pour le Pérou, l’instabilité s’est également traduite par des manifestations soutenues et des violations présumées des droits de la personne qui ont été largement documentées et dénoncées. Le Canada continue à chercher des solutions bilatérales et multilatérales pour sauvegarder les droits de la personne et respecter les processus démocratiques.
Engagement avec les partenaires hémisphériques
Le dixième Sommet des leaders nord-américains s’est tenu en janvier, avec notamment le lancement d’un plan d’action définissant la coopération trilatérale sur six piliers : diversité, équité et inclusion; changements climatiques; compétitivité; migration et développement; santé; et sécurité régionale. Le prochain sommet sera accueilli par le Canada à l’automne.
En février, le premier ministre Trudeau a participé à la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, annonçant 80 millions de dollars de nouvelles initiatives pour soutenir le peuple haïtien, s’attaquer à la crise climatique, relever les défis croissants en matière de sécurité et promouvoir l’égalité des genres. La réunion 2023 du Groupe des ministres des affaires étrangères Canada-CARICOM s’est tenue en juin en marge de l’Assemblée générale de l’OEA. Le Canada présidera le Conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes l’année prochaine.
Le Canada soutient l’Alliance pour le développement de la démocratie (ADD) du Costa Rica, de la République dominicaine, du Panama et de l’Équateur, en s’élevant contre l’érosion de la démocratie dans la région, et a publié une déclaration commune avec l’ADD l’année dernière.
Chine
La Chine est le deuxième partenaire commercial de la région de l’Amérique centrale et des Caraïbes et le premier de l’Amérique du Sud. Elle est un investisseur majeur dans la région, se concentrant sur les ressources naturelles, l’énergie et les infrastructures. Vingt-et-un pays d’Amérique latine et des Caraïbes participent à l’initiative des nouvelles routes de la soie et cinq sont membres à part entière de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, initiée par la Chine (Argentine, Chili, Équateur, Uruguay, Pérou). La Chine continue de gagner en influence politique et commerciale et a tenté d’élever son forum avec la Communauté d’États latino-américains et caribéens (CELAC) pour orienter l’engagement et les investissements multilatéraux.
Russie et Cuba
En juin 2023, le premier ministre cubain Marrero a effectué une longue visite en Russie, au cours de laquelle il a notamment rencontré le président Poutine. Cette visite a été suivie d’une série d’accords commerciaux bilatéraux (la Russie achètera du sucre et du rhum cubains; la Russie exportera vers Cuba du blé et du pétrole et y enverra des touristes).
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Enjeu
- Le Canada entretient depuis longtemps des relations diplomatiques, commerciales et interpersonnelles avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MOAN), une région complexe souvent connue pour ses vastes ressources énergétiques, ses incessants conflits entre États et à l’intérieur de ceux-ci et ses récents défis en matière [CAVIARDÉ]
- Des changements économiques, sociaux et politiques cruciaux sont en cours dans la région du MOAN, [CAVIARDÉ] Pour les économies dépendantes du pétrole, il est nécessaire de se réorienter dans le cadre de l’inévitable transition énergétique mondiale.
- Le Canada est généralement perçu de manière positive et peut s’appuyer sur les liens de la diaspora et de l’éducation dans de nombreux endroits, ainsi que sur son identité francophone (en particulier en Afrique du Nord). [CAVIARDÉ]
- Le Canada dispose d’un portefeuille de développement d’environ 134 millions de dollars dans la région du MOAN, axé sur trois programmes : la stratégie pour le Moyen-Orient, le programme pour les Palestiniens et les programmes nationaux plus modestes pour l’Afrique du Nord.
- Il existe des possibilités de croissance dans nos relations commerciales, y compris des investissements importants. L’engagement au niveau politique est souvent extrêmement utile pour ouvrir des portes.
Contexte
La région du MOAN est une partie du monde diversifiée et souvent cloisonnée. Certains défis sont communs : [CAVIARDÉ] taux de chômage élevés (y compris chez les jeunes et les minorités), inégalités socio-économiques au sein des pays, pressions démographiques et migratoires, insécurité alimentaire, stress hydrique et vulnérabilité aux effets des changements climatiques. Les rivalités stratégiques régionales (par exemple entre l’Algérie et le Maroc), plusieurs conflits (par exemple entre Israël et les Palestiniens) et les États fragiles (par exemple la Libye et [CAVIARDÉ]) viennent s’ajouter aux complexités structurelles.
Le Canada a néanmoins la possibilité de promouvoir une croissance mutuellement bénéfique dans ces relations. Nos programmes de développement actuels répondent aux besoins des plus pauvres, y compris dans des domaines importants tels que l’égalité des genres, l’action climatique et la gouvernance. Il existe également un potentiel de renforcement de la coopération bilatérale avec les pays donateurs de la région du MOAN. D’importantes perspectives commerciales existent avec les États du Golfe, ainsi qu’avec les économies émergentes et dans les secteurs émergents tels que l’énergie propre. [CAVIARDÉ].
Développement
Le budget d’aide internationale du Canada au Moyen-Orient et en Afrique du Nord s’élève à environ 134 millions de dollars par an.
La stratégie pour le Moyen-Orient a été lancée en 2016 [CAVIARDÉ] en tant qu’initiative pangouvernementale visant à répondre aux crises en Irak, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Elle comprenait plus de 4,7 milliards de dollars d’aide au développement international et de programmes de sécurité et de stabilisation. La programmation bilatérale en matière de développement met particulièrement l’accent sur la résilience, le redressement et la lutte contre les causes sous-jacentes à plus long terme et les vecteurs structurels des conflits et de l’instabilité, notamment les changements climatiques, l’insécurité alimentaire et l’inégalité entre les hommes et les femmes.
[CAVIARDÉ] Le Canada a déboursé en moyenne environ 55 millions de dollars par an pour aider à répondre aux besoins humanitaires et de développement des Palestiniens vulnérables. Le Canada ne fournit aucun financement à l’Autorité palestinienne directement, et des protocoles renforcés de diligence raisonnable permettent d’éviter que des fonds canadiens soient détournés au profit d’acteurs malveillants. En juin 2023, le Canada a annoncé le renouvellement de son engagement quadriennal de 25 millions de dollars par an (2023-2026) pour soutenir l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le principal organisme multilatéral qui vient en aide à 5,9 millions de réfugiés palestiniens dans la région.
Enfin, il existe un modeste programme de développement bilatéral d’environ 19 millions de dollars par an en Afrique du Nord. Le Canada soutient actuellement 20 projets en Égypte, au Maroc et en Tunisie, axés sur le renforcement du pouvoir économique, la promotion de l’égalité des genres, l’adaptation au climat et la gouvernance inclusive.
Les pays du Golfe et Israël sont d’importants contributeurs à l’aide publique au développement (APD). [CAVIARDÉ]
Commerce et relations commerciales
Les relations commerciales de la région du MOAN sont dominées par les sous-régions et les pays individuels.
En 2022, les échanges bilatéraux avec l’Afrique du Nord étaient évalués à plus de 6 milliards de dollars, mais les liens commerciaux n’ont pas encore été concrétisés. [CAVIARDÉ] L’Égypte et le Maroc se positionnent comme des points d’entrée sur le continent africain. Le lancement de la Stratégie de coopération économique Canada-Afrique peut mettre en lumière des débouchés pour les entreprises de la sous-région et au-delà.
Les relations commerciales avec Israël sont solides (2,1 milliards de dollars en 2022) et bénéficient de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI). Israël, centre mondial de l’innovation, est la première destination des investissements directs canadiens dans la région du MOAN (537 millions de dollars en 2021). [CAVIARDÉ] Les relations commerciales avec les Palestiniens sont beaucoup plus modestes et plus difficiles à suivre (le commerce bilatéral est estimé à 9,41 millions de dollars en 2019). L’ALECI couvre également le commerce admissible en provenance des territoires palestiniens.
Le commerce canadien au Levant est extrêmement limité en raison des sanctions en Syrie, d’une crise économique majeure au Liban, d’un marché très restreint en Jordanie et d’un Irak instable. En ce qui concerne la Jordanie, un accord de libre-échange est en vigueur depuis octobre 2012 et les échanges commerciaux s’élèveront à 254 millions de dollars en 2022. Bien que l’Irak reste fragile, il représente un marché émergent potentiel avec des débouchés significatifs. Malgré les difficultés économiques du Liban, le commerce bilatéral a très légèrement augmenté depuis 2021. Le Canada n’entretient pas de relations commerciales officielles avec le régime syrien, conformément à sa politique d’engagement contrôlé et aux sanctions canadiennes.
Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) sont d’importants partenaires stratégiques et commerciaux pour le Canada, avec une marge de croissance supplémentaire. La récente normalisation des relations bilatérales entre le Canada et l’Arabie saoudite offre des occasions importantes. Les échanges commerciaux avec les États du Golfe ont totalisé 9,25 milliards de dollars en 2022, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite étant les principaux partenaires commerciaux. Alors que les pays du CCG cherchent à diversifier leurs économies dépendantes du pétrole, il existe d’importants débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes (technologies propres, énergies alternatives, TIC et éducation). La région est une source potentielle importante d’investissements étrangers, notamment en raison de la taille des fonds souverains détenus par les États du Golfe (estimés à 3 700 milliards de dollars). Les investissements canadiens dans la région augmentent également par le biais d’investisseurs institutionnels et de fonds de pension.
Afrique subsaharienne
Enjeu
L’engagement du Canada envers l’Afrique est solide, multiforme et croissant. Des progrès sont réalisés grâce à nos engagements économiques, commerciaux, diplomatiques et en matière d’aide internationale. Bien que les questions de sécurité, de démocratie et de droits de la personne demeurent préoccupantes et que la réalisation de progrès dans le domaine du développement reste un défi dans plusieurs pays, les Africains ont plus d’influence sur la scène internationale qu’auparavant, et l’Afrique offre des perspectives économiques et commerciales ainsi que des possibilités de partenariats.
Contexte
Mandat : Le Secteur fait progresser les priorités du Canada dans les 48 pays de l’Afrique subsaharienne où elle est accréditée, par l’intermédiaire de 16 missions et de 5 bureaux dans 19 pays. Au sein du gouvernement du Canada, le Secteur fait progresser, soutient et coordonne les objectifs de la politique étrangère du Canada en Afrique subsaharienne. Il gère les relations politiques, commerciales et de développement avec les pays de l’Afrique subsaharienne, ainsi qu’avec les institutions régionales et continentales, dont l’Union africaine (UA), et dirige les questions pertinentes dans les forums multilatéraux, notamment les Nations Unies et le G7/G20. Le Secteur est responsable du dialogue sur les politiques et des activités d’engagement des intervenants, ainsi que d’environ 580 millions de dollars par an de fonds d’aide internationale. Le réseau des missions fournit également des services consulaires aux citoyens canadiens à l’étranger et gère un programme actif de défense des intérêts et de diplomatie, ainsi qu’un programme commercial qui fournit des services commerciaux et des conseils aux entreprises canadiennes et les aide à saisir les occasions d’affaires internationales.
Éléments clés
- La ministre du Commerce international (MINT) a été mandatée par le premier ministre pour élaborer une Stratégie de coopération économique Canada-Afrique. Des consultations publiques sont en cours. Le secrétaire parlementaire Virani doit se rendre en Côte d’Ivoire et au Ghana (août 2023) pour recueillir des commentaires et valider ce qui a été entendu lors des consultations à ce jour.
- Les relations entre le Canada et l’Union africaine (UA) sont en pleine expansion. Il convient de noter les faits marquants suivants, survenus au cours de l’année écoulée :
- le Canada a ouvert un bureau de représentation permanente auprès de l’UA et a nommé un observateur permanent auprès de l’UA (Ben‑Marc Diendéré);
- le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Moussa Faki, s’est rendu à Ottawa pour le premier dialogue de haut niveau entre le Canada et la CUA (octobre 2022);
- MINT a accueilli le commissaire au commerce et à l’industrie de l’UA, Albert Muchanga, à Ottawa pour le premier Dialogue sur la politique commerciale entre le Canada et l’UA (mai 2023);
- la lettre d’intention d’organiser un dialogue sur la politique de développement avec la CUA a été signée par le ministre du Développement international (MINE) à Addis-Abeba, en mai 2023.
- La Politique d’aide internationale féministe du Canada consacre 50 % du financement bilatéral à l’Afrique subsaharienne. En 2022-2023, le Canada a consacré 40 % de l’aide bilatérale à cette région. De ce montant, 576 millions de dollars ont été versés par le Secteur de l’Afrique subsaharienne (WGM).
- En Afrique occidentale et centrale, le Canada s’engage, aux côtés de partenaires internationaux et africains, à renforcer la paix, la stabilité, le développement, la démocratie et la gouvernance inclusive. Cette action s’inscrit dans le contexte d’un recul démocratique (gouvernements dirigés par des militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Tchad) et de crises sécuritaires dans la région du Sahel et au Cameroun.
- En Afrique australe et orientale, le Canada collabore avec la communauté internationale et les partenaires de la région pour promouvoir la stabilité politique et économique et la sécurité, notamment en s’attaquant aux foyers de conflit tels que l’Éthiopie et le Soudan.
Engagements du Canada
- Voyage ministériel en 2023 : En juillet, le ministre du Développement international, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse et la députée Kayabaga se sont rendus au Rwanda pour la conférence Women Deliver. Le ministre du Développement international et la députée Kayabaga se sont également rendus en Tanzanie pour une visite bilatérale. En mai, la ministre des Affaires étrangères s’est rendue au Kenya; le ministre du Développement international a visité l’Éthiopie, l’Égypte et le Tchad; et le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion a assisté à l’investiture du président nouvellement élu du Nigéria au nom du premier ministre.
- L’Union africaine au sein du G20 et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : Lors de la récente Journée de l’Afrique (25 mai 2023), le premier ministre a exprimé le soutien du Canada à l’adhésion de l’UA au G20 en tant que membre permanent. Le Canada soutient également la demande de l’UA d’adhérer à l’OMC en tant qu’observateur permanent.
- Les quatorzièmes consultations bilatérales annuelles entre le Canada et l’Afrique du Sud (mai 2023) : Tenues à Ottawa et virtuellement, ces consultations pangouvernementales ont été coprésidées par David Morrison, sous-ministre des Affaires étrangères du Canada, et Zane Dangor, directeur général du ministère des Relations internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud. Les domaines abordés sont le commerce, l’environnement, la santé, la science, la technologie et l’innovation, ainsi que les industries culturelles.
- Visite de l’ancien vice-président du Nigéria (novembre 2022) : L’ancien vice-président Yemi Osinbajo a visité le Canada pour la première fois depuis 2000. La vice-première ministre, le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, le secrétaire parlementaire Oliphant et des sénateurs ont organisé un déjeuner.
Questions prioritaires
- Cadre d’engagement : Au printemps 2022, la ministre des Affaires étrangères a chargé le secrétaire parlementaire des Affaires étrangères d’élaborer un cadre visant à approfondir et à renforcer l’engagement du Canada auprès des partenaires africains, à améliorer la mise en œuvre stratégique de la politique étrangère du Canada à l’égard de l’Afrique et à répondre à l’évolution de la dynamique géopolitique. Des discussions sont en cours concernant les prochaines étapes et la nécessité de garantir la cohérence avec la Stratégie de coopération économique et la Politique d’aide internationale féministe. Certains médias, universitaires et parlementaires ont exprimé des opinions sur le contenu et le processus de cette initiative stratégique.
- Le premier ministre a annoncé en juin 2022 que la représentation du Canada au Rwanda passerait d’un bureau à un haut-commissariat. Le Canada est préoccupé par le soutien apporté par le Rwanda au groupe armé M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et il adopte une approche équilibrée dans ses relations avec les deux pays.
- Insécurité alimentaire : La région connaît une insécurité alimentaire accrue, principalement due à la perturbation mondiale de l’approvisionnement en denrées alimentaires et en engrais (notamment les céréales), ainsi qu’à la persistance de conflits prolongés et de l’instabilité.
- Changements climatiques : Avant la COP27 (novembre 2022, Égypte), l’Union africaine a rendu publique une stratégie globale de lutte contre les changements climatiques. Elle vise à mettre en place une industrie efficace dans l’utilisation des ressources et à rendre les secteurs clés (p. ex. l’agriculture, l’énergie et les infrastructures) résistants aux changements climatiques. Des négociations préalables à la COP sont en cours (sous l’égide du Kenya) afin de définir des objectifs communs pour l’Afrique en vue de la COP28 à Dubaï.
- Montée des sentiments anti-LGBTQI+ : L’Afrique connaît une recrudescence des sentiments et des violences anti-LGBTQI+, notamment en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Ghana et en Namibie. Il s’agit là d’un levier essentiel pour l’engagement de la Russie dans la région.
- Sahel : La région est confrontée à des crises sécuritaires et humanitaires croissantes, notamment des menaces terroristes qui s’étendent aux pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à une instabilité politique permanente due aux transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, qui sont tous dirigés par des gouvernements militaires. Le Canada coordonne ses efforts avec d’autres donateurs et partenaires d’optique commune, notamment par l’intermédiaire de la Coalition internationale pour le Sahel et de l’Alliance Sahel.
- Mali : Le risque de violence à l’encontre des civils augmente, car les forces armées maliennes font équipe avec des mercenaires russes (Wagner) pour combattre les groupes islamistes et rebelles liés à des violations présumées des droits de la personne au Mali. En juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a mis fin à la MINUSMA, vieille de dix ans, après que l’armée malienne au pouvoir a exigé le retrait de la force internationale « sans délai ». Le CSNU a pour objectif d’achever le retrait de la MINUSMA d’ici le 31 décembre 2023.
- Processus de médiation au Cameroun : Depuis août 2022, le Canada mène des pourparlers sur le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. [CAVIARDÉ]
- Éthiopie : Les perspectives de résolution du conflit dans le nord de l’Éthiopie demeurent, bien que l’absence de progrès en matière d’accès humanitaire et de reddition de comptes pour les violations des droits de la personne continue de poser des problèmes et que la situation pourrait se détériorer.
- Mozambique : L’insurrection terroriste à Cabo Delgado se poursuit malgré la présence d’un soutien extérieur, notamment de la part du Rwanda. La crise humanitaire qui en résulte est la plus importante d’Afrique australe.
- Le Kenya est confronté à une série de manifestations populaires dues au coût élevé de la vie. Le président Ruto et son gouvernement sont critiqués pour leur réaction brutale.
- Soudan : Les violences entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) se poursuivent depuis le début du conflit le 15 avril. Plus de 750 000 personnes ont fui le pays, ce qui a eu un impact humanitaire considérable sur la population du Soudan et des pays voisins. Les alliances régionales sont de plus en plus importantes car plusieurs pays, ainsi que des organisations régionales, s’engagent dans l’espace de médiation.
- Soudan du Sud : Déficit démocratique dans la mise en œuvre de l’accord de paix et risque de conflit autour des prochaines élections en 2024.
- Afrique du Sud : L’Afrique du Sud accueillera le Sommet des pays BRICS en août 2023 et il a été récemment confirmé que le président Poutine, accusé par la Cour pénale internationale (CPI), n’y participera pas et que la Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Le pays reste également confronté à une crise de l’électricité, qui a entraîné un nombre record de jours de pannes en succession et suscité des inquiétudes croissantes quant à la stabilité du réseau. L’Afrique du Sud reste un partenaire important pour le Canada, comme en témoignent les récentes consultations bilatérales et le soutien apporté à la transition énergétique.
- Zimbabwe : Les élections générales auront lieu le 23 août 2023. Le président Mnangagwa a promulgué la « loi patriotique » qui menace les libertés garanties aux citoyens et aux résidents permanents du Zimbabwe. Le Canada observera les élections. Le déroulement des élections influencera la réadmission du Zimbabwe au sein du Commonwealth.
E. Thèmes principaux
Climat, environnement et biodiversité
Enjeu
- La triple crise planétaire des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution constitue une menace fondamentale, dont les pays pauvres et marginalisés et les communautés vulnérables sont les plus touchés.
- La lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité nécessite des partenariats mondiaux et des solutions intersectorielles.
- Le Canada a doublé son financement international en faveur du climat pour atteindre 5,3 milliards de dollars sur cinq ans (2021-2026) et s’est engagé à verser 350 millions de dollars sur trois ans (2023-2026) en financements nouveaux et supplémentaires pour des initiatives en faveur de la biodiversité dans les pays en développement.
Contexte
Les changements climatiques et la perte de biodiversité constituent une menace fondamentale, indivisible et croissante pour la planète et tous les peuples. Le réchauffement de la surface de la Terre devrait atteindre 1,5 degré Celsius ou 1,6 degré Celsius au cours des deux prochaines décennies. Les changements climatiques exacerbent les vulnérabilités préexistantes et contribuent à l’insécurité, et l’on s’attend à ce que les défis géopolitiques liés au climat continuent de croître, notamment les conflits pour les terres arables, l’eau, les ressources alimentaires, ainsi que les déplacements humains induits par le climat.
Alors que la biodiversité et les ressources naturelles contribuent aux moyens de subsistance de près de la moitié de la population mondiale, la perte de biodiversité devrait se poursuivre, jusqu’à un million d’espèces menacées d’extinction, ce qui aura des conséquences socio-économiques désastreuses à l’échelle mondiale. Il a également été démontré que les inégalités entre les hommes et les femmes et les écarts de développement amplifient les effets des changements climatiques et de la perte de biodiversité, les femmes et les filles étant touchées de manière disproportionnée, en particulier celles dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles.
La santé des sociétés et des économies et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) dépendent des efforts déployés à l’échelle internationale pour protéger, conserver et restaurer la nature et réduire les émissions. Les pays en développement, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, comme les pays les moins avancés (PMA), sont les plus durement touchés et les moins bien équipés pour prévenir les conséquences et y faire face. Les petits États insulaires en développement (PEID) sont également confrontés à des vulnérabilités structurelles et systémiques. De plus en plus exposés aux conséquences des changements climatiques, ils subissent les effets des pays à fortes émissions par le biais de risques naturels dangereux et intenses tels que les inondations, la sécheresse et l’érosion côtière.
Action internationale du Canada pour le climat et l’environnement
Le Canada s’est engagé à soutenir les pays en développement dans leur transition vers des économies à faibles émissions de carbone, résilientes aux changements climatiques et respectueuses de la nature. Il le fait par le biais d’initiatives qui réduisent les émissions mondiales de gaz à effet de serre, améliorent la résilience climatique et réduisent les risques de catastrophe, et protègent et gèrent durablement les écosystèmes et leurs services au profit des plus pauvres et des plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. L’action en faveur de l’environnement et du climat est l’une des six priorités de la Politique d’aide internationale féministe et concentre ses efforts sur trois parcours :
- Parcours 1 : Renforcer la gouvernance environnementale et la participation des femmes à la prise de décisions.
- Parcours 2 : Investir dans des économies à faibles émissions de carbone, résilientes aux changements climatiques et favorables à la nature.
- Parcours 3 : Favoriser les pratiques environnementales qui appuient des communautés saines, résilientes et adaptatives
Les efforts du Canada s’alignent sur les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris, de la Convention sur la diversité biologique et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et de la Convention sur la lutte contre la désertification.
Le Canada collabore également avec le G7, le G20, l’OCDE et d’autres partenaires, notamment les institutions financières internationales, pour éliminer les flux financiers préjudiciables à la nature, prendre de nouveaux engagements ambitieux tels que l’arrêt des nouvelles aides publiques directes au secteur international des énergies fossiles sans dispositif d’atténuation, et soutenir la transition vers des énergies propres à l’échelle mondiale.
Financement international du climat
Le Canada a pleinement respecté l’engagement qu’il avait pris en 2015 de fournir 2,65 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les programmes d’action climatique. Bon nombre des programmes et des projets soutenus dans le cadre de cet engagement sont en cours et devraient avoir permis de réduire ou de prévenir les émissions de gaz à effet de serre de plus de 228 mégatonnes d’équivalent CO2 – ce qui équivaut à retirer environ 47 millions de voitures des routes pendant un an – et d’aider au moins 6,6 millions de personnes à s’adapter aux effets des changements climatiques.
En juin 2021, lors du Sommet du G7, le Canada a annoncé le doublement de son financement pour le climat, soit 5,3 milliards de dollars pour la période 2021-2026. Cette annonce a été suivie par celle de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), en novembre 2021, selon laquelle plus de 40 % de ce financement serait consacré à l’adaptation, plus de 20 % soutiendrait des solutions fondées sur la nature et d’autres projets présentant des avantages complémentaires pour la biodiversité (c’est-à-dire, lorsque la biodiversité est explicitement promue dans un projet et documentée par des preuves – éviter un impact négatif n’est pas une preuve suffisante), et au moins 1 milliard de dollars soutiendrait l’élimination progressive du charbon. En outre, un minimum de 80 % des projets de l’enveloppe seront principalement axés sur l’égalité des genres. 60 % des fonds seront alloués sous forme de contributions remboursables sans condition (contributions à remboursement non conditionnel (CRNC) ou prêts), tandis que les 40 % restants seront distribués sous forme de subventions. Alors que nous entrons dans la troisième année de l’engagement, les programmes d’AMC, d’Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada sont en bonne voie pour atteindre tous ces objectifs stratégiques.
Programme international sur la biodiversité
Lors de la 15e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) tenue en décembre 2022 à Montréal, le premier ministre Trudeau a annoncé un financement nouveau et supplémentaire de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à stopper et à inverser la perte de la nature grâce à la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal. Affaires mondiales Canada, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, étudie les options de programmation pour un décaissement complet en 2024-2025 et 2025-2026.
Lors de la COP15, les Parties ont convenu de la création d’un Fonds-cadre mondial de la biodiversité, qui sera administré par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et ratifié et lancé lors de la 7e assemblée du FEM à Vancouver en août 2023.
Prochains événements clés
- Septième assemblée du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Vancouver, Canada – du 22 au 26 août 2023
- Sommet des Nations Unies sur l’ambition climatique 2023, New York, États-Unis – 20 septembre 2023
- 28eConférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), Dubaï, Émirats arabes unis – du 30 novembre au 12 décembre 2023
Assistance humanitaire
Enjeu
- Les besoins humanitaires ont atteint un niveau record en 2023, avec plus de 363 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire vitale. En tant que l'un des 10 principaux donateurs humanitaires, le Canada continuera à répondre aux crises humanitaires par l'intermédiaire d'un système mondial de partenaires humanitaires expérimentés, notamment les Nations unies, la Croix-Rouge et les ONG, afin de fournir une aide d'urgence là où elle est le plus nécessaire.
- L'aide du Canada est opportune, fondée sur les besoins et centrée sur les personnes, avec une approche féministe inclusive et basée sur les droits de l'homme.
Contexte
Qu'est-ce que l'aide humanitaire ?
L'aide humanitaire vise à sauver des vies, à alléger les souffrances et à préserver la dignité en réponse aux conflits et aux catastrophes naturelles. Elle est orientée par 4 principes fondamentaux :
- L'humanité : La souffrance humaine doit être prise en compte partout où elle se manifeste.
- Neutralité : Les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre parti dans les hostilités, ni s'engager dans des activités de nature apolitique, raciale, religieuse ou idéologique.
- Impartialité : L’aide humanitaire doit être fournie uniquement en fonction des besoins, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de croyance religieuse, de classe ou d'opinions politiques.
- L'indépendance : L'aide humanitaire doit être distincte des objectifs politiques, économiques, militaires ou autres.
Un paysage humanitaire plus complexe
La portée, l'ampleur et la complexité du paysage humanitaire se sont considérablement accrues au cours de la dernière décennie. Les besoins humanitaires ont atteint des sommets, sous l'effet d'une augmentation de 80 % du nombre de conflits - dont la majorité se prolonge de plus en plus - et de catastrophes naturelles plus fréquentes, exacerbées par le changement climatique. En particulier, l'année 2023 est marquée par le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, un chiffre record de plus de 110 millions de personnes déplacées de force de leur domicile, et une plus grande proportion de violence et d'intolérance qui visent les femmes, les filles et les communautés minoritaires. En outre, notamment dans les contextes de conflit, les acteurs humanitaires se retrouvent de plus en plus souvent attaqués et le droit international humanitaire bafoué.
En réponse, l'appel mondial de l'ONU a triplé par rapport à 2015 pour atteindre près de 55 milliards de dollars en 2023, avec un nombre record de 363 millions de personnes ayant besoin d'une aide vitale. Cependant, le système international a du mal à rester à la hauteur, et il existe des déficits de financement persistants et croissants, ainsi que des besoins non satisfaits.
Aide humanitaire du gouvernement du Canada
Pour faire face à un niveau sans précédent de besoins humanitaires, le Canada a continué à répondre à des situations humanitaires complexes, notamment en Ukraine, en Afghanistan, en Haïti et au Soudan, ainsi qu'à des urgences soudaines telles que les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, et s'emploie activement à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde.
Au cours de l'année civile 2022, le Canada a fourni plus de 1,3 milliard de dollars d'aide humanitaire, ce qui le place au septième rang des donateurs. Avec des décaissements annuels moyens de plus de 985 millions de dollars au cours des 5 derniers exercices, l'aide humanitaire représente une part importante de l'enveloppe de l'aide publique au développement du Canada.
Le Canada dispose d'une solide boîte à outils pour répondre aux crises humanitaires. La réponse du Canada fait appel à de multiples acteurs au sein des Affaires mondiales Canada et de l'ensemble du gouvernement canadien. Les réponses consistent principalement en des contributions financières à des partenaires expérimentés pour soutenir leurs interventions de programmation. Cela comprend la fourniture de nourriture, d'eau et d'assainissement, de santé, d'abris, de transferts d'argent, parmi d'autres formes d'assistance vitale. En 2022, les principaux partenaires humanitaires financés par le Canada étaient les suivants :
- Programme alimentaire mondial - 520,3 millions de dollars
- Fonds commun des Nations unies par pays - 118,9 millions de dollars
- Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés - 113,2 millions de dollars
- Comité international de la Croix-Rouge - 103 millions de dollars
- Société canadienne de la Croix-Rouge - 60,7 millions de dollars
En réponse à des situations d'urgence à développement rapide, le soutien du Canada peut également comprendre un soutien en nature tel que l'envoi de fournitures de secours et de matériel médical provenant de ses stocks, le déploiement d'experts civils et l'utilisation de fonds de contrepartie en tant qu'outil d'engagement public. À la suite de catastrophes naturelles de grande ampleur, il peut également faire appel aux capacités uniques des forces armées canadiennes, telles que l'équipe d'intervention en cas de catastrophe, en dernier recours, lorsque la capacité de réaction dépasse les capacités civiles.
L'élaboration d'une politique humanitaire mondiale
Le Canada s'engage activement au niveau mondial pour améliorer l'efficacité et l'efficience du système humanitaire international. Il s'agit notamment de tirer parti de l'influence du Canada sur les mécanismes de gouvernance des principaux partenaires humanitaires des Nations unies. Le Canada travaille également de manière constructive dans le cadre de divers forums multilatéraux, notamment en tant que signataire du Grand Bargain et du Good Humanitarian Donorship. Ces 2 initiatives visent à améliorer l'action humanitaire, notamment en renforçant la localisation.
Le Canada s'est également engagé à mettre en œuvre le Pacte mondial pour les réfugiés, qui vise à répondre plus efficacement aux situations de réfugiés, à améliorer la vie des réfugiés et à mieux soutenir les communautés d'accueil. Le Canada est une voix forte en faveur d'une solidarité internationale accrue et d'un soutien aux réfugiés. Il est d’ailleurs publiquement reconnu comme un leader mondial en matière de réinstallation des réfugiés, d'asile et de voies d'accès complémentaires. Le prochain Forum mondial sur les réfugiés, qui se tiendra en décembre 2023, sera l'occasion de démontrer une fois de plus le leadership et les contributions constantes du Canada dans la lutte contre les déplacements forcés à l'échelle mondiale.
Action humanitaire tenant compte de la dimension de genre
Conformément à sa politique d'aide internationale féministe, le Canada soutient une action humanitaire tenant compte des spécificités de chaque sexe. Il s'agit notamment d'intégrer les considérations de genre dans tous les efforts de politique et de programmation. Le Canada soutient également les interventions ciblées qui comblent directement les lacunes opérationnelles, telles que la santé sexuelle et reproductive (SSR), ainsi que la prévention et la réponse à la violence fondée sur le sexe (VFS) dans les situations d'urgence.
Sécurité alimentaire
Enjeu
La faim dans le monde est en augmentation depuis 2015 et il y a maintenant jusqu'à 783 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde. La crise mondiale de l'alimentation et de la malnutrition continue d'évoluer sous l'effet de chocs majeurs tels que les changements climatiques, les perturbations économiques et les conflits, en particulier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, qui en souffrent le plus.
Contexte
État de la sécurité alimentaire mondiale
Les systèmes agroalimentaires du monde entier sont très vulnérables aux chocs climatiques, aux conflits et aux chocs économiques qui ont exacerbé les inégalités préexistantes. Ceux-ci ont conduit à des défis croissants pour la capacité des systèmes agroalimentaires à fournir des régimes alimentaires nutritifs, sûrs et abordables pour tous.
Après des décennies de déclin constant, la faim dans le monde est en hausse depuis 2015. En 2022, on estime à 783 millions le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaireNote de bas de page 2, soit 170 millions de personnes de plus qu'avant la pandémie de COVID-19. La croissance de la faim dans le monde s'est stabilisée au cours des deux dernières années grâce aux efforts de redressement économique déployés après la pandémie, qui ont contribué à réduire de 3,8 millions le nombre de personnes souffrant de la faim en 2022 par rapport à 2021. Pourtant, en 2022, 9,2 % de la population mondiale souffrait encore de la faim, contre 7,9 % en 2019. Les progrès ont été compromis par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et continuent d'être exacerbés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
La dénonciation par la Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire le 17 juillet 2023 a provoqué un pic sur les marchés à terme des céréales. Certains analystes pensent que ce pic est basé sur la spéculation et qu'il sera de courte durée, estimant que les marchés avaient intégré la fin de l'initiative. Toutefois, la situation évolue encore et l'impact sur la sécurité alimentaire doit être surveillé de près.
Les tendances de la faim dans le monde varient selon les régions. Des progrès ont été réalisés dans la réduction de la faim en Asie et en Amérique latine. Cependant, les niveaux de faim sont toujours en hausse dans diverses régions telles que l'Afrique, l'Asie occidentale et les Caraïbes. En 2022, 2,4 milliards de personnes (principalement des femmes et des habitants des zones rurales) n'avaient pas accès à une alimentation nutritive, sûre et suffisante tout au long de l'année. Les difficultés d'accès à des régimes alimentaires sains et abordables sont dues à l'augmentation du coût des aliments sains, aux conflits, au changement climatique et aux chocs économiques.
La malnutrition reste un défi majeur pour le développement : 148 millions d'enfants de moins de 5 ans (22,3 %) souffrent d'un retard de croissanceNote de bas de page 3, et 45 millions (6,8 %) d'émaciationNote de bas de page 4. Parallèlement, 37 millions d'enfants de moins de 5 ans (5,6 %) sont en surpoids.
Les prix mondiaux des denrées alimentaires restent supérieurs aux moyennes d'avant la pandémie et les prix intérieurs des denrées alimentaires pour les consommateurs continuent d'augmenter dans la plupart des pays. Les prix élevés affectent de manière disproportionnée les plus pauvres, qui consacrent la majeure partie de leurs revenus à l'alimentation et à d'autres besoins fondamentaux. Elle pousse également les gens à se tourner vers des aliments moins chers et moins nutritifs, ce qui exacerbe les taux de malnutrition. La Banque mondiale estime que pour chaque augmentation d'un point de pourcentage des prix des denrées alimentaires, 10 millions de personnes basculent dans l'extrême pauvreté dans le monde. Les inégalités de genre existantes font en sorte que les femmes et les filles mangent moins et en dernier, ce qui aggrave de manière disproportionnée leurs taux de faim, de malnutrition et de pauvreté.
On craint que la crise alimentaire mondiale ne s'aggrave en 2023 et 2024, car les prix élevés des engrais et d'autres chocs contribuent à réduire la productivité agricole. Les perturbations de l'approvisionnement en engrais liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont contribué à une forte baisse de l'accessibilité financière et de la disponibilité des engrais en 2022. L'utilisation moindre d'engrais est susceptible de réduire les rendements et de diminuer la superficie des cultures à forte teneur en nutriments, ce qui peut réduire les disponibilités alimentaires à court et à moyen terme, exacerber la malnutrition et compromettre les moyens de subsistance des agriculteurs et la croissance économique.
Si les conflits, le changement climatique et les perturbations économiques sont les principaux facteurs de la faim, l'insécurité alimentaire peut également conduire à l'instabilité et aux troubles sociaux. L'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques, mais elle est aussi une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial. L'expansion agricole est également à l'origine de plus de 90% de la déforestation et constitue l'un des principaux facteurs de perte de biodiversité. Par conséquent, les investissements dans les systèmes agroalimentaires peuvent s'attaquer aux facteurs de conflit, aux changements climatiques et à la perte de biodiversité, tout en obtenant des résultats en matière de développement, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition.
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la crise alimentaire mondiale est devenue une priorité absolue pour les dirigeants du G7 et du G20, qui ont réaffirmé leur engagement à réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Parallèlement, la Russie continue de diffuser de la désinformation, accusant l'Occident de contribuer à l'insécurité alimentaire.
Réponse du Canada
La réponse à la crise alimentaire mondiale est une priorité pour atteindre les objectifs de développement du Canada dans la plupart des secteurs et contribuer aux objectifs de développement durable. L'absence de réponse adéquate peut avoir des répercussions sur nos relations avec les pays partenaires du Sud et compromettre d'autres investissements dans le domaine du développement.
Une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence a été un élément clé du portefeuille d'aide humanitaire du Canada au fil du temps. En réponse aux besoins alimentaires et nutritionnels croissants, le Canada a considérablement augmenté la part de son financement humanitaire dans ces secteurs depuis 2017, notamment grâce à l'allocation de ressources pour l'assistance alimentaire et nutritionnelle humanitaire en 2021 (135 millions de dollars) et 2022 (250 millions de dollars).
Le Canada continue de fournir une aide au développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires à plus long terme afin de s'attaquer aux causes profondes de la faim et de renforcer la résilience de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Le Canada a déboursé 670 millions de dollars au cours de l'exercice 2022-23 et déboursera 366 millions de dollars pour des projets opérationnels en 2023-24, dont 203 millions de dollars pour l'agriculture et 94 millions de dollars pour des interventions spécifiques à la nutrition. Environ la moitié des investissements du Canada se fait par l'intermédiaire d'institutions multilatérales et financières, le reste par l'intermédiaire de gouvernements partenaires dans les pays et d'organisations de la société civile.
Le Canada est un ardent défenseur d'une réponse cohérente aux crises immédiates, tout en préparant le terrain pour une résilience à moyen et long terme. Nous travaillons avec des partenaires multilatéraux dans des forums importants tels que les agences des Nations unies basées à Rome, le G7/G20 et l'OMC afin de promouvoir une réponse à la crise coordonnée et fondée sur des données probantes.
Le Canada travaille également à l'échelle internationale au-delà de l'aide publique au développement. Par exemple, le Canada a doublé sa contribution financière au système d'information sur les marchés agricoles (AMIS), une initiative conçue pour assurer la transparence du marché et coordonner les actions politiques en période d'incertitude du marché. Le Canada soutient également les producteurs canadiens d'engrais dans leurs projets d'augmentation de la production nationale en réponse à la pénurie. Il a notamment débloqué 100 millions de dollars pour soutenir une mine de potasse à faible taux d'émission en Saskatchewan.
Santé mondiale et nutrition
Enjeu
- La santé et la nutrition sont essentielles pour réduire la pauvreté et contribuer à l'égalité des sexes dans le monde entier.
- Le Canada est un leader de longue date dans le domaine de la santé et de la nutrition au niveau mondial, plus récemment par le biais de l'engagement de dix ans du premier ministre en faveur de la santé mondiale et des droits des femmes et des filles.
- Le Canada a contribué à la mise en place d'une réponse internationale robuste à la COVID-19 et continue de s'engager activement dans les processus mondiaux visant à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies à l'avenir.
Contexte
Contexte mondial
La santé est un secteur clé de l'aide internationale. Cela joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des 20 dernières années : les gens vivent plus longtemps, moins de personnes meurent à cause de maladies infectieuses, plus de femmes ont accès à la contraception moderne, et moins d'enfants ont un poids insuffisant et sont trop petits pour leur âge en raison de la malnutrition. En 2015, la communauté mondiale s'est engagée à atteindre un ensemble d'objectifs de développement durable d'ici 2030, dont un spécifiquement consacré à l'amélioration de la santé.
Malgré les progrès accomplis, des défis persistent. Leur résolution nécessite des ressources importantes et une volonté politique. Le monde n'était déjà pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable, mais les inégalités ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19. Les systèmes de santé ne répondent souvent pas de manière adéquate aux besoins des femmes, des filles et des groupes marginalisés, et ces groupes sont également trop souvent écartés des processus de prise de décision qui déterminent leur santé et leurs droits.
Leadership canadien
Le Canada est depuis longtemps un leader dans la promotion de la santé mondiale et de la nutrition. Il a traditionnellement alloué un pourcentage plus élevé (plus de 20 %) de son aide publique au développement à la santé mondiale que tout autre donateur, à l'exception des États-Unis. Le Canada est depuis longtemps cofondateur d'initiatives clés en la matière et travaille en collaboration avec des organisations et des partenariats multilatéraux dans le domaine de la santé et de la nutrition mondiales.
Le Canada a été le donateur fondateur de Nutrition International en 1992, le premier donateur bilatéral de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, et a été un précurseur dans la mise en place de plateformes innovantes en matière de santé mondiale, notamment la Facilité de financement mondiale pour les femmes, les enfants et les adolescents (2015), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (2002) et Gavi, l'Alliance du Vaccin (2000). En 2010, le Canada a pris la tête de l'initiative de Muskoka du G8 pour la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), avec un engagement de 2,85 milliards de dollars jusqu'en 2015, suivi de SMNI 2.0 de 2015 à 2020 avec un engagement supplémentaire de 3,5 milliards de dollars.
La phase actuelle du leadership du Canada en matière de santé mondiale est l'Engagement de 10 ans pour la santé et les droits mondiaux, annoncé par le Premier ministre en 2019. Cet engagement est un véhicule clé pour la mise en œuvre de la Politique d'aide internationale féministe (PAIF) du Canada et le soutien à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030.
Dans le cadre de l'engagement de dix ans (2020-2021 à 2029-2030), le ministère augmente son financement en faveur de la santé mondiale et des droits pour atteindre une moyenne de 1,4 milliard de dollars par an à partir de l'exercice 2023-24, avec 700 millions de dollars spécifiquement alloués à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) chaque année. Les investissements du Canada dans les domaines de la santé, de la santé et des droits sexuels et reproductifs, et de la nutrition favorisent l'égalité des sexes et s'appuient sur un soutien à des systèmes de santé efficaces et équitables pour un impact à long terme.
Le Canada a continué à jouer un rôle de premier plan dans la réponse mondiale à la COVID-19, en mobilisant plus de 3,5 milliards de dollars d'aide internationale et en jouant un rôle de premier plan dans l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT-A), qui vise à promouvoir un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements COVID-19. Conformément à la Politique d’aide internationale féministe du Canada, la réponse du Canada au virus COVID-19 et les efforts de redressement se concentrent sur les populations les plus pauvres et les plus marginalisées du monde et prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles.
Bien que la phase aiguë de la pandémie soit terminée, le Canada continue de travailler avec les partenaires de l'ACT-A pour renforcer les systèmes de santé et intégrer la réponse à la COVID-19 dans les services de santé de routine, notamment par le biais de l'Initiative mondiale pour l'équité vaccinale (CanGIVE), dotée d'un budget de 317 millions de dollars. Lancée en juin 2022, CanGIVE soutient 12 pays dans leurs efforts pour soutenir la distribution du vaccin contre la COVID-19, renforcer les systèmes de santé et augmenter la capacité régionale de fabrication de vaccins.
La COVID-19 a démontré les dimensions sanitaires, sociales et économiques dévastatrices des pandémies. Le Canada participe aux efforts mondiaux visant à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies en s'appuyant sur les enseignements tirés de la COVID-19. Cela comprend 50 millions de dollars en fonds d'amorçage pour le nouveau Fonds de lutte contre les pandémies afin d'aider les pays, en particulier les pays à faible et moyen revenu, à développer leurs capacités à contenir les épidémies avant qu'elles ne se transforment en pandémies. Il comprend également 100 millions de dollars pour la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) afin d'accélérer le développement de vaccins pour une série de maladies infectieuses connues et émergentes, y compris celles qui ont un potentiel pandémique, et de soutenir un accès équitable aux vaccins pendant les épidémies, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela inclue également de soutenir le rôle central de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l'écosystème mondial de la santé et de veiller à ce qu'elle dispose de ressources durables, qu'elle soit efficace et qu'elle rende des comptes.
Afin de renforcer la gouvernance mondiale en matière de pandémies, le Canada est engagé dans des négociations avec d'autres États membres de l'OMS sur un nouvel instrument juridiquement contraignant relatif aux pandémies, ainsi que sur des modifications du Règlement sanitaire international (2005).
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance des systèmes de santé nationaux résilients et équitables. Dans le cadre du processus sur l'avenir des initiatives mondiales en matière de santé, le Canada s'est engagé avec la Norvège, le Kenya, l'Éthiopie, le Royaume-Uni, le Japon et d'autres pays à renforcer l'alignement et la collaboration des initiatives mondiales en matière de santé, telles que le Fonds mondial, Gavi et la Facilité de financement mondiale, afin de soutenir les priorités et les plans des pays, ainsi que le renforcement des systèmes de santé.
Éducation mondiale
Enjeu
- La Politique d’aide internationale féministe (PAIF) du Canada donne la priorité à l’éducation et au développement des compétences, en particulier pour les groupes marginalisés et les filles, car ils sont essentiels à la réalisation de tous les Objectifs de développement durable (ODD) et à l’édification de sociétés résilientes, durables, saines et pacifiques.
- Le Canada s’est engagé à répondre à la crise mondiale de l’éducation et à garantir l’accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité, en particulier pour les filles et les enfants et jeunes réfugiés, déplacés et issus des communautés d’accueil.
Contexte
Le monde est confronté à une crise mondiale de l’éducation sans précédent due au triple choc du COVID, des conflits et des changements climatiques. Il y a 222 millions d’enfants et d’adolescents touchés par la crise qui ont besoin d’un soutien à l’éducation. Il existe également une crise de l’apprentissage : on estime que 70 % des enfants de 10 ans dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont incapables de lire et de comprendre un texte simple. La situation est particulièrement grave pour les populations réfugiées et déplacées, et surtout pour les filles et les adolescentes. Cette génération d’élèves risque de perdre 21 000 milliards de dollars en valeur actuelle sur les revenus de toute une vie en raison de la fermeture des écoles, soit l’équivalent de 17 % du PIB mondial actuel.
L’éducation est un investissement essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Elle permet aux femmes et aux filles de s’exprimer; elle est fondamentale pour la consolidation de la paix et la sécurité économique (chaque année supplémentaire d’études entraîne une augmentation de 9 % des revenus); elle est essentielle pour trouver des solutions appropriées aux changements climatiques aux niveaux local, régional et mondial; et elle protège les filles contre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que contre les violences sexuelles et fondées sur le genre. En outre, les systèmes éducatifs permettent d’offrir des services de santé mentale et de soutien psychosocial, des programmes de santé et de nutrition (alimentation scolaire), ainsi que des programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive et d’éducation sexuelle complète.
Initiative de Charlevoix sur l’éducation
Au cours de la présidence du G7 à Charlevoix en 2018, le Canada a placé l’éducation des filles et des adolescentes dans les contextes touchés par les conflits et les crises au sommet de l’ordre du jour international. La Déclaration de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement a été l’un des principaux résultats du Sommet et a généré des promesses de dons d’une valeur historique de 4,3 milliards de dollars, dont 400 millions de dollars du Canada pour soutenir 55 projets touchant plus de 4 millions de filles et de femmes. Les partenaires du G7 se sont engagés à améliorer les possibilités d’éducation et les résultats d’apprentissage des filles et des femmes vivant dans des situations de fragilité, de crise et de conflit, y compris les réfugiés, les personnes déplacées, les rapatriés et les personnes handicapées. De nombreux projets de Charlevoix s’attaquent à des problèmes clés qui empêchent les filles d’aller à l’école, tels que les grossesses d’adolescentes, les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, la violence fondée sur le genre et le manque de connaissances en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs. Ils se concentrent, par exemple, sur la réduction des obstacles qui limitent l’accès des filles et des femmes à l’éducation, sur l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation formelle et non formelle, de la formation et du développement des compétences pour les filles et les femmes, et sur l’amélioration et le renforcement de la résilience des systèmes et des approches en matière d’éducation afin qu’ils soutiennent mieux les filles et les femmes.
Campagne Ensemble pour l’apprentissage
S’appuyant sur son leadership en matière d’éducation, le Canada a lancé en février 2021 la campagne internationale triennale Ensemble pour l’apprentissage afin de promouvoir l’accès à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les jeunes réfugiés, déplacés et issus des communautés d’accueil. La campagne devrait culminer lors du Forum mondial sur les réfugiés (décembre 2023).
Le Conseil de l’éducation des réfugiés (CER) est un élément phare de la campagne. Créé en consultation avec des organisations de la société civile canadienne et hébergé par Vision Mondiale Canada, le CER conseille et informe la campagne et le ministre du Développement international sur les solutions et les approches en matière d’éducation pour les réfugiés et les populations déplacées.
Le Canada a accueilli un sommet Ensemble pour l’apprentissage (mars 2022) qui a permis d’écouter des jeunes réfugiés et déplacés, d’apprendre d’eux et de les faire participer à la résolution de problèmes et à la prise de décisions. Le sommet a débouché sur un Manifeste des jeunes appelant à l’action dans cinq domaines prioritaires : l’inclusion, le soutien mental et psychosocial, l’apprentissage numérique, l’égalité des genres et la responsabilisation.
Contribution globale dans le secteur de l’éducation
Le Canada s’est engagé à construire des systèmes éducatifs plus forts, plus résilients et plus inclusifs, en mettant l’accent sur les populations les plus difficiles à atteindre. Il s’attache à soutenir l’accès à une éducation de qualité qui tient compte du genre, des conflits et des besoins locaux, ainsi qu’à faire entendre la voix de ceux qui sont touchés par les décisions prises au niveau mondial, notamment les enfants et les jeunes réfugiés, déplacés de force ou issus de communautés d’accueil, en particulier les filles et les jeunes femmes, afin qu’ils prennent part aux décisions qui ont le plus d’impact sur leur vie. Le Canada s’engage également à veiller à ce que les enfants et les jeunes réfugiés et déplacés de force aient accès aux systèmes éducatifs nationaux et à ce que l’éducation reçoive le soutien et le financement dont elle a besoin.
En outre, le Canada a augmenté son soutien à l’éducation après le début de la pandémie de COVID-19 pour faire face aux impacts immédiats et à long terme des fermetures prolongées d’écoles dans les pays en développement, en allouant 78,9 millions de dollars d’aide internationale d’urgence pour soutenir les organisations de la société civile, les organismes multilatéraux et les gouvernements nationaux afin de répondre aux défis de la prestation de l’éducation pendant la pandémie.
- [CAVIARDÉ]
Chiffres clés
- 68 % des enfants réfugiés ont accès à l’enseignement primaire, 34 % à l’enseignement secondaire et les possibilités d’enseignement supérieur sont extrêmement limitées.
- Les filles touchées par un conflit sont 2,5 fois plus susceptibles d’abandonner l’école que les garçons.
Égalité des genres / Voix et leadership des femmes
Enjeu
- Comme indiqué dans la Politique d'aide internationale féministe (PAIF), le Canada estime que le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans toute leur diversité est le moyen le plus efficace de créer une paix durable, d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que d'éliminer la pauvreté.
- Le Canada s'est fixé comme priorité de soutenir les organisations de défense des droits des femmes dans le cadre de la PAIF. À l'appui de cette priorité, le gouvernement a récemment annoncé le renouvellement et l'expansion du Programme Voix et leadership des femmes, un programme phare de soutien aux organisations de défense des droits des femmes à l'échelle mondiale.
Contexte
Contexte mondial
Il existe des preuves solides que la promotion de l'égalité des genres est un précurseur de la réalisation des ODD, et que la promotion des droits et de l'action des femmes a des effets positifs sur la société dans son ensemble.
L'APD bilatérale mondiale a connu une hausse historique de 8,5 % pendant la pandémie (chiffres de 2021), soit le niveau le plus élevé jamais atteint. Alors que le volume d'investissement dans l'égalité des genres a également augmenté (de 53,4 US$ par an en moyenne en 2018-2019 à 57,4 milliards US$ en 202020-21), la part de l'APD totale ayant l'égalité des genres comme objectif a légèrement diminué.
La stagnation potentielle de la croissance du financement de l'égalité des genres se produit dans un contexte de crises mondiales multiples et de polarisation accrue. Les femmes sont confrontées à une augmentation de la violence, à un recul de leurs droits et à une exclusion permanente. À elle seule, la pandémie de COVID-19 a fait reculer le monde d'une génération (36 ans) sur la voie de l'égalité des genres, et les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par d'autres crises, notamment l'insécurité alimentaire et les urgences climatiques.
En 2022, l'APD bilatérale a de nouveau dépassé des niveaux record, augmentant de 13,6 %. Toutefois, comme les données sur l'APD consacrée à l'égalité des genres sont publiées 2 ans après les faits, l'impact réel d'autres crises sur le financement de l'égalité des genres, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'est pas encore connue.
Alors que les impacts sur le financement de l'égalité des genres restent inconnus, le contexte géopolitique actuel a déjà de profondes répercussions sur l'égalité des genres et les droits de la personne. L'affaiblissement des démocraties et l'instabilité géopolitique ont également réduit l'espace civique, accru la polarisation et les réactions brutales, et affecté le travail et la sécurité des organisations de défense des droits des femmes et des défenseurs des droits de la personne dans le monde entier.
Leadership canadien
Le Canada est reconnu comme un chef de file dans la promotion de l'égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles à l'échelle mondiale. Dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe, Affaires mondiales Canada s'est engagé à augmenter ses dépenses bilatérales de développement en faveur de l'égalité des genres. Il s'agit notamment de veiller à ce que 80 % des projets intègrent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, tandis que 15 % des projets ciblent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.
Pour la quatrième année, le Canada s'est classé au premier rang des donateurs bilatéraux de l'OCDE pour la part de son APD globale qui contribue à l'égalité des genres. Il se classe également parmi les premiers pour les investissements soutenant les organisations de défense des droits des femmes et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.
En 2021-2022, 99 % de l'aide bilatérale au développement international du Canada, d'une valeur de 3,8 milliards de dollars, a ciblé ou intégré des résultats en matière d'égalité des genres, dépassant ainsi l'objectif fixé à 95 % d'ici 2021-2022. Cependant, le Canada n'a pas atteint le sous-objectif de 15 % des investissements visant spécifiquement les résultats en matière d'égalité des genres, atteignant 10 %, ce qui représente 380,8 millions de dollars.
Voix et leadership des femmes
Le programme Voix et leadership des femmes (VLF) est une initiative phare de la Politique d'aide internationale féministe, qui soutient les organisations de défense des droits des femmes dans 31 pays et régions. VLF apporte un soutien par le biais d'un financement de base, ainsi qu'un financement rapide et réactif afin de répondre aux besoins urgents, et apporte également un soutien au renforcement des capacités et à la création de réseaux. VLF a touché un large éventail d'organisations de défense des droits des femmes, y compris des groupes représentant des femmes handicapées, des survivantes de violences sexuelles et sexistes, des travailleuses du sexe, des migrantes, des femmes autochtones et des organisations LBTQI.
Le 27 avril 2023, le Canada a annoncé un financement de 195 millions de dollars sur 5 ans et de 43,3 millions de dollars par an par la suite pour le renouvellement et l'expansion du programme. Ce renouvellement et cette expansion sont une réponse à l'affaiblissement des démocraties et à l'instabilité géopolitique qui ont réduit l'espace civique, augmenté la polarisation et les réactions négatives, et ont eu un impact négatif sur le travail et la sécurité des organisations de défense des droits des femmes et des défenseurs des droits de la personne.
Le programme VLF est une démonstration de la Politique d'aide internationale féministe en action, qui se traduit par des résultats concrets en matière d'égalité des genres, notamment des changements dans les lois et des services accrus et améliorés pour lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre. La première phase du programme VLF a dépassé les attentes, atteignant plus de 1500 (3 fois plus que prévu) organisations de défense des droits des femmes et groupes LBTQI+.
Résultats en matière d'égalité des genres
Les efforts du Canada ont un impact réel sur le terrain. Par exemple :
- Depuis sa création en 2017, le programme VLF a soutenu plus de 1500 organisations locales de défense des droits des femmes et groupes de lesbiennes, bisexuels, transgenres, queers et intersexués (LBTQI+) dans plus de 30 pays. Grâce au soutien du Canada, les organisations des défense des droits des femmes renforcent leur gestion et leur durabilité, fournissent des services à diverses femmes et filles en situation de vulnérabilité, et défendent avec succès l'égalité des genres et les droits des femmes et des filles.
- En 2021-2022, le Canada a appuyé 57 000 écoles pour créer des espaces accueillants qui répondent aux besoins spécifiques des filles afin qu'elles soient plus nombreuses à s'inscrire et à terminer leurs études, réduisant ainsi le risque de mariage d'enfants, précoce et forcé, et de grossesses précoces, et augmentant leurs chances de mener une vie plus saine et productive, ce qui ultimement contribue à réduire la pauvreté globale.
- En 2020-2021, les partenaires de la société civile d’AMC ont permis à plus de 4,5 millions de personnes d'accéder à des services de santé sexuelle et reproductive améliorés. Par exemple : i) fournir des avortements sûrs et des soins post-avortement à 47 185 femmes ; ii) fournir des services de planification familiale à 3 354 492 femmes. En outre, le programme Fournitures du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) estime que le soutien du Canada aux contraceptifs a contribué à prévenir 5 433 562 grossesses non désirées et à sauver la vie de 14 490 femmes.
Partenaires canadiens pour l’aide internationale
Enjeu
- Les partenaires canadiens jouent un rôle de premier plan dans la réalisation des priorités du Canada en matière de développement international, telles que définies dans la Politique d’aide internationale féministe (PAIF). Enracinés dans les communautés de tout le pays, ils aident le Ministère à tirer parti de l’expertise, des ressources et de l’innovation canadiennes, à comprendre les défis et les possibilités locales, à renforcer le dialogue sur les politiques et l’efficacité de l’aide internationale, et à mobiliser les Canadiens pour susciter la prise de conscience, le soutien et l’action en matière d’aide internationale.
Contexte
- Le Ministère établit des partenariats avec diverses organisations canadiennes (organisations de la société civile, organisations du secteur privé, universités et instituts de recherche) de tailles et de secteurs différents pour : 1) assurer la prestation de programmes d’aide internationale; 2) engager un dialogue sur les politiques, les améliorations à apporter aux processus et l’innovation; et 3) mobiliser, informer et inspirer les Canadiens en matière de développement international. En outre, la vaste portée géographique des partenaires canadiens assure la visibilité du Canada dans le monde entier, y compris dans des pays où la présence du Canada est autrement limitée.
- Environ 185 organisations canadiennes ont reçu des fonds d’Affaires mondiales Canada pour mettre en œuvre des projets d’aide internationale en 2022-2023, dont 35 étaient des petites et moyennes organisations.
- Selon les chiffres préliminaires, Affaires mondiales Canada a alloué plus de 1,14 milliard de dollars d’aide internationale aux organisations canadiennes en 2022-2023 (17,2 %), contre 1,004 milliard de dollars (17,9 %) en 2021-2022. Bien que le volume de l’aide aux organisations canadiennes ait augmenté, la proportion de l’aide internationale d’Affaires mondiales Canada destinée aux organisations canadiennes a diminué. Entre 2013-2014 et 2019-2020, la proportion de l’aide internationale d’Affaires mondiales Canada destinée aux organisations canadiennes a toujours été supérieure à 20 %.
- Budget de 2023 : Une coalition de plus de 90 organisations canadiennes de développement international, dont Coopération Canada, un organisme-cadre représentant plus de 95 organisations de la société civile canadienne travaillant dans le domaine de l’aide internationale et entretenant une relation unique avec Affaires mondiales Canada en raison de la vaste portée de son engagement, a exprimé sa déception car elle estime que le budget de 2023 sape la position du Canada dans le monde.
- Dialogue avec les organisations canadiennes : Affaires mondiales Canada collabore avec les organisations canadiennes en organisant des consultations, divers comités et groupes de travail, des tables rondes et des conférences, ou en y participant : 1) sur des sujets tels que l’environnement favorable à la société civile, les petites et moyennes organisations, les Objectifs de développement durable, l’engagement public, la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, la lutte contre le racisme, le développement mené localement, la Stratégie pour l’Indo-Pacifique, le climat et le développement, etc.; 2) sur des programmes tels que la santé mondiale et l’égalité des genres, y compris la gestion axée sur les résultats; et 3) par la participation à des conférences et à des événements annuels avec le secteur du développement international.
- Mobiliser les Canadiens en tant que citoyens du monde : Les partenaires canadiens représentent un moyen important pour rejoindre les Canadiens, les sensibiliser aux efforts de développement international du Canada et obtenir leur soutien. En étroite collaboration avec des organisations canadiennes, le Ministère mène de multiples initiatives, telles que la Semaine du développement international (SDI), la campagne plus vaste #VisezLesObjectifs (en référence aux Objectifs de développement durable ou ODD) et le nouveau projet d’éducation novatrice pour tous dans le domaine du développement (Innovative Development Education for All – IDEA) pour toucher les jeunes et les Canadiens moins engagés, afin d’atteindre divers groupes de Canadiens dans le but d’élargir et d’éclairer le débat public, de susciter une appréciation de l’importance et des avantages de l’aide internationale et de renforcer les liens entre les Canadiens et les défis mondiaux en matière de développement.
- Transformation des subventions et des contributions (S et C) : La transformation quinquennale des subventions et des contributions prévoit de nouvelles méthodes de travail avec les partenaires afin de réduire la charge administrative et d’accroître la transparence, la réactivité et la prévisibilité de notre aide internationale. Le Ministère s’est engagé à concevoir cette transformation avec ses partenaires et à collaborer régulièrement avec eux afin d’améliorer leur expérience et accroître l’impact des programmes.
- Direction et contrôle : En réponse au plaidoyer du secteur concernant certains éléments de la Loi de l’impôt sur le revenu applicables aux organismes de bienfaisance canadiens menant des activités à l’étranger, le ministère des Finances du Canada a modifié la loi pour tenir compte des points de vue des organismes de bienfaisance selon lesquels les exigences antérieures étaient coûteuses et demandaient beaucoup de travail, entraient en conflit avec les principes de la propriété locale et soutenaient une approche coloniale dépassée de la collaboration avec les partenaires locaux. L’Agence du revenu du Canada doit encore publier une version révisée fondée sur les résultats de la consultation publique qui s’est achevée en janvier 2023. Même si les changements apportés à la loi n’affecteront pas directement la programmation d’Affaires mondiales Canada, la Loi de l’impôt sur le revenu modifiée et les directives connexes de l’Agence du revenu du Canada sont conformes aux ententes de contribution d’Affaires mondiales Canada, comme l’exige la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.
Institutions financières internationales et FinDev Canada
Enjeu
- Les institutions financières internationales (IFI) jouent un rôle essentiel pour fournir un financement indispensable aux États à revenu intermédiaire, pauvres et fragiles, défendre le système fondé sur des règles et promouvoir la stabilité économique mondiale par le biais du développement social et économique.
- FinDev Canada est également une institution essentielle qui fournit des financements à des taux commerciaux au secteur privé dans les pays en développement.
Contexte
Institutions financières internationales (IFI)
Les IFI sont constituées des institutions de Bretton Woods, qui comprennent le Fonds monétaire international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM), des banques régionales de développement (par exemple, la Banque africaine de développement) et du Fonds international de développement agricole (FIDA). Les IFI font partie intégrante de l'architecture financière internationale, car elles fournissent des ressources financières aux pays à revenu intermédiaire (par le biais de prêts) et aux pays les plus pauvres, y compris les États fragiles (par le biais de prêts concessionnels et de subventions). La plupart des capitaux des IFI sont garantis par les États membres donateurs, ce qui leur permet d'offrir des taux d'intérêt préférentiels aux membres emprunteurs. En 2021-22, Affaires mondiales Canada et Finances Canada ont fourni aux IFI environ 2 milliards de dollars en soutien institutionnel ainsi qu'en programmes spécifiques à des initiatives.
Le GBM et les banques régionales de développement, qui sont collectivement connues sous le nom de banques multilatérales de développement (BMD), visent à réduire la pauvreté, à faire progresser le développement économique et social durable et à promouvoir la coopération et l'intégration régionales, en exerçant leur avantage comparatif en soutenant les dépenses sociales, en finançant les investissements liés à la croissance (par exemple, l'infrastructure) et en facilitant l'engagement du secteur privé. Le modèle unique des banques multilatérales de développement tire parti de leur capital social et des fonds des donateurs sur les marchés pour lever des fonds. Par exemple, la 20e reconstitution du guichet de financement du GBM pour les pays les plus pauvres a consisté en 23,5 milliards de dollars de contributions de donateurs, mais générera 93 milliards de dollars de prêts au total avec des financements levés sur les marchés des capitaux, des remboursements et les contributions de la Banque mondiale. Le FMI est chargé d'encourager la coopération monétaire mondiale, de garantir la stabilité financière et de faciliter le commerce international. Le FIDA est une agence spécialisée des Nations unies qui se concentre sur les petits exploitants agricoles et le développement rural.
Les IFI comptent parmi les institutions partenaires les plus importantes et les plus stratégiques du Canada pour soutenir les interventions de développement à grande échelle, compte tenu de la taille de leurs opérations, de leurs antécédents, de leur expertise technique et financière, de leur rôle de rassembleur et de leur leadership intellectuel. Les relations du Canada avec les IFI sont gérées conjointement par AMC et le ministère des Finances. Le ministre des Finances est le gouverneur du Canada auprès de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII). Le ministre du développement international est le gouverneur du Canada auprès de la Banque africaine de développement (BAfD), de la Banque asiatique de développement (BAsD), de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) et de la Banque interaméricaine de développement (BID). Le sous-ministre adjoint chargé des questions mondiales et du développement est le gouverneur du FIDA. Les gouverneurs sont responsables de la surveillance de ces institutions par le Canada.
Les institutions de Bretton Woods
- L'objectif principal du FMI est de permettre la stabilité du système monétaire international par la surveillance économique et les conseils de politique économique, les programmes de prêts pour résoudre les problèmes de balance des paiements, l'assistance technique et la formation. En 2021, le FMI a approuvé une allocation de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS), une monnaie de réserve spéciale que les membres du FMI peuvent échanger contre d'autres monnaies. Le G7/20 s'est engagé à consacrer 100 milliards de dollars des DTS qu'il a reçus aux pays vulnérables. Cet engagement a été atteint en juin 2023, bien que seulement 60 % des promesses aient été tenues jusqu'à présent. Les engagements du Canada ont été entièrement mis en œuvre.
- Le GBM est la plus grande institution partenaire du Canada en matière de développement. L'ampleur et la portée de ses opérations constituent un moyen rentable de faire progresser les priorités du Canada en matière de développement. Il se compose de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui accorde des prêts aux pays à revenu intermédiaire, de l'Association internationale de développement (IDA), qui fournit des financements aux pays les plus pauvres, de la Société financière internationale (SFI), sa branche dédiée au secteur privé, et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), qui fournit une assurance contre les risques politiques.
Banques régionales de développement
Le Canada est également actionnaire de six banques régionales de développement, qui fournissent une assistance financière et technique aux pays à faible et moyen revenu de leur région.
- Banque africaine de développement (BAfD) : Le Canada est le quatrième actionnaire non régional de la BAfD, qui appartient majoritairement à des pays africains. La BAfD mobilise et alloue des ressources pour l'investissement dans les pays membres emprunteurs et fournit des conseils politiques et une assistance technique pour soutenir les efforts de développement. En 2022, le Canada s'est engagé à verser 369 millions de dollars sur trois ans pour la 16e reconstitution du Fonds africain de développement.
- Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID) : Le Canada est le troisième membre non emprunteur. La BID est la plus ancienne banque régionale de développement et la plus grande source de financement multilatéral pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle fait partie d'un groupe plus large de la BID, qui comprend IDB Invest, responsable des opérations du secteur privé, et IDB Lab, un fonds fiduciaire qui sert de laboratoire d'innovation.
- Banque asiatique de développement (BAsD) : Le Canada est actuellement le septième actionnaire et le deuxième actionnaire non régional de la BAsD. Le Fonds asiatique de développement (FAD) accorde des subventions aux pays membres en développement à faible revenu de la BAsD. En 2020, le Canada s'est engagé à verser une contribution de 120,5 millions de dollars sur quatre ans au FAD.
- Banque de développement des Caraïbes (CDB) : Le Canada est un membre fondateur de la CDB et son plus grand actionnaire non régional. Il accueillera l'assemblée annuelle de 2024. Le Canada s'est engagé à verser 81,41 millions de dollars au Fonds spécial de développement de la CDB entre 2021 et 2024, soit la contribution la plus importante de tous les membres.
- Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) : Le Canada est un membre fondateur et le huitième actionnaire le plus important. Le mandat de la BERD consiste à soutenir la transition vers des économies de marché durables en encourageant le développement du secteur privé et l'esprit d'entreprise.
- Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) : Le Canada a rejoint l'AIIB en 2018 avec une participation de 0,995 %. L'AIIB se concentre sur le développement économique par le biais du financement des infrastructures en Asie.
Le Fonds international de développement agricole (FIDA)
Le Canada est un membre fondateur du FIDA depuis 1977. Le FIDA accorde des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt, principalement aux gouvernements, pour soutenir la croissance agricole et la transformation rurale inclusive. Le rôle du FIDA est essentiel dans la crise alimentaire mondiale actuelle, qui touche de manière disproportionnée les populations rurales vulnérables et les petits exploitants agricoles.
FinDev Canada
FinDev Canada est l'institution financière de développement du Canada. Lancée en 2018, elle a pour mandat de fournir des financements à des taux commerciaux au secteur privé et de mobiliser l'investissement privé dans les pays en développement. Elle vise l'autonomisation économique des femmes, le développement des marchés locaux et la lutte contre les changements climatiques, conformément aux priorités du Canada en matière d'aide internationale. Filiale à part entière d'EDC (sous la responsabilité du ministre du Commerce international), FinDev Canada a son propre mandat, sa propre gouvernance et sa propre stratégie d'investissement, et se rapporte à EDC. Le ministre du Développement international est chargé de superviser les priorités stratégiques, la planification d'entreprise et les rapports annuels de FinDev Canada, ainsi que les questions législatives et réglementaires.
- Date de modification: