Le point sur le commerce 2024 : Les chaînes d’approvisionnement
ISSN 2562-8348
Table des matières
- Message de la ministre
- Sommaire
- Partie 1 : Bilan de 2023
- Partie 2 : Les chaînes d’approvisionnement
- Vue d'ensemble
- 2.1 Avant la pandémie : L’évolution des chaînes d’approvisionnement internationales et leur importance pour le Canada
- 2.2 Chaînes d’approvisionnement internationales pendant la pandémie de COVID-19
- 2.3 Les chaînes d’approvisionnement internationales après la pandémie de COVID-19 et à l’avenir
- 2.4 Rapatriement et autres stratégies de localisation
- 2.5 Conclusion
- Bibliographie
Message de la ministre
J’ai le grand plaisir de vous présenter le rapport Le point sur le commerce 2024 du Canada, qui offre un aperçu complet de l’économie et du commerce international du Canada en 2023.
Le commerce fait partie intégrante de l’économie canadienne. En effet, il représente les deux tiers du PIB du Canada, et les exportations soutiennent à elles seules près de 3,3 millions d’emplois canadiens, soit 1 emploi sur 6. Malgré un contexte mondial exigeant, 2023 a montré la résilience du commerce canadien. Nos exportations ont augmenté de 1,4 %, et les importations ont suivi avec une augmentation de 3,1 %, ce qui témoigne de la ténacité des importatrices et importateurs et des exportatrices et exportateurs canadiens.
Ces chiffres soulignent la confiance que le monde continue d’accorder aux biens, aux services, aux talents et à l’innovation du Canada. Le monde continue également de considérer le Canada comme une destination de choix pour les investissements – nos entreprises et nos industries ont attiré plus de 60 milliards de dollars d’investissements directs étrangers en 2023.
Tout cela est de bon augure pour les entreprises et les investisseuses et investisseurs canadiens qui cherchent à s’implanter sur de nouveaux marchés à l’étranger. Lorsqu’ils le font, ils créent davantage d’emplois de qualité, de meilleures possibilités et une économie canadienne plus solide.
C’est pourquoi le Canada demeure déterminé à renforcer le commerce international fondé sur des règles en travaillant avec l’Organisation mondiale du commerce et, plus particulièrement, avec le Groupe d’Ottawa sur la réforme de l’OMC, dirigé par le Canada. En outre, nous restons déterminés à créer de nouveaux débouchés sur de nouveaux marchés – comme les économies croissantes et dynamiques de la région indo-pacifique – grâce aux missions commerciales ciblées d’Équipe Canada.
Je vous invite à découvrir le dossier spécial de cette année sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, qui met en évidence une résilience remarquable face aux défis. L’intégration du Canada dans les chaînes d’approvisionnement mondiales favorise la productivité des entreprises canadiennes, diversifie le choix des consommatrices et consommateurs et contribue à la baisse des prix – des avantages indéniables qui nécessitent une innovation et une adaptation permanentes à mesure que le contexte mondial évolue.
À l’avenir, nous continuerons à promouvoir les entreprises, les industries et l’innovation canadiennes partout dans le monde, tout en attirant les talents, les capitaux et les investissements étrangers. Nous continuerons également à créer des possibilités pour accroître le commerce afin qu’il profite à un plus grand nombre d’entrepreneures et entrepreneurs, de consommatrices et consommateurs et d’industries.
Nous poursuivons ces efforts en sachant qu’un commerce solide mène à des économies fortes et à un avenir meilleur pour les Canadiennes et les Canadiens d’un océan à l’autre. Je me réjouis de communiquer les résultats de ces efforts fructueux dans les prochains rapports faisant le point sur le commerce.
L’honorable Mary Ng
Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique
Sommaire
Les économies mondiale et canadienne ont de nouveau ralenti en 2023, mais ont néanmoins résisté aux vents contraires. Après avoir atteint des niveaux record en 2022, l’inflation a baissé dans plusieurs économies, mais pas sans conséquence. Dans de nombreux pays, la politique monétaire a été restrictive, ce qui a entraîné un ralentissement des investissements et des dépenses. Les économies avancées ont enregistré un ralentissement de la croissance à 1,6 % en 2023, alors que la faible croissance dans l’Union européenne et une récession au Royaume-Uni ont compensé la vigueur des États-Unis et du Japon. Dans les marchés émergents et les économies en développement, la croissance s’est accélérée pour atteindre 4,3 % malgré une réouverture plus faible que prévu de l’économie chinoise et la poursuite des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.
Le paysage mondial du commerce et de l’investissement s’est heurté à des obstacles tels qu’un protectionnisme accru, des perturbations maritimes comme celles du canal de Panama et de la mer Rouge, et des tensions géopolitiques. En conséquence, le volume des échanges mondiaux a considérablement diminué et les données préliminaires indiquent un ralentissement des investissements mondiaux pour 2023. Dans l’ensemble, la croissance économique mondiale a ralenti, passant de 3,5 % en 2022 à 3,2 % en 2023.
L’économie canadienne s’en est moins bien sortie, mais a réussi à éviter une récession, avec une croissance passant de 3,8 % en 2022 à 1,2 % en 2023. L’inflation est passée d’un pic de 6,8 % en 2022, le plus élevé en 40 ans, à 3,9 % en 2023, ralentissant encore au cours des premiers mois de 2024. Toutefois, les taux d’intérêt directeurs de la Banque du Canada ayant atteint en 2023 leur niveau le plus élevé depuis 23 ans, l’investissement et les dépenses des ménages ont été limités tout au long de l’année et les effets de la hausse des taux devraient perdurer. Les dépenses des ménages ont soutenu la croissance globale, mais ont diminué par personne. Les exportations nettes, soutenues par la vigueur de l’économie américaine, ont été le principal facteur de croissance en 2023.
En 2023, la croissance a été menée par les services, qui ont augmenté de 2,0 %, tandis que les industries de biens ont enregistré une baisse de 1,2 %. Les services de transport et d’entreposage ainsi que l’administration publique, stimulée en grande partie par des gains dans les administrations locales, municipales, régionales, provinciales et territoriales, ont contribué le plus à la croissance des services. Alors que l’expansion des voyages après la pandémie se poursuivait et que de plus en plus de travailleurs retournaient au bureau, les transports aériens et les services de transport urbain ont été à l’origine de l’augmentation des transports et de l’entreposage. En revanche, la baisse enregistrée dans les secteurs des biens a été généralisée, les secteurs de la construction et de l’agriculture, sensibles aux taux d’intérêt, jouant un rôle important dans cette situation.
Malgré une nouvelle année de faible croissance mondiale ainsi qu’une contraction des prix mondiaux des matières premières, le commerce international du Canada a de nouveau enregistré de nouveaux records en 2023. Toutefois, la croissance a été beaucoup plus lente que celle observée en 2022. Les exportations de biens et de services ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 965,1 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est entièrement due aux services, les exportations de biens ayant diminué en raison de la baisse des prix des matières premières, en particulier des produits énergétiques. Une forte augmentation des exportations de véhicules à moteur, soutenue par l’amélioration continue des chaînes d’approvisionnement internationales, a partiellement compensé la diminution des biens. Dans le même temps, les exportations de voyages ont stimulé les échanges de services et ont finalement dépassé leurs niveaux d’avant la pandémie. Les importations de biens et services ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 978,2 milliards de dollars, les biens et services progressant. Tout comme pour les exportations, les véhicules automobiles et les voyages ont stimulé la croissance des importations.
Autre illustration de la résilience, les flux d’investissements directs étrangers du Canada ont renoué avec la croissance en 2023, après une baisse en 2022. Plus précisément, après avoir baissé de 17,8 % en 2022, les flux d’investissements directs canadiens à l’étranger ont augmenté de 1,8 % en 2023, tandis que les flux d’investissements directs étrangers au Canada ont enregistré une hausse de 3,7 % (contre -20,6 % en 2022).
Malgré une nouvelle année difficile pour la croissance économique mondiale et canadienne, le commerce international et les chaînes d’approvisionnement qui sous-tendent ces transactions continuent à bien se porter. Le point sur le commerce 2024 offre une vue d’ensemble de l’évolution des chaînes d’approvisionnement avant, pendant et après la pandémie de COVID-19. Les chaînes d’approvisionnement internationales proposent de nombreux avantages aux Canadiens et à l’économie canadienne. Pour les Canadiens, les chaînes d’approvisionnement internationales contribuent à faire baisser les prix et à accroître le choix, la stabilité et la variété des produits disponibles. Pour les entreprises canadiennes, les avantages se résument à une augmentation de la productivité. Les chaînes d’approvisionnement internationales permettent aux entreprises de se spécialiser dans des tâches essentielles, d’accéder à des intrants spécialisés, de favoriser la diffusion des connaissances et d’accroître la concurrence.
Les chaînes d’approvisionnement ont bien résisté à la pandémie de COVID-19. La pandémie a provoqué un changement de la demande des services vers les biens de consommation durables, ce qui a exercé une pression sur les infrastructures de transport, entraînant des retards dans les ports et une augmentation des coûts du transport maritime. Toutefois, les volumes d’échanges mondiaux ont rapidement repris et ont déjà retrouvé leurs niveaux d’avant l’entrée en vigueur de la directive sur la COVID-19 en novembre 2020. Pendant la pandémie, les Canadiens ont pu accéder à la plupart des biens et services dont ils avaient besoin. Toutefois, quelques perturbations notables ont été observées, notamment dans le domaine des microprocesseurs, qui constituent un élément crucial pour de nombreuses industries canadiennes telles que la fabrication automobile, et sont examinées de manière plus approfondie dans ce dossier spécial.
À l’avenir, les chaînes d’approvisionnement internationales seront confrontées à des incertitudes liées aux changements climatiques, aux risques humains et organisationnels, aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi qu’aux bouleversements géopolitiques. Les entreprises canadiennes peuvent renforcer leur résilience face à ces défis de plusieurs manières, notamment en diversifiant leurs fournisseurs, en gérant leurs stocks, en innovant dans leurs processus ou en reconfigurant leur chaîne d’approvisionnement, notamment par la relocalisation ou la délocalisation dans un pays proche.
La relocalisation est une réponse possible aux risques actuels auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales, mais cela représente un coût pour les entreprises qui renoncent aux avantages que les chaînes d’approvisionnement internationales procurent aux consommateurs et aux entreprises. Au moment de la rédaction du rapport sur le point sur le commerce, il n’y a guère de preuves indiquant que les entreprises canadiennes rapatrient leur production. Toutefois, certains éléments montrent que les chaînes d’approvisionnement internationales se restructurent et modifient la localisation de certaines sources d’intrants (délocalisation dans un pays proche). Les entreprises peuvent estimer que la délocalisation dans un autre pays est préférable à la relocalisation, car elles peuvent faire face aux risques ou aux vulnérabilités tout en continuant à profiter des avantages comparatifs d’autres pays.
L’avenir des chaînes d’approvisionnement internationales et les défis qu’elles posent aux entreprises restent incertains. Toutefois, leurs avantages durables et la nécessité pour les entreprises de s’adapter et d’innover sont évidents. Les entreprises canadiennes doivent relever ces défis, renforcer leurs chaînes d’approvisionnement et s’intégrer davantage dans les réseaux commerciaux mondiaux pour rester compétitives.
Partie 1 : Bilan de 2023
Vue d’ensemble
La croissance économique mondiale a ralenti en 2023 dans un contexte d’inflation toujours élevée, de conditions financières tendues et de fragmentation géopolitique accrue.
- Ralentissement de la croissance mondiale : L’économie mondiale a mieux résisté que prévu, mais la croissance a tout de même ralenti, passant de 3,5 % en 2022 à 3,2 % en 2023. La croissance dans les économies avancées (1,6 %) a nettement ralenti tandis que celle des marchés émergents et des économies en développement (4,3 %) a légèrement progressé.
- Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale devrait se maintenir à 3,2 % en 2024.
- Difficultés commerciales : Le volume des échanges mondiaux de biens et de services a fortement ralenti, passant de 5,6 % en 2022 à 0,3 % en 2023, en raison de la guerre en Ukraine, de l’inflation élevée et du resserrement des conditions financières qui ont tous pesé sur la croissance.
- On prévoit une reprise du commerce mondial à 3,0 % en 2024 à mesure que l’inflation et les conditions financières se détendent.
Vue d’ensemble figure 1 : Croissance du PIB réel mondial et Croissance du volume des échanges mondiaux de biens et de services
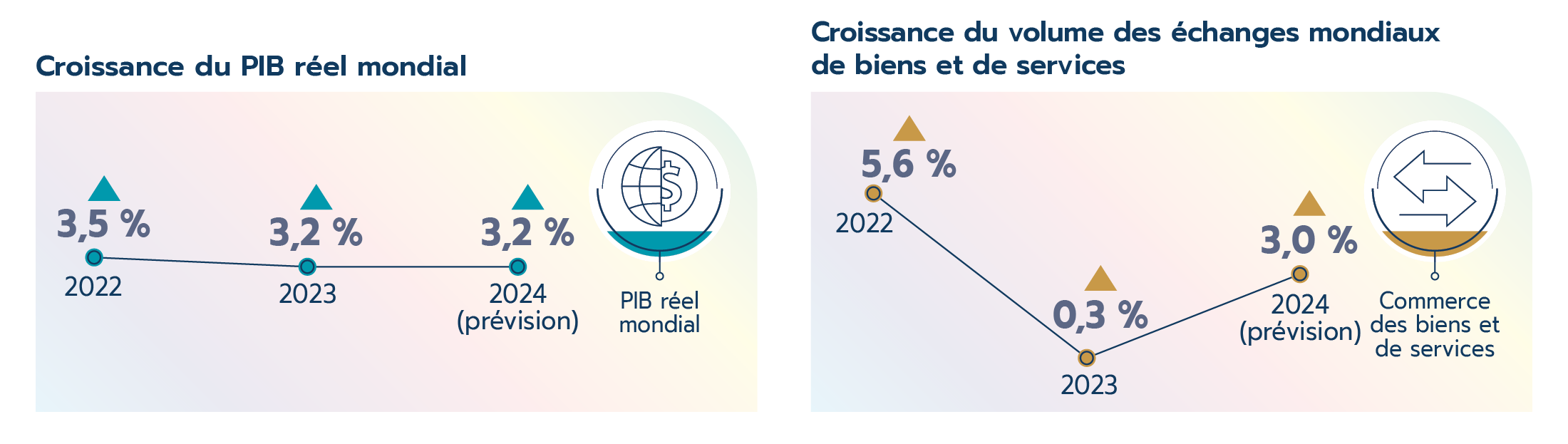
Version texte - Vue d’ensemble figure 1
- Croissance du PIB mondial en 2022 : 3,5 %
- Croissance du PIB mondial en 2023 : 3,2 %
- Croissance du PIB mondial en 2024 (prévision) : 3,2 %
- Croissance du volume des échanges mondiaux de biens et de services en 2022 : 5,6 %
- Croissance du volume des échanges mondiaux de biens et de services en 2023 : 0,3 %
- Croissance du volume des échanges mondiaux de biens et de services en 2024 (prévision) : 3,0 %
La performance économique du Canada a fortement ralenti pour atteindre 1,2 % en 2023 – néanmoins, le Canada a enregistré la troisième croissance la plus forte parmi les économies du G7, derrière les États-Unis et le Japon.
- Une croissance dominée par les services : Les industries de services (2,0 %) ont de nouveau été le moteur de la croissance en 2023, les services de transport et d’entreposage et l’administration publique arrivant en tête.
- Diminution des industries de biens : Les industries de biens ont diminué de 1,2 % en 2023. La baisse a été généralisée, menée par le secteur de la construction, sensible aux taux d’intérêt.
- Baisse de l’inflation : L’inflation a ralenti, passant de 6,8 % en 2022, son plus haut niveau depuis 40 ans, à 3,9 % en 2023, grâce à la baisse des prix de l’énergie et à une politique monétaire rigoureuse.
- Assouplissement sur le marché du travail : Le chômage a légèrement augmenté pour atteindre 5,4 % en 2023 dans l’ensemble et a terminé l’année à 5,8 % en décembre. Le nombre d’offres d’emploi a diminué tandis que l’activité sur le marché du travail est restée stable.
Vue d’ensemble figure 2 : Aperçu de l’économie canadienne
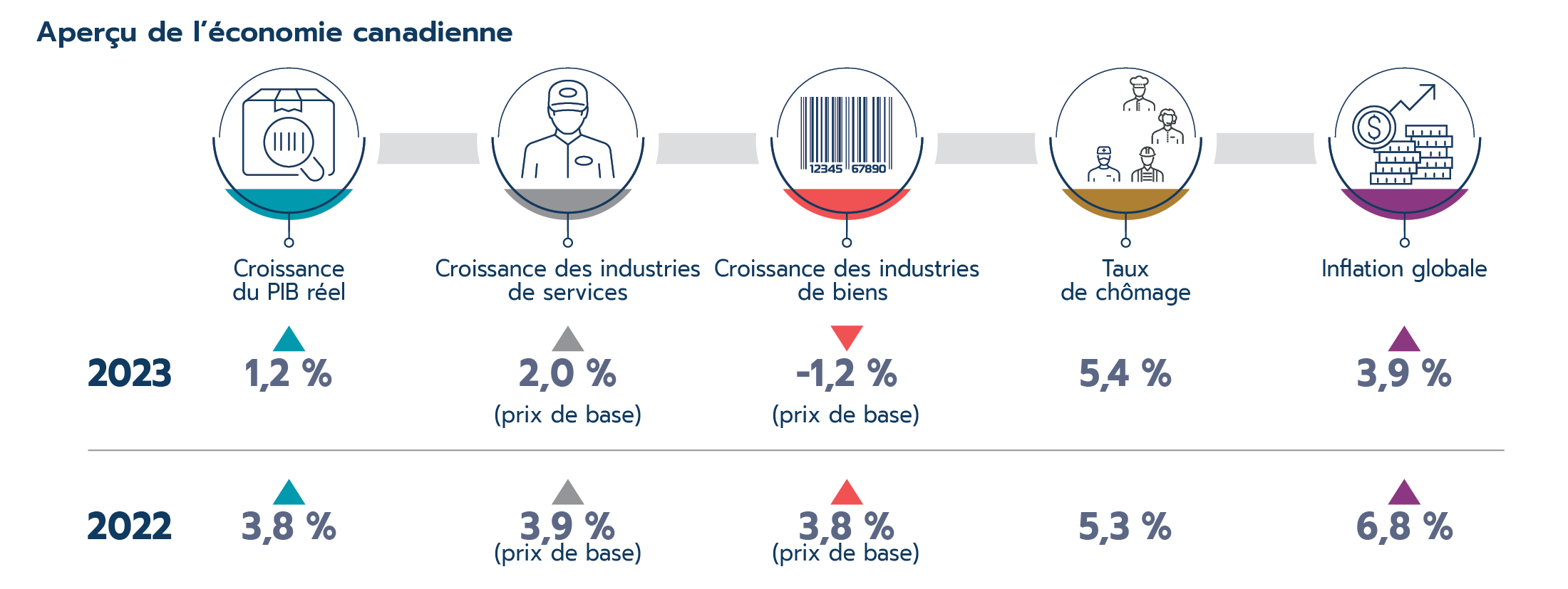
Version texte - Vue d’ensemble figure 2
- Croissance du PIB réel canadien en 2022 : 3,8 %
- Croissance du PIB réel canadien en 2023 : 1,2 %
- Croissance de l’industrie des services (prix de base) en 2022 : 3,9 %
- Croissance de l’industrie des services (prix de base) en 2023 : 2,0 %
- Croissance de l’industrie des biens (prix de base) en 2022 : 3,8 %
- Croissance de l’industrie des biens (prix de base) en 2023 : -1,2 %
- Taux de chômage en 2022 : 5,3 %
- Taux de chômage en 2023 : 5,4 %
- Inflation globale en 2022 : 6,8 %
- Inflation globale en 2023 : 3,9 %
Les exportations et les importations canadiennes ont progressé malgré un environnement mondial difficile – les échanges bilatéraux de biens et de services ont totalisé les 1 900 milliards de dollars en 2023.
- Ralentissement de la croissance des échanges : La croissance des exportations canadiennes de biens et de services a nettement ralenti, passant de 21,2 % en 2022 à 1,4 % en 2023. La croissance a été menée par les exportations de services (13,8 %), tandis que les exportations de biens (-1,4 %) ont diminué. Les services de voyage et les produits et pièces détachées automobiles ont enregistré de fortes hausses.
- La croissance des importations de biens et services (3,1 %) a dépassé celle des exportations, les importations de services (10,1 %) et de biens (1,4 %) ayant toutes deux progressé. Comme pour les exportations, les services de voyage et les produits et pièces détachées automobiles ont été les principaux moteurs de la croissance des importations en 2023.
- Avec la levée des restrictions liées à la COVID-19, les exportations et les importations de services de voyage ont dépassé pour la première fois en 2023 leurs niveaux d’avant la pandémie de 2019.
- Reprise de la croissance de l’investissement : Après avoir diminué en 2022, les flux d’investissements internationaux bilatéraux du Canada ont augmenté en 2023. Finance et assurances ont stimulé l’augmentation des investissements canadiens à l’étranger, tandis que la fabrication a été à l’origine de la croissance des investissements étrangers au Canada.
- En 2023, les entrées et sorties d’investissements internationaux ont été supérieures à leurs moyennes historiques respectives (entre 2010 et 2019), mais sont restées inférieures à leurs niveaux de 2021.
Vue d’ensemble figure 3 : Aperçu du commerce et de l’investissement internationaux du Canada
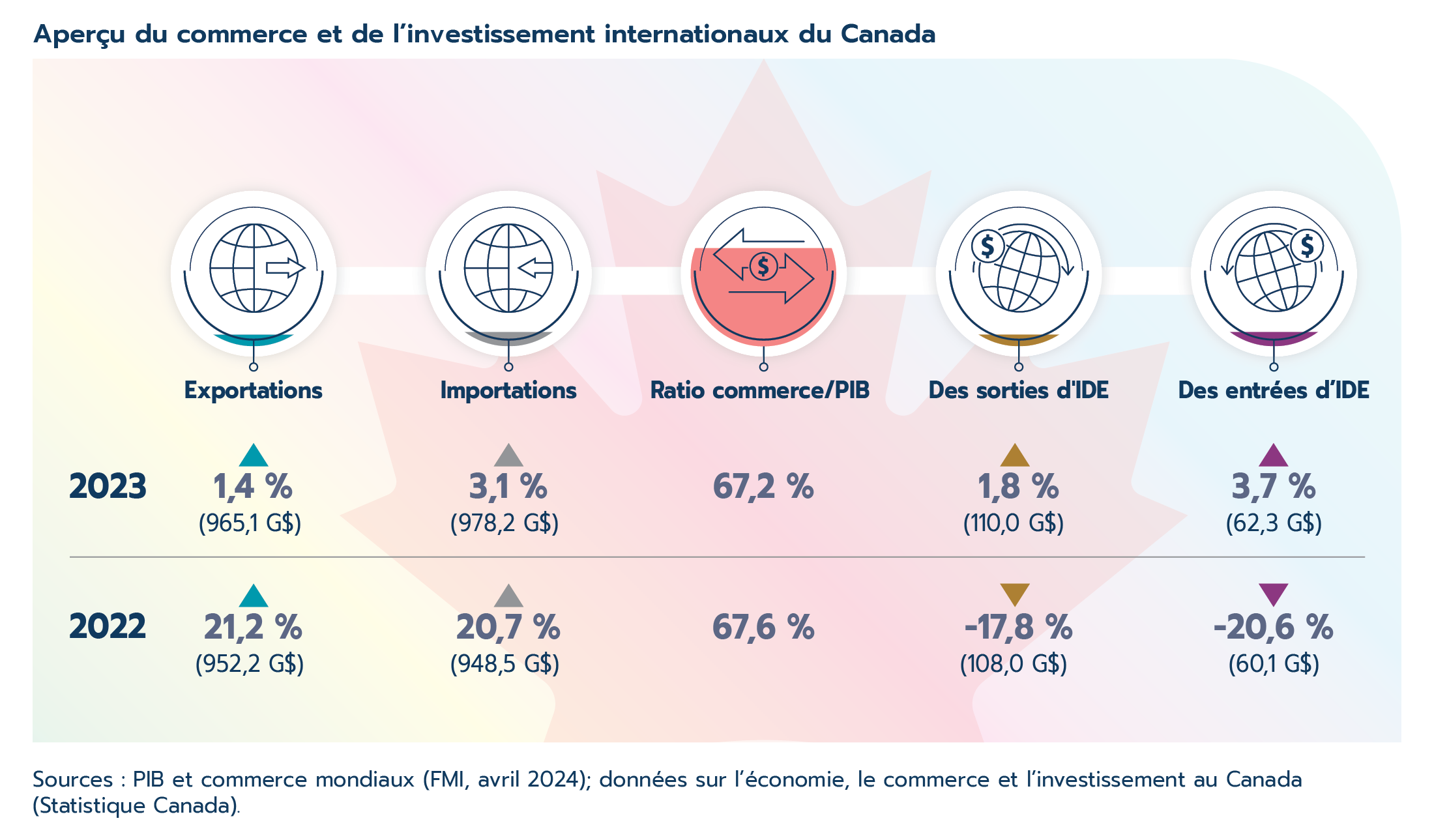
Sources : PIB et commerce mondiaux (FMI, avril 2024); données sur l’économie, le commerce et l’investissement au Canada (Statistique Canada).
Version texte - Vue d’ensemble figure 3
- Exportations de biens et services en 2022 : 21,2 % (952,2 milliards de dollars)
- Exportations de biens et services en 2023 : 1,4 % (965.1 milliards de dollars)
- Importations de biens et services en 2022 : 20,7 % (948.5 milliards de dollars)
- Importations de biens et services en 2023 : 3,1 % (978.2 milliards de dollars)
- Ratio commerce/PIB en 2022 : 67,6 %
- Ratio commerce/PIB en 2023 : 67,2 %
- Sorties d’investissements directs étrangers du Canada en 2022 : -17,8 % (108,0 milliards de dollars)
- Sorties d’investissements directs étrangers du Canada en 2023 : 1,8 % (110,0 milliards de dollars)
- Entrées d’investissements directs étrangers au Canada en 2022 : -20,6 % (60,1 milliards de dollars)
- Entrées d’investissements directs étrangers au Canada en 2023 : 3,7 % (62,3 milliards de dollars)
1.1 Introduction
Après une inflation historique, l’éclatement de la guerre en Europe et un resserrement synchronisé de la politique monétaire en 2022, les perspectives pour 2023 étaient sombres. Pourtant, c’est la résilience qui s’est imposée. Bien que la croissance ait ralenti, la plupart des économies avancées ont évité la récession, et la croissance des marchés émergents et des économies en développement s’est légèrement accélérée. L’inflation a ralenti dans la plupart des régions, entraînant des baisses de taux dans certaines économies et des discussions sur des baisses dans d’autres, tandis que les marchés du travail sont restés relativement robustes au cours du processus.
Malgré cette résistance globale, l’année a connu son lot d’épreuves : le conflit au Moyen-Orient, une réouverture économique chinoise plus faible que prévu, une croissance européenne en difficulté et des tensions géopolitiques croissantes ont pesé sur la croissance. Entre-temps, de nombreuses économies à faible revenu n’ont pas encore retrouvé leur niveau de production d’avant la pandémie. Le commerce et l’investissement mondiaux ont été mis à mal par ces défis. Pour 2024, les gouvernements devraient réduire leurs dépenses, le resserrement de la politique monétaire continuera à freiner la croissance et la croissance sous-jacente de la productivité devrait être faible. On s’attend donc à une nouvelle année de résultats économiques médiocres. Dans la première partie de Le point sur le commerce 2024, nous examinons les moteurs de la performance économique, commerciale et d’investissement dans les économies mondiale et canadienne pour 2023 et les attentes pour 2024.
1.2 Le contexte mondial
Au début de l’année 2023, les économies mondiales étaient aux prises avec une inflation record. Les murmures de stagflation, de récessions et de pessimisme généralisé étaient monnaie courante. Les événements ont pris une tournure positive, puisque l’économie mondiale a résisté en 2023 : la croissance s’est ralentie, mais l’économie mondiale a quand même progressé, la croissance aux États-Unis et au Japon ayant dépassé les attentes.
Plusieurs évolutions positives ont soutenu la croissance mondiale en 2023. L’inflation a ralenti dans les économies avancées, ainsi que dans les marchés émergents et les économies en développement, qui ont enregistré respectivement une moyenne de 4,6 % et 8,3 %, respectivement. La baisse des prix mondiaux de l’énergie d’environ 29,9 % a certainement aidé (Groupe de la Banque mondiale, 2024), tout comme le resserrement de la politique monétaire dans de nombreuses économies. Les marchés du travail sont restés relativement solides dans les économies avancées, avec un taux de chômage plus faible que prévu, ce qui a permis aux dépenses de consommation de progresser. Il est important de noter que la politique budgétaire favorable, en particulier dans les économies avancées, a contribué à la croissance de 2023. En effet, dans certains grands marchés, les dépenses publiques ont dépassé la croissance économique.
Pourtant, 2023 n’a pas été sans poser de nombreux problèmes. La guerre fait toujours rage en Ukraine et un nouveau conflit a éclaté au Moyen-Orient, entraînant des coûts humains dévastateurs et des conséquences ultérieures pour la croissance mondiale. Malgré la baisse de l’inflation, l’inflation alimentaire reste élevée dans de nombreux pays, et ce sont les populations vulnérables qui en subissent le plus les conséquences. La hausse des taux d’intérêt a également exposé plus de la moitié des économies à faible revenu à un risque de détresse financière (FMI, 2023).
Dans l’ensemble, la croissance économique mondiale a ralenti, passant de 3,5 % en 2022 à 3,2 % en 2023, restant ainsi inférieure à la croissance mondiale d’avant la pandémie (3,7 %). Les économies avancées ont été à l’origine de ce ralentissement, la croissance passant de 2,6 % en 2022 à 1,6 % en 2023. Dans le même temps, les marchés émergents et les économies en développement ont dépassé les attentes, avec une croissance qui atteindra 4,3 % en 2023.
Figure 1.1 : Les économies avancées sont à l’origine du ralentissement tandis que les marchés émergents s'accélèrent
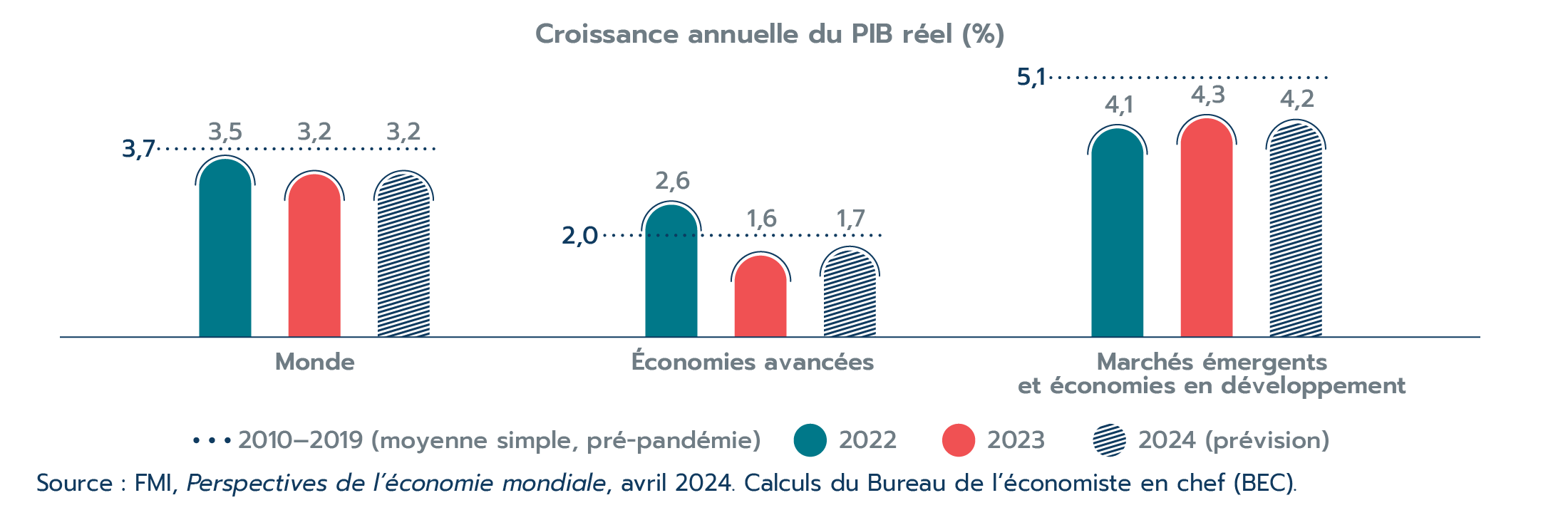
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2024. Calculs du Bureau de l’économiste en chef (BEC).
Version texte - Figure 1.1
| Croissance du PIB | 2010-2019 (moyenne simple avant la pandémie) | 2022 | 2023 | 2024 (prévisions) |
|---|---|---|---|---|
| Monde | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| Économies avancées | 2,0 | 2,6 | 1,6 | 1,7 |
| Marchés émergents et économies en développement | 5,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
Les États-Unis ont mené la croissance des économies avancées, malgré une hausse historiquement rapide des taux d’intérêt. Les dépenses de consommation, soutenues par un marché de l’emploi toujours sain, et les solides dépenses publiques ont contribué à cette croissance. La croissance économique américaine a dépassé les attentes en s’accélérant, passant de 1,9 % en 2022 à 2,5 % en 2023. Une reprise des investissements fixes et des exportations nettes a permis de faire augmenter la croissance économique du Japon de près de 1,0 % en 2022 à 1,9 %. Néanmoins, un ralentissement marqué dans la zone euro, au Royaume-Uni et au Canada l’a emporté sur une croissance plus rapide aux États-Unis et au Japon.
La guerre qui fait rage en Ukraine, l’inflation et les taux d’intérêt élevés ont pesé sur la croissance économique de la zone euro, qui a fortement baissé, passant de 3,4 % en 2022 à 0,4 % en 2023. L’Allemagne se distingue au sein de la zone euro par une récession annuelle (-0,3 %) en 2023. Le Royaume-Uni a connu des difficultés similaires : l’économie n’a progressé que de 0,1 % en 2023, après être entrée en récession technique avec une croissance négative au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année.
Sur les marchés émergents, la reprise de la croissance en Chine et en Russie a été compensée par un ralentissement en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La levée rapide et inattendue des restrictions liées à la COVID-19 en Chine n’a pas produit l’essor économique que beaucoup attendaient. La Chine a également été confrontée à des problèmes importants dans son secteur immobilier tout au long de l’année. Malgré cela, la Chine a enregistré une croissance de 5,2 % en 2023, ce qui représente une amélioration par rapport à la croissance la plus faible depuis 20 ans observée en 2022 (à l’exclusion de 2020). Malgré une croissance plus lente en 2023, l’Inde (7,8 %) et l’Indonésie (5,0 %), les deuxième et sixième plus grands marchés émergents, ont connu une croissance plus rapide que les autres marchés émergents et économies en développement. Le resserrement des conditions financières mondiales et l’inflation ont continué à freiner la croissance dans d’autres marchés émergents et dans l’ensemble des économies en développement. Dans le même temps, l’Arabie saoudite (-0,8 %) est entrée en récession à la suite de la chute des prix mondiaux de l’énergie.
Commerce et investissements mondiaux
Le volume des échanges mondiaux de biens et de services a nettement ralenti, passant de 5,6 % en 2022 à 0,3 % en 2023. Les économies avancées (0,3 %) et les marchés émergents et économies en développement (0,6 %) ont vu la croissance de leur commerce réduire de manière significative. Si la poursuite de l’amélioration des chaînes d’approvisionnement mondiales et la levée des restrictions liées à la pandémie en Chine ont soutenu le commerce, les effets persistants de la guerre en Ukraine, l’inflation élevée et le resserrement des conditions financières ont tous pesé sur la croissance en 2023. En outre, les attaques contre les navires traversant la mer Rouge ont réduit le volume des échanges au cours des dernières semaines de l’année. Au-delà de ces défis, la fragmentation géopolitique nuit à la croissance du commerce : en 2023, environ 3 388 nouvelles restrictions commerciales ont été imposées dans le monde (Global Trade Alert, 2024).
Figure 1.2 : Arrêt de la croissance du volume des échanges de biens et de services en 2023
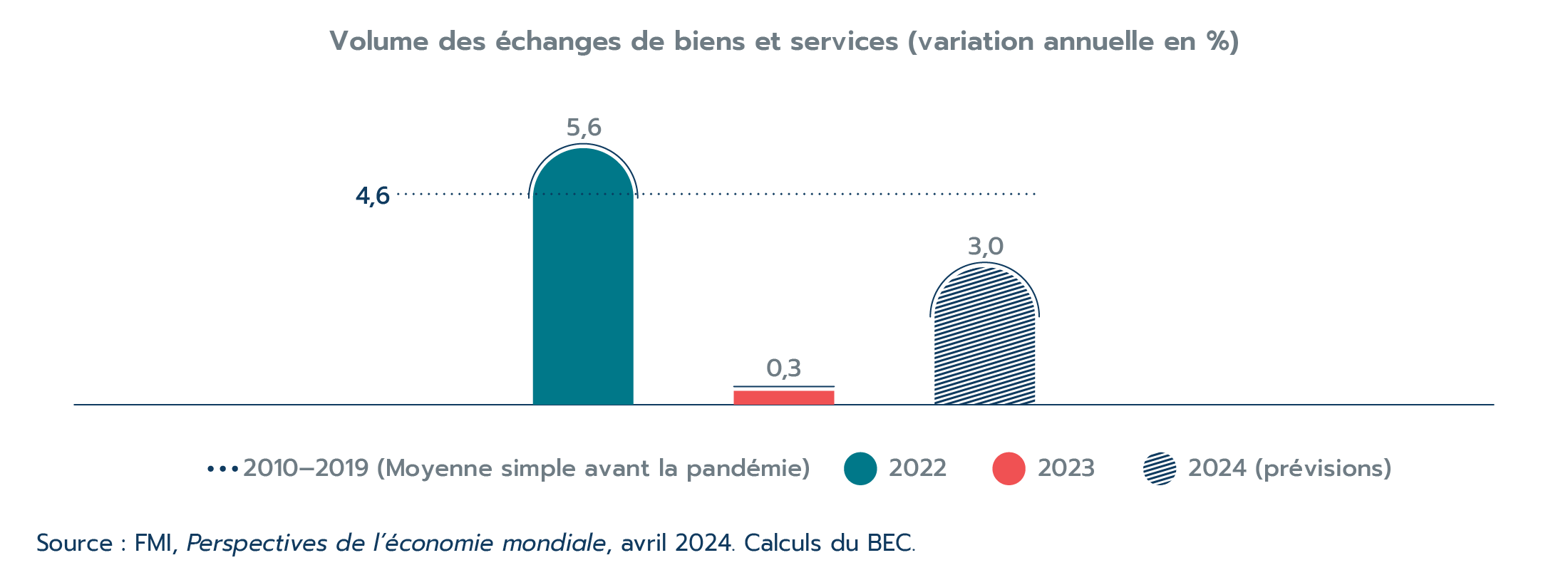
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2024. Calculs du BEC.
Version texte - Figure 1.2
| Moyenne simple avant la pandémie (2010-2019) | 2022 | 2023 | 2024 (prévisions) | |
|---|---|---|---|---|
| Volume des échanges de biens et services (variation annuelle en %) | 4,6 % | 5,6 % | 0,3 % | 3,0 % |
Encadré 1.1 : Perturbations du commerce maritime en 2023
Grâce à la taille des navires modernes, à la création d’infrastructures clés et à la prédominance du transport maritime par conteneurs, le transport de marchandises par voie maritime est beaucoup moins coûteux que par avion, train ou camion. En réalité, l’efficacité du transport international des produits a joué un rôle crucial dans l’essor des chaînes d’approvisionnement internationales (voir le dossier spécial sur les chaînes d’approvisionnement). Aujourd’hui, plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde voyagent par voie maritime, ce qui équivaut à plus de 20 000 milliards de dollars en 2023, soit environ sept fois le PIB du Canada.Note de bas de page 1 Cependant, des événements récents ont mis en évidence les multiples facteurs qui peuvent avoir une incidence négative sur le commerce maritime.
Les conditions de sécheresse historiques provoquées par les changements climatiques dans le canal de Panama n’ont laissé aux autorités du canal d’autre choix que de mettre en place des plafonds de transit – le nombre de navires passant par le canal a été progressivement réduit d’une moyenne de 36 navires avant la sécheresse à seulement 18 navires en février 2024 (Autorité du canal de Panama, 2024). Bien que le nombre de navires pouvant transiter par le canal ait augmenté depuis, le canal a fonctionné bien en deçà de sa capacité historique pendant plus de quatre mois et, en mars 2024, il fonctionnait encore à environ 70 % de sa capacité. Par conséquent, les volumes des échanges dans le canal de Panama ont été inférieurs de 32 % au cours des deux premiers mois de 2024 par rapport aux deux premiers mois de 2023.
Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, l’année 2023 s’est terminée par l’attaque d’un groupe de militants yéménites contre des navires naviguant en mer Rouge. La mer Rouge a connu des difficultés plus importantes que le canal de Panama, avec des volumes d’échanges en baisse de 59 % au cours des deux premiers mois de 2024 par rapport aux deux premiers mois de 2023. En mai 2024, les volumes commerciaux sur les deux voies de transit étaient toujours supprimés.
Figure 1.3 : Baisse des volumes d’échanges dans la mer Rouge et le canal de Panama
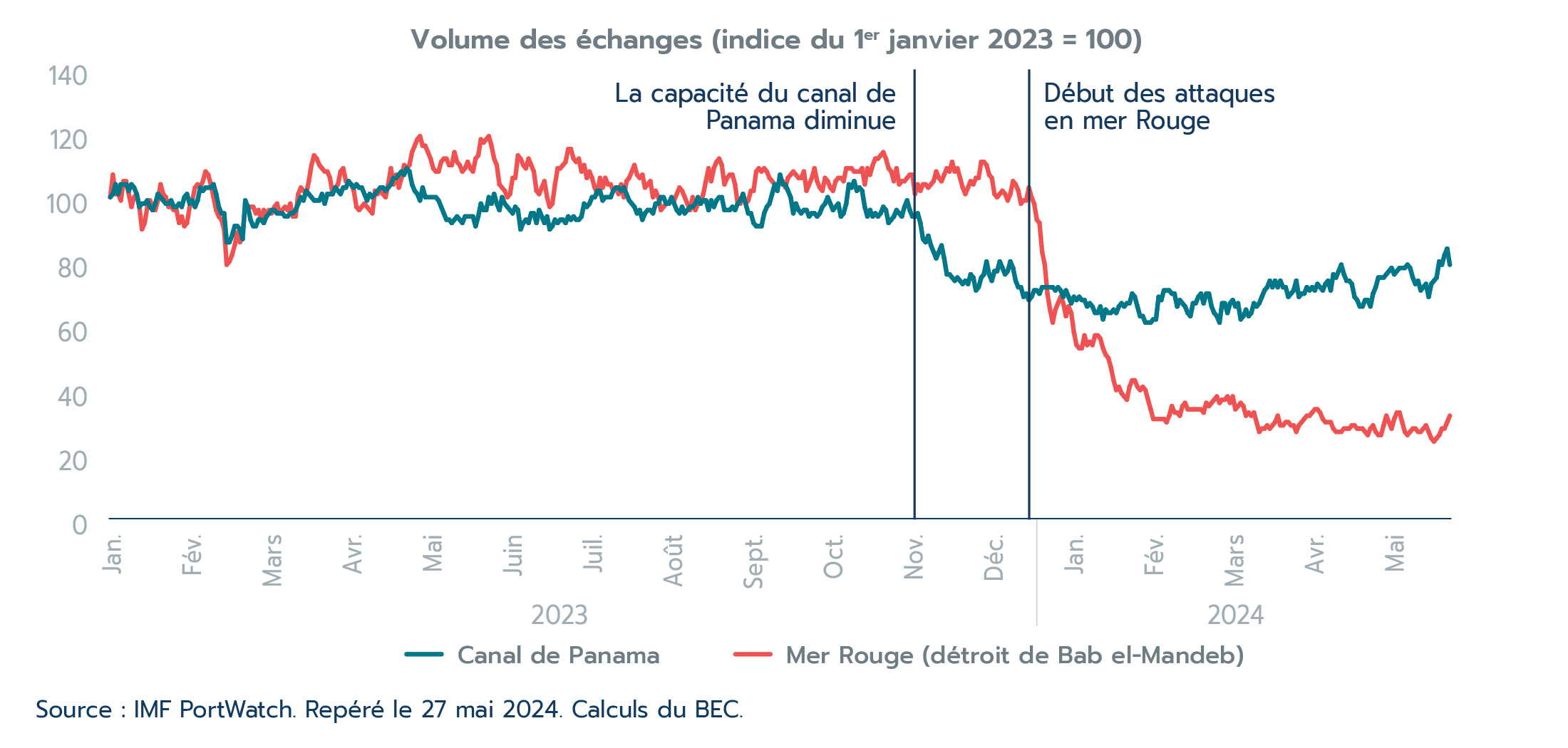
Source : IMF PortWatch. Repéré le 27 mai 2024. Calculs du BEC.
Version texte - Figure 1.3
| Volume des échanges (indice du 1er janvier 2023 = 100) | Canal de Panama | Mer Rouge (détroit de Bab el-Mandeb) |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 100 | 100 |
| 2023-01-01 | 100 | 100 |
| 2023-01-02 | 101 | 107 |
| 2023-01-03 | 104 | 101 |
| 2023-01-04 | 101 | 101 |
| 2023-01-05 | 104 | 99 |
| 2023-01-06 | 104 | 105 |
| 2023-01-07 | 104 | 105 |
| 2023-01-08 | 102 | 101 |
| 2023-01-09 | 104 | 97 |
| 2023-01-10 | 103 | 100 |
| 2023-01-11 | 101 | 101 |
| 2023-01-12 | 97 | 97 |
| 2023-01-13 | 98 | 90 |
| 2023-01-14 | 98 | 92 |
| 2023-01-15 | 99 | 97 |
| 2023-01-16 | 97 | 99 |
| 2023-01-17 | 96 | 97 |
| 2023-01-18 | 98 | 96 |
| 2023-01-19 | 101 | 99 |
| 2023-01-20 | 100 | 104 |
| 2023-01-21 | 99 | 101 |
| 2023-01-22 | 98 | 100 |
| 2023-01-23 | 98 | 97 |
| 2023-01-24 | 99 | 97 |
| 2023-01-25 | 97 | 96 |
| 2023-01-26 | 97 | 96 |
| 2023-01-27 | 98 | 92 |
| 2023-01-28 | 97 | 94 |
| 2023-01-29 | 100 | 91 |
| 2023-01-30 | 101 | 92 |
| 2023-01-31 | 98 | 97 |
| 2023-02-01 | 99 | 99 |
| 2023-02-02 | 97 | 103 |
| 2023-02-03 | 99 | 104 |
| 2023-02-04 | 103 | 103 |
| 2023-02-05 | 102 | 105 |
| 2023-02-06 | 103 | 108 |
| 2023-02-07 | 103 | 107 |
| 2023-02-08 | 103 | 104 |
| 2023-02-09 | 104 | 100 |
| 2023-02-10 | 101 | 96 |
| 2023-02-11 | 97 | 94 |
| 2023-02-12 | 95 | 93 |
| 2023-02-13 | 95 | 90 |
| 2023-02-14 | 86 | 79 |
| 2023-02-15 | 86 | 80 |
| 2023-02-16 | 88 | 82 |
| 2023-02-17 | 91 | 85 |
| 2023-02-18 | 91 | 89 |
| 2023-02-19 | 90 | 86 |
| 2023-02-20 | 87 | 89 |
| 2023-02-21 | 99 | 97 |
| 2023-02-22 | 97 | 97 |
| 2023-02-23 | 93 | 97 |
| 2023-02-24 | 91 | 97 |
| 2023-02-25 | 91 | 95 |
| 2023-02-26 | 93 | 96 |
| 2023-02-27 | 93 | 93 |
| 2023-02-28 | 92 | 96 |
| 2023-03-01 | 94 | 95 |
| 2023-03-02 | 95 | 96 |
| 2023-03-03 | 96 | 95 |
| 2023-03-04 | 96 | 97 |
| 2023-03-05 | 95 | 98 |
| 2023-03-06 | 95 | 95 |
| 2023-03-07 | 95 | 96 |
| 2023-03-08 | 94 | 97 |
| 2023-03-09 | 94 | 96 |
| 2023-03-10 | 95 | 98 |
| 2023-03-11 | 95 | 94 |
| 2023-03-12 | 96 | 94 |
| 2023-03-13 | 98 | 101 |
| 2023-03-14 | 100 | 103 |
| 2023-03-15 | 99 | 102 |
| 2023-03-16 | 102 | 101 |
| 2023-03-17 | 101 | 105 |
| 2023-03-18 | 100 | 110 |
| 2023-03-19 | 99 | 113 |
| 2023-03-20 | 99 | 112 |
| 2023-03-21 | 99 | 110 |
| 2023-03-22 | 101 | 109 |
| 2023-03-23 | 98 | 108 |
| 2023-03-24 | 101 | 108 |
| 2023-03-25 | 101 | 106 |
| 2023-03-26 | 101 | 101 |
| 2023-03-27 | 103 | 103 |
| 2023-03-28 | 102 | 104 |
| 2023-03-29 | 101 | 108 |
| 2023-03-30 | 103 | 109 |
| 2023-03-31 | 103 | 105 |
| 2023-04-01 | 105 | 105 |
| 2023-04-02 | 104 | 104 |
| 2023-04-03 | 103 | 102 |
| 2023-04-04 | 104 | 97 |
| 2023-04-05 | 103 | 96 |
| 2023-04-06 | 103 | 97 |
| 2023-04-07 | 101 | 98 |
| 2023-04-08 | 99 | 97 |
| 2023-04-09 | 101 | 96 |
| 2023-04-10 | 100 | 95 |
| 2023-04-11 | 101 | 102 |
| 2023-04-12 | 102 | 101 |
| 2023-04-13 | 103 | 102 |
| 2023-04-14 | 103 | 101 |
| 2023-04-15 | 102 | 100 |
| 2023-04-16 | 103 | 104 |
| 2023-04-17 | 104 | 109 |
| 2023-04-18 | 106 | 104 |
| 2023-04-19 | 106 | 107 |
| 2023-04-20 | 107 | 103 |
| 2023-04-21 | 108 | 106 |
| 2023-04-22 | 107 | 110 |
| 2023-04-23 | 109 | 109 |
| 2023-04-24 | 108 | 110 |
| 2023-04-25 | 104 | 114 |
| 2023-04-26 | 102 | 116 |
| 2023-04-27 | 101 | 118 |
| 2023-04-28 | 99 | 119 |
| 2023-04-29 | 103 | 116 |
| 2023-04-30 | 100 | 116 |
| 2023-05-01 | 100 | 114 |
| 2023-05-02 | 100 | 112 |
| 2023-05-03 | 100 | 109 |
| 2023-05-04 | 100 | 108 |
| 2023-05-05 | 99 | 108 |
| 2023-05-06 | 97 | 111 |
| 2023-05-07 | 95 | 112 |
| 2023-05-08 | 93 | 112 |
| 2023-05-09 | 93 | 110 |
| 2023-05-10 | 92 | 110 |
| 2023-05-11 | 93 | 114 |
| 2023-05-12 | 94 | 111 |
| 2023-05-13 | 93 | 110 |
| 2023-05-14 | 92 | 108 |
| 2023-05-15 | 94 | 109 |
| 2023-05-16 | 94 | 111 |
| 2023-05-17 | 94 | 109 |
| 2023-05-18 | 94 | 108 |
| 2023-05-19 | 91 | 112 |
| 2023-05-20 | 94 | 113 |
| 2023-05-21 | 98 | 118 |
| 2023-05-22 | 96 | 117 |
| 2023-05-23 | 96 | 118 |
| 2023-05-24 | 100 | 119 |
| 2023-05-25 | 98 | 116 |
| 2023-05-26 | 101 | 112 |
| 2023-05-27 | 98 | 110 |
| 2023-05-28 | 96 | 104 |
| 2023-05-29 | 100 | 103 |
| 2023-05-30 | 98 | 102 |
| 2023-05-31 | 97 | 100 |
| 2023-06-01 | 96 | 101 |
| 2023-06-02 | 95 | 106 |
| 2023-06-03 | 97 | 106 |
| 2023-06-04 | 96 | 113 |
| 2023-06-05 | 90 | 112 |
| 2023-06-06 | 92 | 110 |
| 2023-06-07 | 93 | 109 |
| 2023-06-08 | 92 | 112 |
| 2023-06-09 | 95 | 110 |
| 2023-06-10 | 95 | 108 |
| 2023-06-11 | 92 | 102 |
| 2023-06-12 | 96 | 101 |
| 2023-06-13 | 94 | 103 |
| 2023-06-14 | 92 | 105 |
| 2023-06-15 | 94 | 100 |
| 2023-06-16 | 90 | 97 |
| 2023-06-17 | 91 | 98 |
| 2023-06-18 | 93 | 104 |
| 2023-06-19 | 92 | 109 |
| 2023-06-20 | 93 | 109 |
| 2023-06-21 | 93 | 110 |
| 2023-06-22 | 92 | 111 |
| 2023-06-23 | 94 | 115 |
| 2023-06-24 | 93 | 115 |
| 2023-06-25 | 94 | 112 |
| 2023-06-26 | 93 | 111 |
| 2023-06-27 | 93 | 112 |
| 2023-06-28 | 94 | 108 |
| 2023-06-29 | 98 | 110 |
| 2023-06-30 | 97 | 106 |
| 2023-07-01 | 98 | 108 |
| 2023-07-02 | 100 | 106 |
| 2023-07-03 | 100 | 103 |
| 2023-07-04 | 102 | 101 |
| 2023-07-05 | 102 | 106 |
| 2023-07-06 | 99 | 103 |
| 2023-07-07 | 100 | 106 |
| 2023-07-08 | 100 | 104 |
| 2023-07-09 | 100 | 104 |
| 2023-07-10 | 102 | 102 |
| 2023-07-11 | 103 | 103 |
| 2023-07-12 | 103 | 101 |
| 2023-07-13 | 102 | 104 |
| 2023-07-14 | 103 | 100 |
| 2023-07-15 | 101 | 105 |
| 2023-07-16 | 99 | 106 |
| 2023-07-17 | 98 | 108 |
| 2023-07-18 | 97 | 110 |
| 2023-07-19 | 95 | 107 |
| 2023-07-20 | 96 | 106 |
| 2023-07-21 | 93 | 107 |
| 2023-07-22 | 95 | 103 |
| 2023-07-23 | 96 | 104 |
| 2023-07-24 | 96 | 105 |
| 2023-07-25 | 95 | 100 |
| 2023-07-26 | 98 | 102 |
| 2023-07-27 | 98 | 100 |
| 2023-07-28 | 100 | 96 |
| 2023-07-29 | 100 | 97 |
| 2023-07-30 | 98 | 98 |
| 2023-07-31 | 98 | 98 |
| 2023-08-01 | 100 | 99 |
| 2023-08-02 | 98 | 99 |
| 2023-08-03 | 96 | 101 |
| 2023-08-04 | 95 | 103 |
| 2023-08-05 | 97 | 102 |
| 2023-08-06 | 95 | 100 |
| 2023-08-07 | 96 | 98 |
| 2023-08-08 | 97 | 96 |
| 2023-08-09 | 97 | 100 |
| 2023-08-10 | 98 | 96 |
| 2023-08-11 | 100 | 98 |
| 2023-08-12 | 98 | 98 |
| 2023-08-13 | 99 | 101 |
| 2023-08-14 | 99 | 105 |
| 2023-08-15 | 96 | 109 |
| 2023-08-16 | 99 | 105 |
| 2023-08-17 | 97 | 109 |
| 2023-08-18 | 99 | 111 |
| 2023-08-19 | 100 | 112 |
| 2023-08-20 | 100 | 110 |
| 2023-08-21 | 96 | 104 |
| 2023-08-22 | 96 | 106 |
| 2023-08-23 | 96 | 107 |
| 2023-08-24 | 97 | 107 |
| 2023-08-25 | 96 | 104 |
| 2023-08-26 | 98 | 98 |
| 2023-08-27 | 99 | 98 |
| 2023-08-28 | 101 | 101 |
| 2023-08-29 | 98 | 98 |
| 2023-08-30 | 95 | 99 |
| 2023-08-31 | 95 | 102 |
| 2023-09-01 | 92 | 102 |
| 2023-09-02 | 91 | 108 |
| 2023-09-03 | 91 | 109 |
| 2023-09-04 | 91 | 108 |
| 2023-09-05 | 95 | 109 |
| 2023-09-06 | 97 | 108 |
| 2023-09-07 | 98 | 106 |
| 2023-09-08 | 101 | 105 |
| 2023-09-09 | 104 | 104 |
| 2023-09-10 | 102 | 103 |
| 2023-09-11 | 107 | 105 |
| 2023-09-12 | 104 | 105 |
| 2023-09-13 | 104 | 103 |
| 2023-09-14 | 102 | 106 |
| 2023-09-15 | 100 | 107 |
| 2023-09-16 | 95 | 108 |
| 2023-09-17 | 98 | 107 |
| 2023-09-18 | 96 | 106 |
| 2023-09-19 | 95 | 106 |
| 2023-09-20 | 96 | 108 |
| 2023-09-21 | 96 | 102 |
| 2023-09-22 | 94 | 104 |
| 2023-09-23 | 95 | 106 |
| 2023-09-24 | 95 | 109 |
| 2023-09-25 | 94 | 105 |
| 2023-09-26 | 95 | 103 |
| 2023-09-27 | 97 | 102 |
| 2023-09-28 | 98 | 106 |
| 2023-09-29 | 100 | 105 |
| 2023-09-30 | 98 | 103 |
| 2023-10-01 | 96 | 102 |
| 2023-10-02 | 97 | 105 |
| 2023-10-03 | 98 | 106 |
| 2023-10-04 | 94 | 106 |
| 2023-10-05 | 95 | 105 |
| 2023-10-06 | 98 | 109 |
| 2023-10-07 | 104 | 109 |
| 2023-10-08 | 103 | 109 |
| 2023-10-09 | 105 | 108 |
| 2023-10-10 | 102 | 108 |
| 2023-10-11 | 103 | 108 |
| 2023-10-12 | 102 | 109 |
| 2023-10-13 | 97 | 104 |
| 2023-10-14 | 94 | 109 |
| 2023-10-15 | 96 | 107 |
| 2023-10-16 | 94 | 110 |
| 2023-10-17 | 95 | 112 |
| 2023-10-18 | 94 | 112 |
| 2023-10-19 | 95 | 113 |
| 2023-10-20 | 97 | 114 |
| 2023-10-21 | 96 | 112 |
| 2023-10-22 | 92 | 109 |
| 2023-10-23 | 93 | 108 |
| 2023-10-24 | 94 | 105 |
| 2023-10-25 | 96 | 109 |
| 2023-10-26 | 95 | 104 |
| 2023-10-27 | 94 | 105 |
| 2023-10-28 | 97 | 105 |
| 2023-10-29 | 99 | 106 |
| 2023-10-30 | 96 | 107 |
| 2023-10-31 | 94 | 107 |
| 2023-11-01 | 94 | 101 |
| 2023-11-02 | 95 | 104 |
| 2023-11-03 | 92 | 102 |
| 2023-11-04 | 87 | 104 |
| 2023-11-05 | 86 | 104 |
| 2023-11-06 | 88 | 103 |
| 2023-11-07 | 85 | 104 |
| 2023-11-08 | 83 | 105 |
| 2023-11-09 | 81 | 108 |
| 2023-11-10 | 83 | 106 |
| 2023-11-11 | 85 | 105 |
| 2023-11-12 | 81 | 107 |
| 2023-11-13 | 76 | 109 |
| 2023-11-14 | 76 | 108 |
| 2023-11-15 | 75 | 111 |
| 2023-11-16 | 74 | 108 |
| 2023-11-17 | 75 | 109 |
| 2023-11-18 | 74 | 106 |
| 2023-11-19 | 73 | 103 |
| 2023-11-20 | 74 | 101 |
| 2023-11-21 | 73 | 103 |
| 2023-11-22 | 76 | 105 |
| 2023-11-23 | 75 | 104 |
| 2023-11-24 | 71 | 106 |
| 2023-11-25 | 72 | 106 |
| 2023-11-26 | 75 | 111 |
| 2023-11-27 | 76 | 111 |
| 2023-11-28 | 80 | 110 |
| 2023-11-29 | 76 | 107 |
| 2023-11-30 | 74 | 106 |
| 2023-12-01 | 77 | 101 |
| 2023-12-02 | 77 | 100 |
| 2023-12-03 | 80 | 101 |
| 2023-12-04 | 78 | 102 |
| 2023-12-05 | 76 | 101 |
| 2023-12-06 | 77 | 99 |
| 2023-12-07 | 80 | 101 |
| 2023-12-08 | 78 | 105 |
| 2023-12-09 | 74 | 104 |
| 2023-12-10 | 72 | 102 |
| 2023-12-11 | 72 | 98 |
| 2023-12-12 | 69 | 99 |
| 2023-12-13 | 70 | 99 |
| 2023-12-14 | 68 | 103 |
| 2023-12-15 | 69 | 100 |
| 2023-12-16 | 71 | 98 |
| 2023-12-17 | 71 | 93 |
| 2023-12-18 | 70 | 92 |
| 2023-12-19 | 72 | 83 |
| 2023-12-20 | 72 | 79 |
| 2023-12-21 | 72 | 70 |
| 2023-12-22 | 72 | 65 |
| 2023-12-23 | 72 | 61 |
| 2023-12-24 | 71 | 65 |
| 2023-12-25 | 72 | 67 |
| 2023-12-26 | 71 | 69 |
| 2023-12-27 | 69 | 67 |
| 2023-12-28 | 71 | 63 |
| 2023-12-29 | 69 | 66 |
| 2023-12-30 | 67 | 64 |
| 2023-12-31 | 69 | 58 |
| 2024-01-01 | 68 | 54 |
| 2024-01-02 | 69 | 53 |
| 2024-01-03 | 68 | 53 |
| 2024-01-04 | 68 | 57 |
| 2024-01-05 | 66 | 54 |
| 2024-01-06 | 67 | 55 |
| 2024-01-07 | 66 | 54 |
| 2024-01-08 | 64 | 57 |
| 2024-01-09 | 64 | 57 |
| 2024-01-10 | 66 | 56 |
| 2024-01-11 | 62 | 53 |
| 2024-01-12 | 65 | 51 |
| 2024-01-13 | 64 | 50 |
| 2024-01-14 | 64 | 47 |
| 2024-01-15 | 65 | 43 |
| 2024-01-16 | 64 | 40 |
| 2024-01-17 | 66 | 41 |
| 2024-01-18 | 67 | 39 |
| 2024-01-19 | 66 | 38 |
| 2024-01-20 | 67 | 37 |
| 2024-01-21 | 67 | 41 |
| 2024-01-22 | 70 | 43 |
| 2024-01-23 | 69 | 43 |
| 2024-01-24 | 66 | 41 |
| 2024-01-25 | 63 | 40 |
| 2024-01-26 | 63 | 41 |
| 2024-01-27 | 61 | 40 |
| 2024-01-28 | 61 | 37 |
| 2024-01-29 | 61 | 34 |
| 2024-01-30 | 62 | 31 |
| 2024-01-31 | 62 | 31 |
| 2024-02-01 | 69 | 31 |
| 2024-02-02 | 68 | 31 |
| 2024-02-03 | 71 | 31 |
| 2024-02-04 | 71 | 30 |
| 2024-02-05 | 71 | 32 |
| 2024-02-06 | 70 | 35 |
| 2024-02-07 | 70 | 33 |
| 2024-02-08 | 66 | 33 |
| 2024-02-09 | 68 | 32 |
| 2024-02-10 | 67 | 35 |
| 2024-02-11 | 66 | 36 |
| 2024-02-12 | 64 | 34 |
| 2024-02-13 | 63 | 34 |
| 2024-02-14 | 67 | 34 |
| 2024-02-15 | 67 | 34 |
| 2024-02-16 | 69 | 34 |
| 2024-02-17 | 70 | 34 |
| 2024-02-18 | 67 | 33 |
| 2024-02-19 | 70 | 36 |
| 2024-02-20 | 70 | 35 |
| 2024-02-21 | 66 | 36 |
| 2024-02-22 | 64 | 37 |
| 2024-02-23 | 63 | 39 |
| 2024-02-24 | 61 | 36 |
| 2024-02-25 | 67 | 37 |
| 2024-02-26 | 67 | 37 |
| 2024-02-27 | 64 | 38 |
| 2024-02-28 | 67 | 36 |
| 2024-02-29 | 68 | 38 |
| 2024-03-01 | 66 | 34 |
| 2024-03-02 | 67 | 35 |
| 2024-03-03 | 62 | 36 |
| 2024-03-04 | 63 | 35 |
| 2024-03-05 | 65 | 32 |
| 2024-03-06 | 63 | 33 |
| 2024-03-07 | 64 | 32 |
| 2024-03-08 | 67 | 33 |
| 2024-03-09 | 66 | 30 |
| 2024-03-10 | 67 | 27 |
| 2024-03-11 | 69 | 28 |
| 2024-03-12 | 71 | 28 |
| 2024-03-13 | 72 | 29 |
| 2024-03-14 | 74 | 28 |
| 2024-03-15 | 72 | 29 |
| 2024-03-16 | 74 | 30 |
| 2024-03-17 | 72 | 32 |
| 2024-03-18 | 74 | 29 |
| 2024-03-19 | 72 | 29 |
| 2024-03-20 | 72 | 30 |
| 2024-03-21 | 69 | 30 |
| 2024-03-22 | 70 | 29 |
| 2024-03-23 | 71 | 29 |
| 2024-03-24 | 74 | 27 |
| 2024-03-25 | 69 | 29 |
| 2024-03-26 | 70 | 30 |
| 2024-03-27 | 70 | 31 |
| 2024-03-28 | 72 | 32 |
| 2024-03-29 | 71 | 32 |
| 2024-03-30 | 72 | 33 |
| 2024-03-31 | 71 | 34 |
| 2024-04-01 | 73 | 34 |
| 2024-04-02 | 72 | 33 |
| 2024-04-03 | 71 | 31 |
| 2024-04-04 | 73 | 30 |
| 2024-04-05 | 74 | 30 |
| 2024-04-06 | 71 | 30 |
| 2024-04-07 | 76 | 28 |
| 2024-04-08 | 75 | 27 |
| 2024-04-09 | 77 | 27 |
| 2024-04-10 | 79 | 27 |
| 2024-04-11 | 76 | 28 |
| 2024-04-12 | 74 | 28 |
| 2024-04-13 | 74 | 28 |
| 2024-04-14 | 73 | 29 |
| 2024-04-15 | 69 | 29 |
| 2024-04-16 | 68 | 28 |
| 2024-04-17 | 66 | 28 |
| 2024-04-18 | 66 | 28 |
| 2024-04-19 | 68 | 27 |
| 2024-04-20 | 68 | 26 |
| 2024-04-21 | 66 | 28 |
| 2024-04-22 | 70 | 29 |
| 2024-04-23 | 72 | 27 |
| 2024-04-24 | 75 | 26 |
| 2024-04-25 | 75 | 26 |
| 2024-04-26 | 75 | 29 |
| 2024-04-27 | 76 | 32 |
| 2024-04-28 | 77 | 30 |
| 2024-04-29 | 78 | 28 |
| 2024-04-30 | 76 | 31 |
| 2024-05-01 | 77 | 33 |
| 2024-05-02 | 78 | 33 |
| 2024-05-03 | 78 | 30 |
| 2024-05-04 | 78 | 27 |
| 2024-05-05 | 79 | 26 |
| 2024-05-06 | 78 | 27 |
| 2024-05-07 | 75 | 28 |
| 2024-05-08 | 73 | 28 |
| 2024-05-09 | 74 | 27 |
| 2024-05-10 | 71 | 27 |
| 2024-05-11 | 72 | 28 |
| 2024-05-12 | 73 | 29 |
| 2024-05-13 | 69 | 27 |
| 2024-05-14 | 73 | 25 |
| 2024-05-15 | 74 | 24 |
| 2024-05-16 | 75 | 25 |
| 2024-05-17 | 80 | 26 |
| 2024-05-18 | 79 | 28 |
| 2024-05-19 | 82 | 28 |
| 2024-05-20 | 84 | 30 |
| 2024-05-21 | 79 | 32 |
Les routes du canal de Panama et de la mer Rouge représentent, à elles deux, environ 20 % des volumes du commerce maritime mondial; trouver d’autres routes ou modes de transport peut être coûteux. Par exemple, au-delà de la mer Rouge, le meilleur choix pour les navires se rendant d’Asie en Europe du Nord consiste à contourner la pointe sud de l’Afrique, un trajet qui ajoute une semaine ou deux aux temps de parcours. Un allongement de cette durée aura une incidence significative sur les coûts de carburant, d’assurance et autres.
À la fin du mois de février 2024, les prix du fret maritime avaient augmenté de 162 % en moyenne. Les augmentations de prix pour les liaisons entre la Chine et l’Europe du Nord, l’une des routes les plus touchées, ont culminé à environ 274 % à la mi-janvier. Bien qu’il s’agisse d’une hausse significative, ces événements ont eu, jusqu’à présent, une incidence beaucoup moins importante que la pandémie de COVID-19, où les prix ont été multipliés par près de huit en raison du choc simultané de l’offre et de la demande.
Figure 1.4 : Flambée des prix du fret maritime mondial
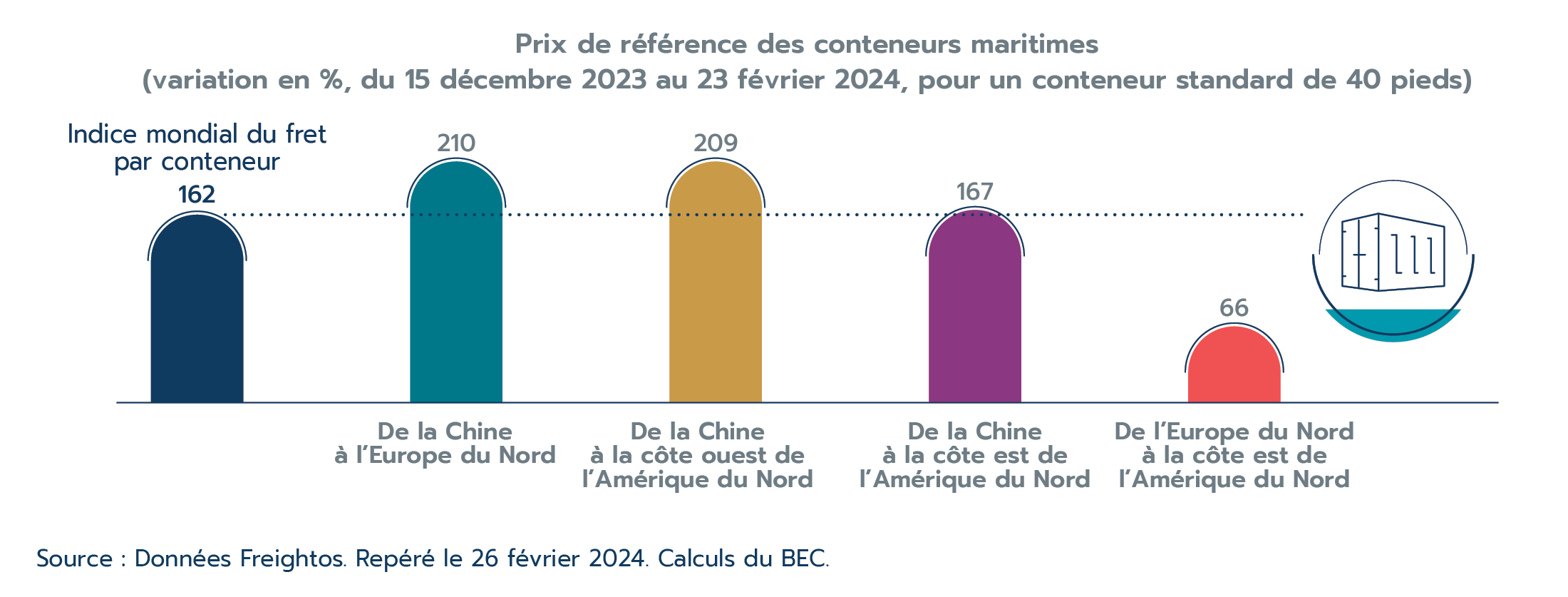
Source : Données Freightos. Repéré le 26 février 2024. Calculs du BEC.
Version texte - Figure 1.4
| Conteneurs maritimes | Prix de référence |
|---|---|
| Indice mondial du fret par conteneur | 162 |
| De la Chine à l’Europe du Nord | 210 |
| De la Chine à la côte ouest de l’Amérique du Nord | 209 |
| De la Chine à la côte est de l’Amérique du Nord | 167 |
| De l’Europe du Nord à la côte est de l’Amérique du Nord | 66 |
Bien que moins importantes que les hausses de prix observées à la suite des perturbations de la pandémie de COVID-19, ces événements ont exercé une pression à la hausse sur le coût des marchandises à l’échelle mondiale, à un moment où une grande partie du monde continue de lutter contre une inflation élevée. Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le doublement des coûts d’expédition mondiaux ajoute environ 0,7 point de pourcentage au taux d’inflation mondial (Carrière-Swallow et al., 2022). Selon Oxford Economics, les perturbations du canal de Panama et de la mer Rouge pourraient ajouter environ 0,25 point de pourcentage à l’inflation américaine en 2024 (Sweet, 2024).
Pour aggraver la situation, en 2023, le transport maritime a également été perturbé par des grèves dans les principaux ports, notamment le port de Vancouver et celui de Prince Rupert. Les grèves en Colombie-Britannique ont duré 13 jours au cours de l’été 2023, provoquant d’importantes perturbations. De plus, en mai 2024, il existe un risque de grève des débardeurs du port de Montréal ainsi que chez les travailleurs opérant dans les ports de la côte Est et de la côte du Golfe des États-Unis. De plus, la navigation sur la côte Est des États-Unis a été perturbée par l’effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, le 26 mars 2024. Le volume des échanges dans le port de Baltimore, qui représente près de 3 % du commerce maritime américain, a fortement chuté dans les jours qui ont suivi (IMF PortWatch, 2024). Le port de Halifax est l’un des dix plus grands ports d’expédition et de réception des navires de Baltimore et peut connaître des volumes imprévus plus importants, ce qui pourrait entraîner des retards. Toutefois, il est peu probable que ces perturbations aient des répercussions significatives sur les prix mondiaux des transports maritimes ou sur l’économie canadienne.
En fin de compte, le transport maritime a toujours été exposé à des risques et le secteur a l’habitude de s’adapter aux perturbations, qu’elles soient dues à des facteurs environnementaux, géopolitiques, sociaux ou autres. Un autre exemple récent de cette adaptation est le réacheminement des chargeurs de la mer Noire vers les ports du Danube à la suite de la guerre en Ukraine. Toutefois, si la fréquence et la gravité de ces risques augmentent, comme cela pourrait se produire si les risques environnementaux poursuivent leur trajectoire actuelle (Lee et al., 2023), les coûts du transport commercial pourraient augmenter de manière plus significative et permanente. Ces hausses auraient des répercussions négatives sur le commerce mondial et la croissance économique.
En raison de conditions financières restrictives à l’échelle mondiale et d’une augmentation continue de la fragmentation géopolitique, l’investissement mondial a chuté en 2023. D’après les données préliminaires de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les flux d’investissements directs étrangers mondiaux ont diminué de 18 % une fois que les flux vers les économies intermédiaires européennes ont été supprimés. Dans les économies développées, les flux ont reculé de 28 %, les flux vers l’Europe et d’autres économies développées ayant diminué, tandis que les flux vers l’Amérique du Nord ont affiché une croissance nulle. Les flux d’investissements directs étrangers vers les économies en développement ont baissé de 9 %, entraînés par une réduction de 12 % des flux vers l’Asie. Il est important de noter que les flux d’investissements directs étrangers vers la Chine ont diminué de 6 % en 2023, reflétant les problèmes des marchés financiers et macroéconomiques du pays au cours de l’année.
Les données préliminaires ont également montré que les ventes de fusions et acquisitions transfrontalières ont baissé pour la deuxième année consécutive (CNUCED, 2024). La diminution a été généralisée dans toutes les grandes régions. Parallèlement, les annonces d’investissements en installations nouvelles ont diminué en 2023 (-6 %), mais la valeur des projets annoncés a augmenté (6 %), ce qui pourrait soutenir une reprise des flux d’investissements directs étrangers en 2024.
Perspectives d’avenir
Bien que l’économie mondiale ait montré une résilience supérieure aux attentes en 2023, elle est maintenant sur un terrain incertain en abordant l’année 2024. Le FMI prévoit que la croissance économique mondiale se maintiendra à 3,2 % en 2024 (figure 1.1), avec des risques équilibrés à la hausse et à la baisse. Si cette croissance se réalise, elle sera cohérente avec un atterrissage en douceur, ce qui signifie qu’elle évitera des récessions profondes et généralisées.
Le retour réussi de l’inflation dans la fourchette cible, processus considéré comme un exercice d’équilibrisme délicat, est un élément déterminant de la perspective du FMI. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à l’inflation en 2023. Les problèmes de logistique commerciale, tels que ceux de la mer Rouge et du canal de Panama, pourraient s’aggraver. Plusieurs facteurs pourraient entraîner une nouvelle flambée des prix de l’énergie à l’échelle mondiale, comme une intensification du conflit en cours au Moyen-Orient. En outre, les tensions sur le marché du travail pourraient persister, ou des événements climatiques extrêmes pourraient entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires. Chacun de ces événements pourrait conduire les banques centrales à maintenir les taux d’intérêt à un niveau plus élevé pendant une plus longue période. En revanche, un assouplissement plus rapide des tensions sur le marché du travail, une répercussion plus forte de la baisse des prix de l’énergie ou une diminution de la marge bénéficiaire des entreprises pour éviter de nouvelles hausses de prix pourraient tous mener à un ralentissement du taux d’inflation, ce qui amènerait les banques centrales à abaisser les taux d’intérêt plus tôt que prévu.
Dans les économies avancées, le FMI prévoit une légère reprise de la croissance, qui passera de 1,6 % en 2023 à 1,7 % en 2024. Les États-Unis devraient être en tête de la croissance grâce à leurs performances exceptionnelles, passant de 2,5 % en 2023 à 2,7 % en 2024. La zone euro et le Royaume-Uni continueront à freiner la croissance des économies avancées, avec une progression de seulement 0,8 % et 0,5 %, respectivement, en 2024. La croissance des marchés émergents et des économies en développement devrait légèrement ralentir, passant de 4,3 % en 2023 à 4,2 % en 2024. Un ralentissement dans les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine devrait être compensé par une hausse au Moyen-Orient et en Asie centrale, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. Malgré sa reprise en 2023, l’économie chinoise est confrontée à plusieurs vents contraires. La croissance de la Chine devrait ralentir, passant de 5,2 % en 2023 à 4,6 % en 2024. Pendant ce temps, l’Inde pourrait bénéficier de la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle connaîtra l’une des croissances les plus importantes des marchés émergents en 2024, même si un ralentissement est prévu, la croissance passant de 7,8 % en 2023 à 6,8 % en 2024.
Si les prévisions de base pour l’économie mondiale se confirment et que les restrictions financières commencent à s’assouplir, le commerce et l’investissement devraient en profiter. Le FMI prévoit que les volumes d’échanges de biens et de services enregistreront une hausse en 2024, progressant de 3,0 %. La CNUCED envisage également une légère augmentation des flux d’investissements directs étrangers en 2024. Bien entendu, si les problèmes de logistique commerciale persistent, que le fardeau de la dette mondiale se révèle trop lourd ou que la fragmentation géopolitique s’aggrave, les résultats du commerce et de l’investissement pourraient être inférieurs à ces estimations.
Encadré 1.2 : Hausse des mesures commerciales préjudiciables
L’année 2023 a été une nouvelle année néfaste pour la politique commerciale. Les mesures commerciales préjudiciables se multiplient et les politiques industrielles de nombreuses économies sont de plus en plus protectionnistes. Au fil du temps, ces mesures pourraient freiner la croissance économique.
En 2023, près de 3 400 nouvelles mesures préjudiciables en matière de commerce et d’investissement ont été mises en œuvre à l’échelle mondiale, contre seulement 908 mesures de libéralisation.Note de bas de page 2 Le nombre moyen de nouvelles mesures préjudiciables mises en œuvre entre 2020 et 2023 était trois fois plus élevé que celui des mesures mises en œuvre entre 2016 et 2019. La Chine et l’Allemagne sont les pays les plus touchés, avec plus de 1 100 mesures préjudiciables en 2023. Plus de 850 mesures préjudiciables ont touché le Canada cette année.
Figure 1.5 : Le protectionnisme s’est considérablement développé après la pandémie
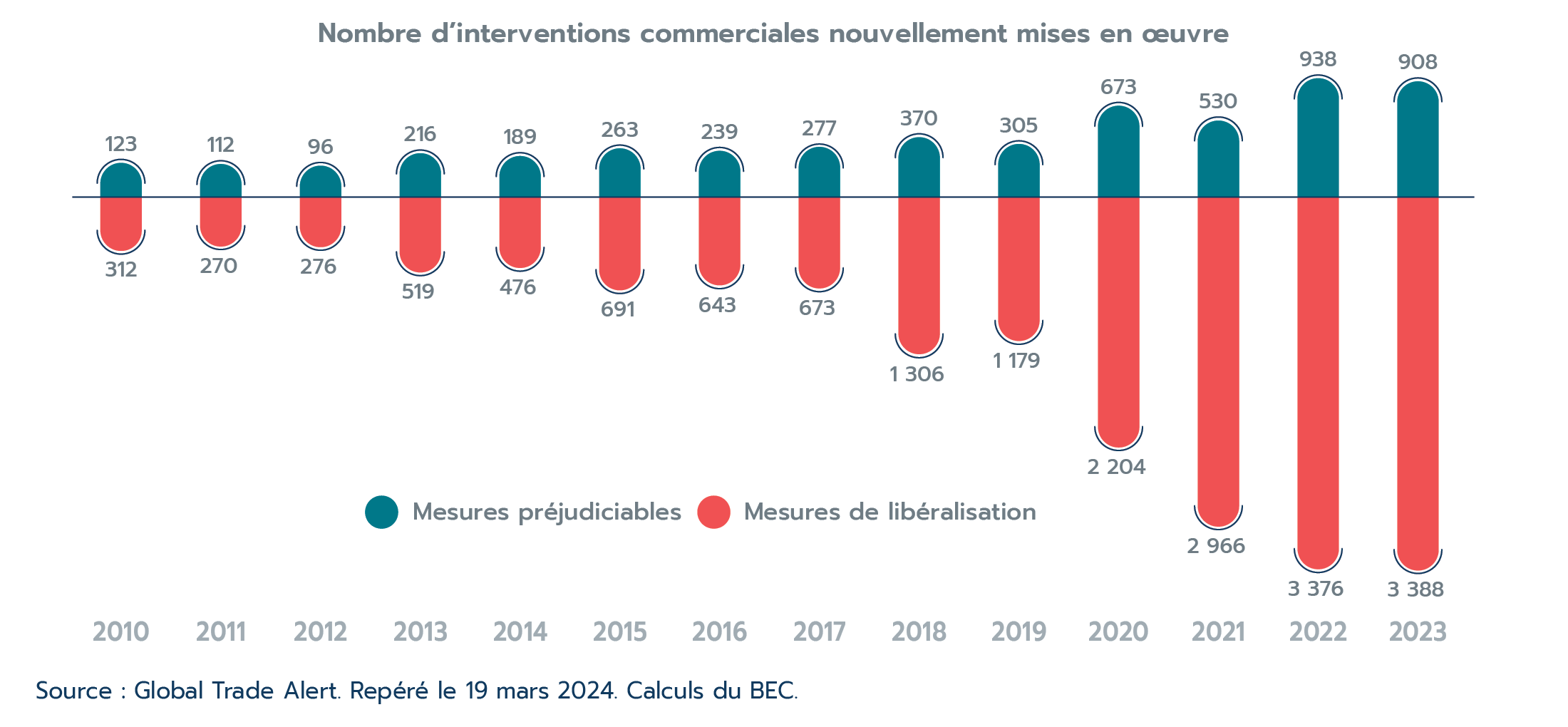
Source : Global Trade Alert. Repéré le 19 mars 2024. Calculs du BEC.
Version texte - Figure 1.5
| Nombre d’interventions commerciales nouvellement mises en œuvre | Mesures préjudiciables | Mesures de libéralisation |
|---|---|---|
| 2010 | 312 | 123 |
| 2011 | 270 | 112 |
| 2012 | 276 | 96 |
| 2013 | 519 | 216 |
| 2014 | 476 | 189 |
| 2015 | 691 | 263 |
| 2016 | 643 | 239 |
| 2017 | 673 | 277 |
| 2018 | 1 306 | 370 |
| 2019 | 1 179 | 305 |
| 2020 | 2 204 | 673 |
| 2021 | 2 966 | 530 |
| 2022 | 3 376 | 938 |
| 2023 | 3 388 | 908 |
Selon Global Trade Alert, le secteur des produits métalliques, des machines et des équipements (33,6 %) représentait la plus grande part des mesures préjudiciables nouvellement mises en œuvre en 2023, suivi de près par les produits divers tels que les produits chimiques, les produits du bois et les plastiques (28,6 %), ainsi que les produits alimentaires et textiles (22,4 %). Étant donné leur importance dans la construction, la fabrication automobile et d’autres industries phares, les produits en acier et en fer figurent en tête de liste des mesures préjudiciables, comme cela est le cas depuis au moins la dernière décennie. Toutefois, ces dernières années, les technologies avancées, telles que les semi-conducteurs ou les technologies à faible teneur en carbone, ont fait l’objet de restrictions plus importantes. Dans l’ensemble, les estimations suggèrent que les mesures mises en œuvre en 2023 couvrent au moins 22,0 % du commerce mondial (Evenett et al., 2024).
Figure 1.6 : Les métaux et les produits métalliques continuent de dominer la liste des restrictions commerciales
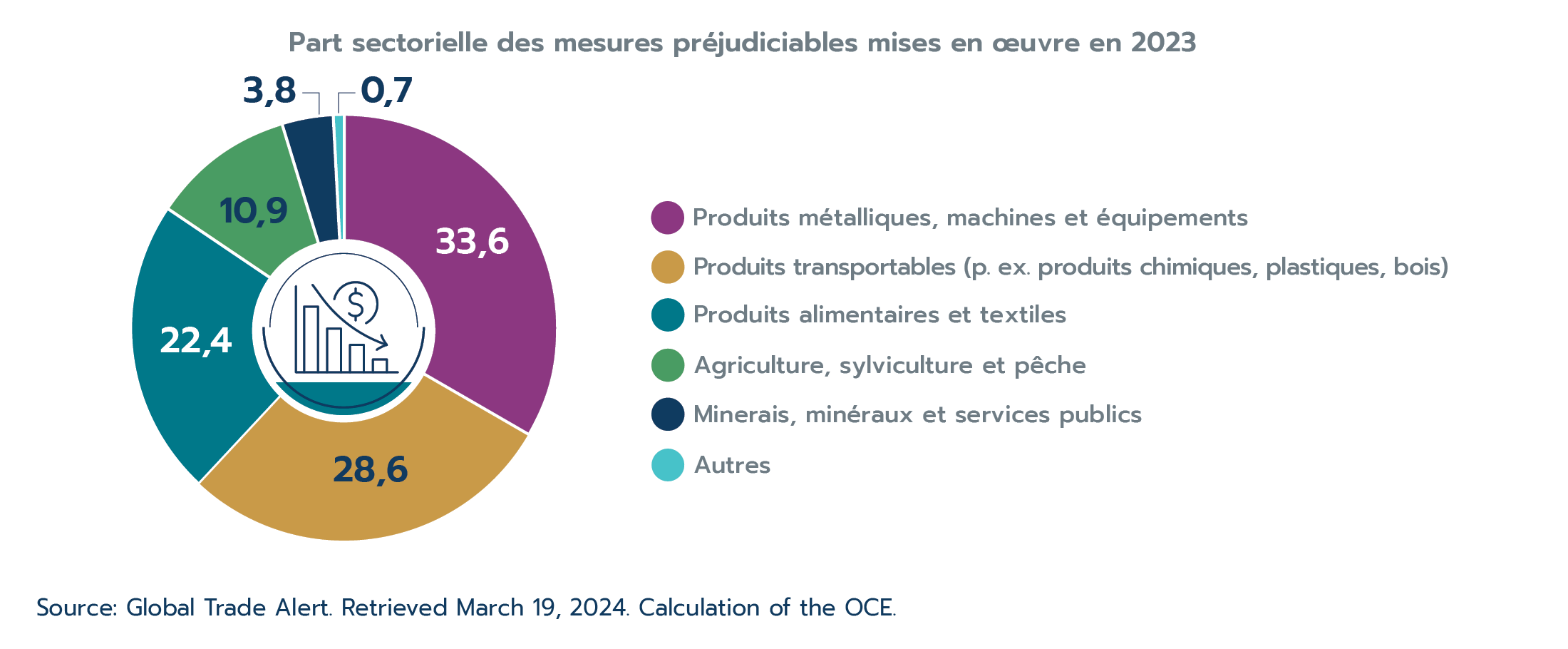
Source : Global Trade Alert. Repéré le 19 mars 2024. Calculs du BEC.
Version texte - Figure 1.6
| Secteur | Part sectorielle des mesures préjudiciables mises en œuvre en 2023 |
|---|---|
| Produits métalliques, machines et équipements | 33,6 % |
| Produits transportables (p. ex. produits chimiques, plastiques, bois) | 28,6 % |
| Produits alimentaires et textiles | 22,4 % |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10,9 % |
| Minerais, minéraux et services publics | 3,8 % |
| Autres | 0,7 % |
Plus de la moitié (58,1 %) des mesures commerciales préjudiciables mises en œuvre en 2023 ont pris la forme de subventions intérieures non liées aux exportations, telles que des prêts publics, des allègements fiscaux ou des aides financières aux entreprises ou aux industries.Note de bas de page 3 Les mesures liées aux exportations (y compris les subventions à l’exportation) ne représentaient que 13,4 % des mesures préjudiciables mises en œuvre. En 2023, la plupart des subventions internes ont été mises en œuvre par les économies avancées, tandis que les marchés émergents et les économies en développement sont plus susceptibles d’utiliser des restrictions à l’importation et à l’exportation. Cela peut changer au fil du temps et peut également refléter la capacité fiscale plus faible des marchés émergents et des économies en développement à mettre en œuvre des subventions nationales.
Les raisons invoquées pour les mesures préjudiciables récemment mises en place varient, allant de la compétitivité stratégique et des préoccupations géopolitiques à l’atténuation des changements climatiques et à la sécurité nationale. Quelle que soit leur motivation, les politiques industrielles protectionnistes risquent de créer un environnement où tous les pays ou groupes de pays sont en concurrence et se rendent coup pour coup afin de prendre la tête dans les mêmes secteurs. Selon les chercheurs du FMI, pour les subventions annoncées ou mises en œuvre en 2023, il y a environ 74,0 % de chances que si la Chine, l’UE ou les États-Unis instaurent une subvention pour un produit donné, une autre grande économie impose une subvention de rétorsion sur ce même produit dans l’année qui suit (Evenett et al., 2024).
Toutes les mesures commerciales restrictives ne sont pas intrinsèquement mauvaises, car elles peuvent parfois viser à soutenir d’autres objectifs politiques. Par exemple, la restriction du commerce des emballages en plastique peut contribuer à la transition climatique, même si elle réduit le commerce dans son ensemble. Cependant, de nombreuses restrictions à l’exportation et à l’importation augmenteront le coût des biens et des services au niveau mondial et pourraient ralentir les progrès vers d’autres objectifs mondiaux, tels que l’atténuation des changements climatiques, en rendant les technologies nécessaires plus coûteuses ou en ralentissant leur entrée sur le marché. En outre, les subventions peuvent conduire à une duplication des efforts et à une offre excédentaire, et elles peuvent ne pas constituer une bonne utilisation de l’espace budgétaire limité.
En fin de compte, ces mesures commerciales préjudiciables entravent le commerce et la croissance économique. Selon le FMI, une augmentation des restrictions commerciales pourrait faire baisser la production mondiale de 0,2 %, dans un scénario de restrictions limitées, jusqu’à 7 % du PIB dans un scénario de restrictions élevées (Aiyar, 2023). Avec un découplage technologique plus important, les pertes de production pourraient atteindre 12 % pour certains pays. Comme l’a souligné Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, la montée de la fragmentation commence par l’augmentation des barrières au commerce et à l’investissement et peut, dans sa forme extrême, aboutir à la division des pays en blocs économiques rivaux. Cette situation risque de faire régresser les gains transformateurs produits par l’intégration économique mondiale (Georgieva, 2023).
1.3 Performance économique du Canada
Après deux années consécutives de forte croissance, l’économie canadienne a ralenti, passant d’une croissance de 3,8 % en 2022 à 1,2 % en 2023. Ce ralentissement était attendu, car les effets de l’inflation et des taux d’intérêt élevés se sont combinés pour ralentir la demande et écraser les investissements.
La vigueur des dépenses des ménages et des exportations a permis à l’économie de démarrer l’année 2023 sur une note positive, le produit intérieur brut (PIB) progressant de 3,4 % (en données désaisonnalisées annualisées) au premier trimestre. La performance économique a ensuite été chancelante pendant le reste de l’année. Le PIB n’a progressé que de 0,7 % au deuxième trimestre avant de se contracter de 0,3 % au troisième trimestre. L’économie a terminé l’année 2023 en demi-teinte, avec une croissance de seulement 0,1 % au quatrième trimestre. Dans l’ensemble, une récession technique a été évitée en 2023 et un « atterrissage en douceur » semble de plus en plus probable.
Tout au long de l’année, les dépenses des ménages ont permis à l’économie canadienne d’éviter la récession. Toutefois, cela a grandement été stimulé par la croissance de la population. Par personne, les dépenses des ménages ont diminué en 2023. Les exportations nettes, soutenues par la vigueur de l’économie américaine, ont été le principal facteur de croissance. Par ailleurs, une diminution des investissements des entreprises de 4,8 % et une contraction des stocks ont été les principaux freins à la croissance en 2023.
Après avoir atteint en 2022 un pic de 6,8 %, ce qu’on n’avait pas vu depuis 40 ans, l’inflation a ralenti pour atteindre 3,9 % en 2023. Sous l’effet de la reprise de la demande d’activités en personne après la pandémie, l’inflation des services (4,6 %) a dépassé l’inflation des biens (3,1 %). Les prix de l’énergie ont joué un rôle important dans le ralentissement de l’inflation des biens; après avoir augmenté de 22,5 % en 2022, ils se sont contractés de 4,2 % en 2023. Malgré le ralentissement général de l’inflation, l’inflation des produits alimentaires (7,5 %) et du logement (5,6 %) était trop élevée en 2023, ce qui a nui de manière disproportionnée aux populations vulnérables du Canada. Enfin, l’inflation a fortement ralenti au cours des six premiers mois de l’année 2023 et s’est stabilisée lors de la deuxième moitié de l’année. Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre l’inflation, la Banque du Canada a relevé le taux d’intérêt directeur à trois reprises en 2023; il a atteint son niveau le plus élevé en 23 ans, à savoir 5,0 %, en juillet, et il est encore à ce niveau en mai 2024. Les premières données pour 2024 montrent que l’inflation est tombée dans la fourchette cible de 1,0 % à 3,0 %; toutefois, les effets des hausses de taux antérieures devraient perdurer. Il faut généralement entre 18 et 24 mois pour que les effets des changements de politique monétaire sur l’économie se matérialisent pleinement (Banque du Canada, 2021).
Dans l’ensemble, le Canada s’est classé au troisième rang en ce qui concerne la performance économique parmi les économies du G7 en 2023, derrière les États-Unis et le Japon (figure 1.7). Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance économique du Canada se maintiendra à environ 1,2% en 2024; seuls les États-Unis devraient enregistrer une meilleure performance parmi les pays du G7.
Figure 1.7 : Le Canada affiche la troisième plus forte croissance parmi les pays du G7 en 2023, et s’apprête à enregistrer la deuxième plus forte performance en 2024
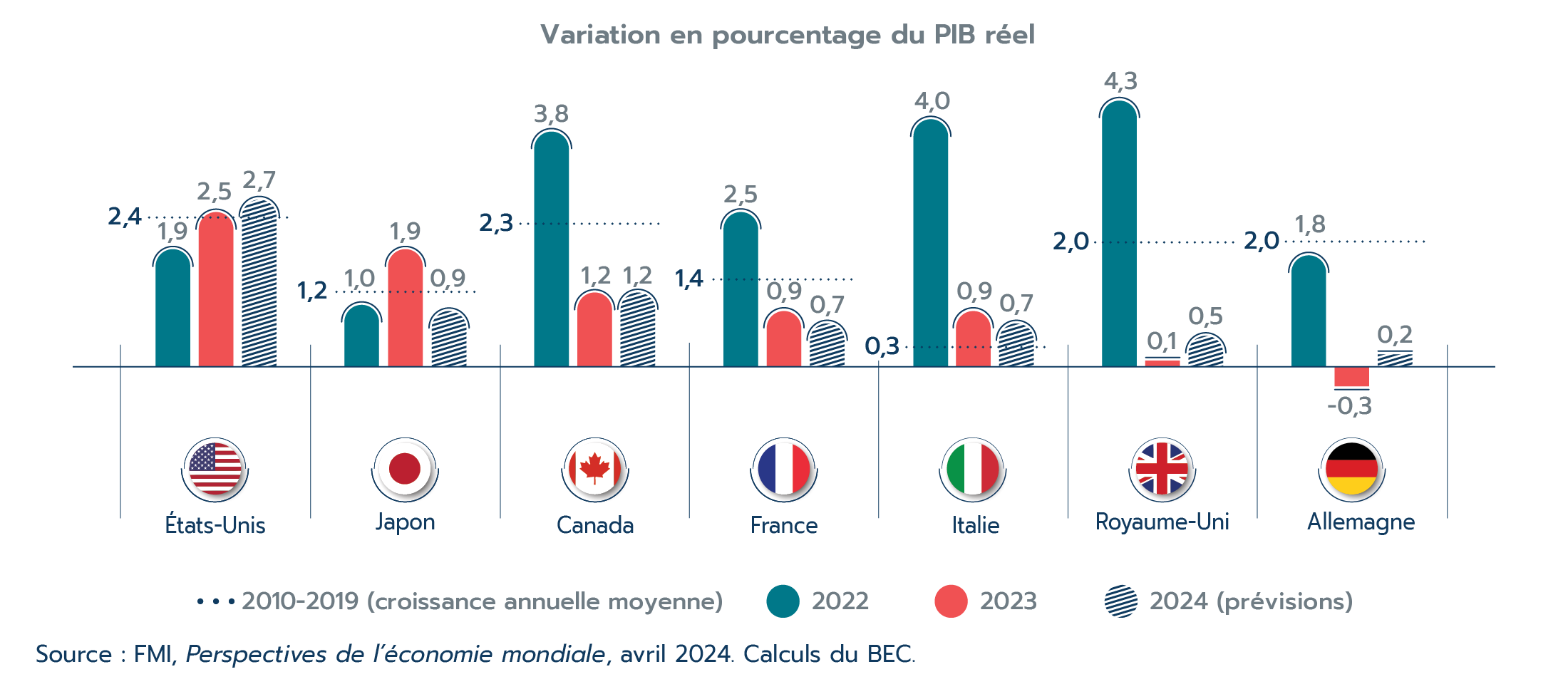
Version texte - Figure 1.7
| Pays | 2010 à 2019 (croissance annuelle moyenne) | 2022 | 2023 | 2024 (prévisions) |
|---|---|---|---|---|
| Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2024. Calculs du BEC. | ||||
| États-Unis | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
| Japon | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 0,9 |
| Canada | 2,3 | 3,8 | 1,2 | 1,2 |
| Italie | 0,3 | 4,0 | 0,9 | 0,7 |
| France | 1,4 | 2,5 | 0,9 | 0,7 |
| Royaume-Uni | 2,0 | 4,3 | 0,1 | 0,5 |
| Allemagne | 2,0 | 1,8 | -0,3 | 0,2 |
Performance de l’industrie
Après avoir progressé de 3,8 % en 2022, les industries de biens se sont contractées de 1,2 % en 2023. La contraction a été généralisée, quatre des cinq principales industries de biens ayant reculé. Le secteur de la construction, sensible aux taux d’intérêt et influencé par le secteur résidentiel, a été le principal frein à la croissance en 2023 (figure 1.8). La sécheresse dans l’ouest du Canada a fait chuter la production agricole, ce qui a fait de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche le deuxième contributeur le plus important à la contraction des biens. Le secteur de la fabrication s’est contracté pour la première fois depuis 2020. Les baisses enregistrées dans plusieurs sous-secteurs, notamment la fabrication de matières plastiques, de bois et de papier, l’ont emporté sur la forte croissance de la fabrication de véhicules automobiles et de machinerie. L’extraction minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz sont les seules industries de biens à progresser en 2023, bien qu’avec un modeste taux de 0,2 %.
Figure 1.8 : Les industries de biens sont en difficulté en 2023
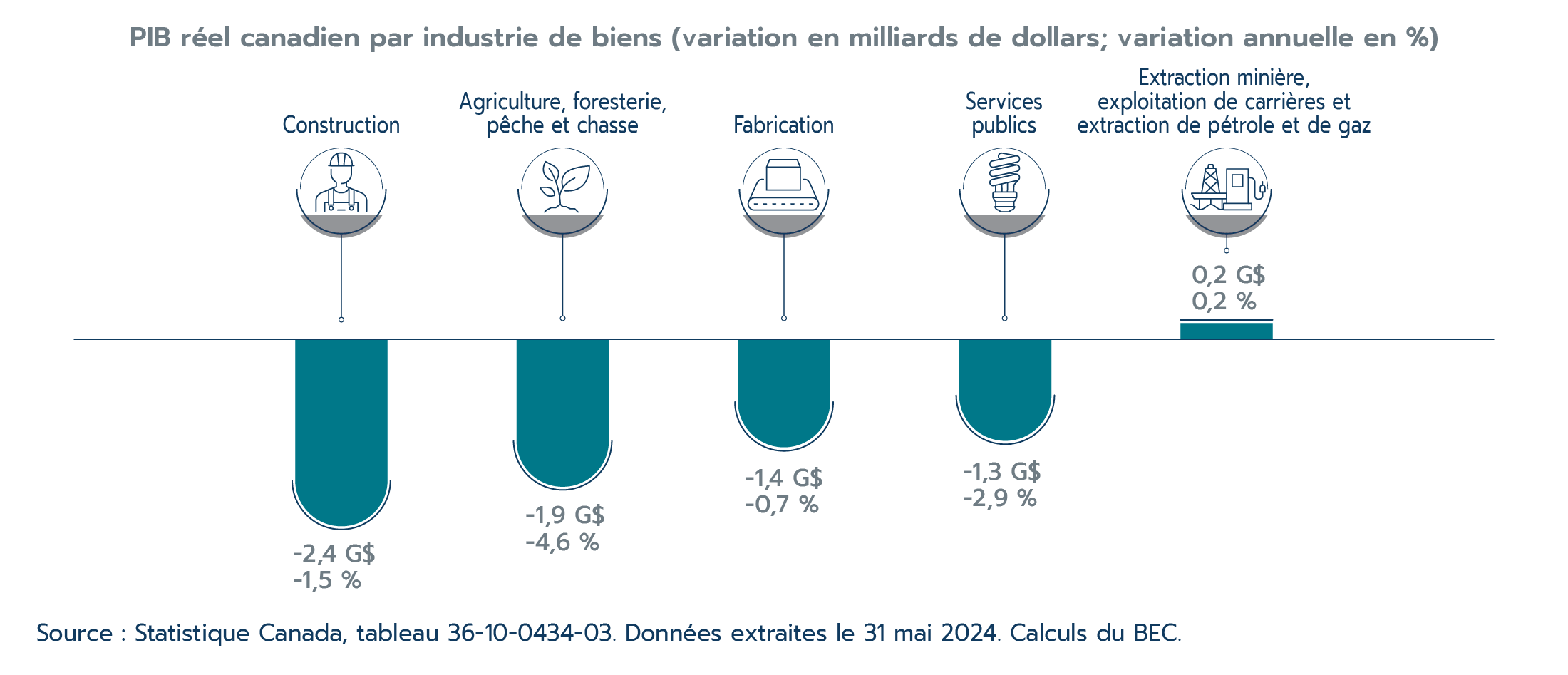
Version texte - Figure 1.8
| Industrie de biens | Comparaison de 2022 et de 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison de 2022 et de 2023 (variation en %) |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0434-03. Données extraites le 31 mai 2024. Calculs du BEC. | ||
| Construction | -2,4 | -1,5 % |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | -1,9 | -4,6 % |
| Fabrication | -1,4 | -0,7 % |
| Services publics | -1,3 | -2,9 % |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 0,2 | 0,2 % |
Les industries de services ont tiré la croissance pour la deuxième année consécutive, progressant de 2,0 % en 2023. Les services de transport et d’entreposage ainsi que l’administration publique, stimulée en grande partie par des gains dans l’administration locale, municipale, régionale, provinciale et territoriale, ont contribué le plus à la croissance des services (figure 1.9). Alors que l’expansion des voyages après la pandémie se poursuivait et que de plus en plus de travailleurs retournaient au bureau, les transports aériens et les services de transport urbain ont été à l’origine de l’augmentation des transports et de l’entreposage. Les services professionnels et scientifiques, l’immobilier et les soins de santé ont également contribué à la croissance des services. Seuls le commerce de gros et les services d’information et de culture se sont contractés en 2023.
Malgré cet élan continu, plusieurs industries de services sont restées en dessous de leurs niveaux d’avant la pandémie de 2019, notamment le transport et l’entreposage, la gestion administrative et la gestion des déchets, et les services d’hébergement et de restauration.
Figure 1.9 : Les industries de services mènent la croissance
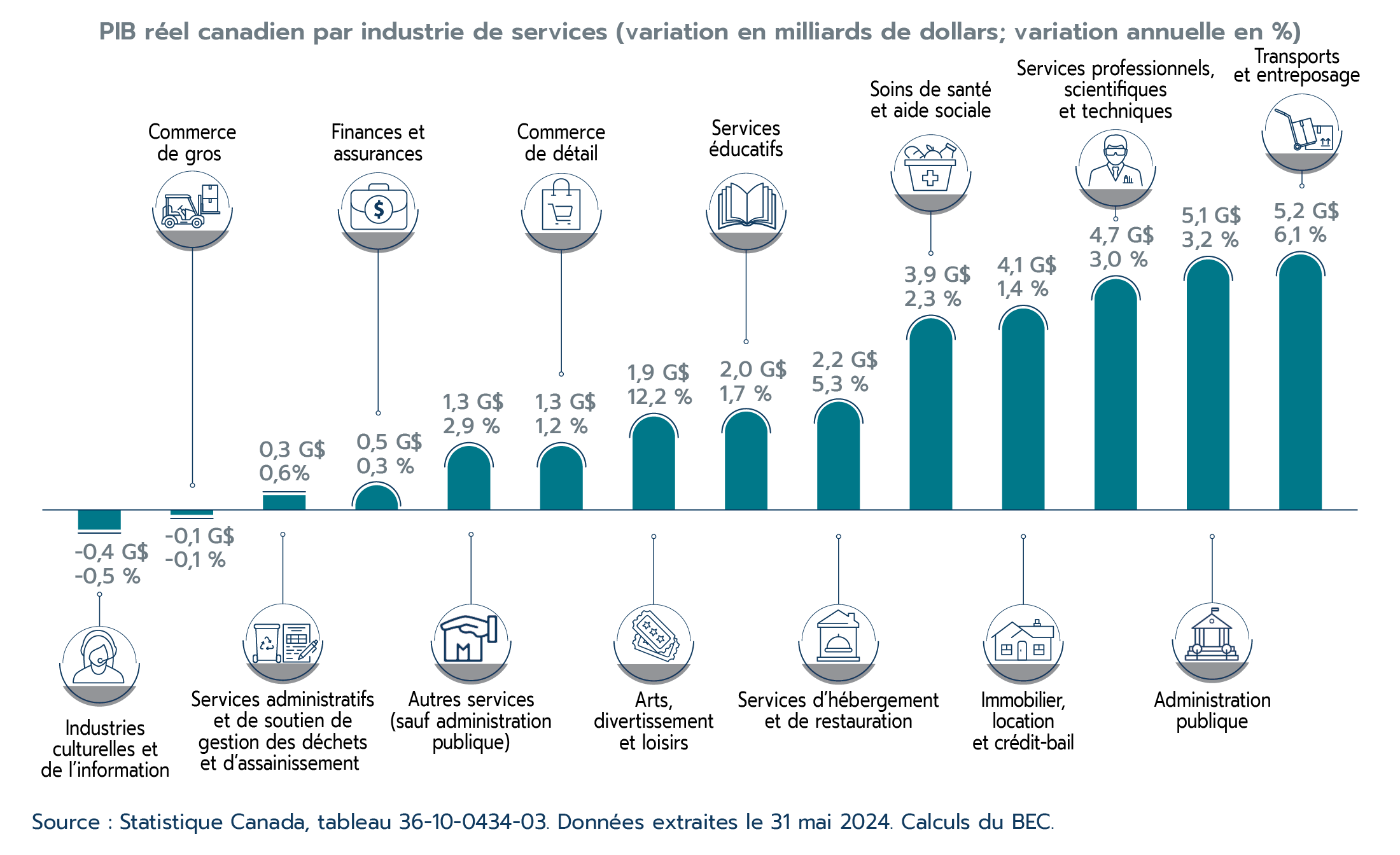
Version texte - Figure 1.9
| Industrie de services | Comparaison de 2022 et de 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison de 2022 et de 2023 (variation en %) |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0434-03. Données extraites le 31 mai 2023. Calculs du BEC. | ||
| Industrie de l’information et industrie culturelle | -0,4 | -0,5 % |
| Distribution en gros | -0,1 | -0,1 % |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement | 0,3 | 0,6 % |
| Finance et assurances | 0,5 | 0,3 % |
| Autres services (sauf l’administration publique) | 1,3 | 2,9 % |
| Distribution en détail | 1,3 | 1,2 % |
| Arts, spectacles et loisirs | 1,9 | 12,2 % |
| Services éducatifs | 2,0 | 1,7 % |
| Services d’hébergement et de restauration | 2,2 | 5,3 % |
| Soins de santé et assistance sociale | 3,9 | 2,3 % |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 4,1 | 1,4 % |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 4,7 | 3,0 % |
| Administration publique | 5,1 | 3,2 % |
| Transport et entreposage | 5,2 | 6,1 % |
Performance du marché du travail
Après une année record, les tensions sur le marché du travail canadien se sont quelque peu atténuées en 2023. Le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 5,3 % en 2022 à 5,4 % en 2023. Toutefois, ce chiffre annuel masque la hausse observée au second semestre de 2023 et le taux de chômage a terminé 2023 à 5,8% en décembre. La participation à la population active (c’est-à-dire le nombre de personnes en âge de travailler qui travaillent ou cherchent un emploi) est restée pratiquement inchangée, et environ 475 000 emplois ont été créés dans l’économie en 2023, la plupart étant des postes à temps plein. Enfin, après avoir atteint des niveaux record en 2022, les offres d’emploi (c’est-à-dire la demande de main-d’œuvre non satisfaite) ont diminué de manière significative en 2023. Dans l’ensemble, le marché du travail canadien semble plus équilibré en 2023, et les craintes d’un chômage généralisé ne se sont pas concrétisées.
Perspectives d’avenir
L’économie canadienne devrait connaître une nouvelle année de faible croissance en 2024, les taux d’intérêt élevés continuant à peser sur les dépenses et les investissements. Le ralentissement prévu de la croissance des salaires devrait renforcer la baisse de la consommation par habitant. Une nouvelle année de croissance mondiale lente devrait également atténuer la performance du Canada en matière d’exportation. Compte tenu de l’affaiblissement de la demande, la Banque du Canada s’attend à ce que les marchés du travail continuent à se détendre et à ce que l’inflation termine l’année à environ 2,2 % (quatrième trimestre). Toutefois, plusieurs facteurs pourraient conduire à une inflation plus élevée que prévu, notamment une aggravation du conflit au Moyen-Orient, la persistance d’une croissance élevée des salaires ou une croissance plus forte que prévu des prix internes. En revanche, si la performance économique mondiale ou canadienne est moins bonne que prévu, l’inflation pourrait diminuer plus rapidement que prévu. Sauf surprise, l’économie canadienne devrait se redresser au second semestre de 2024.
1.4 Faits marquants de la performance du Canada en matière de commerce international
Malgré une nouvelle année de faible croissance mondiale ainsi qu’une contraction des prix mondiaux des matières premières, le commerce international du Canada a de nouveau enregistré de nouveaux records en 2023, bien que la croissance ait été plus faible qu’en 2022. Les exportations en matière de biens et services ont progressé de 1,4 % pour atteindre 965,1 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 978,2 milliards de dollars. Le Canada a enregistré un léger déficit commercial de 13,1 milliards de dollars en 2023. De plus, le ratio du commerce au PIB a légèrement baissé à 67,2 %.
La vigueur des secteurs des véhicules à moteur et pièces ainsi que des services de voyage, en pleine reprise, a stimulé la croissance du commerce international du Canada tout au long de l’année 2023. La présente section décrit les tendances annuelles du commerce des biens et services sur la base de la balance des paiements. Se reporter au Bureau de l’économiste en chef (2024) pour un examen du commerce des biens du Canada en 2023 sur une base douanière.
Figure 1.10 : Le commerce des biens et services du Canada s’accroît d’une année supplémentaire en 2023
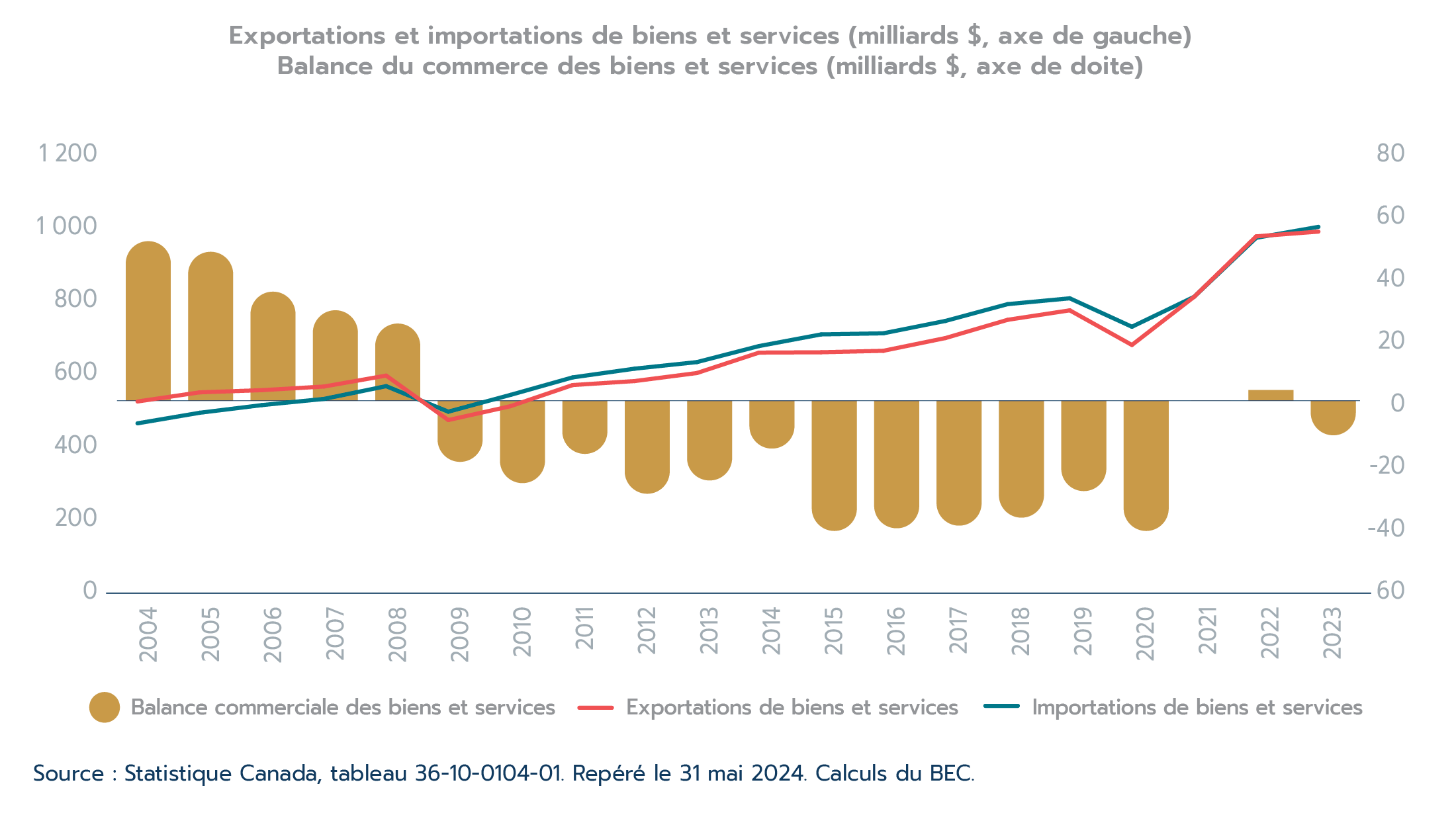
Version texte - Figure 1.10
| Année | Exportations de biens et services | Importations de biens et services | Balance commerciale des biens et services |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0104-01. Repéré le 31 mai 2024. Calculs du BEC. | |||
| 2004 | 499 | 439 | 60 |
| 2005 | 524 | 468 | 56 |
| 2006 | 530 | 489 | 41 |
| 2007 | 540 | 506 | 34 |
| 2008 | 570 | 541 | 29 |
| 2009 | 448 | 471 | -23 |
| 2010 | 486 | 517 | -31 |
| 2011 | 544 | 565 | -20 |
| 2012 | 555 | 589 | -35 |
| 2013 | 577 | 607 | -30 |
| 2014 | 633 | 651 | -18 |
| 2015 | 634 | 683 | -49 |
| 2016 | 638 | 686 | -48 |
| 2017 | 673 | 720 | -47 |
| 2018 | 723 | 766 | -44 |
| 2019 | 749 | 782 | -34 |
| 2020 | 654 | 704 | -49 |
| 2021 | 786 | 786 | 0 |
| 2022 | 952 | 948 | 4 |
| 2023 | 965 | 978 | -13 |
Commerce des biens
Le commerce de véhicules à moteur et pièces a stimulé la croissance, tandis que le commerce des ressources naturelles a quant à lui chuté
Alors que les exportations des biens et de services ont augmenté ensemble, les exportations de biens du Canada ont diminué de 10,9 milliards de dollars (soit 1,4 %) en 2023, en raison d’une contraction de 9,9 % des exportations en matière de ressources. Les exportations de produits énergétiques ont mené cette contraction, diminuant de 40,9 milliards de dollars (-19,1 %). Après avoir connu un pic en 2022, en partie en raison du déclenchement de la guerre en Europe, le prix du baril de brut a diminué de 100,9 USD en 2022 à 82,5 USD en 2023 (prix mondial du pétrole brut Brent). Le prix du Western Canada Select (WCS), que reçoivent la plupart des producteurs canadiens, s’est également contracté en même temps que le prix du gaz naturel. Les prix des exportations d’énergie du Canada se sont généralement contractés de 20,9 % en 2023. Cependant, en termes de volume, les exportations d’énergie ont augmenté de 2,2 %. En outre, malgré la forte contraction, la valeur des exportations d’énergie était encore la deuxième plus élevée jamais enregistrée en 2023.
Les exportations de produits autres que les ressources ont en partie compensé la contraction des ressources, augmentant de 36,9 milliards de dollars (13,8 %) en 2023. Soutenues par la poursuite de l’amélioration des chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que par une demande comprimée, les exportations de véhicules à moteur et pièces ont tiré la croissance (+26,1 %) [tableau 1.1]. Les exportations d’aéronefs et autres matériels de transport et pièces (+25,5 %) ainsi que de machines et matériels industriels et pièces (+12,1 %) ont également affiché une forte croissance. À l’inverse de la tendance observée pour les ressources, les exportations de produits de la ferme et de la pêche et aliments intermédiaires (+6,5 %) et de produits minéraux métalliques et non métalliques (+6,2 %) ont progressé, bien qu’à un rythme plus lent qu’en 2022. La croissance des produits de l’agriculture, de la pêche et des aliments intermédiaires s’est ralentie, en partie à cause de l’amélioration de l’offre mondiale de blé et de canola qui a entraîné une baisse des prix. Par ailleurs, les produits forestiers et matériaux de construction et d’emballage (-16,3 %), les minerais métalliques et minéraux non métalliques (-14,8 %), ainsi que les produits chimiques de base et industriels, plastiques et caoutchouc (-5,6 %) ont tous contribué à la contraction des ressources.
Les importations de biens ont augmenté de 1,4 % en 2023, la croissance des produits hors ressources (+6,0 %) compensant notamment la contraction des importations de ressources (-6,6 %). Les importations n’ont augmenté que dans cinq des onze principales catégories de produits. Les fortes augmentations des importations de véhicules à moteur et pièces (19,6 %), d’aéronefs et autres matériels de transport et pièces (11,3 %), et de machines et matériels industriels et pièces (8,5 %) ont été à l’origine de la croissance. Parallèlement, les importations de produits de consommation (-3,3 %) ont diminué, les consommateurs au Canada ayant ralenti leurs dépenses. Les produits énergétiques (-14,7 %) ont également été à l’origine de la contraction des importations de ressources, les prix à l’importation ayant diminué alors que les volumes ont continué à augmenter. À l’exception des produits de la ferme et de la pêche et aliments intermédiaires (+0,5 %), les importations ont diminué dans tous les secteurs de ressources.
Tableau 1.1 : Valeur du commerce des biens du Canada par secteur de produits
| 2023 (en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (% de variation) | |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0020-01. Repéré le 30 mai 2024. Calculs du BEC. | |||
| Exportations de biens | |||
| Produits de la ferme et de la pêche et aliments intermédiaires | 61,1 | 3,7 | 6,5% |
| Produits énergétiques | 173,7 | -40,9 | -19,1% |
| Minerais métalliques et minéraux non métalliques | 29,3 | -5,1 | -14,8% |
| Produits métalliques et de minéraux non métalliques | 90,9 | 5,3 | 6,2% |
| Produits chimiques de base et industriels, plastiques et caoutchouc | 42,5 | -2,5 | -5,6% |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d’emballage | 46,8 | -9,1 | -16,3% |
| Machines et matériels industriels et pièces | 51,4 | 5,6 | 12,1% |
| Matériels électroniques et électriques et pièces | 33,2 | 2,6 | 8,4% |
| Véhicules à moteur et pièces | 102,0 | 21,1 | 26,1% |
| Aéronefs et autres matériel de transport et pièces | 30,5 | 6,2 | 25,5% |
| Biens de consommation | 86,0 | 1,4 | 1,7% |
| Total de exportations de biens | 768,3 | -10,9 | -1,4% |
| Importations de biens | |||
| Produits de la ferme et de la pêche et aliments intermédiaires | 28,5 | 0,2 | 0,5% |
| Produits énergétiques | 43,8 | -7,6 | -14,7% |
| Minerais métalliques et minéraux non métalliques | 18,7 | -0,4 | -2,1% |
| Produits métalliques et de minéraux non métalliques | 64,0 | -1,0 | -1,5% |
| Produits chimiques de base et industriels, plastiques et caoutchouc | 59,7 | -7,0 | -10,4% |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d’emballage | 33,5 | -1,7 | -4,9% |
| Machines et matériels industriels et pièces | 90,0 | 7,1 | 8,5% |
| Matériels électroniques et électriques et pièces | 85,9 | 0,3 | 0,4% |
| Véhicules à moteur et pièces | 141,8 | 23,2 | 19,6% |
| Aéronefs et autre matériels de transport et pièces | 26,3 | 2,7 | 11,3% |
| Biens de consommation | 150,1 | -5,1 | -3,3% |
| Total de tmportations de biens | 770,2 | 10,7 | 1,4% |
Le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis ont tiré vers le bas les exportations de biens du Canada, tandis que les importations de biens en provenance des États-Unis ont quant à elles tiré la croissance
Les exportations totales de biens du Canada ont diminué de 1,4 %, passant à 768,3 milliards de dollars en 2023 (tableau 1.2). Les exportations vers le Royaume-Uni (-4,8 milliards de dollars) ont été le principal facteur de la baisse générale des exportations de biens en 2023. Malgré la forte croissance économique américaine, les exportations de biens vers les États-Unis (-2,1 milliards de dollars) se sont contractées en 2023, et ce, sous l’effet d’une baisse des exportations d’énergie. Hormis le secteur de l’énergie, les exportations de biens vers les États-Unis ont augmenté sur une base douanière en 2023. Les exportations vers le Japon (-2,3 milliards de dollars) ont également enregistré une contraction à la fois substantielle et généralisée. Soutenues par la réouverture de son économie, les exportations de biens vers la Chine (+1,8 milliard de dollars) affichent la plus forte hausse parmi tous les partenaires d’exportation du Canada pour 2023. Cette évolution s’explique en grande partie par une augmentation importante des exportations d’oléagineux, qui ont dépassé les niveaux de 2018 pour atteindre un record historique en 2023. Les exportations vers Hong Kong (+1,5 milliard de dollars) et les Pays-Bas (+1,0 milliard de dollars) ont également contribué à modérer la contraction générale des exportations de biens.
Les importations de biens du Canada en provenance de tous les pays ont augmenté de 10,7 milliards de dollars en 2023, soit une progression nettement moins importante que celle de 125,2 milliards de dollars enregistrée pour 2022. Les États-Unis (+10,8 milliards de dollars; principalement des machines, des véhicules à moteur et des machines électriques) et l’UE (+5,6 milliards de dollars; principalement des machines et des véhicules à moteur) ont quant à eux tiré la croissance. Les importations en provenance du Mexique (+4,4 milliards de dollars) et du Japon (+3,2 milliards de dollars) ont également connu une forte croissance. Dans le même temps, les importations en provenance de Chine (-9,4 milliards de dollars; tirées par plusieurs biens) se sont grandement contractées, en raison d’un ralentissement de la demande des consommateurs.
Tableau 1.2 : Commerce des biens du Canada avec les 10 principaux partenaires commerciaux
| Partenaires | 2023 (en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (% de variation) |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0023-01. Repéré le 30 mai 2023. Calculs du BEC. | |||
| Exportations de biens | |||
| États-Unis | 592,8 | -2,1 | -0,4% |
| Chine | 31,0 | 1,8 | 6,0% |
| Japon | 16,0 | -2,3 | -12,4% |
| Royaume-Uni | 15,2 | -4,8 | -23,9% |
| Mexique | 9,6 | -0,3 | -3,3% |
| Pays-Bas | 7,6 | 1,0 | 14,5% |
| Allemagne | 7,1 | -0,5 | -7,0% |
| Corée du Sud | 7,1 | -1,8 | -20,0% |
| Inde | 5,2 | -0,2 | -3,7% |
| Hong Kong | 4,9 | 1,5 | 44,0% |
| Tous les autres pays | 72,0 | -3,1 | -4,2% |
| Total de exportations de biens | 768,3 | -10,9 | -1,4% |
| Importations de biens | |||
| États-Unis | 484,0 | 10,8 | 2,3% |
| Chine | 60,2 | -9,4 | -13,6% |
| Mexique | 28,7 | 4,4 | 18,0% |
| Allemagne | 21,2 | 2,5 | 13,2% |
| Japon | 15,2 | 3,2 | 27,0% |
| Corée du Sud | 11,5 | 0,6 | 5,4% |
| Royaume-Uni | 10,9 | 1,0 | 9,8% |
| Italie | 9,8 | 0,8 | 9,3% |
| Suisse | 8,1 | 0,3 | 4,0% |
| Brésil | 8,0 | 0,5 | 7,0% |
| Tous les autres pays | 112,7 | -3,9 | -3,4% |
| Total de importations de biens | 770,2 | 10,7 | 1,4% |
Commerce de services
Les services de voyage stimulent la croissance du commerce, dépassant les niveaux de 2019, et ce, pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19
Une nouvelle année de forte croissance des exportations de services du Canada (+13,8 %) a compensé la contraction des exportations de biens, de sorte que les exportations de biens et de services ont encore progressé dans l’ensemble en 2023. Les exportations de services ont augmenté dans les quatre grandes catégories, tirées par la croissance des services de voyage, pour atteindre 196,8 milliards de dollars en 2023 (tableau 1.3). Après une lente reprise, les exportations de services de voyage ont finalement dépassé leurs niveaux de 2019 (figure 1.11), enregistrant une forte croissance de 42,2 % pour atteindre 51,9 milliards de dollars. Les services de voyage ont représenté près de 65 % de la croissance des exportations de services en 2023. L’augmentation de 51,8 % du nombre de voyageurs entrant au Canada en 2023 reflète cette tendance; les voyageurs en provenance des États-Unis et des pays autres que les États-Unis ont augmenté dans des proportions semblables. Néanmoins, quelque 5,2 millions de voyageurs en moins ont visité le Canada en 2023 par rapport à 2019. L’augmentation des dépenses des visiteurs étrangers et des étudiants étrangers a également soutenu le secteur des services de voyage.
Figure 1.11 : Le commerce de services de voyage dépasse les niveaux d’avant la pandémie pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19
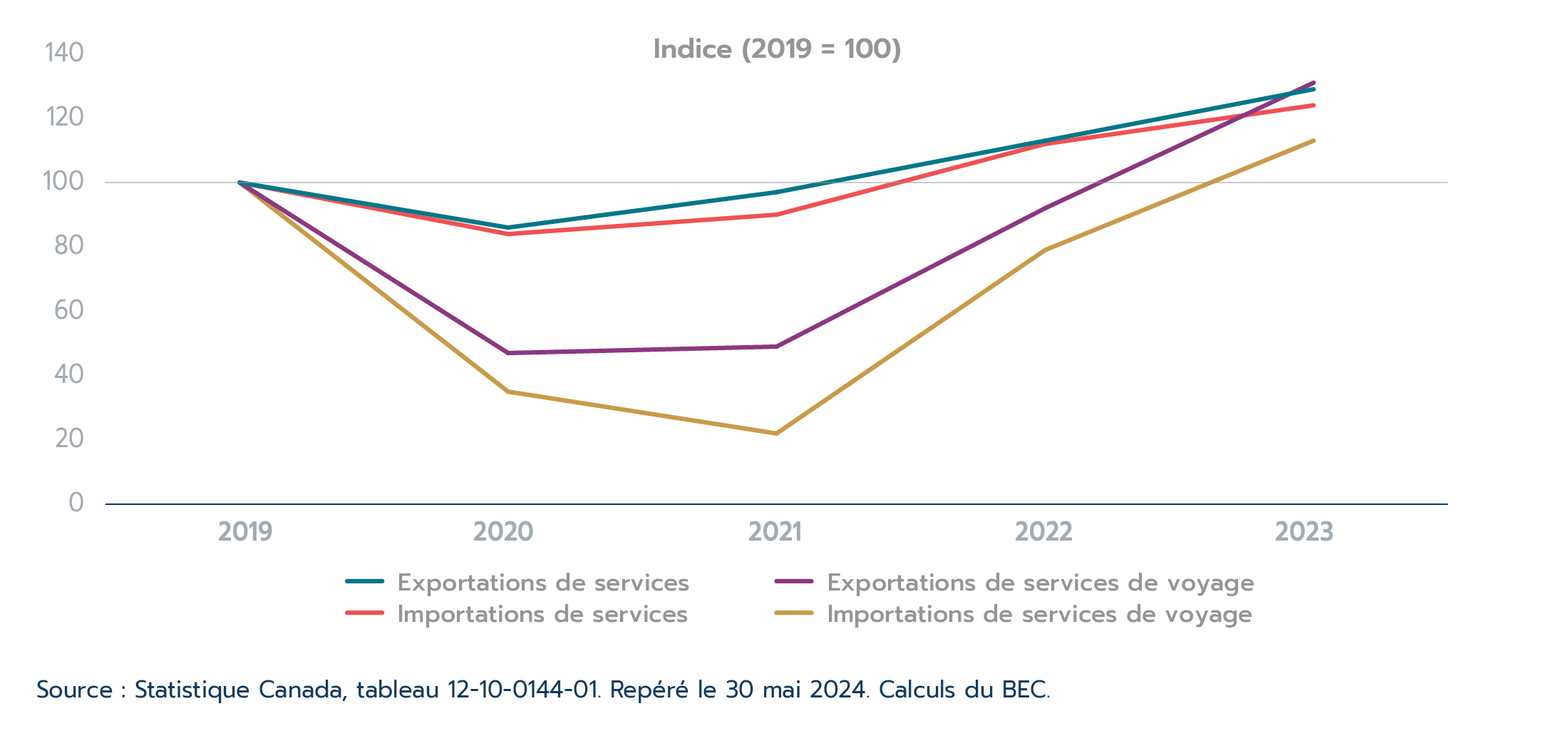
Version texte - Figure 1.11
| Indice (2019 = 100) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 12-10-0144-01. Repéré le 31 mai 2024. Calculs du BEC. | |||||
| Exportations de services | 100 | 86 | 97 | 113 | 129 |
| Exportations de services de voyage | 100 | 47 | 49 | 92 | 131 |
| Importations de services | 100 | 84 | 90 | 112 | 124 |
| Importations de services de voyage | 100 | 35 | 22 | 79 | 113 |
Les exportations de services commerciaux (+6,5 %) ont continué à progresser en 2023, soutenues notamment par les exportations de services numériques aux entreprises. Les exportations vers les États-Unis (+5,4 milliards de dollars) et l’UE (+1,2 milliard de dollars) ont représenté 88,0 % de la hausse générale des exportations de services commerciaux. Les exportations de services de transport (+4,3 %), qui, comme les services de voyage, ont également été affectées par les restrictions physiques mises en œuvre au cours de la pandémie de COVID-19, ont continué d’augmenter. Toutefois, les exportations de services de transport avaient déjà dépassé leur niveau d’avant la pandémie de COVID-19 en 2022. Enfin, les exportations de services gouvernementaux, qui représentent moins de 1 % des exportations de services, augmentent de 4,3 % en 2023, mais restent toutefois en dessous des niveaux prépandémiques.
Tableau 1.3 : Commerce des services du Canada par secteur
| Service | 2023 (en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (% de variation) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 12-10-0144-01. Repéré le 30 mai 2023. Calculs du BEC. | |||||
| Exportations de services | |||||
| Services commerciaux | 123,4 | 7,5 | 6,5% | ||
| Services de voyage | 51,9 | 15,4 | 42,2% | ||
| Services de transport | 19,7 | 0,8 | 4,3% | ||
| Services gouvernementaux | 1,8 | 0,1 | 4,3% | ||
| Total des exportations de services | 196,8 | 23,8 | 13,8% | ||
| Importations de services | |||||
| Services commerciaux | 118,7 | 4,9 | 4,3% | ||
| Services de voyage | 52,8 | 15,5 | 41,6% | ||
| Services de transport | 34,7 | -1,4 | -4,0% | ||
| Services gouvernementaux | 1,9 | 0,1 | 5,4% | ||
| Total des importations de services | 208,0 | 19,1 | 10,1% | ||
Les importations de services ont connu une croissance plus faible que les exportations en 2023, mais ont tout de même augmenté de 10,1 % pour atteindre 208,0 milliards de dollars pour l’année (tableau 1.3). Les importations de services ont augmenté dans toutes les catégories, à l’exception des services de transport. Comme pour les exportations, les importations de services de voyage (+41,6 %) ont largement dépassé la croissance générale des importations. En progression de 15,5 milliards de dollars, les services de voyage ont constitué le plus grand contributeur à la croissance des importations en 2023. Le nombre de Canadiens voyageant vers les États-Unis (+50,4 %) ainsi que vers des destinations autres que les États-Unis (+39,9 %) a augmenté de manière importante en 2023. Néanmoins, moins de Canadiens ont voyagé à l’étranger en 2023 qu’en 2019. Les dépenses des Canadiens à l’étranger, en grande partie dans des destinations autres que les États-Unis, ont constitué le principal facteur de la croissance des importations de services de voyage. Dans l’ensemble, les importations de services de voyage ont terminé l’année 2023 à 12,5 % soit un niveau supérieur à celui de 2019, bien que le nombre de Canadiens voyageant à l’étranger demeure faible.
Les importations de services commerciaux, le deuxième facteur de croissance, ont augmenté de 4,3 % en 2023. Les importations de services commerciaux en provenance des États-Unis (+2,7 milliards de dollars) ont constitué le principal facteur de croissance, bien qu’elles aient augmenté à un rythme légèrement plus lent (+3,5 %) que l’ensemble des importations de services commerciaux. Parallèlement, les importations de services commerciaux en provenance de l’UE (+1,5 milliard de dollars) ont affiché une croissance supérieure à la moyenne (+11,6 %) et ont constitué le deuxième contributeur le plus important aux importations de services commerciaux en 2023. Les importations de services gouvernementaux (+5,4 %) ont également augmenté. Cependant, les importations de services de transport ont diminué de 4,0 %, en partie en raison de la baisse des paiements liés aux services de transport maritime pour les biens entrant au Canada.
La croissance des exportations de services a été robuste pour tous les principaux partenaires commerciaux du Canada, tandis qu’une contraction des importations de services en provenance de plusieurs économies asiatiques a partiellement compensé les gains enregistrés ailleurs
Les exportations de services du Canada ont augmenté de 23,8 milliards de dollars en 2023, les exportations de services vers les États-Unis (+11,4 milliards de dollars) représentant près de la moitié de cette augmentation, bien qu’elles aient affiché une croissance plus lente que l’ensemble des exportations de services (tableau 1.4). L’Inde (+20,0 %) occupe le deuxième rang des exportations canadiennes de services pour la deuxième année consécutive, les exportations vers ce pays augmentant de 1,7 milliard de dollars en 2023. Les exportations de services vers tous les autres grands partenaires commerciaux ont également augmenté, et parmi eux le Mexique (+50,4 %), l’Australie (+36,6 %) et la France (+22,1 %) affichant tous une croissance nettement supérieure à la moyenne.
Les importations de services ont augmenté de 19,1 milliards de dollars en 2023, les États-Unis (+11,8 milliards de dollars) représentant quant à eux plus de 60 % de cette augmentation. Après les États-Unis, les importations de services en provenance du Mexique
(+1,4 milliard de dollars) et de l’Allemagne (+0,7 milliard de dollars) contribuent le plus à la croissance en 2023. Les importations en provenance du Japon (+25,6 %) ont augmenté à un rythme nettement supérieur à la moyenne, mais sont toutefois restées inférieures à leur niveau de 2019. Les importations de services pour plusieurs des autres principaux partenaires commerciaux du Canada en Asie se sont contractées ou encore ont affiché une faible croissance. Les importations en provenance de Hong Kong, troisième source d’importations de services, ont quant à elles diminué de 1,2 milliard de dollars. Les importations de services en provenance de Chine (0,2 milliard de dollars) ont légèrement augmenté et les importations de Singapour (-0,4 milliard de dollars) ont diminué.
Tableau 1.4 : Commerce des services du Canada avec les 10 principaux partenaires commerciaux
| Partenaires | 2023 (en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (variation en milliards de dollars) | Comparaison entre 2022 et 2023 (% de variation) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 12-10-0157-01. Repéré le 30 mai 2024. Calculs du BEC. | |||||
| Exportations de services | |||||
| États-Unis | 104,6 | 11,4 | 12,3% | ||
| Inde | 10,1 | 1,7 | 20,0% | ||
| Royaume-Uni | 8,9 | 0,8 | 9,9% | ||
| Chine | 7,3 | 1,1 | 17,6% | ||
| France | 5,5 | 1,0 | 22,1% | ||
| Allemagne | 4,0 | 0,6 | 15,8% | ||
| Mexique | 3,2 | 1,1 | 50,4% | ||
| Suisse | 2,9 | 0,2 | 7,5% | ||
| Australie | 2,7 | 0,7 | 36,6% | ||
| Hong Kong | 2,7 | 0,2 | 9,9% | ||
| Tous les autres pays | 44,8 | 5,0 | 12,5% | ||
| Total de exportations de services | 196,8 | 23,8 | 13,8% | ||
| Importations de services | |||||
| États-Unis | 122,9 | 11,8 | 10,6% | ||
| Royaume-Uni | 9,6 | -0,3 | -2,6% | ||
| Hong Kong | 5,2 | -1,2 | -18,3% | ||
| Mexique | 5,0 | 1,4 | 38,9% | ||
| Allemagne | 4,2 | 0,7 | 20,1% | ||
| France | 4,1 | 0,6 | 18,1% | ||
| Chine | 4,1 | 0,2 | 4,4% | ||
| Inde | 3,4 | 0,4 | 14,3% | ||
| Japon | 3,0 | 0,6 | 25,6% | ||
| Singapour | 2,8 | -0,4 | -11,8% | ||
| Tous les autres pays | 43,7 | 5,1 | 13,2% | ||
| Total de importations de services | 208,0 | 19,1 | 10,1% | ||
Encadré 1.3 : La survie des exportations pour les exportateurs canadiens
Si l’on s’attache beaucoup à inciter les entreprises à exporter et à accroître les exportations en termes de valeur et de destinations, la survie des exportations – c’est-à-dire la longévité de l’activité d’exportation d’une entreprise – a quant à elle fait l’objet de moins d’attention. Elle est tout aussi importante, car sans la survie des exportations, une entreprise ne peut pas participer de manière cohérente aux marchés internationaux et peut avoir du mal à accroître ses exportations. Une étude du BEC (Tran, à paraître) a exploré la dynamique de survie des périodes d’exportation des entreprises canadiennes. Une période d’exportation constitue le nombre d’années consécutives pendant lesquelles une entreprise a exporté. Par exemple, si une entreprise a exporté chaque année entre 2005 et 2008, mais n’a pas exporté en 2009, ces années d’exportations consécutives seront estimées comme une période d’exportation de trois ans. Si l’entreprise recommence à exporter en 2011, cela constitue le début d’une nouvelle période d’exportation. Malheureusement, les périodes d’exportation des exportateurs canadiens ne durent pas très longtemps : environ 40 % de ces périodes n’ont duré qu’un an. En outre, seuls environ 30 % des exportateurs canadiens exportent encore la cinquième année.
L’étude classe ensuite les entreprises qui exportent en trois types, et ce, en fonction de leur stratégie d’exportation :
- « Progressivement mondiales » : Il s’agit d’entreprises qui se concentrent d’abord sur le marché intérieur canadien, puis sur le marché de l’exportation.
- « Nées régionales » : Il s’agit d’entreprises qui exportent très tôt, mais dont les premières ventes à l’exportation sont destinées aux États-Unis, le partenaire commercial le plus proche du Canada. Plus tard dans leur parcours d’exportation, ces entreprises peuvent possiblement explorer d’autres destinations.
- « Nées mondiales » : Il s’agit d’entreprises qui exportent depuis leur plus jeune âge et qui, dès le début de leurs activités d’exportation, réalisent des ventes dans d’autres pays que les États-Unis.
Selon le modèle d’internationalisation traditionnel, une entreprise doit d’abord s’établir sur son marché national, puis accroît progressivement son engagement et ses ressources sur le marché international. Toutefois, contrairement à ce modèle traditionnel, Tran (à paraître) constate que les entreprises canadiennes de type « Nées mondiales » et « Nées régionales » ont généralement des valeurs d’exportation plus élevées et exportent davantage de produits. En outre, les périodes d’exportation des entreprises « Nées mondiales » ont duré plus longtemps que les périodes d’exportation des entreprises « Nées régionales », qui ont à leur tour survécu plus longtemps que les entreprises « Progressivement mondiales ». Cependant, une fois que d’autres facteurs de contrôle sont inclus dans le modèle (comme la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la valeur des exportations, le nombre de produits exportés, le nombre de destinations d’exportation, etc.), ce sont les périodes d’exportation des entreprises « Nées régionales » qui présentent le taux de survie le plus élevé au cours des premières années
(voir figure 1.12). Les résultats révèlent que, contrairement aux conseils du modèle d’internationalisation traditionnel, selon lequel les entreprises doivent d’abord se concentrer sur le marché intérieur avant d’exporter, les jeunes entreprises canadiennes qui se concentrent sur l’exportation dès le début peuvent mieux survivre sur les marchés d’exportation, et ce, si l’accent est mis sur les États-Unis au début de l’exportation.
La diversification des échanges, tant du point de vue des nouveaux exportateurs que de celui des destinations, constitue un objectif politique important du Canada. Bien que cette étude semble s’opposer à l’objectif de diversification commerciale, puisque les résultats révèlent que les jeunes entreprises qui se concentrent sur l’exportation vers les États-Unis ont un taux de survie plus élevé sur le marché de l’exportation, la diversification commerciale au moyen des États-Unis représente une possibilité. Le BEC constate qu’environ 20 % des exportateurs vers les États-Unis finissent par exporter vers d’autres marchés. On peut donc encourager ces jeunes entreprises, dont le taux de survie à l’exportation est plus élevé aux États-Unis, à envisager à se diversifier sur de nouveaux marchés.
Figure 1.12 : Les jeunes entreprises qui se concentrent très tôt sur le marché américain obtiennent un taux de survie à l’exportation plus élevé
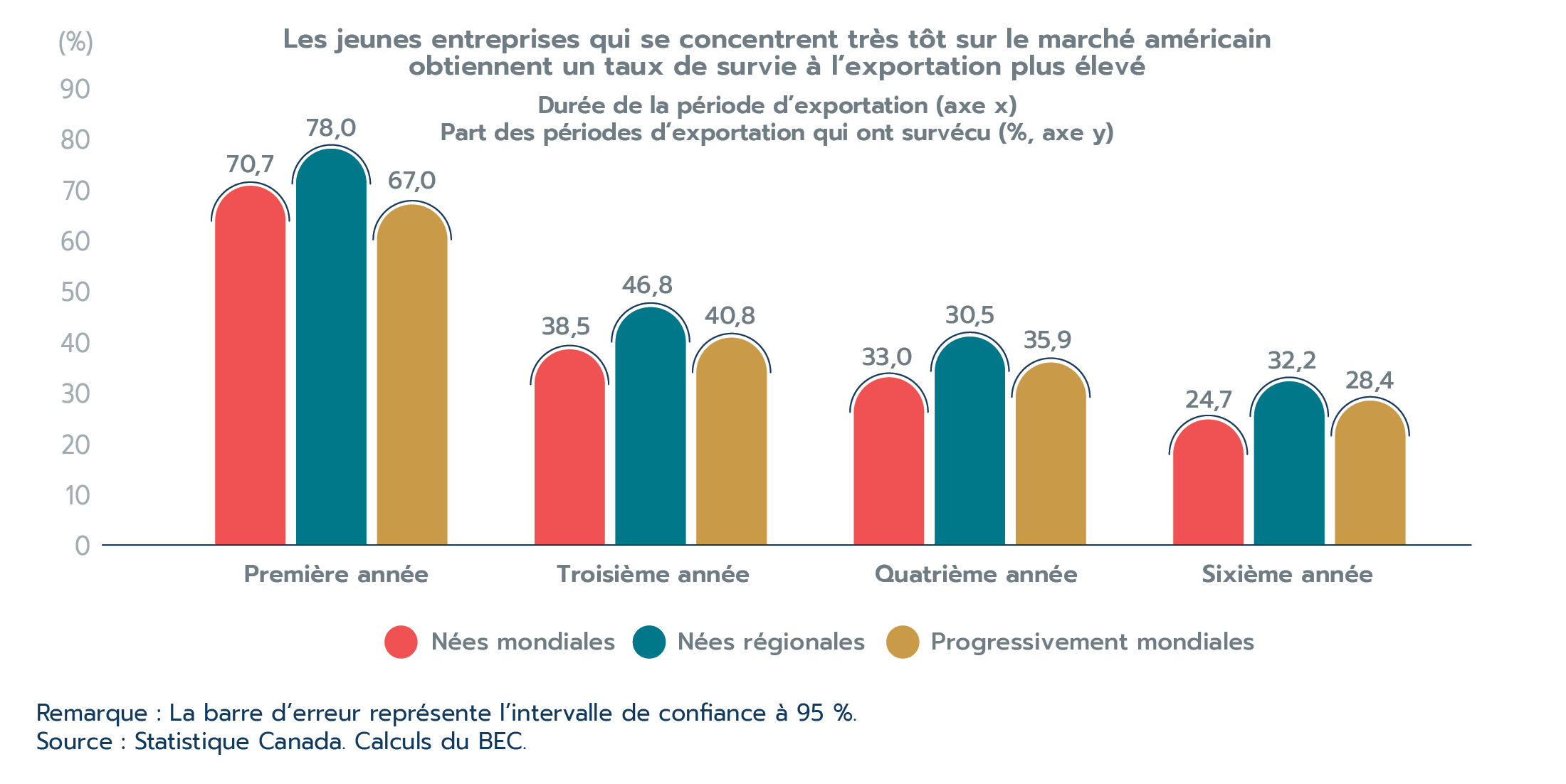
Version texte - Figure 1.12
| Durée de la période d’exportation | Nées mondiales | Nées régionales | Progressivement mondiales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation | Minimum | Maximum | Estimation | Minimum | Maximum | Estimation | Minimum | Maximum | |
| Remarque : La barre d’erreur représente l’intervalle de confiance à 95 %. L’estimation représente le taux de survie prédit, le minimum est la valeur inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % et le maximum est la valeur supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Source : Statistique Canada. Calculs du BEC. | |||||||||
| Première année | 70,7 | 68,0 | 73,1 | 78,0 | 76,0 | 79,9 | 67,0 | 65,0 | 69,0 |
| Troisième année | 38,5 | 35,3 | 41,6 | 46,8 | 43,5 | 49,9 | 40,8 | 38,1 | 43,4 |
| Quatrième année | 33,0 | 23,3 | 43,0 | 41,0 | 30,5 | 51,2 | 35,9 | 27,2 | 44,7 |
| Sixième année | 24,7 | 8,1 | 46,0 | 32,2 | 12,4 | 54,0 | 28,4 | 11,7 | 47,7 |
1.5 La performance du Canada au chapitre de l’investissement direct étranger
En 2023, les flux d’investissements directs étrangers du Canada ont renoué avec la croissance, après une légère baisse enregistrée en 2022. Plus précisément, après avoir connu une diminution de 17,8 % en 2022, les flux d’investissements directs canadiens à l’étranger (IDCE) ont augmenté de 1,8 % pour atteindre 110,0 milliards de dollars en 2023, tandis que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) au Canada ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 62,3 milliards de dollars. Comme pour 2022, leur niveau de 2023 est supérieur à leur moyenne décennale respective (87,9 milliards de dollars pour l’IDCE et 55,6 milliards de dollars pour les flux d’IDE), mais inférieur à leur niveau de 2021 (131,5 milliards de dollars pour l’IDCE, un record historique, et 75,7 milliards de dollars pour les flux d’IDE, un deuxième record historique).
L’augmentation des flux d’IDCE en 2023 (1,9 milliards de dollars) est principalement attribuable aux fusions-acquisitions, qui ont bondi de 115,3 % (31,4 milliards de dollars). Les bénéfices réinvestis ont baissé légèrement de 0,4 % (245,0 millions de dollars). Alors que la hausse des fusions-acquisitions en 2023 constitue la deuxième plus importante depuis 2007 (après 241,1 % en 2021), les bénéfices réinvestis représentent une valeur plus importante (67,7 milliards de dollars) dans les flux totaux d’IDCE, par rapport aux fusions-acquisitions (58,6 milliards de dollars). Les autres flux ont réduit le montant des flux totaux d’IDCE de 29,2 milliards de dollars (-266,3 %) par rapport à 2022.
La hausse de 3,7 % (2,2 milliards de dollars) des flux d’IDE est principalement attribuable à l’augmentation observée dans la catégorie « autres flux », qui a rebondi après une baisse historique en 2022 (-21,0 milliards de dollars) pour atteindre 12,6 milliards de dollars. En particulier, les bénéfices réinvestis en 2023 ont réduit les flux d’IDE de 13,7 milliards de dollars.
Comme l’illustre la figure 1.13, les flux d’IDCE ont dépassé les flux d’IDE en 2023, poursuivant ainsi la tendance observée depuis 2014.
Figure 1.13 : Flux d’investissements directs étrangers au Canada (en milliards de dollars)
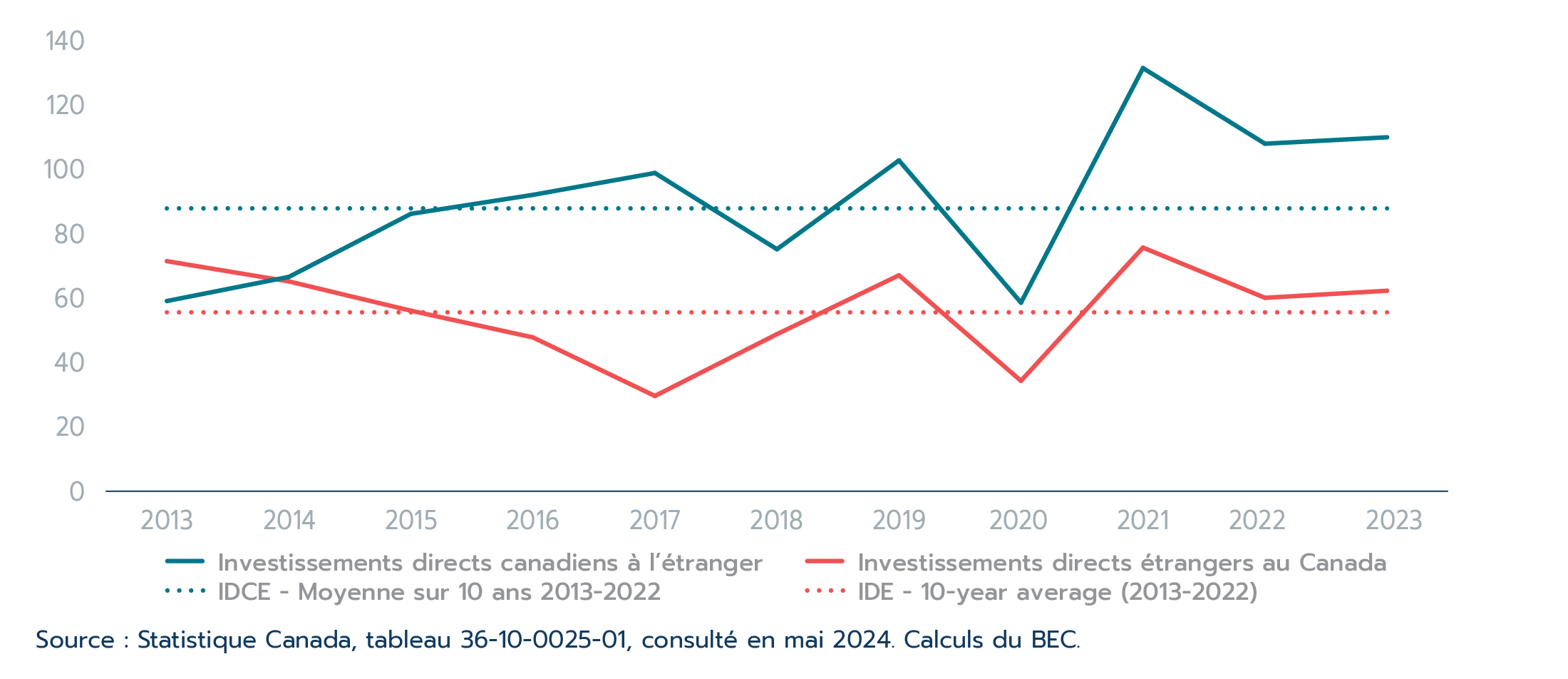
Version texte - Figure 1.13
| Année | Investissements directs canadiens à l’étranger (en milliards de dollars) | Investissements directs étrangers au Canada (en milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0025-01, consulté en mai 2024. Calculs du BEC. | ||
| 2013 | 59,1 | 71,5 |
| 2014 | 66,6 | 65,2 |
| 2015 | 86,2 | 56,1 |
| 2016 | 92,1 | 47,8 |
| 2017 | 98,9 | 29,6 |
| 2018 | 75,2 | 48,8 |
| 2019 | 102,8 | 67,1 |
| 2020 | 58,6 | 34,3 |
| 2021 | 131,5 | 75,7 |
| 2022 | 108,0 | 60,1 |
| 2023 | 110,0 | 62,3 |
| Moyenne sur 10 ans 2013-2022 | 87,9 | 55,6 |
Composition sectorielle
En ce qui concerne les secteurs, le secteur des finances et assurances représente la part la plus importante des flux d’IDCE en 2023, avec 45,9 % (50,5 milliards de dollars), suivi de la gestion de sociétés et d’entreprises (20,3 %), puis de l’énergie et de l’extraction minière (11,9 %). Les flux d’IDCE dans le secteur des finances et assurances ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 50,0 milliards de dollars en 2023, le plus haut niveau atteint depuis le record de 54,3 milliards de dollars établi en 2015.
En 2023, l’IDCE a augmenté de 1,9 milliards de dollars par rapport à 2022 (de 108,0 milliards de dollars à 110,0 milliards de dollars). Cette augmentation est principalement attribuée au secteur des finances et assurances (+3,5 milliards de dollars) et, dans une moindre mesure, l’industrie manufacturière (+2,7 milliards de dollars). En particulier, les flux peuvent parfois être négatifs, comme dans les cas suivants : i) cessions et rapatriement des bénéfices lorsque l’argent retourne à la société mère étrangère; ii) société affiliée accordant un prêt à sa société mère; ou iii) société affiliée remboursant un prêt qu’elle a obtenu de sa société mère. Parfois, la valeur totale des transactions négatives de certaines filiales peut l’emporter sur la valeur totale des transactions positives d’autres filiales étrangères, ce qui se traduit aussi par un résultat négatif pour les flux totaux de l’année en question.
En 2023, les flux d’IDE ont augmenté de 2,2 milliards de dollars par rapport à 2022 (soit de 60,1 milliards de dollars à 62,3 milliards de dollars). Les industries manufacturières et les autres industries ont contribué le plus à cette augmentation. D’une part, le secteur manufacturier canadien a enregistré une augmentation annuelle de 6,3 milliards de dollars pour atteindre 18,2 milliards de dollars en 2023, tandis que le secteur des autres industries a presque quadruplé, avec une augmentation annuelle de 12,0 milliards de dollars pour atteindre 16,1 milliards de dollars. (tableau 1.5).
Tableau 1.5 : Flux d’IDCE et d’IDE par secteur (2023)
| Secteur | Valeur (en milliards de dollars) | Variation par rapport à 2022 (G$) | Variation par rapport à 2022 (%) |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0026-01. Consulté en mai 2024. Calculs du BEC. | |||
| Investissements directs canadiens à l’étranger | |||
| Énergie et extraction minière | 13,1 | -8,9 | -40,5 % |
| Fabrication | 10,4 | 2,7 | 35,5 % |
| Commerce et transport | 1,6 | -1,8 | -52,9 % |
| Finances et assurances | 50,5 | 3,5 | 7,4 % |
| Gestion de sociétés et d’entreprises | 22,4 | 2,0 | 9,6 % |
| Autres secteurs | 12,1 | 4,5 | 58,4 |
| Tous les secteurs | 110,0 | 1,9 | 1,8 % |
| Investissements directs étrangers au Canada | |||
| Énergie et extraction minière | 7,7 | -5,8 | -43,0 % |
| Fabrication | 18,2 | 6,3 | 53,0 % |
| Commerce et transport | 8,7 | 0,5 | 6,5 % |
| Finances et assurances | 5,5 | -2,6 | -32,2 % |
| Gestion de sociétés et d’entreprises | 6,1 | -8,2 | -57,4 % |
| Autres secteurs | 16,1 | 12,0 | 298,0 % |
| Tous les secteurs | 62,3 | 2,2 | 3,7 % |
Composition géographique
Les États-Unis demeurent le principal pays bénéficiaire d’IDCE, recevant 62,8 % (69,1 milliards de dollars) des flux d’IDCE en 2023. Après avoir été le principal moteur de la baisse des flux totaux d’IDCE en 2022, les États-Unis ont mené l’augmentation d’IDCE avec une contribution de 19,9 milliards de dollars, ce qui représente leur troisième augmentation en importance depuis 2013.
Le Royaume-Uni représente la deuxième destination des flux d’IDCE en 2023, avec une part de 7,0 % du total. Fait notable, le Royaume-Uni a occupé ce rang au cours des 12 dernières années, à l’exception de 2020 (10e) et 2021 (8e). Les autres principaux bénéficiaires d’IDCE en 2023 sont Hong Kong (4,3 %), l’Australie (3,8 %) et le Mexique (3,5 %). Dans l’ensemble, le top 5 des pays de destination d’IDCE a représenté 81,5 % des flux totaux, soit une augmentation par rapport à 2021 (74,2) et à 2022 (66,6). Comparativement à 2022, seule la France a quitté le top 5 des destinations d’IDCE. En 2023, elle a été remplacée par Hong Kong.
Figure 1.14 : Parts du top 5 des pays dans le total des flux d’IDCE et d’IDE (2023)
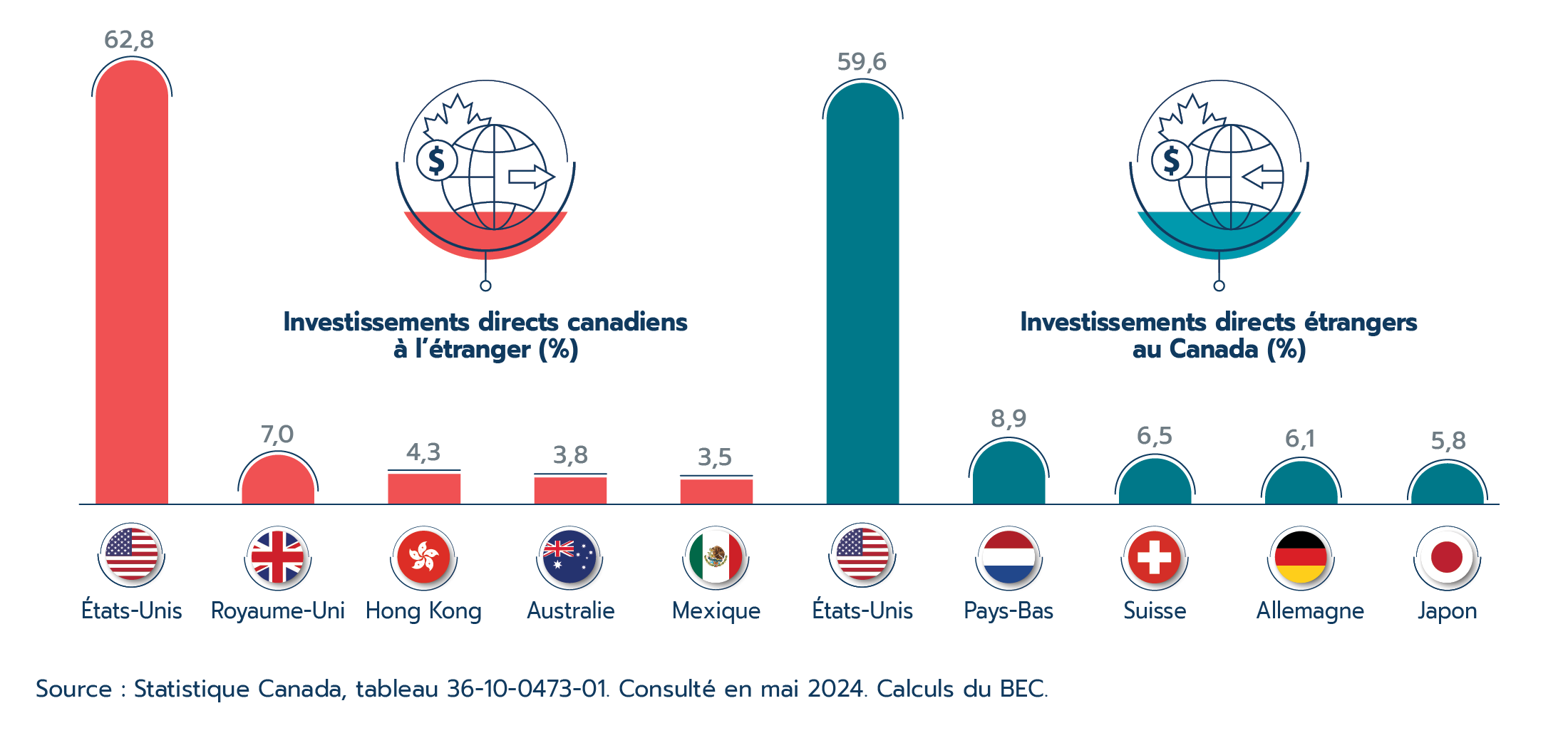
Version texte - Figure 1.14
| Pays | % |
|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0473-01. Consulté en mai 2024. Calculs du BEC. | |
| Investissements directs canadiens à l’étranger | |
| États-Unis | 62,8 % |
| Royaume-Uni | 7,0 % |
| Hong Kong | 4,3 % |
| Australie | 3,8 % |
| Mexique | 3,5 % |
| Investissements directs étrangers au Canada | |
| États-Unis | 59,6 % |
| Pays-Bas | 8,9 % |
| Suisse | 6,5 % |
| Allemagne | 6,1 % |
| Japon | 5,8 % |
De même, les États-Unis ont demeuré le premier investisseur au Canada en 2023, avec 59,6 % du total des flux d’IDE, soit une part nettement supérieure à la moyenne de la dernière décennie (41,0 % pour 2013-2022).
Les Pays-Bas (8,9 %) se sont classés au deuxième rang des pays investisseurs, une position qu’ils ont occupée neuf fois au cours des douze dernières années. La Suisse (6,5 %), l’Allemagne (6,1 %) et le Japon (5,8 %) ont constitué le reste du top 5 des pays investissant dans l’IDE en 2023, remplaçant ainsi le Luxembourg, l’Australie et la France, qui figuraient dans le top 5 en 2022.
Tableau 1.6 : Flux d’IDCE et d’IDE (2023) – Top 5 des pays
| Pays | Valeur (en milliards de dollars) | Variation par rapport à 2022 (G$) | Variation par rapport à 2022 (%) |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0473-01. Consulté en mai 2024. Calculs du BEC. | |||
| Destinations de l’IDCE | |||
| États-Unis | 69,1 | 19,9 | 40,4 % |
| Royaume-Uni | 7,0 | 2,6 | 50,8 % |
| Hong Kong | 4,8 | 4,7 | 6012,8 % |
| Australie | 4,2 | -1,3 | -24,3 % |
| Mexique | 3,9 | 2,1 | 119,6 % |
| Tous les pays | 110,0 | 1,9 | 1,8 % |
| Sources d’IDE | |||
| États-Unis | 37,1 | 10,8 | 41,9 % |
| Pays-Bas | 5,6 | -5,5 | -49,6 % |
| Suisse | 4,0 | 3,8 | 1355,2 % |
| Allemagne | 3,8 | 3,0 | 372,3 % |
| Japon | 3,6 | 5,5 | -287,5 % |
| Tous les pays | 62,3 | 2,2 | 3,7 % |
Il convient de noter que les données des flux d’IDCE et d’IDE reflètent les renseignements relatifs à la destination immédiate ou à l’investisseur et se réfèrent au pays par lequel l’investissement a transité avant d’atteindre sa destination. Ces données diffèrent de celles basées sur la destination finale ou relative à l’investisseur, qui sont plus précises, mais qui ne sont pas disponibles pour les flux. Par conséquent, les données portant sur les flux peuvent ne pas refléter avec précision les investissements des pays qui investissent au moyen d’intermédiaires (p. ex., la Chine ou le Japon) ou qui agissent en tant qu’intermédiaires (p. ex., les Pays-Bas, Hong Kong ou la Barbade). Pour plus de détails sur la différence entre destination immédiate et destination finale ou de l’investisseur, se reporter au chapitre 2, Le point sur le commerce 2021 du Canada.
En conclusion, 2023 a vu un rebond des flux d’investissements directs étrangers du Canada, et ce, après une légère baisse enregistrée en 2022. Par ailleurs, pour 2023, les valeurs d’IDCE et d’IED étaient supérieures à leur moyenne décennale respective, mais inférieures à leurs niveaux de 2021. Au cours de l’année à venir, les flux d’IDCE et d’IDE poursuivront probablement leur tendance positive à partir de 2023, car la probabilité d’une grave récession économique est moindre, les perspectives de croissance mondiale sont plus équilibrées et le potentiel de désinflation est plus rapide (FMI, 2024). Néanmoins, l’augmentation pourrait être modeste, car des risques importants persistent, notamment des incertitudes géopolitiques, un endettement élevé au sein de nombreux pays et une fragmentation supplémentaire de l’économie mondiale (CNUCED, 2024).
Partie 2 : Les chaînes d’approvisionnement
Vue d'ensemble
2.1 Avant la pandémie : L’évolution des chaînes d’approvisionnement internationales et leur importance pour le Canada
- Les chaînes d’approvisionnement internationales ont été un moteur du commerce mondial : Entre 1990 et la crise financière mondiale de 2008, les produits intermédiaires ont représenté deux tiers de la croissance des exportations mondiales.
- Les chaînes d’approvisionnement internationales comportent d’importants avantages pour le Canada :
- Entreprises canadiennes – Les chaînes d’approvisionnement internationales permettent aux entreprises de se spécialiser dans des tâches essentielles, d’accéder à des intrants spécialisés, de favoriser la diffusion des connaissances et d’accroître la concurrence, ce qui se traduit par une productivité accrue.
- Les Canadiens – Les chaînes d’approvisionnement internationales contribuent à faire baisser les prix et à accroître le choix et la variété des produits disponibles.
- Elles présentent également des inconvénients potentiels – Les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent constituer un vecteur de contagion pour les chocs mondiaux.
- Le commerce, y compris celui des produits intermédiaires, a ralenti : Entre 2008 et 2019, les exportations mondiales ont augmenté à un taux annuel moyen de seulement 2,0 %, contre 10,5 % entre 1995 et 2008. Les exportations de produits et services intermédiaires, une mesure du commerce de la chaîne d’approvisionnement, sont restées à la traîne de la croissance totale des exportations, ne progressant que de 1,4 % par an au cours de cette période.
2.2 Chaînes d’approvisionnement internationales pendant la pandémie de COVID-19
- Perturbations relatives à la pandémie de COVID-19 : La pandémie a fortement perturbé l’économie mondiale, entraînant des fermetures de frontières, des restrictions en matière de déplacements et des fermetures temporaires d’usines et de manufactures, les travailleurs étant renvoyés chez eux en quarantaine.
- Les consommateurs ont modifié la demande : Aux États-Unis et au Canada, les consommateurs ont délaissé les services, et ce, au profit des biens de consommation durables. Cette situation a exercé une pression sur les infrastructures de transport, entraînant des retards dans les ports ainsi qu’une augmentation des coûts du transport maritime.
- Les chaînes d’approvisionnement internationales sont demeurées solides : Bien que les chaînes d’approvisionnement aient incontestablement été perturbées pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des pénuries, par exemple en matière d’équipements de protection individuelle (EPI) et de puces électroniques, les chaînes d’approvisionnement internationales ont fait preuve d’une robustesse remarquable face à un choc d’une telle ampleur, et les Canadiens ont continué à avoir accès à la plupart des biens et des services dont ils avaient besoin.
Vue d’ensemble figure 4 : Consommateur COVID-19

Version texte - Vue d’ensemble figure 4
Consommateur pré-COVID-19 : dépenses en services tel que le café, les divertissements, et les voyages.
Consommateur post-COVID-19 : dépenses en biens de consommation durables tels que les cafetières, le divertissement à domicile et l’amélioration domiciliaire.
2.3 Les chaînes d’approvisionnement internationales après la pandémie de COVID-19 et à l’avenir
- De nouveaux risques ont vu le jour : Les risques et défis actuels pour les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : les catastrophes naturelles et les changements climatiques; les risques humains et organisationnels; les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); et l’évolution de l’environnement géopolitique.
- Améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement : Les entreprises canadiennes peuvent atténuer les risques qui pèsent sur leurs chaînes d’approvisionnement internationales en constituant des stocks, en diversifiant leurs fournisseurs, en innovant dans leurs processus de production ainsi qu’en changeant le lieu d’approvisionnement.
- Les PME canadiennes ne sont pas à l’abri des défis auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales : Une étude de l’Université Laval révèle que les PME canadiennes sont intégrées de manière importante dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Cependant, toutes les PME ne savent pas exactement d’où proviennent leurs intrants, et près d’un tiers des PME interrogées font état de lacunes importantes à l’égard de la connaissance et de la visibilité de leurs sources d’intrants.
2.4 Rapatriement et autres stratégies de localisation
- Peu de données probantes relatives à relocalisation : Les recherches et les données disponibles ne confirment pas l’existence de tendances générales en matière de relocalisation au Canada ou aux États-Unis. Bien que les entreprises puissent envisager de relocaliser pour accroître la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement, elles n’ont pas encore achevé ou même déployé leurs plans.
- Délocalisation ou relocalisation : La délocalisation peut revêtir plus d’avantages que la relocalisation. En transférant leurs activités dans d’autres pays, les entreprises peuvent atténuer de manière efficace leurs vulnérabilités tout en tirant parti des avantages comparatifs d’autres pays.
- Évolution des stratégies de délocalisation : Les tendances émergentes dans les données portant sur les investissements directs étrangers sortants du Canada et des États-Unis peuvent être révélatrices de certaines décisions en matière de délocalisation. En outre, les investissements en installations nouvelles en Chine ont diminué au cours de la dernière décennie, alors qu’ils sont restés constants dans la région de l’Asie.
2.1 Avant la pandémie : L’évolution des chaînes d’approvisionnement internationales et leur importance pour le Canada
Un grand nombre de biens et de services dont la population canadienne dépend quotidiennement sont transportés par camion, par bateau ou par avion depuis l’étranger. En outre, de nombreux produits fabriqués au Canada le sont à partir d’intrants, de matériaux ou encore d’ingrédients provenant également de l’étranger. En 2023, près de la moitié des importations de marchandises du Canada (47 %) étaient des biens intermédiaires. En bref, le Canada est parfaitement intégré dans un réseau complexe de chaînes d’approvisionnement internationales. Des événements importants survenus ces dernières années, comme la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les perturbations attribuables aux changements climatiques (les inondations en Colombie-Britannique, par exemple), ont mis en évidence la fragilité potentielle des chaînes d’approvisionnement internationales pour la population canadienne. Ce qui est peut-être moins évident pour la population canadienne, ce sont les nombreux avantages et les raisons pour lesquelles les chaînes d’approvisionnement internationales – la production de biens et de services au-delà des frontières nationales – sont devenues le modèle commun pour les entreprises du monde entier, y compris ici, au Canada. La première partie de ce dossier spécial examine la genèse des chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que les avantages qu’en retirent les entreprises et les consommateurs du Canada.
Figure 2.1 : « Voyageurs franchissant une cascade en canot »
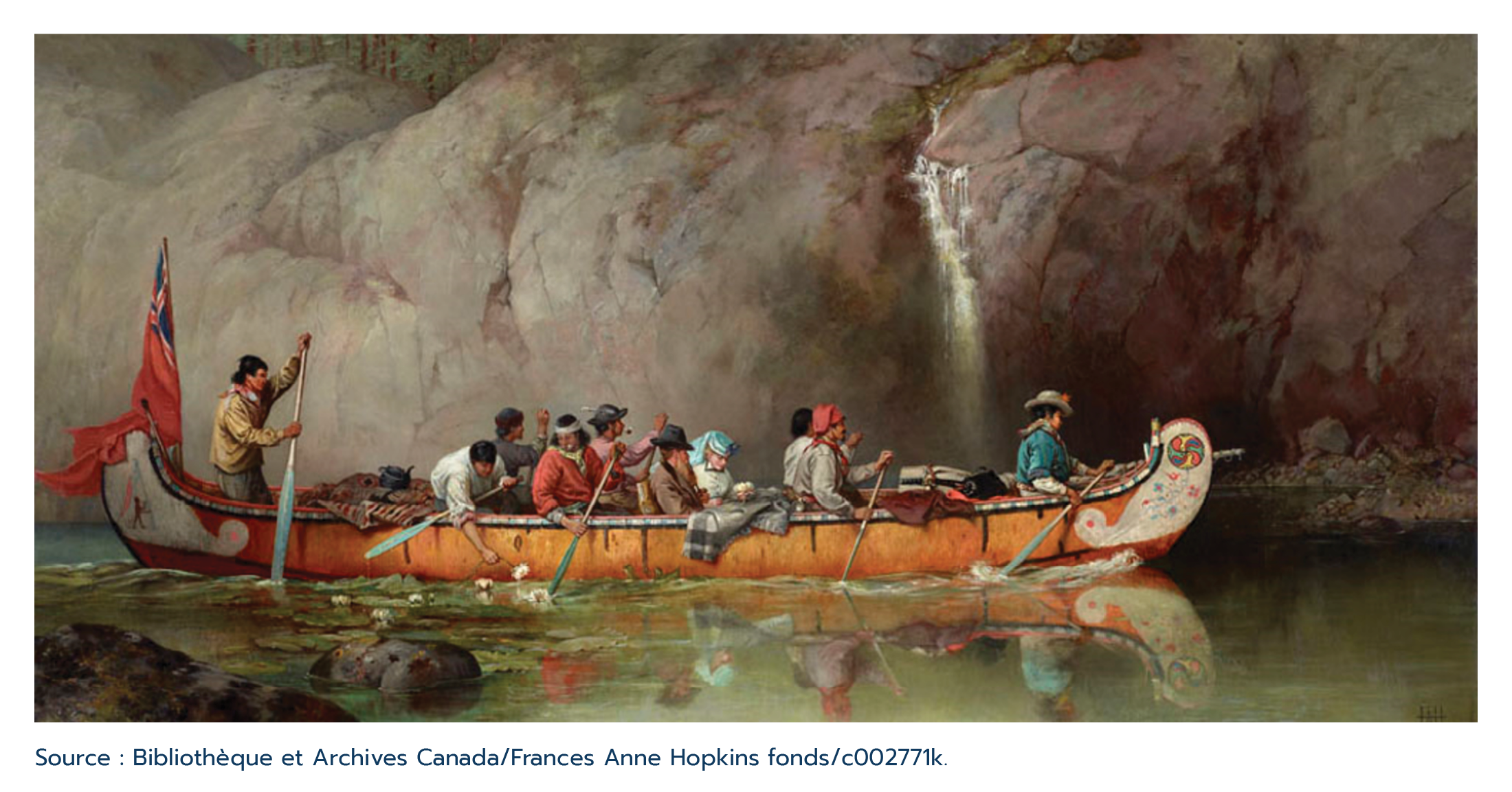
Version texte - Figure 2.1
Source : Bibliothèque et Archives Canada/Frances Anne Hopkins fonds/c002771k.
L’expression « chaîne d’approvisionnement internationale » peut être définie comme l’organisation transfrontalière des activités nécessaires à la production de biens ou de services et à leur acheminement vers les consommateurs au moyen d’intrants et de différentes phases de développement, de production et de livraison.Note de bas de page 4 Il ne s’agit pas d’un nouveau concept. En effet, la production de biens, décomposés en étapes qui sont achevées dans de nombreux pays, existe depuis des siècles. Il suffit de se pencher sur l’histoire du Canada pour en retrouver un exemple frappant : le commerce des fourrures. Selon l’Encyclopédie canadienne, la traite des fourrures a duré quelque 250 ans, du début du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle. Elle reposait essentiellement sur le piégeage des castors pour répondre à la demande européenne de chapeaux de feutre. Les Européens ont fait du commerce avec les peuples autochtones pour obtenir des peaux de castor, qui ont été échangées et expédiées dans la nature sauvage canadienne, puis transportées de l’autre côté de l’Atlantique. En Europe, les peaux étaient utilisées par des fabricants, en France ou en Angleterre, pour fabriquer des chapeaux élégants qui étaient ensuite vendus aux consommateurs dans toute l’Europe. Cette chaîne d’approvisionnement de fourrures a joué un rôle important dans le développement du Canada. Elle a motivé les premières explorations européennes du Canada et est demeurée le fondement économique de l’Ouest canadien jusqu’en 1870 environ.Note de bas de page 5
Si les chapeaux de feutre pour hommes sont tombés en désuétude, il n’en va pas évidemment de même pour les chaînes d’approvisionnement internationales. En fait, elles sont plus populaires que jamais et sont à l’origine de la plupart des biens et services utilisés par la population canadienne aujourd’hui. Elles sont également, dans la plupart des cas, bien plus complexes que l’exemple historique présenté plus haut. Le terme « chaîne » peut toutefois être trompeur : il est préférable d’estimer les chaînes d’approvisionnement internationales comme un réseau de fournisseurs, de producteurs, de points d’assemblage et de distribution nécessaires à la mise sur le marché d’un produit moderne. Il est également important d’observer que si les chaînes d’approvisionnement internationales comprennent toujours l’approvisionnement en matières premières, comme dans l’exemple du commerce de la fourrure, elles englobent bien plus que cela. Aujourd’hui, les chaînes d’approvisionnement internationales comprennent l’acquisition de compétences et de connaissances, comme la recherche et développement (R et D) scientifique, les services juridiques et le marketing. Elles comprennent également des intrants de haute technologie, comme les semi-conducteurs, les systèmes informatiques et électroniques, les métaux composites, etc., qui sont des composants essentiels pour de nombreux produits actuels.
L’expansion des chaînes d’approvisionnement internationales : Des années 1990 à la crise financière mondiale de 2008
Ces chaînes d’approvisionnement internationales, plus complexes et davantage étendues, ont connu une croissance et une adoption particulièrement fortes en tant que modèle d’entreprise au début des années 1990 et jusqu’en 2008 environ (lorsque la crise financière mondiale a frappé). Plusieurs facteurs ont contribué à stimuler le « dégroupement » de la production au-delà des frontières. Baldwin (2013) souligne les avancées majeures des technologies de l’information et de la communication (TIC) au milieu des années 1980 et la fusion des télécommunications, des ordinateurs et des logiciels d’organisation, qui ont notamment permis aux entreprises de coordonner la « complexité » sur de bien plus grandes distances. Alors que Baldwin écrit que « la révolution des TIC a rendu possible la coordination de la complexité à distance », l’auteur fait ensuite remarquer que « les énormes différences de salaires entre les pays dits développés et les pays en développement ont rendu la séparation rentable ». Si la croissance des marchés émergents – et la main-d’œuvre à moindre coût à laquelle ils donnent accès – a joué un rôle important dans le développement des chaînes d’approvisionnement internationales, elle n’en a pas pour autant été le principal moteur. Sydor (2011) souligne que d’autres tendances, comme les progrès en matière de transport, la baisse des prix du pétrole (du début des années 1980 à 1998) et la chute des droits de douane, ont joué un rôle important dans la fragmentation transfrontalière de la production.
Un aspect important de la limite des coûts de main-d’œuvre en tant que moteur de la croissance réside d’ailleurs dans la nature même des chaînes d’approvisionnement. Pour l’essentiel, les chaînes d’approvisionnement internationales sont largement régionales. Baldwin (2013) divise les chaînes d’approvisionnement internationales en trois zones géographiques : « usines Amérique du Nord, usines Europe et usines Asie ». Les données portant sur le commerce international nous montrent que, pour la plupart des pays, si certains intrants importés proviennent de pays très éloignés, la majorité d’entre eux proviennent de pays voisins. En d’autres termes, la distance revêt son importance et, aujourd’hui encore, les pays effectuent davantage de commerce avec leurs voisins limitrophes. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, le Canada, dont les chaînes d’approvisionnement sont largement intégrées à celles des États-Unis, en tire des avantages en termes de compétences et de technologie plutôt qu’en termes de main-d’œuvre à faible coût.
Figure 2.2 : Importance des produits intermédiaires dans les exportations mondiales
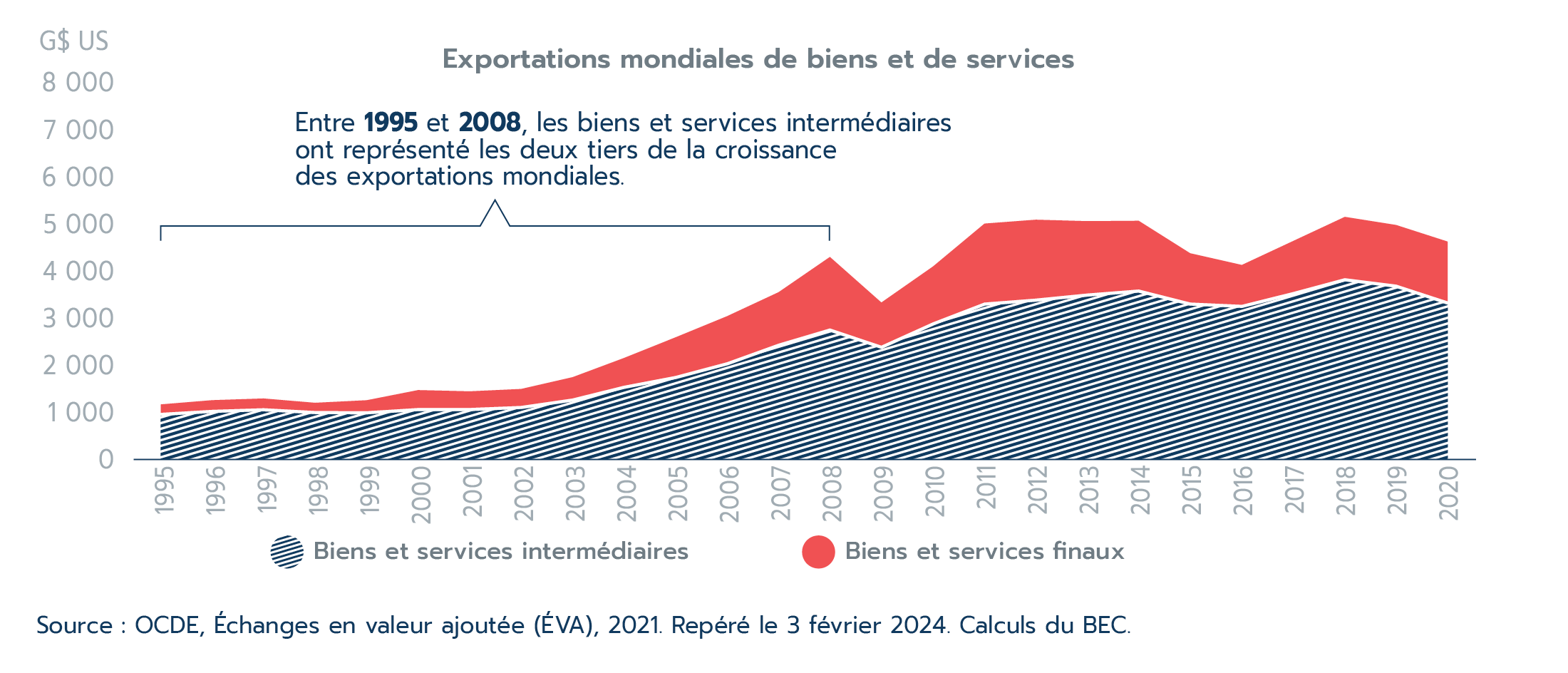
Version texte - Figure 2.2
| Année | Biens et services intermédiaires (milliards de dollars) | Biens et services finaux (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Source : OCDE, Échanges en valeur ajoutée (ÉVA), 2021. Repéré le 3 février 2024. Calculs du BEC. | ||
| 1995 | 1 015 | 830 |
| 1996 | 1 104 | 894 |
| 1997 | 1 141 | 929 |
| 1998 | 1 049 | 870 |
| 1999 | 1 103 | 865 |
| 2000 | 1 319 | 933 |
| 2001 | 1 292 | 934 |
| 2002 | 1 342 | 977 |
| 2003 | 1 593 | 1 135 |
| 2004 | 2 001 | 1 405 |
| 2005 | 2 438 | 1 613 |
| 2006 | 2 886 | 1 904 |
| 2007 | 3 395 | 2 298 |
| 2008 | 4 146 | 2 621 |
| 2009 | 3 179 | 2 257 |
| 2010 | 3 941 | 2 750 |
| 2011 | 4 851 | 3 170 |
| 2012 | 4 933 | 3 255 |
| 2013 | 4 902 | 3 362 |
| 2014 | 4 910 | 3 447 |
| 2015 | 4 222 | 3 171 |
| 2016 | 3 974 | 3 122 |
| 2017 | 4 484 | 3 394 |
| 2018 | 4 994 | 3 688 |
| 2019 | 4 821 | 3 551 |
| 2020 | 4 469 | 3 195 |
L’essor des chaînes d’approvisionnement internationales au cours des années 1990 à 2008 est particulièrement évident si l’on examine les données du commerce mondial. La base de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les échanges en valeur ajoutée (ÉVA) montre que les exportations mondiales de biens et de services ont plus que triplé, passant de 1,8 billion de dollars américains en 1995 à 6,8 billions de dollars américains en 2008. En outre, comme l’illustre la figure 2.2, les deux tiers de cette croissance sont imputables aux exportations de biens et services intermédiaires – une approximation courante du commerce de la chaîne d’approvisionnement. Ces biens et services constituent des « produits matériels et immatériels utilisés comme intrants dans la production, à l’exclusion des actifs fixes. Les statistiques commerciales sur les produits intermédiaires reflètent d’ailleurs les échanges de pièces, de composants, d’accessoires et de services intermédiaires qui ont lieu au sein des chaînes d’approvisionnement.Note de bas de page 6 » En bref, le commerce international s’est développé rapidement au cours de cette période et a été largement alimenté par le commerce d’intrants intermédiaires, donnant ainsi lieu à des chaînes d’approvisionnement internationales.
Figure 2.3 : Croissance des exportations mondiales de services commerciaux
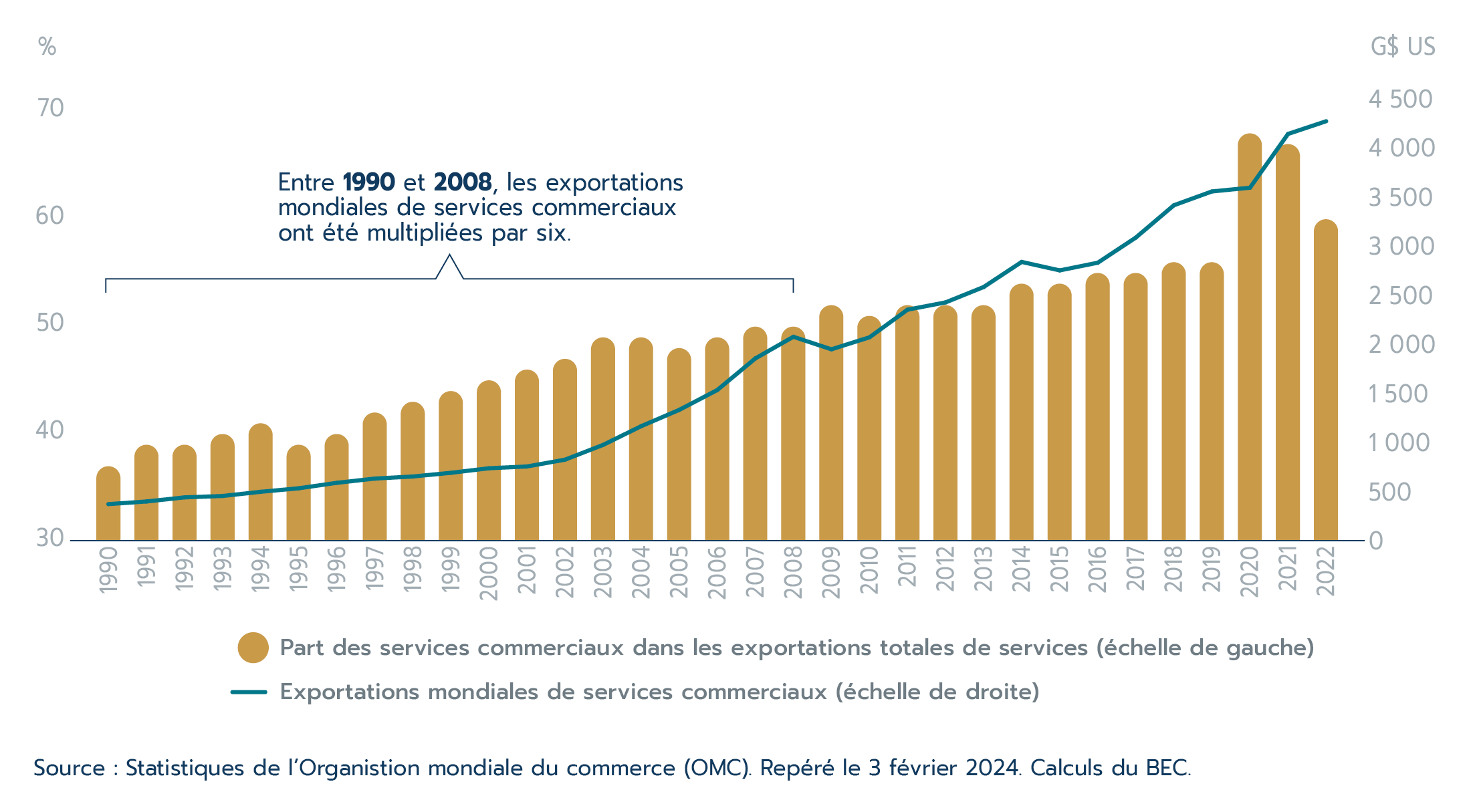
Version texte - Figure 2.3
| Année | Part des services commerciaux dans les exportations totales de services (échelle de gauche), en pourcentage | Exportations mondiales de services commerciaux (échelle de droite), milliards de dollars US |
|---|---|---|
| Source : Statistiques de l’Organistion mondiale du commerce (OMC). Repéré le 3 février 2024. Calculs du BEC. | ||
| 1990 | 36 % | 303 |
| 1991 | 38 % | 329 |
| 1992 | 38 % | 371 |
| 1993 | 39 % | 386 |
| 1994 | 40 % | 428 |
| 1995 | 38 % | 464 |
| 1996 | 39 % | 519 |
| 1997 | 41 % | 563 |
| 1998 | 42 % | 584 |
| 1999 | 43 % | 622 |
| 2000 | 44 % | 668 |
| 2001 | 45 % | 686 |
| 2002 | 46 % | 755 |
| 2003 | 48 % | 906 |
| 2004 | 48 % | 1 096 |
| 2005 | 47 % | 1 262 |
| 2006 | 48 % | 1 464 |
| 2007 | 49 % | 1 786 |
| 2008 | 49 % | 2 007 |
| 2009 | 51 % | 1 879 |
| 2010 | 50 % | 2 001 |
| 2011 | 51 % | 2 283 |
| 2012 | 51 % | 2 357 |
| 2013 | 51 % | 2 513 |
| 2014 | 53 % | 2 769 |
| 2015 | 53 % | 2 683 |
| 2016 | 54 % | 2 761 |
| 2017 | 54 % | 3 017 |
| 2018 | 55 % | 3 346 |
| 2019 | 55 % | 3 487 |
| 2020 | 67 % | 3 525 |
| 2021 | 66 % | 4 073 |
| 2022 | 59 % | 4 202 |
Les chaînes d’approvisionnement ne se limitent cependant pas à l’approvisionnement en intrants physiques; elles comprennent également l’approvisionnement en compétences ou en services nécessaires à la fabrication des produits. Alors que la figure 2.2 montre la croissance des biens intermédiaires et des services entre 1995 et 2008, la figure 2.3 quant à elle se concentre sur les seuls services. Les services commerciaux – à l’exclusion toutefois des transports et des voyages – constituent une bonne mesure des types de compétences et de services utilisés par les entreprises. Ils comprennent une grande variété de services comme la R et D, les services juridiques, le marketing et la publicité, l’ingénierie, les services informatiques et d’information, pour n’en citer que quelques-uns. La figure 2.3 montre que les exportations mondiales de services commerciaux ont plus que sextuplé, passant de 303 milliards de dollars américains en 1990 à quelque 2 billions de dollars américains au moment de la crise financière mondiale (2008). Cette croissance a ainsi dépassé celle du total des services – qui comprend les voyages, les transports et les services gouvernementaux – au cours de cette période, les services commerciaux passant d’un tiers des services mondiaux à près de la moitié (49 %), comme le montrent les barres de la figure 2.3.
Une autre dimension de l’expansion des chaînes d’approvisionnement internationales entre le début des années 1990 et la fin des années 2000 est également révélée lorsque l’on examine les tendances des investissements directs étrangers (IDE) à l’échelle mondiale. Ces données d’ailleurs révèlent deux tendances importantes qui mettent en évidence la croissance des chaînes d’approvisionnement. Premièrement, la forte croissance générale des IDE à l’échelle mondiale au cours de cette période indique que les entreprises développent leurs usines et leurs installations à l’étranger et mettent en place le capital et l’infrastructure nécessaires aux chaînes d’approvisionnement internationales. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le stock mondial d’IDE a plus que sextuplé entre 1990 et 2008, dépassant la croissance du commerce. Deuxièmement, l’autre tendance qui ressort des données relatives aux IDE est le rôle des économies émergentes et en développement dans le cadre de la croissance de la chaîne d’approvisionnement. La part du stock d’IDE entrant représentée par les économies en développement est passée de 23 % à 27 % au cours de cette même période. Si ces 4 points de pourcentage équivaut à une augmentation de 3,5 billions de dollars du stock d’IDE dans les économies en développement, il indique également que la majorité des activités en matière d’IDE se déroule toujours entre les économies développées, ce qui montre une fois de plus que la fragmentation de la production à travers les frontières ne se limite pas à la recherche d’une main-d’œuvre à faible coût. Parmi les économies émergentes et en développement, la Chine a été le principal bénéficiaire des IDE au cours de cette période, sa part dans les flux mondiaux d’IDE passant de 2 % en 1990 à 7 % en 2008. L’afflux important d’investissements étrangers en Chine au cours de cette période a été motivé par l’utilisation de la Chine par les entreprises occidentales dans leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui a contribué de manière importante à l’exceptionnelle croissance économique de la Chine.
De nombreuses études utilisant des données et des méthodes de mesure plus complexes révèlent également une forte croissance et la création de chaînes d’approvisionnement entre le début des années 1990 et 2008. L’une de ces études est celle de Degain, Meng et Wang (2017), dans laquelle les auteurs utilisent les tableaux d’entrées-sorties mondiaux pour déterminer le contenu en valeur ajoutée étrangère utilisé dans la production qui est ensuite utilisé pour une exportation ultérieure (c’est-à-dire qui traverse deux fois une frontière internationale). Les auteurs ont constaté que ces activités complexes associées aux chaînes de valeur mondiales, transfrontalières et de répartition de la production ont été le moteur de la mondialisation et de la croissance du produit intérieur brut (PIB) entre 1995 et 2008.
Les avantages et les coûts des chaînes d’approvisionnement internationales
La croissance des chaînes d’approvisionnement entre le début des années 1990 et 2008 n’est pas le fruit du hasard, et cela n’est pas sans raison. Les chaînes d’approvisionnement ont été conçues par les entreprises, car la diffusion des activités commerciales au-delà des frontières présentait de grands avantages. L’avantage pour ces entreprises se résume principalement à une augmentation de la productivité. Criscuolo et Timmis (2017) résument plusieurs canaux de gains en matière de productivité des entreprises provenant des chaînes d’approvisionnement internationales, notamment l’accès aux intrants importés, les retombées de connaissances, l’augmentation de la compétitivité due à l’exposition à la concurrence étrangère et la possibilité pour les entreprises de se concentrer sur des tâches essentielles. Baldwin et Yan (2014) et Globerman (2011) estiment quant à eux qu’en permettant la fragmentation de la production entre les pays, les entreprises bénéficient d’une division du travail et d’une spécialisation plus fines, et les activités commerciales peuvent être menées là où les compétences et les matériaux nécessaires sont disponibles au coût le plus compétitif. Acemoglu et Tahbaz-Salehi (2020), pour leur part, soutiennent que les chaînes d’approvisionnement génèrent des gains de productivité en permettant la personnalisation des intrants.
On pourrait avancer que le principal gain de productivité pour les entreprises réside dans l’approvisionnement en produits intermédiaires dans des pays où la main-d’œuvre est moins chère, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Baldwin et Yan (2014) démontrent que pour les fabricants canadiens, la croissance de la productivité était plus élevée pour les entreprises qui importaient des intermédiaires et exportaient des produits vers d’autres pays à hauts salaires. Pour ces auteurs, l’un des principaux avantages des chaînes d’approvisionnement est de permettre le transfert de technologies. En particulier, les fabricants au Canada ont accès à une meilleure technologie et à un meilleur savoir-faire. Si l’on examine les données canadiennes, on constate qu’en 2022, plus de la moitié (53 %) des importations canadiennes de biens intermédiaires et plus de deux tiers (69 %) des importations de services commerciaux provenaient des États-Unis, un pays dont les coûts de main-d’œuvre sont semblables à ceux du Canada, mais qui est réputé pour sa compétitivité en matière de technologies avancées, de R et D et de main-d’œuvre hautement qualifiée et éduquée.
Les avantages des chaînes d’approvisionnement ne profitent toutefois pas qu’aux entreprises. Il a été démontré que les gains en termes d’efficacité des chaînes d’approvisionnement internationales peuvent être associés à des prix plus bas et plus stables pendant la majeure partie des années 1990 et jusqu’à la crise financière mondiale. Si cette baisse des prix a profité aux consommateurs, elle a également permis aux banques centrales d’abaisser les taux d’intérêt et ainsi de stimuler la croissance économique. Soyres et Franco (2020) constatent que l’intégration commerciale a entraîné une baisse de l’inflation et que la participation à la chaîne d’approvisionnement internationale a quant à elle entraîné une plus grande corrélation des schémas d’inflation entre les pays. Andrews, Gal et Witheridge (2018) retrouvent des indications selon lesquelles les chaînes d’approvisionnement internationales ont exercé une pression à la baisse sur les prix à la production, principalement en permettant aux entreprises de remplacer les intrants nationaux par des intrants étrangers moins coûteux. Les auteurs affirment que la participation à une chaîne d’approvisionnement internationale exerce une pression à la baisse sur les coûts unitaires de main-d’œuvre, et ce, en augmentant la productivité et en réduisant les salaires dans le pays importateur, ce qui est particulièrement évident lorsque des pays à bas salaires sont intégrés dans les chaînes d’approvisionnement. Dans le cas particulier du Canada, Kim (2020), en examinant uniquement les produits en provenance de Chine, constate que les importations ont réduit les prix au Canada de 1,2 point de pourcentage entre 2001 et 2011.
Comme pour toute chose, cela ne veut toutefois pas dire que les chaînes d’approvisionnement internationales ne présentent pas d’inconvénients ou de coûts. Comme l’ont déjà souligné Andrews, Gal et Witheridge (2018), la baisse des prix en raison des gains de productivité peut être en partie attribuable à la baisse des salaires. D’autres études ont montré que les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent également être associées à des pertes d’emploi. Kennedy et Mazzocco (2022) passent en revue les conclusions de plusieurs études influentes portant sur les répercussions de l’intensification des échanges avec la Chine sur l’emploi aux États-Unis. Ils concluent de manière générale que des emplois ont été perdus et que cela a eu des conséquences importantes pour certains travailleurs et certaines régions des États-Unis, mais ils ne sont pas en mesure de rendre pleinement compte des gains d’emploi réalisés ailleurs et de ce qui a contribué à ces gains. Pour le cas du Canada, Kim (2020) constate que les travailleurs canadiens ont effectivement été déplacés par la concurrence accrue des importations en provenance de Chine. Il est toutefois important de noter que de nombreux travailleurs commencent et arrêtent de travailler au cours d’une année donnée et que ce passage d’un emploi à l’autre est un élément important de la croissance économique.
Les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent également constituer un vecteur de transmission des chocs ou de contagion au-delà des frontières. Acemoglu et Tahbaz-Salehi (2020) décrivent d’ailleurs bien ce phénomène : en développant un modèle non concurrentiel dans lequel les relations personnalisées entre fournisseurs et clients augmentent la productivité, ils démontrent que l’échec d’une entreprise peut se propager à travers les fournisseurs et les clients du réseau de production. En d’autres termes, les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent contribuer à perpétuer un choc négatif et, en raison de leur nature mondiale, possiblement au-delà des frontières. La crise financière mondiale de 2008 en est un exemple probable, selon Sydor (2011). En effet, pour l’auteur, si la crise a commencé dans les secteurs de la finance et du logement dans un nombre limité de pays et s’est principalement propagée au moyen du secteur financier, les liens à travers les chaînes d’approvisionnement y ont aussi probablement contribué. L’auteur prend l’exemple d’une baisse de la demande aux États-Unis qui a directement entraîné une réduction de la production en Chine, laquelle a à son tour entraîné une réduction de la production dans d’autres pays fournisseurs. Le PIB réel mondial a reculé de 0,1 % en 2009 tandis que le volume des échanges de biens et de services a baissé de 10,3 %; toutefois, le PIB et les échanges se sont redressés l’année suivante, augmentant respectivement de 5,5 % et de 12,8 % en 2010. Les chaînes d’approvisionnement internationales ont probablement joué un rôle dans ce cas aussi; la reprise dans un pays augmentant la demande pour les producteurs et les fournisseurs dans d’autres pays.
La maturation des chaînes d’approvisionnement internationales : De l’après-crise financière mondiale à la pandémie de 2019
La crise financière mondiale de 2008 a entraîné un ralentissement de la croissance du commerce de la chaîne d’approvisionnement. C’est ce que révèle à nouveau la figure 2.2 où, selon les données de l’OCDE, entre 2008 et 2019, les exportations mondiales n’ont progressé que de 2,0 % en moyenne annuelle, contre 10,5 % entre 1995 et 2008. En outre, alors que les exportations de biens et services intermédiaires, notre indicateur du commerce de la chaîne d’approvisionnement, ont dépassé la croissance totale des exportations au cours de la période précédant la crise financière mondiale, de 2008 à 2019, elles sont demeurées à la traîne de la croissance totale des exportations, n’augmentant que de 1,4 % par an de 2008 à 2019. En outre, la mesure du commerce international de chaînes d’approvisionnement complexes utilisée par Degain, Meng et Wang (2017) a révélé une baisse du commerce de chaînes d’approvisionnement complexes entre 2012 et 2015.
Si la croissance du commerce des chaînes d’approvisionnement a été inférieure à celle du commerce total au cours de cette période, cela ne signifie pas pour autant que le phénomène des chaînes d’approvisionnement internationales s’est inversé ou que les chaînes d’approvisionnement ont été démantelées. Il s’agit plus vraisemblablement d’une maturation du commerce de la chaîne d’approvisionnement, de nombreuses entreprises mondiales utilisant désormais pleinement ce modèle de production et moins de nouvelles chaînes d’approvisionnement étant établies. En d’autres termes, il s’agit plutôt d’une décélération de la croissance, et non d’une inversion. Un autre aspect intéressant de cette période est que, si les intermédiaires physiques sont restés à la traîne de la croissance des exportations, les services commerciaux n’ont quant à eux pas suivi cette tendance. Comme l’illustre la figure 2.3, après une légère baisse en 2009, les services commerciaux ont continué à croître entre 2008 et 2019, bien qu’à un rythme plus lent (5,2 % contre 11,9 % par an). Plus important encore, ils ont continué à dépasser l’ensemble des services, où les services commerciaux représentant 49 % du total des échanges mondiaux de services en 2008 et 55 % en 2019. Ainsi, alors que les échanges d’intrants physiques ont peut-être ralenti, il semble pourtant que les services aux entreprises aient continué à croître.
Figure 2.4 : Part de la Chine dans les exportations mondiales de produits intermédiaires
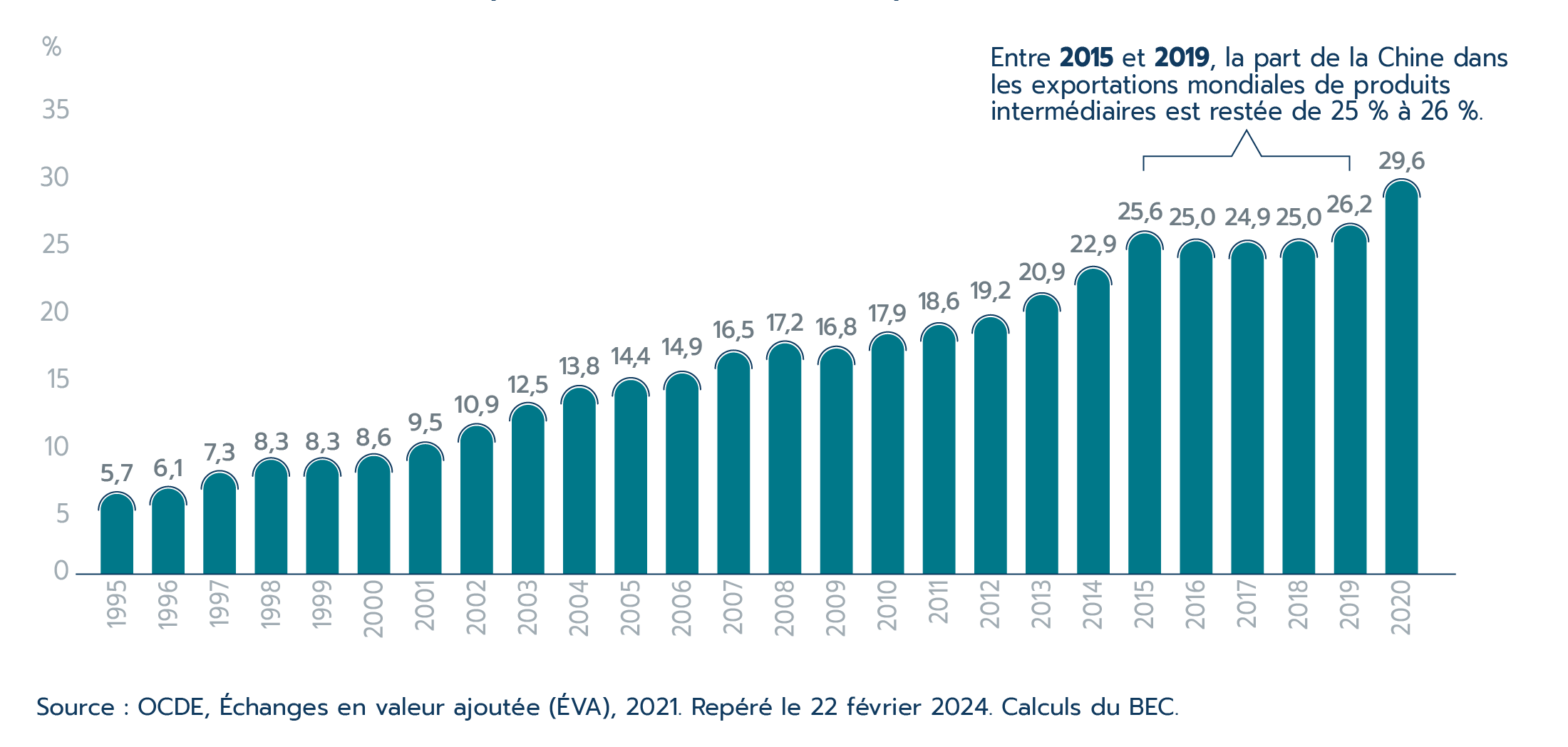
Version texte - Figure 2.4
| Année | Pourcentage |
|---|---|
| Source : OCDE, Échanges en valeur ajoutée (ÉVA), 2021. Repéré le 22 février 2024. Calculs du BEC. | |
| 1995 | 5,7 % |
| 1996 | 6,1 % |
| 1997 | 7,3 % |
| 1998 | 8,3 % |
| 1999 | 8,3 % |
| 2000 | 8,6 % |
| 2001 | 9,5 % |
| 2002 | 10,9 % |
| 2003 | 12,5 % |
| 2004 | 13,8 % |
| 2005 | 14,4 % |
| 2006 | 14,9 % |
| 2007 | 16,5 % |
| 2008 | 17,2 % |
| 2009 | 16,8 % |
| 2010 | 17,9 % |
| 2011 | 18,6 % |
| 2012 | 19,2 % |
| 2013 | 20,9 % |
| 2014 | 22,9 % |
| 2015 | 25,6 % |
| 2016 | 25,0 % |
| 2017 | 24,9 % |
| 2018 | 25,0 % |
| 2019 | 26,2 % |
| 2020 | 29,6 % |
Si la Chine a joué un rôle dans la croissance du commerce de la chaîne d’approvisionnement avant la crise financière mondiale, ce pays peut également avoir contribué à une partie du ralentissement après la crise. Comme l’illustre la figure 2.4, si la part de la Chine dans les exportations mondiales de produits intermédiaires est passée de 6 % en 1995 à 26 % en 2015, elle s’est ensuite stabilisée et s’est maintenue entre 25 % et 26 % pendant les quatre années suivantes, jusqu’à la pandémie de COVID-19. Il convient de noter que le PIB de la Chine a continué d’afficher une forte croissance au cours de cette période, ce qui illustre possiblement un approfondissement de l’économie chinoise, avec davantage d’échanges intermédiaires à l’intérieur du pays lui-même.
La croissance des chaînes d’approvisionnement internationales au cours de cette période peut également avoir été entravée par une libéralisation plus lente des politiques commerciales et même, dans certains cas, par un protectionnisme accru, en particulier au cours de la période qui a précédé la pandémie de COVID-19. Par exemple, les notifications présentées par les membres à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et portant sur les réglementations nationales susceptibles d’avoir des répercussions sur le commerce internationalNote de bas de page 7 ont connu un bond de 16 % entre 2017 et 2018, suivi d’une augmentation de 9 % l’année suivante. En outre, les cinq années précédant 2019 ont été marquées par plusieurs événements importants qui ont nui au commerce ou qui ont pu exacerber l’incertitude face aux stratégies relatives la chaîne d’approvisionnement des entreprises. Le Brexit (2016) et les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis (2018 à aujourd’hui) en sont d’ailleurs de parfaits exemples.
Les défis auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales en raison des tensions commerciales et du protectionnisme se font encore ressentir aujourd’hui, mais avant d’aborder les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement, la deuxième partie de ce dossier spécial se penchera sur un test majeur de la résilience des chaînes d’approvisionnement internationales : la pandémie de COVID-19.
2.2 Chaînes d’approvisionnement internationales pendant la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les chaînes d’approvisionnement internationales
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été déterminée pour la première fois en décembre 2019 et s’est rapidement propagée dans le monde entier au cours des premiers mois de 2020. La COVID-19 a constitué la pandémie sanitaire la plus meurtrière depuis la grippe espagnole de 1918-1920. Elle a également fortement perturbé l’économie mondiale, entraînant des fermetures de frontières, des restrictions en matière de déplacements et des fermetures temporaires d’usines et de manufactures, les travailleurs étant renvoyés chez eux en quarantaine. La pandémie de COVID-19 a entraîné la chute la plus importante et la plus rapide de la production économique mondiale depuis la Grande Dépression. Pour le Canada, elle a déclenché une récession bien plus profonde que toutes les autres de cette génération récente, le PIB réel canadien chutant presque trois fois plus que la crise financière mondiale (2008-2009), et ce, en deux fois moins de temps (se reporter à la figure 2.5). Elle a également mis en lumière la vulnérabilité potentielle des chaînes d’approvisionnement internationales : ce qui était autrefois un sujet de discussion aride réservé à quelques spécialistes est aujourd’hui débattu autour des tables de cuisine de la population canadienne.
Figure 2.5 : Les tendances trimestrielles de la récession au Canada
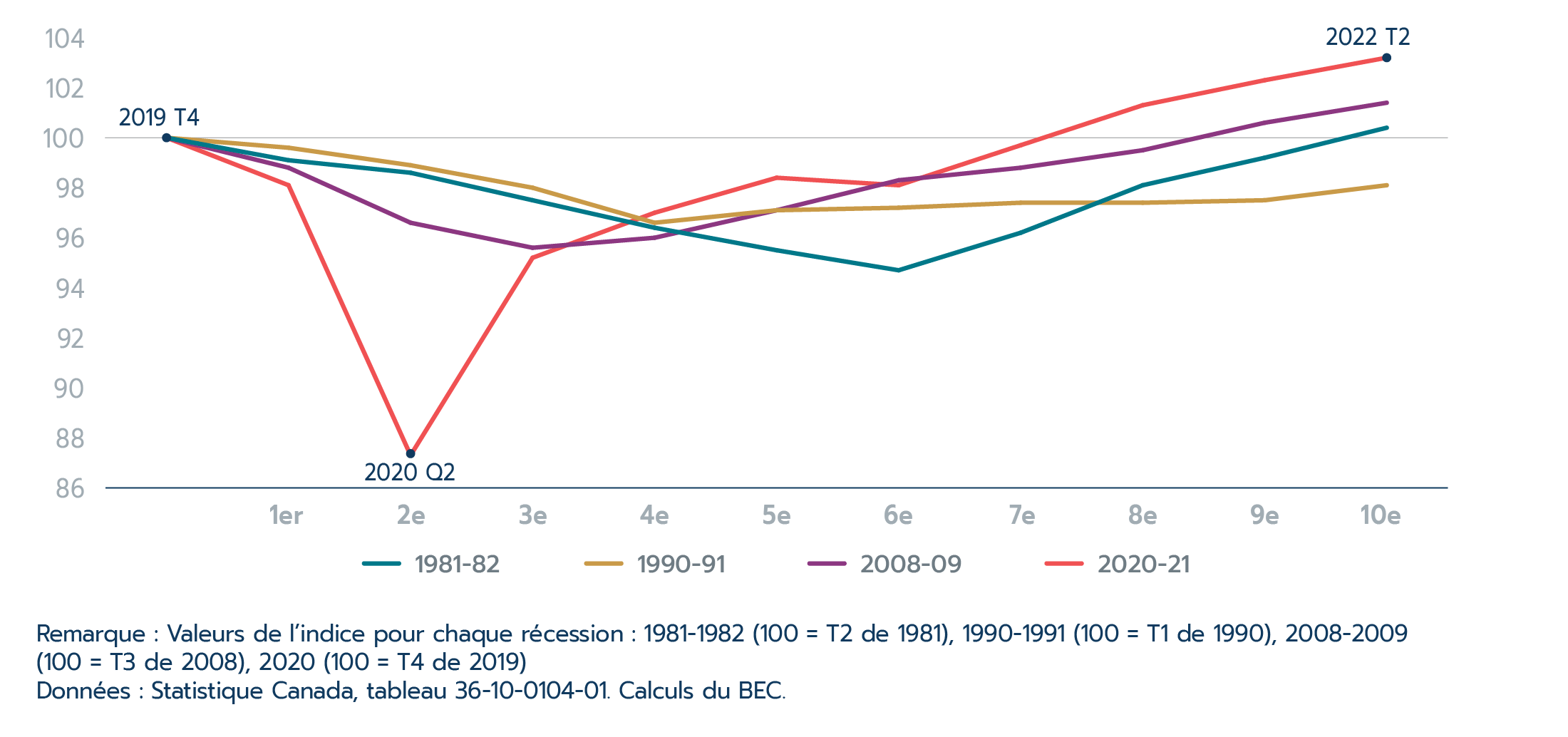
Version texte - Figure 2.5
| 1981-1982 | 1990-1991 | 2008-2009 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Remarque : Valeurs de l’indice pour chaque récession : 1981-1982 (100 = T2 de 1981), 1990-1991 (100 = T1 de 1990), 2008-2009 (100 = T3 de 2008), 2020 (100 = T4 de 2019) Données : Statistique Canada, tableau 36-10-0104-01. Calculs du BEC. | ||||
| 2019 - T4 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1er - 2020 - T1 | 99,1 | 99,6 | 98,8 | 98,1 |
| 2e - 2020 - T2 | 98,6 | 98,9 | 96,6 | 87,3 |
| 3e - 2020 - T3 | 97,5 | 98,0 | 95,6 | 95,2 |
| 4e - 2020 - T4 | 96,4 | 96,6 | 96,0 | 97,0 |
| 5e - 2021 - T1 | 95,5 | 97,1 | 97,1 | 98,4 |
| 6e - 2021 - T2 | 94,7 | 97,2 | 98,3 | 98,1 |
| 7e - 2021 - T3 | 96,2 | 97,4 | 98,8 | 99,7 |
| 8e - 2021 - T4 | 98,1 | 97,4 | 99,5 | 101,3 |
| 9e - 2022 - T1 | 99,2 | 97,5 | 100,6 | 102,3 |
| 10e - 2022 - T2 | 100,4 | 98,1 | 101,4 | 103,2 |
Cependant, et dans l’ensemble, les chaînes d’approvisionnement internationales ont bien résisté à la pandémie. En effet, tout au long de la pandémie de COVID-19, la population canadienne a continué à avoir accès à la plupart des biens et services dont elle avait besoin. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de perturbations au cours de cette période, puisqu’il y a eu notamment des pénuries notables d’équipements de protection individuelle (EPI), de médicaments et de puces électroniques (voir encadré 2.1), pour n’en citer que quelques-unes. Pourtant, dans l’ensemble, les magasins sont restés bien approvisionnés en produits de première nécessité,Note de bas de page 8 et les entreprises canadiennes ont continué à avoir accès aux intrants nécessaires au fonctionnement de leurs usines, de leurs établissements, de leurs entrepôts et de leurs bureaux, ces derniers étant désormais fréquentés par de nombreux membres du personnel de bureau au Canada qui se connectent à partir de leur domicile.
Encadré 2.1 : Les micropuces causent de macro-problèmes
L’un des problèmes en matière de chaîne d’approvisionnement les plus médiatisés pendant la pandémie a été celui des micropuces.Note de bas de page 9 Comme pour d’autres produits examinés dans le cadre de ce dossier, les problèmes de chaîne d’approvisionnement des micropuces ont commencé par un choc de demande. Cependant, alors que la production de la plupart des autres produits a rapidement augmenté et que le facteur limitant était le réseau de transport, la production de micropuces n’a pas pu être augmentée suffisamment afin de répondre à la hausse de la demande. Les usines de fabrication dans lesquelles les micropuces sont produites nécessitent d’importants investissements et des années de planification. En outre, le processus de production lui-même est difficile à mettre à l’échelle rapidement, car certains processus prennent un temps fixe, et ce, en raison de la physique qu’ils impliquent. Le résultat final aura été une pénurie d’approvisionnement. Les micropuces sont devenues un élément essentiel de presque tous les aspects de l’économie moderne, mais aucun secteur n’a été davantage touché par la pénurie de micropuces pendant la pandémie que celui de l’automobile.
Lorsque la pandémie a commencé, les constructeurs automobiles ont craint une récession économique et, anticipant un effondrement des ventes, ont rapidement réduit leur production et annulé des commandes auprès de leurs fournisseurs, y compris les fabricants de micropuces. Alors que les ventes d’automobiles ont d’abord fortement chuté, le monde ayant connu une baisse rapide et d’une ampleur historique de la production et du commerce, les mesures de relance budgétaire et monétaire prises par les gouvernements ainsi que le passage rapide au télétravail ont entraîné un rebond tout aussi historique. Ce rebond s’est accompagné d’une demande étonnamment forte de voitures.
Malheureusement, lorsque les constructeurs automobiles ont tenté de rétablir leur approvisionnement en matière de micropuces, ils ont découvert que d’autres, comme les fabricants de consoles de jeux vidéo, d’appareils d’exercice, d’ordinateurs portables, etc., avaient déjà bloqué leurs approvisionnements. On estime que la production automobile mondiale a diminué de 12,5 millions de véhicules en 2021 et 2022 en raison de la pénurie de micropuces (S&P Global, 2023). Ce déficit en matière de production se traduit par des usines sous-utilisées, des concessions vides, des emplois perdus et des consommateurs mécontents.
La production automobile ne représente qu’environ 10 % à 15 % de l’utilisation mondiale des micropuces, le reste étant destiné à toutes sortes de produits, des téléphones intelligents aux machines à laver (MIT Management, 2022). Cependant, les micropuces sont de plus en plus importantes pour la production automobile, car elles sont utilisées dans tous les domaines, de l’amélioration de l’efficacité du moteur aux écrans DEL. Une voiture moderne moyenne comporte entre 1 400 et 1 500 puces, certaines pouvant même en compter jusqu’à 3 000 (DRrex, 2023). Il est donc impossible de fabriquer un véhicule moderne sans elles. Les constructeurs automobiles ont fait de leur mieux avec ce qu’ils avaient, en donnant souvent la priorité à la production des véhicules les plus haut de gamme et les plus rentables, mais les répercussions économique se sont faites largement ressentir.
Concepteurs et fabricants de micropuces
Les producteurs de micropuces ont également fait tout leur possible en vue de répondre à la demande. Pendant la pandémie de COVID-19, la production de micropuces a atteint un niveau record, comme en témoigne le commerce mondial. En 2022, les exportations de micropuces ont augmenté de 65 % par rapport à 2019, avant la pandémie (se reporter à la figure 2.6). Les usines de fabrication dans lesquelles les micropuces sont produites nécessitent toutefois d’énormes investissements en termes de capital et prennent beaucoup de temps à produire. La production de micropuces représente un processus délicat qui repose sur des propriétés physiques comme la croissance des cristaux, qu’il est impossible d’augmenter à court terme. L’offre n’a pas pu augmenter suffisamment afin de répondre à la demande accrue de micropuces pendant la pandémie. Dans l’ensemble, les pénuries de micropuces survenues pendant la pandémie peuvent être résumées comme constituant une incapacité à augmenter suffisamment l’offre pour répondre à un pic soudain de la demande plutôt que comme un problème de chaîne d’approvisionnement.
Figure 2.6 : La pénurie mondiale de micropuces du point de vue de l’offre
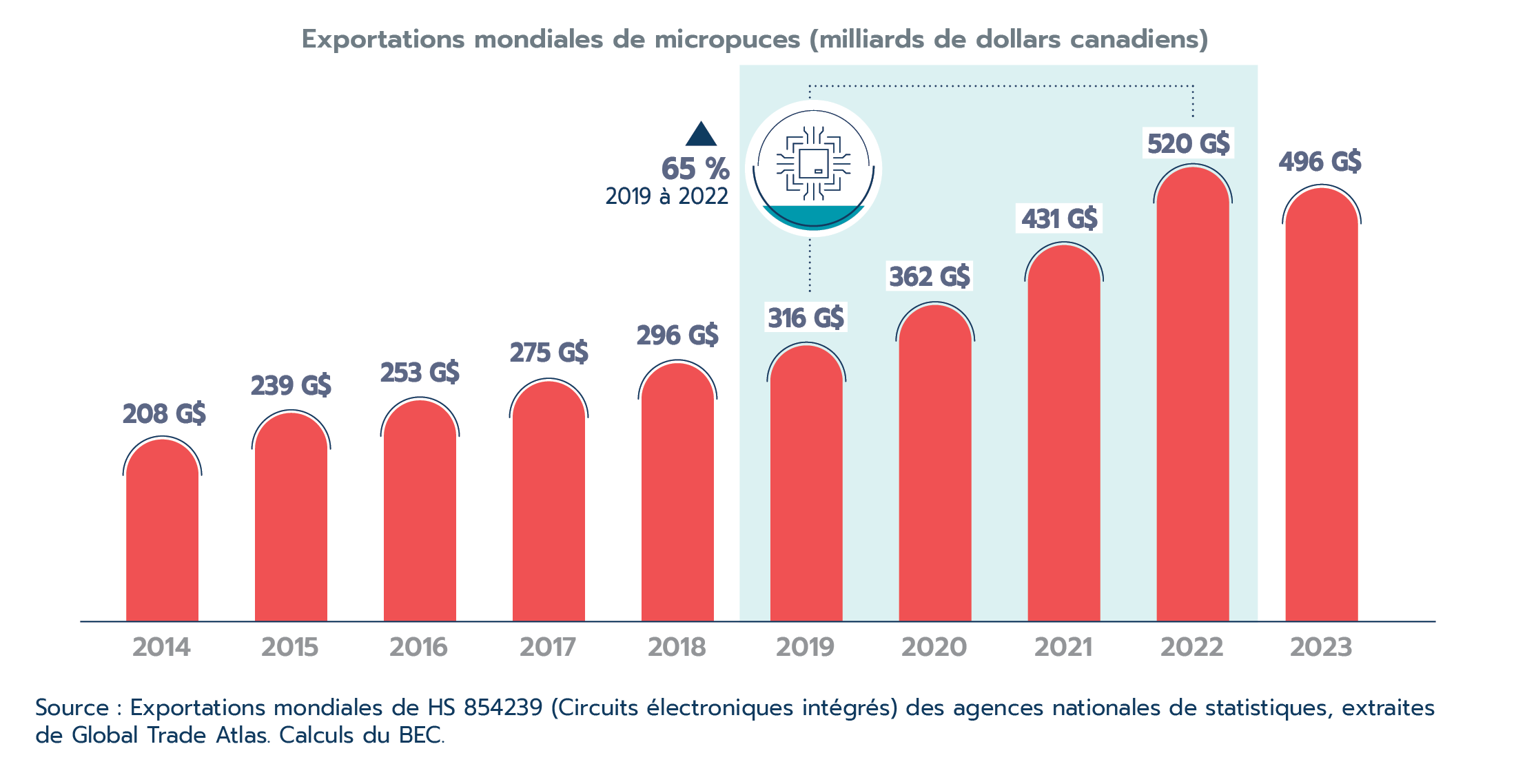
Version texte - Figure 2.6
| Exportations mondiales de micropuces | Milliards de dollars canadiens |
|---|---|
| Source : Exportations mondiales de HS 854239 (Circuits électroniques intégrés) des agences nationales de statistiques, extraites de Global Trade Atlas. Calculs du BEC. | |
| 2014 | 208,4 |
| 2015 | 238,7 |
| 2016 | 253,1 |
| 2017 | 274,8 |
| 2018 | 295,6 |
| 2019 | 315,9 |
| 2020 | 362,2 |
| 2021 | 430,7 |
| 2022 | 519,9 |
| 2023 | 496,1 |
D’une manière générale, les micropuces se divisent en deux catégories : la mémoire et la logique, la première ayant été peu utilisée pendant la pandémie, mais elle a fait l’objet d’une attention particulière plus récemment. De plus, les puces logiques ne sont pas toutes du même type. Celles qui sont utilisées dans la production automobile ne sont peut-être pas les plus sophistiquées, mais elles doivent être très résistantes, capables de supporter des vibrations permanentes et des écarts de température importants. Dans le même temps, les puces les plus avancées sont à la pointe de la production de micropuces et sont souvent décrites en termes de nanomètres en raison de la taille des transistors qui peuvent être conçus ainsi que de la proximité des composants qui peuvent être assemblés, et elles doivent inclure d’autres facteurs innovants comme une dissipation rapide de la chaleur. Ces puces les plus avancées sont utilisées afin de faire fonctionner les centres de données et entraîner les modèles qui font appel à l’intelligence artificielle. Bien que ce ne soit pas ce type de puces qui soit utilisé dans la plupart des applications, et que ce ne soit pas elles qui aient fait l’objet de pénuries pendant la pandémie, ce sont elles qui ont suscité le plus d’attention dans le domaine géopolitique; les pays s’inquiétant de leur rôle dans la prochaine génération de technologies.
Répercussions sur le Canada
En 2023, les importations de micropuces du Canada ne s’élèvent qu’à quelque 1,0f milliards de dollars. Toutefois, ce chiffre sous-estime considérablement les importations canadiennes de micropuces ainsi que leur importance pour l’économie canadienne. La plupart des micropuces qui franchissent les frontières internationales du Canada sont intégrées au sein d’autres produits. La même année, les exportations canadiennes de micropuces ont atteint 300 millions de dollars, ce qui fait résolument du Canada un important importateur net de micropuces. À l’échelle mondiale, la production de micropuces est fortement concentrée en Asie, la majeure partie de la production ayant lieu à Taïwan, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. À elle seule, Taïwan représentait 25,9 % des importations canadiennes de micropuces en 2023, et ce, sans compter celles déjà intégrées dans d’autres produits.
Projets de fabrication nationale de micropuces
La pénurie de micropuces s’est atténuée avec la baisse de la demande de produits électroniques ainsi que l’abandon des mesures de restriction relatives à la pandémie. Les micropuces n’ont cependant pas perdu leur place à la une des journaux. Plus récemment, l’accent a été mis sur les efforts déployés par les États-Unis en vue de relocaliser la production de micropuces en recourant à de généreuses subventions. Aux États-Unis, la part des capacités modernes de fabrication de semi-conducteurs est passée de 37 % en 1990 à 12 % aujourd’hui (U.S. Semiconductor Industry Association, 2024). En juillet 2022, le gouvernement américain a adopté la loi CHIPS (CHIPS Act), qui vise à renforcer la fabrication, la conception et la recherche nationales en matière de semi-conducteurs, à consolider l’économie et la sécurité nationale et à renforcer les chaînes d’approvisionnement en puces des États-Unis. Toutefois, les États-Unis ne sont pas les seuls à jouer à ce jeu. Récemment, le Japon a également accordé des subventions afin d’accroître la production nationale de micropuces de pointe. Les micropuces sont ainsi devenues l’épine dorsale de la plupart des économies ainsi que de la vie moderne. Les micropuces alimentent non seulement les téléphones intelligents, les ordinateurs et Internet, qui représentent tous des caractéristiques de la vie moderne, mais également les voitures, les machines à laver et tout autre produit qui utilise des micropuces dans une certaine mesure, y compris dans le domaine des soins de santé. En bref, les micropuces sont essentielles à l’économie, à la santé et à la sécurité de la population canadienne. Il est donc essentiel d’en garantir un approvisionnement sûr.
La pandémie de COVID-19 entraîne un déplacement de la demande des consommateurs des services vers les biens.
Si l’on examine cette période relative à la pandémie de COVID-19, on constate qu’il s’agit davantage de chocs du côté de la demande que de perturbations du côté de l’offre. La forte baisse initiale de la production s’est rapidement inversée alors que des mesures en matière de relance budgétaire et monétaire sans précédent commençaient à produire leurs effets au sein des économies développées. Comme l’expliquent Makin et Layton (2021), la réponse budgétaire à la crise a pris diverses formes et elle a également varié selon les pays. Elle comprenait, entre autres, des prestations sociales aux particuliers, des subventions aux petites entreprises, des mesures de soutien aux entreprises pour qu’elles conservent leur personnel, ainsi que des services de garde d’enfants subventionnés. Le FMI estime que les déficits budgétaires mondiaux ont augmenté de 6 points de pourcentage entre 2019 et 2020 en vue atteindre un niveau record de 9,6 % du PIB mondial. Les interventions relatives à la politique monétaire varient également d’un pays à l’autre; Saker (2020) décrit les fortes réductions des taux d’intérêt qui ont suivi la pandémie de COVID-19,Note de bas de page 10 combinées à diverses formes d’achats d’actifs, à des mesures de crédit et de liquidité, ainsi qu’à diverses mesures macrofinancières. Cette combinaison à la fois d’un soutien budgétaire et monétaire solide, et le fait que de nombreuses économies ont mieux résisté à la pandémie de COVID-19 que prévu, ont conduit à une forte reprise de l’économie mondiale. Comme le montre la figure 2.7, après avoir chuté de 2,8 % en 2020, le PIB mondial réel a augmenté de 6,3 % en 2021.
Figure 2.7 : Croissance du PIB mondial réel (variation en pourcentage)
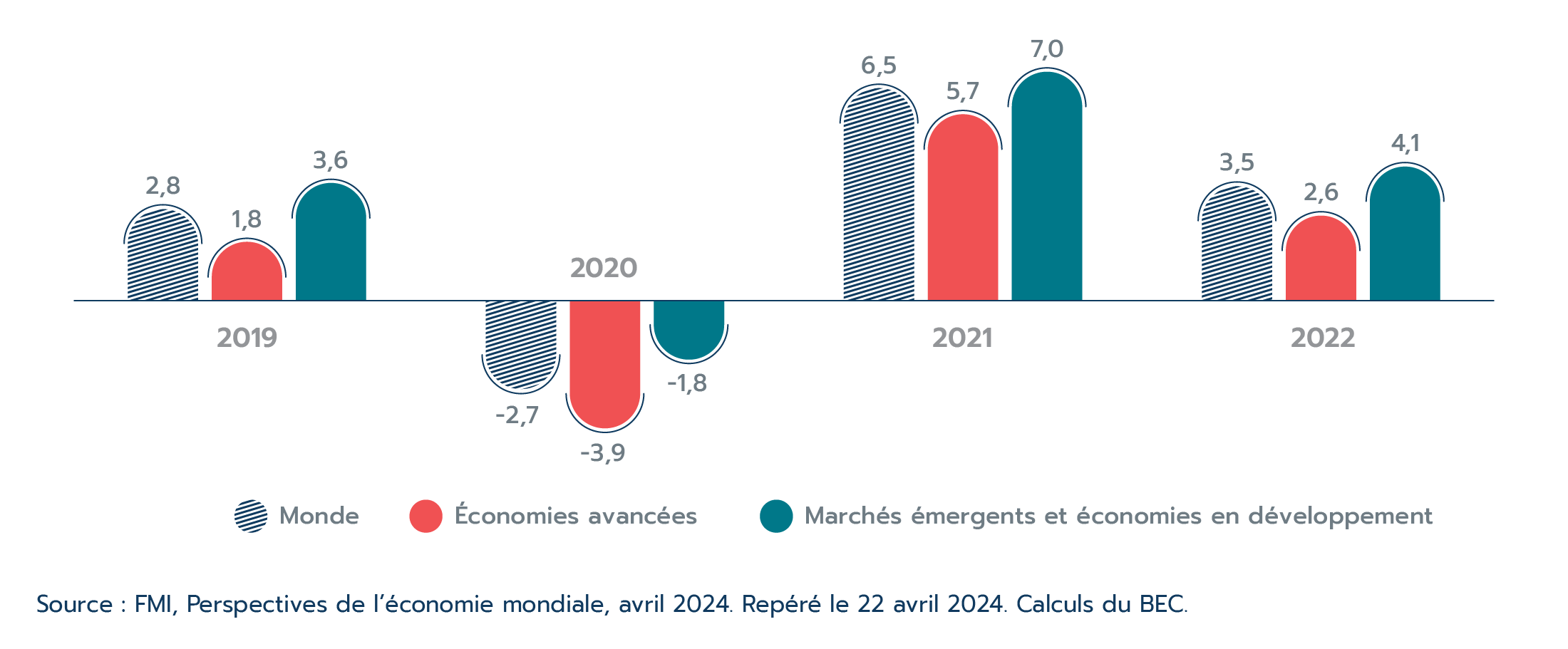
Version texte - Figure 2.7
| Année | Monde | Économies avancées | Marchés émergents et économies en développement |
|---|---|---|---|
| Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2023. Repéré le 22 avril 2024. Calculs du BEC. | |||
| 2019 | 2,8 | 1,8 | 3,6 |
| 2020 | -2,7 | -3,9 | -1,8 |
| 2021 | 6,5 | 5,7 | 7 |
| 2022 | 3,5 | 2,6 | 4,1 |
Outre les mesures en matière de relance budgétaire et monétaire, les habitudes de consommation ont également changé de manière radicale. Les consommateurs qui consacraient autrefois une grande partie de leurs revenus aux repas au restaurant, au cinéma, aux voyages et à d’autres services se retrouvaient désormais coincés chez eux à la recherche de distractions. Ces personnes ont acheté des téléviseurs, des machines à jeux vidéo, des machines à pain, des vélos d’appartement, des chaises de bureau et ont lancé des projets d’amélioration de l’habitat afin de rendre les mesures de confinement relatives à la pandémie de COVID-19 plus supportables. En bref, les mesures de relance, la résilience économique et un changement de mode de vie – qui s’est traduit par un passage des services aux biens – ont entraîné un important choc de la demande pour les biens de consommation durables.
La figure 2.8 illustre l’évolution importante des dépenses réelles personnelles en biens de consommation au cours de la pandémie de COVID-19, tant au Canada qu’aux États-Unis. Aux États-Unis, la hausse des dépenses de consommation de biens a été particulièrement forte, augmentant de 18,6 % entre le quatrième trimestre de 2019 (début de la pandémie de COVID-19) et le quatrième trimestre de 2021. Dans le cas du Canada, la hausse est moins prononcée, mais reste considérable; les dépenses en biens augmentant de 11,7 % entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021. Cependant, comme l’illustre la figure 2.8, si l’on examine une ventilation plus détaillée des dépenses de consommation de la population canadienne, on constate une croissance exceptionnellement forte dans des domaines comme l’ameublement, les articles de loisirs et les produits relatifs au jardinage et aux soins des animaux de compagnie, alors que, comme mentionné précédemment, les dépenses en matière de services, en particulier les services de restauration et d’hébergement et les dépenses relatives aux voyages, ont connu une forte baisse.
Figure 2.8 : Un passage important des services aux biens
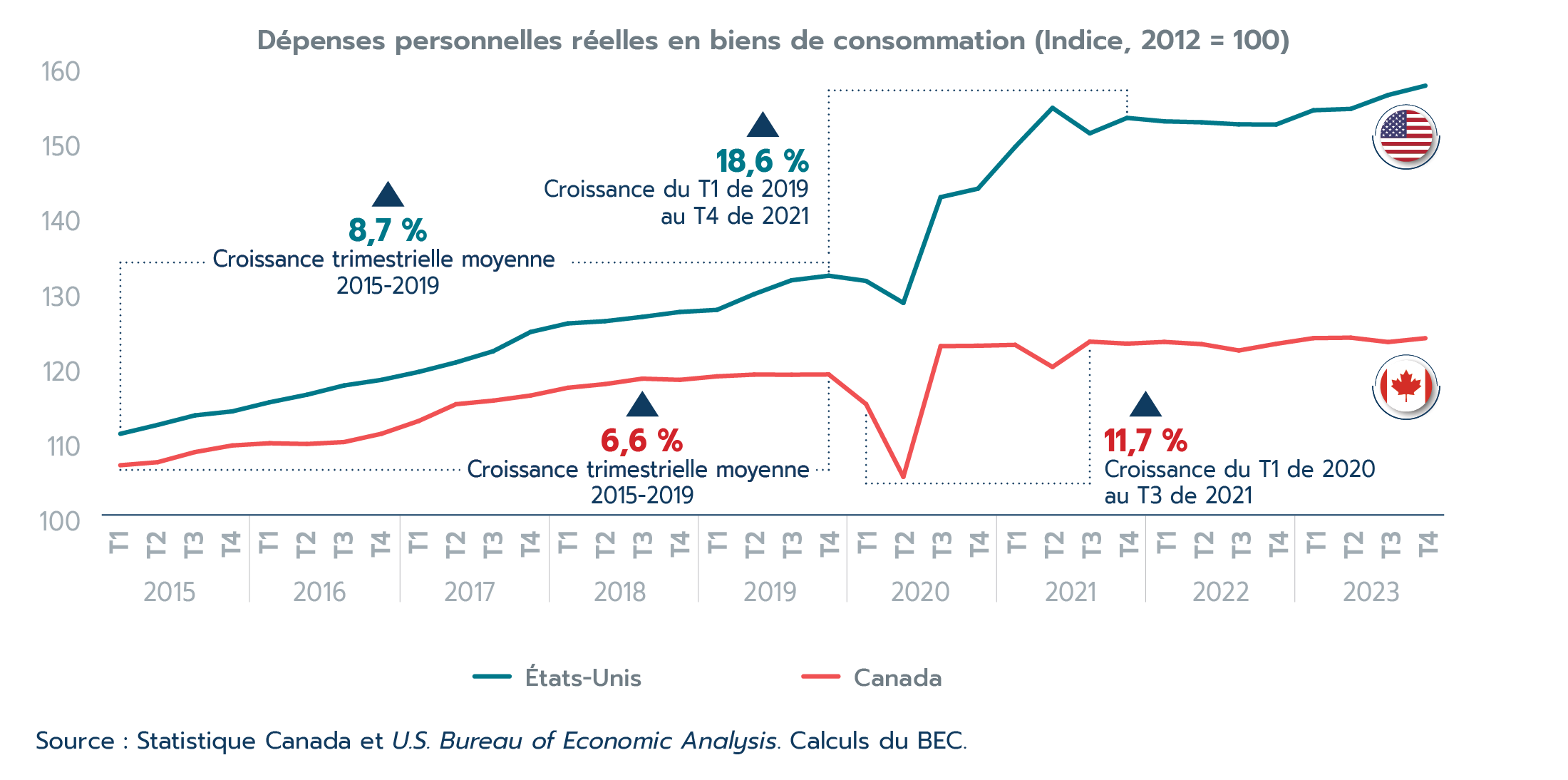
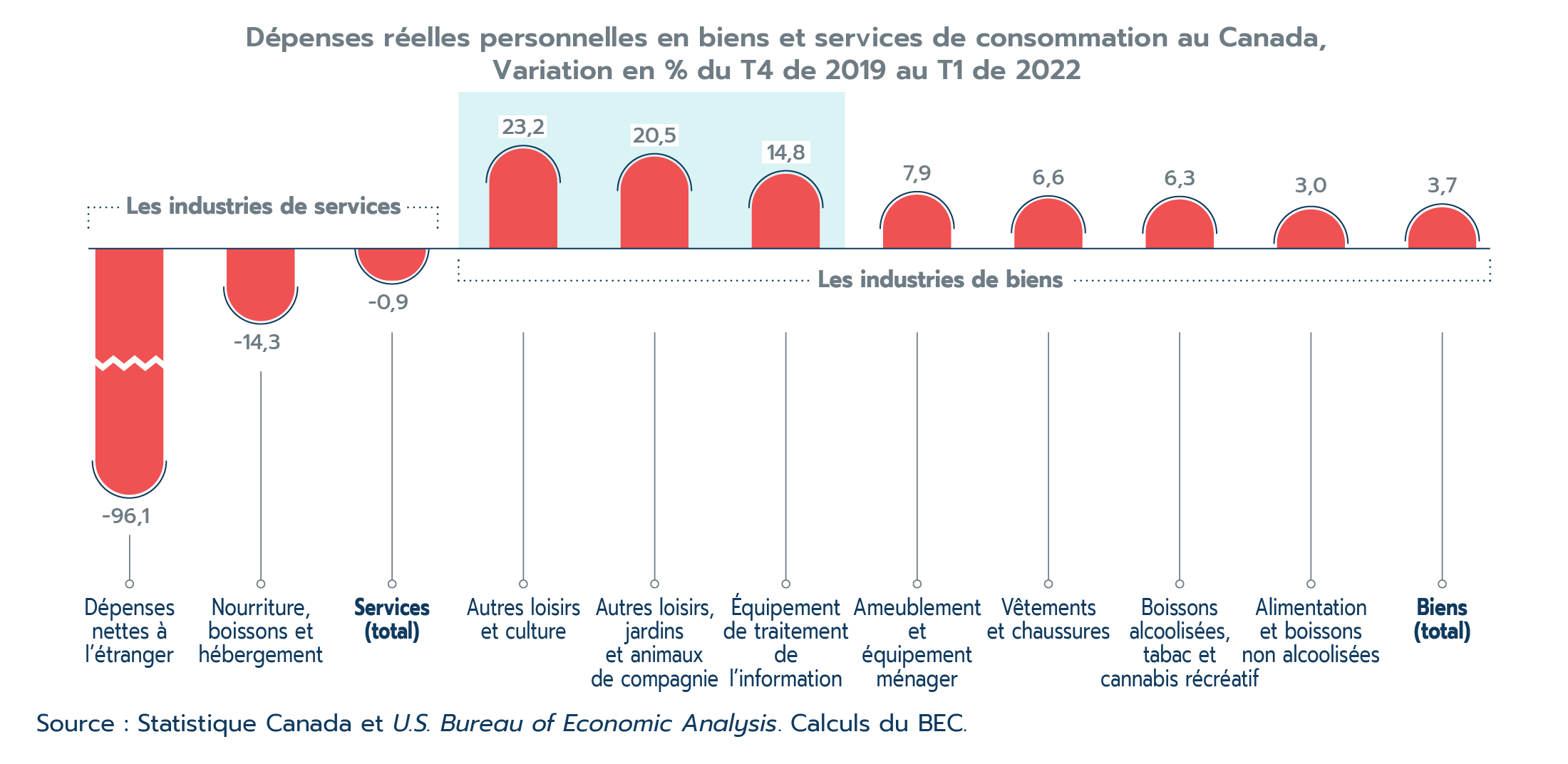
Version texte - Figure 2.8
| Trimestres | États-Unis | Canada |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada et U.S. Bureau of Economic Analysis. Calculs du BEC. | ||
| 2015 : T1 | 110,8 | 106,6 |
| 2015 : T2 | 112,0 | 107,0 |
| 2015 : T3 | 113,3 | 108,4 |
| 2015 : T4 | 113,8 | 109,3 |
| 2016 : T1 | 115,0 | 109,6 |
| 2016 : T2 | 116,0 | 109,4 |
| 2016 : T3 | 117,3 | 109,7 |
| 2016 : T4 | 118,0 | 110,8 |
| 2017 : T1 | 119,1 | 112,5 |
| 2017 : T2 | 120,3 | 114,8 |
| 2017 : T3 | 121,8 | 115,2 |
| 2017 : T4 | 124,4 | 115,9 |
| 2018 : T1 | 125,5 | 116,9 |
| 2018 : T2 | 125,8 | 117,4 |
| 2018 : T3 | 126,4 | 118,2 |
| 2018 : T4 | 127,0 | 118,0 |
| 2019 : T1 | 127,3 | 118,5 |
| 2019 : T2 | 129,4 | 118,7 |
| 2019 : T3 | 131,3 | 118,7 |
| 2019 : T4 | 131,9 | 118,7 |
| 2020 : T1 | 131,2 | 114,8 |
| 2020 : T2 | 128,3 | 105,1 |
| 2020 : T3 | 142,3 | 122,5 |
| 2020 : T4 | 143,5 | 122,5 |
| 2021 : T1 | 149,0 | 122,7 |
| 2021 : T2 | 154,2 | 119,7 |
| 2021 : T3 | 150,8 | 123,1 |
| 2021 : T4 | 152,9 | 122,8 |
| 2022 : T1 | 152,4 | 123,1 |
| 2022 : T2 | 152,3 | 122,8 |
| 2022 : T3 | 152,0 | 121,9 |
| 2022 : T4 | 152,0 | 122,8 |
| 2023 : T1 | 153,9 | 123,6 |
| 2023 : T2 | 154,1 | 123,6 |
| 2023 : T3 | 155,9 | 123,0 |
| 2023 : T4 | 157,2 | 123,5 |
| Croissance trimestrielle moyenne (2015-2019) | 8,7 % | 6,6 % |
| Croissance du T1 de 2019 au T4 de 2021 | 18,6 % | S.O. |
| Croissance du T1 de 2020 au T3 de 2021 | S.O. | 11,7 % |
| Trimestres | Variation en % |
|---|---|
| Source : Statistique Canada et U.S. Bureau of Economic Analysis. Calculs du BEC. | |
| Dépenses nettes à l’étranger | - 96,1 |
| Nourriture, boissons et hébergement | - 14,3 |
| Services (total) | - 0,9 |
| Autres loisirs et culture | 23,2 |
| Autres loisirs, jardins et animaux de compagnie | 20,5 |
| Équipement de traitement de l’information | 14,8 |
| Ameublement et équipement ménager | 7,9 |
| Vêtements et chaussures | 6,6 |
| Boissons alcoolisées, tabac et cannabis récréatif | 6,3 |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 3 |
| Biens (total) | 3,7 |
Augmentation des exportations de la Chine
Ce passage des services aux biens ainsi qu’une forte augmentation de la demande pour de nombreux biens de consommation durables ont eu des répercussions importantes sur les chaînes d’approvisionnement internationales au cours de la pandémie de COVID-19. Avant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays développés s’étaient lentement détournés de l’industrie manufacturière au profit d’économies davantage axées sur les services. Dans le cas du Canada, la part de l’industrie manufacturière dans le PIB était déjà de 15 % en 1997, puis elle est tombée à 10 % en 2019. En revanche, les économies de l’Asie, et en particulier celle de la Chine, sont devenues de grands exportateurs de produits manufacturés. Selon les données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (ÉVA), la part de la Chine dans les exportations manufacturières mondiales est passée de 2,7 % en 1995 à 18,6 % en 2019. Par conséquent, une grande partie de l’augmentation de la demande de biens de consommation durables au cours de la pandémie de COVID-19 a été satisfaite par la Chine.
Figure 2.9 : Forte croissance des exportations de la Chine
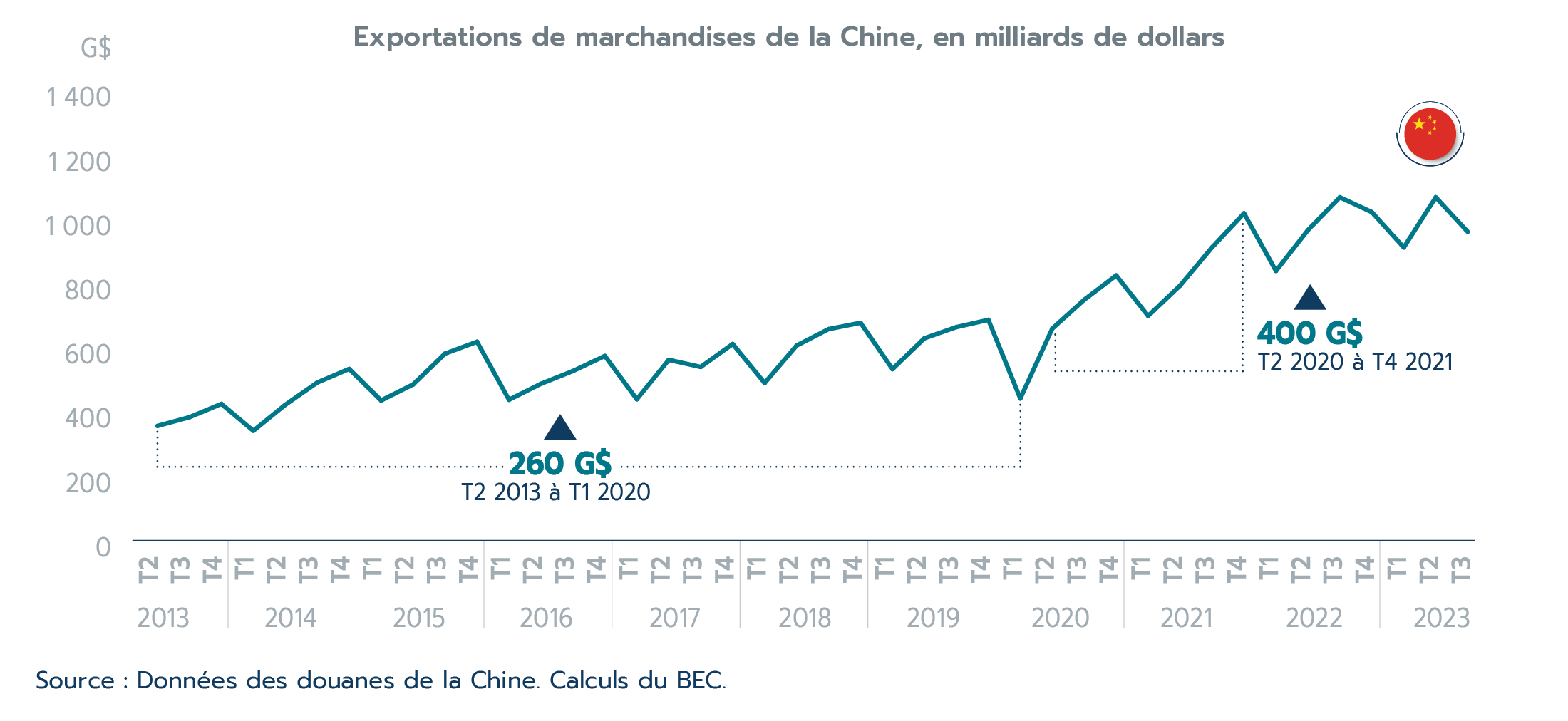
Version texte - Figure 2.9
| Trimestres | Exportations de marchandises de la Chine, en milliards de dollars |
|---|---|
| Source : Données des douanes de la Chine. Calculs du BEC. | |
| T2 de 2013 | 556,7 |
| T3 de 2013 | 583,8 |
| T4 de 2013 | 625,2 |
| T1 de 2014 | 541,7 |
| T2 de 2014 | 622,5 |
| T3 de 2014 | 691,7 |
| T4 de 2014 | 734,0 |
| T1 de 2015 | 636,0 |
| T2 de 2015 | 685,7 |
| T3 de 2015 | 781,7 |
| T4 de 2015 | 818,6 |
| T1 de 2016 | 638,1 |
| T2 de 2016 | 687,8 |
| T3 de 2016 | 727,5 |
| T4 de 2016 | 774,4 |
| T1 de 2017 | 639,8 |
| T2 de 2017 | 762,3 |
| T3 de 2017 | 740,2 |
| T4 de 2017 | 811,7 |
| T1 de 2018 | 690,2 |
| T2 de 2018 | 806,8 |
| T3 de 2018 | 857,9 |
| T4 de 2018 | 877,6 |
| T1 de 2019 | 733,6 |
| T2 de 2019 | 829,5 |
| T3 de 2019 | 864,2 |
| T4 de 2019 | 886,8 |
| T1 de 2020 | 642,2 |
| T2 de 2020 | 859,7 |
| T3 de 2020 | 949,3 |
| T4 de 2020 | 1025,1 |
| T1 de 2021 | 899,0 |
| T2 de 2021 | 993,5 |
| T3 de 2021 | 1112,4 |
| T4 de 2021 | 1218,2 |
| T1 de 2022 | 1039,0 |
| T2 de 2022 | 1166,0 |
| T3 de 2022 | 1268,0 |
| T4 de 2022 | 1221,9 |
| T1 de 2023 | 1112,1 |
| T2 de 2023 | 1268,0 |
| T3 de 2023 | 1160,8 |
La figure 2.9 montre l’évolution des exportations de la Chine avant, pendant et après la pandémie de COVID-19. Elle illustre deux points intéressants. Tout d’abord, si la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions initiales sur les exportations de la Chine, il s’agissait d’une perturbation de courte durée et limitée. Les exportations de la Chine ont chuté de 247 milliards de dollars US, soit 27,8 %, entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, mais elles se sont rapidement redressées et ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie au troisième trimestre de 2020. Deuxièmement, la figure illustre l’augmentation radicale des exportations de la Chine après la perturbation initiale causée par la pandémie de COVID-19, les exportations ayant augmenté de 400 milliards de dollars au cours des deux années qui ont suivi. En comparaison, il a fallu six ans pour que les exportations de la Chine augmentent de 260 milliards de dollars avant la pandémie de COVID-19. Bien que, sans aucun doute, l’approvisionnement de certains produits en provenance de Chine ait été interrompu en raison de mesures de confinement strictes dans ce pays. La production et les exportations de la Chine ont augmenté rapidement afin de répondre à la demande accrue.
Les systèmes de transport sont lents à s’adapter au choc causé par la demande
La croissance de la demande de marchandises, à laquelle l’Asie – et plus particulièrement la Chine – a joué un rôle important, a exercé une pression sur les réseaux mondiaux de transport maritime. Ce fut l’un des principaux points d’étranglement et l’une des principales complications pour les chaînes d’approvisionnement internationales lors de la pandémie de COVID-19. Alors que la production augmentait, les réseaux de transport n’étaient pas en mesure de s’adapter au même rythme, car leur expansion nécessite des capitaux considérables et beaucoup de temps. Conçus pour croître à un rythme habituel, ces réseaux n’ont pas pu faire face à la forte augmentation des marchandises transportées. Komaromi, Cerdeiro et Liu (2022) montrent qu’en raison de la congestion des ports et des retards, la durée moyenne des trajets maritimes a commencé à augmenter après le début de la pandémie de COVID-19, et qu’en décembre 2021, elle avait augmenté de 25 %. Les auteurs constatent que ces retards relatifs à l’expédition ont eu des répercussions importantes sur les coûts du commerce mondial, estimant que les jours de transit supplémentaires pour l’expédition moyenne en décembre 2021 peuvent être comparés à un tarif ad valorem de 0,9 à 3,1 %.
Les retards portuaires observés à l’échelle mondiale ont été particulièrement marqués sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, les ports de Vancouver, Prince Rupert, Seattle, Los Angeles et Long Beach ayant tous connu une forte augmentation des temps de transit entre la moitié de 2020 et 2021. Selon Transports Canada, le temps de transit moyen de bout en bout des conteneurs, mesuré depuis Shanghai jusqu’à Chicago en passant par le port de Vancouver ou de Prince Rupert, est passé d’une moyenne de 25,4 jours en 2019 à 29,1 jours en 2020 et à 33,8 jours en 2021. Cette forte pression sur le transport maritime s’est également traduite par une escalade des prix du transport par conteneurs. Selon le Baltic Freight Index (BFI), et comme le montre la figure 2.10, le prix du transport maritime de conteneurs a augmenté de 385 %, soit plus de quatre fois, entre novembre 2020 et septembre 2021. Les retards dans les ports signifient que les marchandises doivent attendre plus longtemps sur les navires, ce qui entraîne une augmentation des prix, mais réduit aussi la disponibilité du transport maritime, ce qui a conduit à l’augmentation rapide des coûts de transport maritime observée pendant la pandémie de COVID-19. D’autres modes de transport ont également connu des augmentations de prix, bien qu’elles soient moins importantes que pour le transport maritime. Au Canada, l’Indice des prix des services de transport ferroviaire de marchandises (IPSTFM) a augmenté de 21 % entre novembre 2020 et juillet 2022, tandis que l’Indice des prix des services de camionnage pour compte d’autrui (IPSCCA) a augmenté de 36 % au cours de la même période.
Figure 2.10 : Hausse et baisse des coûts du transport maritime
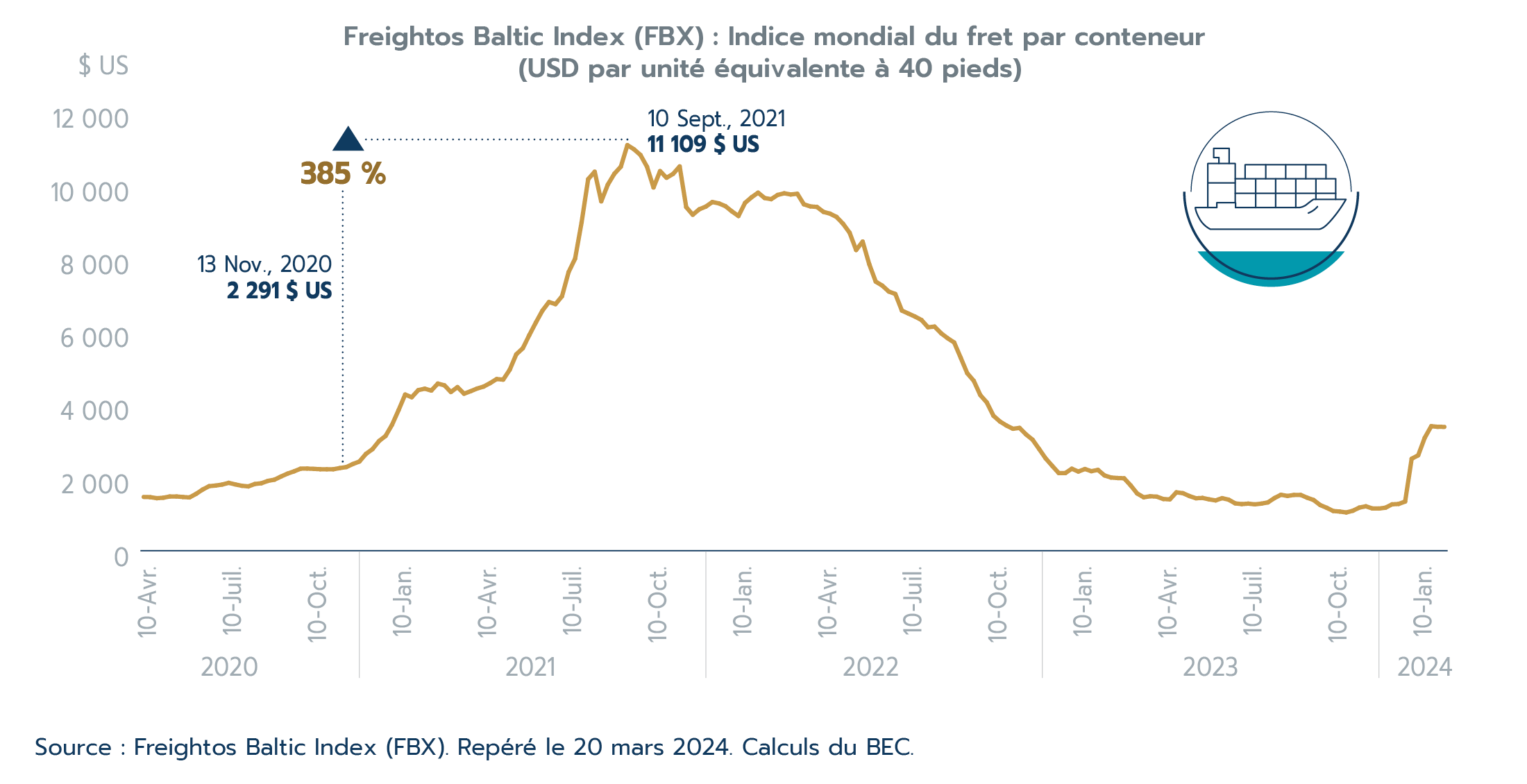
Version texte - Figure 2.10
| Date | Freightos Baltic Index |
|---|---|
| Source : Freightos Baltic Index (FBX). Repéré le 20 mars 2024. Calculs du BEC. | |
| 10 avril 2020 | 1 473 |
| 17 avril 2020 | 1 467 |
| 24 avril 2020 | 1 439 |
| 1er mai 2020 | 1 451 |
| 8 mai 2020 | 1 487 |
| 15 mai 2020 | 1 487 |
| 22 mai 2020 | 1 471 |
| 29 mai 2020 | 1 459 |
| 5 juin 2020 | 1 556 |
| 12 juin 2020 | 1 674 |
| 19 juin 2020 | 1 768 |
| 26 juin 2020 | 1 785 |
| 3 juill. 2020 | 1 812 |
| 10 juill. 2020 | 1 859 |
| 17 juill. 2020 | 1 816 |
| 24 juill. 2020 | 1 779 |
| 31 juill. 2020 | 1 762 |
| 7 août 2020 | 1 828 |
| 14 août 2020 | 1 848 |
| 21 août 2020 | 1 913 |
| 28 août 2020 | 1 946 |
| 4 sept. 2020 | 2 032 |
| 11 sept. 2020 | 2 112 |
| 18 sept. 2020 | 2 174 |
| 25 sept. 2020 | 2 247 |
| 2 oct. 2020 | 2 250 |
| 9 oct. 2020 | 2 242 |
| 16 oct. 2020 | 2 232 |
| 23 oct. 2020 | 2 230 |
| 30 oct. 2020 | 2 231 |
| 6 nov. 2020 | 2 264 |
| 13 nov. 2020 | 2 291 |
| 20 nov. 2020 | 2 375 |
| 27 nov. 2020 | 2 443 |
| 4 déc. 2020 | 2 652 |
| 11 déc. 2020 | 2 782 |
| 18 déc. 2020 | 3 004 |
| 25 déc. 2020 | 3 143 |
| 1er janv. 2021 | 3 452 |
| 8 janv. 2021 | 3 854 |
| 15 janv. 2021 | 4 277 |
| 22 janv. 2021 | 4 204 |
| 29 janv. 2021 | 4 398 |
| 5 févr. 2021 | 4 438 |
| 12 févr. 2021 | 4 386 |
| 19 févr. 2021 | 4 578 |
| 26 févr. 2021 | 4 530 |
| 5 mars 2021 | 4 347 |
| 12 mars 2021 | 4 481 |
| 19 mars 2021 | 4 300 |
| 26 mars 2021 | 4 367 |
| 2 avril 2021 | 4 442 |
| 9 avril 2021 | 4 495 |
| 16 avril 2021 | 4 591 |
| 23 avril 2021 | 4 702 |
| 30 avril 2021 | 4 686 |
| 7 mai 2021 | 4 957 |
| 14 mai 2021 | 5 379 |
| 21 mai 2021 | 5 545 |
| 28 mai 2021 | 5 908 |
| 4 juin 2021 | 6 251 |
| 11 juin 2021 | 6 576 |
| 18 juin 2021 | 6 811 |
| 25 juin 2021 | 6 753 |
| 2 juill. 2021 | 6 970 |
| 9 juill. 2021 | 7 629 |
| 16 juill. 2021 | 7 998 |
| 23 juill. 2021 | 8 999 |
| 30 juill. 2021 | 10 176 |
| 6 août 2021 | 10 380 |
| 13 août 2021 | 9 568 |
| 20 août 2021 | 10 024 |
| 27 août 2021 | 10 323 |
| 3 sept. 2021 | 10 519 |
| 10 sept. 2021 | 11 109 |
| 17 sept. 2021 | 10 996 |
| 24 sept. 2021 | 10 839 |
| 1er oct. 2021 | 10 517 |
| 8 oct. 2021 | 9 949 |
| 15 oct. 2021 | 10 396 |
| 22 oct. 2021 | 10 215 |
| 29 oct. 2021 | 10 321 |
| 5 nov. 2021 | 10 525 |
| 12 nov. 2021 | 9 411 |
| 19 nov. 2021 | 9 202 |
| 26 nov. 2021 | 9 351 |
| 3 déc. 2021 | 9 425 |
| 10 déc. 2021 | 9 550 |
| 17 déc. 2021 | 9 513 |
| 24 déc. 2021 | 9 437 |
| 31 déc. 2021 | 9 293 |
| 7 janv. 2022 | 9 167 |
| 14 janv. 2022 | 9 526 |
| 21 janv. 2022 | 9 680 |
| 28 janv. 2022 | 9 806 |
| 4 févr. 2022 | 9 660 |
| 11 févr. 2022 | 9 628 |
| 18 févr. 2022 | 9 745 |
| 25 févr. 2022 | 9 789 |
| 4 mars 2022 | 9 757 |
| 11 mars 2022 | 9 777 |
| 18 mars 2022 | 9 488 |
| 25 mars 2022 | 9 430 |
| 1er avril 2022 | 9 416 |
| 8 avril 2022 | 9 280 |
| 15 avril 2022 | 9 232 |
| 22 avril 2022 | 9 142 |
| 29 avril 2022 | 8 955 |
| 6 mai 2022 | 8 710 |
| 13 mai 2022 | 8 236 |
| 20 mai 2022 | 8 466 |
| 27 mai 2022 | 7 851 |
| 3 juin 2022 | 7 370 |
| 10 juin 2022 | 7 261 |
| 17 juin 2022 | 7 098 |
| 24 juin 2022 | 7 032 |
| 1er juill. 2022 | 6 577 |
| 8 juill. 2022 | 6 495 |
| 15 juill. 2022 | 6 414 |
| 22 juill. 2022 | 6 319 |
| 29 juill. 2022 | 6 120 |
| 5 août 2022 | 6 139 |
| 12 août 2022 | 5 956 |
| 19 août 2022 | 5 820 |
| 26 août 2022 | 5 703 |
| 2 sept. 2022 | 5 286 |
| 9 sept. 2022 | 4 862 |
| 16 sept. 2022 | 4 653 |
| 23 sept. 2022 | 4 262 |
| 30 sept. 2022 | 4 060 |
| 7 oct. 2022 | 3 699 |
| 14 oct. 2022 | 3 540 |
| 21 oct. 2022 | 3 429 |
| 28 oct. 2022 | 3 340 |
| 4 nov. 2022 | 3 364 |
| 11 nov. 2022 | 3 185 |
| 18 nov. 2022 | 3 040 |
| 25 nov. 2022 | 2 786 |
| 2 déc. 2022 | 2 528 |
| 9 déc. 2022 | 2 325 |
| 16 déc. 2022 | 2 127 |
| 23 déc. 2022 | 2 126 |
| 30 déc. 2022 | 2 246 |
| 6 janv. 2023 | 2 168 |
| 13 janv. 2023 | 2 238 |
| 20 janv. 2023 | 2 178 |
| 27 janv. 2023 | 2 214 |
| 3 févr. 2023 | 2 062 |
| 10 févr. 2023 | 2 005 |
| 17 févr. 2023 | 1 991 |
| 24 févr. 2023 | 1 984 |
| 3 mars 2023 | 1 790 |
| 10 mars 2023 | 1 568 |
| 17 mars 2023 | 1 463 |
| 24 mars 2023 | 1 492 |
| 31 mars 2023 | 1 481 |
| 7 avril 2023 | 1 416 |
| 14 avril 2023 | 1 406 |
| 21 avril 2023 | 1 599 |
| 28 avril 2023 | 1 576 |
| 5 mai 2023 | 1 497 |
| 12 mai 2023 | 1 437 |
| 19 mai 2023 | 1 446 |
| 26 mai 2023 | 1 407 |
| 2 juin 2023 | 1 378 |
| 9 juin 2023 | 1 440 |
| 16 juin 2023 | 1 398 |
| 23 juin 2023 | 1 297 |
| 30 juin 2023 | 1 277 |
| 7 juill. 2023 | 1 290 |
| 14 juill. 2023 | 1 270 |
| 21 juill. 2023 | 1 290 |
| 28 juill. 2023 | 1 323 |
| 4 août 2023 | 1 441 |
| 11 août 2023 | 1 533 |
| 18 août 2023 | 1 500 |
| 25 août 2023 | 1 529 |
| 1er sept. 2023 | 1 530 |
| 8 sept. 2023 | 1 453 |
| 15 sept. 2023 | 1 389 |
| 22 sept. 2023 | 1 251 |
| 29 sept. 2023 | 1 176 |
| 6 oct. 2023 | 1 088 |
| 13 oct. 2023 | 1 073 |
| 20 oct. 2023 | 1 048 |
| 26 oct. 2023 | 1 095 |
| 3 nov. 2023 | 1 182 |
| 10 nov. 2023 | 1 217 |
| 17 nov. 2023 | 1 157 |
| 24 nov. 2023 | 1 155 |
| 1er déc. 2023 | 1 179 |
| 8 déc. 2023 | 1 270 |
| 15 déc. 2023 | 1 281 |
| 22 déc. 2023 | 1 346 |
| 5 janv. 2024 | 2 519 |
| 12 janv. 2024 | 2 613 |
| 19 janv. 2024 | 3 093 |
| 26 janv. 2024 | 3 411 |
| 2 févr. 2024 | 3 393 |
| 9 févr. 2024 | 3 392 |
Y a-t-il des leçons à tirer de la pandémie de COVID-19?
On dit souvent que la pandémie a démontré la fragilité des chaînes d’approvisionnement internationales. Après l’examen des éléments de preuve, le contraire pourrait en fait être une conclusion plus juste. La planète entière a connu une pandémie relativement coordonnée et, malgré cela, les rayons des épiceries au Canada sont restés approvisionnés, les besoins de base ont été satisfaits et même la consommation ostentatoire s’est poursuivie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’enjeux. En effet, comme le montre la figure 2.11, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de 16 % du volume des échanges mondiaux entre décembre 2019 et avril 2020. Il y a effectivement eu des pénuries, qu’il s’agisse de puces électroniques (se reporter à l’encadré 2.1), de médicaments, d’EPI ou de vaccins nécessaires. Les fermetures d’usines en Chine ont eu un effet domino, limitant ainsi les intrants nécessaires à la production dans d’autres pays. Mais comme l’indique aussi la figure 2.11, le volume du commerce mondial a rapidement rebondi et a déjà retrouvé son niveau d’avant la pandémie de COVID-19 en novembre 2020. Bien que le débat soit toujours ouvert, on peut en effet soutenir que la pandémie de COVID-19 a illustré à la fois les vulnérabilités et les atouts des chaînes d’approvisionnement internationales.
Figure 2.11 : Baisse et reprise du commerce mondial
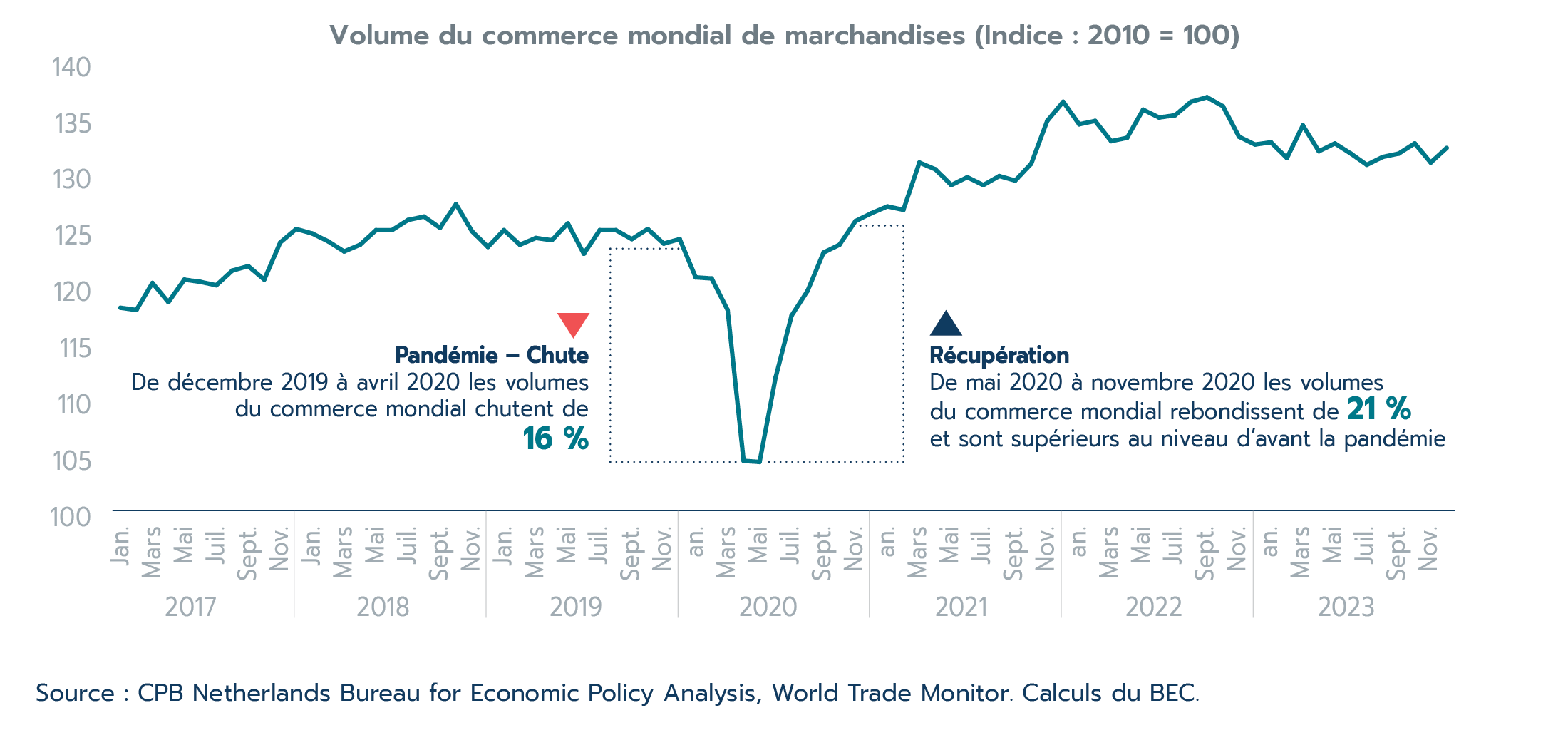
Version texte - Figure 2.11
| Mois | Volume du commerce mondial de Marsandises |
|---|---|
| Source : CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor. Calculs du BEC. | |
| 2017 - Janvier | 118,0 |
| 2017 - Février | 117,8 |
| 2017 - Mars | 120,2 |
| 2017 - Avril | 118,5 |
| 2017 - Mai | 120,5 |
| 2017 - Juin | 120,3 |
| 2017 - Juillet | 120,0 |
| 2017 - Août | 121,3 |
| 2017 - Septembre | 121,7 |
| 2017 - Octobre | 120,5 |
| 2017 - Novembre | 123,8 |
| 2017 - Décembre | 125,0 |
| 2018 - Janvier | 124,6 |
| 2018 - Février | 123,9 |
| 2018 - Mars | 123,0 |
| 2018 - Avril | 123,6 |
| 2018 - Mai | 124,9 |
| 2018 - Juin | 124,9 |
| 2018 - Juillet | 125,8 |
| 2018 - Août | 126,1 |
| 2018 - Septembre | 125,1 |
| 2018 - Octobre | 127,2 |
| 2018 - Novembre | 124,8 |
| 2018 - Décembre | 123,4 |
| 2019 - Janvier | 124,9 |
| 2019 - Février | 123,6 |
| 2019 - Mars | 124,2 |
| 2019 - Avril | 124,0 |
| 2019 - Mai | 125,5 |
| 2019 - Juin | 122,8 |
| 2019 - Juillet | 124,9 |
| 2019 - Août | 124,9 |
| 2019 - Septembre | 124,1 |
| 2019 - Octobre | 125,0 |
| 2019 - Novembre | 123,7 |
| 2019 - Décembre | 124,1 |
| 2020 - Janvier | 120,7 |
| 2020 - Février | 120,6 |
| 2020 - Mars | 117,8 |
| 2020 - Avril | 104,4 |
| 2020 - Mai | 104,3 |
| 2020 - Juin | 111,8 |
| 2020 - Juillet | 117,3 |
| 2020 - Août | 119,5 |
| 2020 - Septembre | 122,9 |
| 2020 - Octobre | 123,6 |
| 2020 - Novembre | 125,7 |
| 2020 - Décembre | 126,4 |
| 2021 - Janvier | 127,0 |
| 2021 - Février | 126,7 |
| 2021 - Mars | 130,9 |
| 2021 - Avril | 130,3 |
| 2021 - Mai | 128,9 |
| 2021 - Juin | 129,6 |
| 2021 - Juillet | 128,9 |
| 2021 - Août | 129,7 |
| 2021 - Septembre | 129,3 |
| 2021 - Octobre | 130,8 |
| 2021 - Novembre | 134,6 |
| 2021 - Décembre | 136,3 |
| 2022 - Janvier | 134,3 |
| 2022 - Février | 134,6 |
| 2022 - Mars | 132,8 |
| 2022 - Avril | 133,1 |
| 2022 - Mai | 135,6 |
| 2022 - Juin | 134,9 |
| 2022 - Juillet | 135,1 |
| 2022 - Août | 136,3 |
| 2022 - Septembre | 136,7 |
| 2022 - Octobre | 135,9 |
| 2022 - Novembre | 133,2 |
| 2022 - Décembre | 132,5 |
| 2023 - Janvier | 132,7 |
| 2023 - Février | 131,3 |
| 2023 - Mars | 134,2 |
| 2023 - Avril | 131,9 |
| 2023 - Mai | 132,6 |
| 2023 - Juin | 131,7 |
| 2023 - Juillet | 130,7 |
| 2023 - Août | 131,4 |
| 2023 - Septembre | 131,7 |
| 2023 - Octobre | 132,6 |
| 2023 - Novembre | 130,9 |
| 2023 - Décembre | 132,2 |
Les leçons que les gouvernements ou les entreprises devraient tirer de la pandémie de COVID-19 en termes de chaînes d’approvisionnement sont encore loin d’être claires. La mise en place et le maintien d’une capacité supplémentaire de production et de consommation dans tous les secteurs de l’économie coûteraient très cher pour un événement qui, souhaitons-le, ne se reproduira plus jamais. Il peut être d’ailleurs préférable d’investir dans la prévention des pandémies plutôt que dans le renforcement des capacités de la chaîne d’approvisionnement. Parmi les autres enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, on peut citer l’amélioration de la transparence des chaînes d’approvisionnement : pour que les entreprises puissent réagir aux perturbations, elles doivent connaître le fonctionnement de leurs chaînes d’approvisionnement et être en mesure de déterminer leurs fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2. Cela peut être particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME), comme le montre l’encadré 2.2. La fin de la pandémie de COVID-19 ne signifie pas qu’il n’y a plus de menaces à venir ou existantes pour les chaînes d’approvisionnement internationales. Des défis comme les changements climatiques et l’évolution du paysage géopolitique remodèlent les chaînes d’approvisionnement internationales. Mais la manière dont les entreprises et les gouvernements réagissent face à ces nouveaux défis est importante. Il existe de nombreuses façons d’intégrer la résilience dans les chaînes d’approvisionnement, certaines solutions étant toutefois plus coûteuses que d’autres. Les deux dernières parties de ce chapitre examinent certains moyens possibles en vue de renforcer la résilience et d’atténuer les risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement.
2.3 Les chaînes d’approvisionnement internationales après la pandémie de COVID-19 et à l’avenir
Après avoir surmonté le choc de la pandémie de COVID-19, les chaînes d’approvisionnement internationales sont entrées dans une période de nouveaux défis et d’incertitude. Afin de fonctionner correctement, les chaînes d’approvisionnement internationales dépendent de la libre circulation des biens et des services à travers les frontières. Tout obstacle, risque ou coût supplémentaire à la circulation des biens et des services – qu’il soit intentionnel ou non, d’origine humaine ou naturelle – réduira les avantages tirés des chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que les incitations pour les entreprises à les utiliser. En outre, les chaînes d’approvisionnement sont complexes et il n’est pas toujours simple ou facile pour les entreprises de s’adapter rapidement à de nouveaux obstacles ou encore à des perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement, d’où l’importance de déterminer et d’élaborer des stratégies en vue de faire face à ces risques émergents. Dans le cadre de ce rapport, les risques et défis actuels pour les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : les catastrophes naturelles et les changements climatiques; les risques humains et organisationnels; les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); et l’évolution de l’environnement géopolitique. Chacun de ces risques et défis sera examiné successivement avant de voir comment les entreprises peuvent à la fois s’adapter à ces défis et atténuer ces risques.
Les risques associés aux changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les chaînes d’approvisionnement internationales
Les changements climatiques et les catastrophes naturelles constituent un risque permanent et croissant pour les chaînes d’approvisionnement internationales. Boileau et Sydor (2020) soulignent que même les chaînes d’approvisionnement internationales les plus simples comportent de nombreux goulots d’étranglement potentiels. Il s’agit notamment des installations de production à l’étranger, des frontières étrangères, des systèmes et infrastructures de transport, de la frontière canadienne ainsi que des installations de production et entrepôts nationaux au Canada.Note de bas de page 11 Tous ces goulots d’étranglement sont susceptibles d’être perturbés par les catastrophes naturelles et les changements climatiques. En effet, d’innombrables perturbations attribuables à des événements climatiques ou à des catastrophes naturelles se sont produites ces dernières années. Rien que pour l’année 2021, Jacques Leslie (2022) énumère une longue série de perturbations attribuables à des événements climatiquesNote de bas de page 12 :
- Un grand froid au Texas : Cet événement a entraîné une panne d’électricité qui a exacerbé la pénurie de micropuces constatée à l’époque (se reporter à l’encadré 2.1).
- Perturbation du fleuve Rhin : La fonte des neiges et les fortes pluies ont d’abord brisé les berges et provoqué des fermetures de la voie fluviale, puis les sécheresses ont imposé des limites de capacité à la navigation. Le Rhin est une voie navigable majeure pour les expéditions et le commerce des produits manufacturés en Europe.
- Inondations dans le centre de la Chine : Ces inondations ont perturbé les chaînes d’approvisionnement des produits de base et de l’agriculture et ont également entraîné la fermeture d’une grande usine automobile.
- Ouragan Ida : L’ouragan a frappé la côte du Golfe du Mexique, endommageant des usines qui fabriquent toute une série de produits, notamment des plastiques et des produits pharmaceutiques.
- Feux de forêt en Colombie-Britannique : Les feux ont entraîné la fermeture d’un goulot d’étranglement des transports au canyon Fraser qui a immobilisé des milliers de wagons et bloqué leur contenu.
- Inondations en Colombie-Britannique : Elles ont coupé les liaisons ferroviaires et routières vers le port de Vancouver et forcé ainsi la fermeture d’un pipeline régional.
- Inondations causées par un typhon en Malaisie : Klang, le deuxième port d’Asie du Sud-Est, a été gravement endommagé, ce qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement des micropuces en provenance de Taïwan qui sont emballées en Malaisie avant d’être expédiées aux États-Unis.
Un exemple plus récent de perturbation des chaînes d’approvisionnement internationales attribuable aux changements climatiques est la baisse actuelle (au moment de la rédaction) du niveau des eaux du canal de Panama, qui restreint le trafic commercial et augmente ainsi les temps d’attente (se reporter à l’encadré 1.1 pour plus de détails).
Ces perturbations associées aux changements climatiques et ces catastrophes naturelles peuvent avoir un large éventail d’incidences sur les chaînes d’approvisionnement internationales, mais certaines d’entre elles ont eu des conséquences graves et mesurables à la fois sur les chaînes d’approvisionnement ainsi que sur l’ensemble de l’économie. Un exemple bien étudié est le grand tremblement de terre de l’est du Japon de 2011. Carvalho, Nirei, Saito et Alireza Tahbaz-Salehi (2021) ont étudié les liens en amont et en aval des entreprises japonaises et ont constaté que le tremblement de terre avait entraîné une baisse de 3,6 points de pourcentage du taux de croissance des entreprises ayant des fournisseurs sinistrés et une baisse de 2,9 points de pourcentage du taux de croissance des entreprises ayant des clients sinistrés. Les auteurs estiment également que le PIB du Japon a baissé de 0,47 % l’année suivant le tremblement de terre, en raison des effets qui se sont propagés dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Une autre étude réalisée par Tokui, Kawasaki et Miyagawa (2017) a utilisé des tableaux d’entrées et de sorties interrégionaux pour estimer les pertes de production s’élevant à au moins 0,35 % du PIB du Japon.
Malheureusement, les perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales attribuables à des événements associés aux changements climatiques risquent de s’exacerber dans les années à venir. Si les entreprises ne peuvent jamais éliminer les risques relatifs à ces perturbations, il existe des moyens de les atténuer, dont certains seront examinés plus loin dans le cadre de ce chapitre. Tokui, Kawasaki et Miyagawa (2017) ont toutefois examiné l’option de la diversification ou de la redondance des fournisseurs comme une solution possible aux perturbations causées par le grand tremblement de terre de l’est du Japon. Ils indiquent que la mise en place de chaînes d’approvisionnement multiples aurait pu atténuer les dommages indirects à hauteur de 60 % de l’ampleur d’une catastrophe aussi énorme que le grand tremblement de terre de l’est du Japon.
Figure 2.12 : Commerce international des marchandises par mode de transport au Canada (2023)
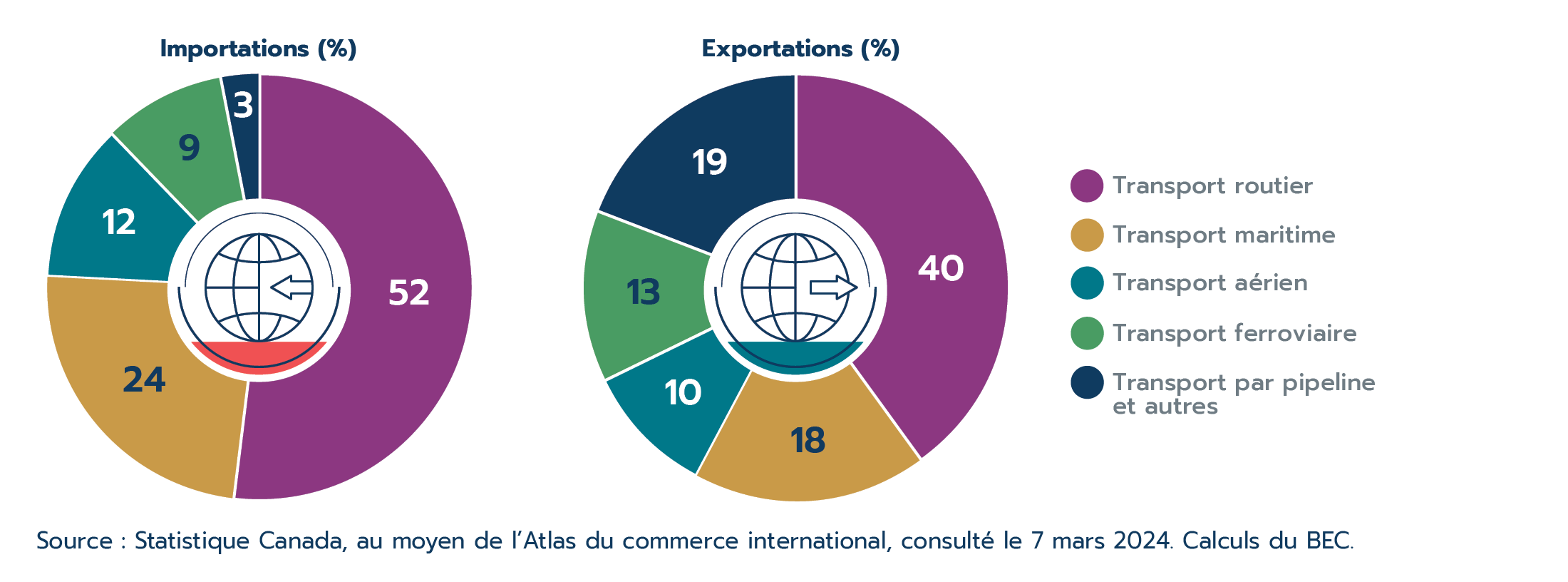
Version texte - Figure 2.12
| Mode de transport | Part des importations | Part des exportations |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada, au moyen de l’Atlas du commerce international, consulté le 7 mars 2024. Calculs du BEC. | ||
| Transport routier | 52 % | 40 % |
| Transport maritime | 24 % | 18 % |
| Transport aérien | 12 % | 10 % |
| Transport ferroviaire | 9 % | 13 % |
| Transport par pipeline et autres | 3 % | 19 % |
Avec une population relativement faible répartie sur une vaste zone géographique, les chaînes d’approvisionnement internationales du Canada peuvent être particulièrement sensibles aux perturbations associées aux changements climatiques. La concentration des infrastructures de transport constitue de surcroît un risque supplémentaire pour le Canada. La figure 2.12 révèle que la part des modes de transport dans les importations et les exportations canadiennes de marchandises. Pour les importations de marchandises canadiennes, le transport routier et maritime constitue les deux principaux modes de transport vers le Canada.Note de bas de page 13 Dans les deux cas, la plupart des importations acheminées au moyen de ces modes de transport sont concentrées dans une poignée de ports ou de postes frontaliers. Par exemple, selon Transports Canada, dans le cas du commerce routier (également appelé « commerce par camion »), le principal passage frontalier – le pont Ambassadeur de Windsor – représentait 28 % du commerce routier bilatéral (importations et exportations) en 2020. Cela représente près d’un tiers de l’ensemble des échanges routiers du Canada et 12 % du total des échanges bilatéraux de marchandises, tous modes de transport confondus (se reporter au tableau 2.1). Les cinq principaux postes frontaliersNote de bas de page 14 représentaient plus des deux tiers (68 %) du commerce bilatéral de camions en 2020 et près d’un tiers (31 %) du commerce bilatéral total de marchandises. Bien qu’il soit possible de détourner le trafic vers d’autres postes frontaliers en cas de perturbation, il est évident que le commerce des camions canadiens est très concentré aux principaux points d’entrée, ce qui le rend vulnérable à d’éventuelles perturbations. Cela comprend également les perturbations qui ne sont pas attribuables aux changements climatiques, comme les manifestations, comme le blocage en 2022 du pont Ambassadeur et d’autres points d’entrée frontaliers. La concentration des infrastructures de transport est encore davantage radicale en ce qui concerne le commerce maritime du Canada. Selon Transports Canada, le port de Vancouver-Fraser représentait quelque 42 % du tonnage total de marchandises manutentionnées par tous les ports canadiens en 2022.
Tableau 2.1 : Sélection de points d’entrée frontaliers et de ports d’entrée frontaliers importants pour le commerce canadien
| Mode | Ports et points d’entrée frontaliers | Part du commerce total (%) (importations et exportations combinées pour 2023) |
|---|---|---|
| Source : Statistique Canada. | ||
| Transport maritime | Port de Vancouver | 5,7 % |
| Port de Montréal | 4,2 % | |
| Transport routier | Windsor – Pont Ambassadeur | 12,2 % |
| Fort Érié/Niagara Falls | 7,4 % | |
| Sarnia | 7,3 % | |
| Emerson | 2,3 % | |
| Lacolle | 2,3 % | |
| Total des ports et points d’entrée frontaliers sélectionnés | 41,4 % | |
Du côté des exportations, après le transport routier, le transport par pipeline constitue le deuxième mode de transport le plus important pour les exportations canadiennes. En 2023, le Canada a exporté pour 193,2 milliards de dollars de combustibles minéraux, ce qui en fait la première exportation de marchandises du pays. La plupart de ces exportations, soit 134,4 milliards de dollars, étaient constituées de pétrole brut, dont 92 % sont acheminés vers les États-Unis par pipeline. Le Canada dispose d’un nombre limité de pipelines clés reliant le Canada aux États-Unis, ce qui en fait un autre mode de transport susceptible d’être touché par des événements climatiques ou encore des catastrophes naturelles.
Risques humains et organisationnels pour les chaînes d’approvisionnement internationales
Les risques humains et organisationnels désignent les risques auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales et qui sont attribuables à des personnes ou à des événements inattendus survenant au sein d’une organisation. Tout d’abord, et pour faire simple, les chaînes d’approvisionnement peuvent être perturbées par des personnes, que ce soit de manière intentionnelle ou non. Comme nous l’avons déjà mentionné, les chaînes d’approvisionnement internationales comportent de nombreux goulots d’étranglement vulnérables dans lesquels une perturbation peut provoquer un effet domino en cascade tout le long de la chaîne. Un exemple de ce type de perturbation a été observé en mars 2021, lorsqu’un porte-conteneurs s’est échoué dans le canal de Suez, ce qui a bloqué le trafic sur cette importante voie de navigation maritime pendant six jours. Un exemple plus malveillant est la cyberattaque contre le Colonial Pipeline. Le pipeline, qui achemine des produits pétroliers raffinés comme l’essence et le kérosène entre le Texas et New York, a fait l’objet d’une cyberattaque en mai 2021, ce qui a entraîné une fermeture de six jours qui a provoqué des pénuries de carburant dans plusieurs aéroports ainsi que de nombreuses stations-service aux États-Unis. Les ports, les postes frontaliers, les usines de production et autres goulots d’étranglement peuvent également être bloqués par des grèves, des manifestations, voire des attaques terroristes. Le Canada a connu des blocages de routes et de voies ferrées en raison de manifestations, y compris la fermeture de postes frontaliers, comme le pont Ambassadeur lors des manifestations du « convoi de la liberté » de 2022. Dans la même logique que les perturbations associées aux changements climatiques, la concentration des infrastructures de transport au Canada rend le pays particulièrement vulnérable aux risques humains et organisationnels qui pèsent sur les chaînes d’approvisionnement internationales.
Préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les chaînes d’approvisionnement internationales
Les entreprises canadiennes sont de plus en plus confrontées à la nécessité de mieux gérer et contrôler leurs chaînes d’approvisionnement internationales afin de s’assurer que leurs produits sont fabriqués dans le respect de l’éthique ainsi que selon des méthodes durables sur le plan environnemental. Les préoccupations relatives aux pratiques éthiques et durables sur le plan environnemental sont souvent désignées par l’expression préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les préoccupations ESG sont mises au premier plan des stratégies et des opérations des entreprises, à la fois en interne par les membres du personnel et les actionnaires, et en externe par les demandes des consommateurs ainsi que par les réglementations et les lois adoptées par les gouvernements.
Moody’s Analytics (2022) détermine certains risques et préoccupations ESG courants que les entreprises doivent gérer et dont elles doivent être conscientes au sein de leurs chaînes d’approvisionnement au sens large.Note de bas de page 15
Environnement :
- Changements climatiques et émissions : Les entreprises tentent de réduire l’intensité carbone (IC) de leurs chaînes d’approvisionnement.
- Ressources naturelles et biodiversité : De nombreuses entreprises tentent de s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement ne comportent pas d’activités, ou encore limitent les activités, préjudiciables à l’environnement, par exemple la déforestation illégale, l’épuisement des matières premières ou la surconsommation d’eau.
- Pollution et déchets : Les entreprises doivent prendre en compte la réutilisation et le recyclage des matériaux de même que l’élimination des déchets dans leurs chaînes d’approvisionnement.
Social :
- Les droits de la personne : Il s’agit d’une vaste catégorie de risques auxquels les entreprises sont confrontées afin de garantir le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, notamment le droit à la vie et à la liberté, à la santé et à la sécurité, ainsi que le droit au travail.
- Normes du travail : Les entreprises sont confrontées à des risques relatifs aux conditions de travail et à la rémunération des travailleurs, ainsi qu’à des préoccupations concernant le travail forcé et le travail des enfants au sein des chaînes d’approvisionnement.
- Répercussions sur la communauté : Les entreprises doivent tenir compte des répercussions potentielles de leurs activités ou de celles de leurs fournisseurs sur les communautés locales; cet aspect peut recouper celui des droits de la personne, par exemple les droits des populations autochtones.
Gouvernance :
- La corruption : La corruption au sein d’une chaîne d’approvisionnement peut entraîner des poursuites judiciaires et ainsi nuire à la réputation d’une entreprise.
- Diversité et discrimination : Les actionnaires et les clients demandent aux entreprises de promouvoir la diversité et l’inclusion tant à l’échelle de la direction que de la main-d’œuvre.
Il existe de nombreuses motivations possibles pour que les entreprises s’intéressent aux préoccupations ESG. Selon Sprinkle et Maines (2010), ces motivations peuvent aller de l’altruisme à l’apaisement des groupes de parties prenantes afin d’obtenir une exposition positive, d’aider à recruter, motiver et retenir les membres du personnel, ou encore de répondre aux demandes des clients. Les auteurs notent que le fait de se concentrer sur les préoccupations environnementales peut aussi entraîner une réduction des coûts de production. Enfin, les entreprises peuvent aborder les préoccupations ESG afin de répondre à des contraintes légales ou réglementaires ou encore bénéficier de déductions fiscales ou de crédits offerts par les gouvernements pour les efforts relatifs aux préoccupations ESG.
Les gouvernements peuvent jouer un rôle important dans la prise en compte des risques et préoccupations ESG dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Un bon exemple de cette situation est l’enjeu relatif au recours au travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Ces dernières années, de nombreux pays ont adopté des lois ou des règlements obligeant les entreprises nationales à faire preuve d’une plus grande transparence dans leurs chaînes d’approvisionnement ainsi qu’à s’assurer qu’aucun matériau ou intrant n’est produit en recourant au travail forcé ou au travail des enfants. Au Canada, le projet de loi S-211, Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanesNote de bas de page 16 est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Cette Loi exige que certaines entités au Canada, principalement les grandes entreprisesNote de bas de page 17 et certaines institutions gouvernementales, déposent des rapports annuels détaillant leurs efforts pour prévenir et atténuer le travail forcé et le travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les entreprises seront sanctionnées si elles ne soumettent pas de rapport annuel ou encore si elles incluent des informations fausses ou trompeuses dans leurs rapports. D’autres économies, comme les États-Unis et l’Union européenne, ont adopté ou sont sur le point d’adopter des règles et des réglementations semblables qui imposent essentiellement aux entreprises nationales de faire preuve de la diligence nécessaire pour savoir comment et d’où proviennent leurs intrants en aval et de s’assurer que le processus de production de ces intrants n’a pas recours au travail forcé. Le travail forcé n’est qu’un exemple parmi d’autres des risques et des préoccupations ESG qui sont abordés au moyen de lois et de réglementations gouvernementales susceptibles de remodeler de manière significative les chaînes d’approvisionnement internationales dans les années à venir.
La relation entre les risques et préoccupations ESG ainsi que les chaînes d’approvisionnement internationales n’est pas nécessairement à sens unique. Alors que les préoccupations ESG remodèlent les chaînes d’approvisionnement internationales, Schiller (2018) montre que ces dernières agissent également comme un mécanisme de transmission des exigences réglementaires et des normes à travers les frontières. En utilisant des ensembles de données à l’échelle de l’entreprise à l’égard des préoccupations ainsi que des données sur les réseaux/relations de la chaîne d’approvisionnement entre les entreprises et des données sur les émissions toxiques, l’auteur montre que les politiques environnementales et sociales se propagent des clients aux fournisseurs, et que c’est particulièrement le cas lorsque les clients (dans ce cas, les entreprises le long de la chaîne d’approvisionnement) ont un pouvoir de négociation plus élevé et que les fournisseurs se trouvent dans des pays où les normes ESG sont moins strictes. En bref, les chaînes d’approvisionnement internationales peuvent aussi constituer un moyen de diffuser les règles, les réglementations, les normes et les exigences des consommateurs en matière de préoccupations ESG, et ce, bien au-delà des frontières.
Évolution du paysage géopolitique et des chaînes d’approvisionnement internationales
La dernière grande catégorie de défis ou de risques auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales est de nature géopolitique. De par leur définition même, les chaînes d’approvisionnement internationales traversent des frontières internationales. Par conséquent, les relations en constante évolution entre les pays, qu’elles soient positives ou négatives, peuvent avoir des répercussions importantes sur la manière dont les chaînes d’approvisionnement internationales sont mises en place et comment elles évoluent au fil du temps. Cette catégorie de risques peut couvrir un large éventail d’événements, depuis les petits changements de politiques entre pays, aux tensions commerciales, en passant par les différends régionaux jusqu’aux guerres de grande envergure. Par conséquent, les risques et les répercussions à l’égard des chaînes d’approvisionnement internationales associés à ces événements dépendent aussi de leur ampleur. Parmi les événements géopolitiques récents qui ont eu des répercussions importantes sur les chaînes d’approvisionnement internationales, citons le Brexit (2016), les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis (de 2018 à aujourd’hui), la guerre en Ukraine ainsi que les sanctions qui en découlent pour la Russie (de 2022 à aujourd’hui) et, plus récemment, la guerre entre Israël et le Hamas qui a commencé en octobre 2023.
Les risques géopolitiques ou les événements comme ceux mentionnés ci-dessus peuvent avoir des répercussions sur les décisions d’une entreprise en matière de chaîne d’approvisionnement, et ce, de plusieurs manières. Souvent, comme dans le cas des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le différend ne perturbe pas entièrement les chaînes d’approvisionnement, mais cela a plutôt une incidence sur l’augmentation des coûts d’approvisionnement en intrants provenant de certains pays. Si le litige entraîne une hausse trop importante des coûts ou encore ajoute trop d’incertitude à la relation fournisseur-client, les entreprises pourraient être amenées à reconfigurer leur chaîne d’approvisionnement en s’éloignant de l’un ou même des deux pays impliqués dans le litige. Ces derniers temps, l’instabilité géopolitique actuelle ainsi que les subventions importantes accordées aux entreprises pour délocaliser leurs activités ont fait de la possibilité de mouvements importants dans la délocalisation des chaînes d’approvisionnement un sujet de conversation brûlant. Le concept de délocalisation à grande échelle et les éléments de preuve de son existence seront abordés dans la dernière partie de ce dossier. Si les tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis entraînant le rapatriement peuvent être remis en question, il est évident que ce différend permanent a eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement internationales et, par conséquent, sur l’économie dans son ensemble. En utilisant le modèle des Tableaux internationaux des entrées-sorties (TIES) de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), Wu, Wood, Oh et Jang (2021) estiment que cinq séries de progressions tarifaires ont entraîné une charge tarifaire indirecte d’environ 23 milliards de dollars américains. Il est intéressant de noter que si les auteurs ont constaté que les États-Unis et la Chine étaient les principales victimes économiques du différend, ils soulignent également que l’UE, le Canada et le Mexique ont aussi subi des coûts tarifaires indirects de l’ordre de 700 millions à 1,7 milliard de dollars, les coûts tarifaires étant répercutés sur les pays tiers par l’intermédiaire des chaînes d’approvisionnement internationales.
Dans le cas des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l’augmentation des droits de douane ainsi que les contrôles des exportations et des importations constituent les principaux risques pour les chaînes d’approvisionnement internationales. Dans le cas d’autres types d’événements géopolitiques, comme les guerres, les perturbations peuvent être plus directes et s’apparenter à celles évoquées dans le cadre des changements climatiques et des catastrophes naturelles, c’est-à-dire que les frontières peuvent être fermées, les ports et autres liaisons de transport peuvent être bloqués, et les usines et centres de distribution peuvent être perturbés. La guerre actuelle en Ukraine a eu des répercussions importantes sur les chaînes d’approvisionnement en Europe et même dans le monde entier. Elle a perturbé la circulation de produits de base importants comme le blé, les céréales, les métaux, le pétrole et le gaz naturel. Elle a également coupé les vivres à des fournisseurs de l’Ukraine ou de la Russie qui approvisionnent des pays du monde entier. Selon une étude de Dun and Bradstreet (2022), au moins 374 000 entreprises dans le monde font appel à des fournisseurs de la Russie et au moins 241 000 entreprises dans le monde font appel à des fournisseurs de l’Ukraine.
Outre les guerres et les tensions commerciales, la résurgence actuelle de la politique industrielle dans de nombreux pays incite aussi les entreprises à restructurer leurs chaînes d’approvisionnement. Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, mais aussi en raison des tensions et de la concurrence géopolitiques, de nombreux pays développés ont entrepris de vastes programmes de dépenses publiques afin de relancer l’économie, mais aussi en vue de faire progresser ou de promouvoir certains secteurs essentiels de leur économie nationale et de réaliser leur transition vers une économie carboneutre. Ces dépenses ciblent souvent des domaines estimés importants pour la sécurité nationale ou le progrès économique (comme la fabrication de pointe, les technologies de l’information et de la communication [TIC], etc.) ou favorisent des objectifs comme la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; par exemple, de nombreux gouvernements, y compris au Canada, encouragent les investissements dans les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques (VE). Deux programmes de dépenses notables lancés ces dernières années aux États-Unis sont la loi sur les puces et la science (CHIPS and Science Act) [2022] et la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) [2022]. La loi sur les puces et la science (CHIPS and Science Act) autorise un financement du gouvernement américain à hauteur de 280 milliards de dollars US pour la recherche et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Bien que le Congrès n’ait pas affecté la totalité de ces fonds, ils sont suffisamment capitalisés afin de stimuler les investissements générationnels dans les semi-conducteurs nationaux et réorienter la recherche-développement (R et D) dans les technologies essentielles et émergentes. La loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) est plus large, mais comprend environ 369 milliards de dollars (dont un montant important sous forme de crédits d’impôt) pour des investissements dans l’énergie propre, les véhicules électriques et la fabrication de pointe, entre autres secteurs, selon les estimations initiales. Compte tenu d’une plus grande utilisation des crédits d’impôt, le montant de l’aide fournie par la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) a été revu à la hausse par différentes estimations. Bien que les répercussions de ces lois commencent à peine à se faire sentir, il est très probable que ces investissements et dépenses importants modifieront de nombreuses chaînes d’approvisionnement internationales, en particulier celles de l’Amérique du Nord.
Améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement
Les changements climatiques et les catastrophes naturelles, les risques humains et organisationnels, les préoccupations ESG et un environnement géopolitique en constante évolution sont autant de défis pour les chaînes d’approvisionnement internationales. Ces perturbations obligent les entreprises du monde entier, et ici au Canada, à renforcer la résilience et la souplesse de leurs chaînes d’approvisionnement internationales. La délocalisation est souvent estimée comme une solution pour limiter les risques dans les chaînes d’approvisionnement et fait l’objet de la dernière section de ce dossier spécial, mais il s’agit probablement de l’un des moyens les plus coûteux pour les entreprises de réduire les risques et d’éliminer bon nombre des avantages que les entreprises (et leurs clients) retirent de l’utilisation des chaînes d’approvisionnement internationales. Il existe d’autres moyens potentiels pour une entreprise d’atténuer les risques relatifs à la rupture de la chaîne d’approvisionnement, notamment la constitution de stocks, la diversification des fournisseurs ou l’innovation en matière de production et d’internalisation de l’offre afin de modifier les besoins en approvisionnement ou la composition des intrants utilisés. Ces trois options seront examinées avant d’aborder plus en détail le cas du rapatriement.
Constitution de stocks
Dans la plupart des cas, les entreprises s’efforcent de détenir le moins de stocks possible afin de mener à bien leurs activités. C’est ce que l’on appelle communément la gestion des stocks « à flux tendus » ou « juste à temps », qui est largement utilisée par les entreprises en raison de son efficacité : les entreprises détiennent juste assez de stocks pour répondre à leurs besoins opérationnels et réapprovisionnent en permanence les stocks lorsque de nouvelles commandes de clients le justifient. Selon Forbes (2023), les principaux avantages de l’utilisation de la gestion des stocks « à flux tendus » sont la réduction des déchets, l’augmentation de la productivité, l’amélioration de la qualité et une plus grande souplesse. Toutefois, l’un des inconvénients de la gestion des stocks « à flux tendus » est le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Cet inconvénient de la gestion des stocks « à flux tendus » a conduit certaines entreprises à adopter une nouvelle stratégie de gestion des stocks, connue sous le nom de « juste au cas ». Le concept de la gestion des stocks « juste au cas » consiste à privilégier la préparation plutôt que l’inefficacité, les entreprises stockant des intrants essentiels afin de réagir ou d’être en mesure de soutenir toute perturbation de leurs chaînes d’approvisionnement.
Les données sur les stocks des fabricants au Canada et aux États-Unis (se reporter à la figure 2.13) montrent une forte accumulation des stocks, à la fois en termes de matières premières et transformées et de produits finis, à partir de janvier 2021 environ, ou au début de la pandémie de COVID-19. Ce qui est intéressant, c’est que ces niveaux de stocks plus élevés sont restés élevés après la pandémie, ce qui pourrait indiquer le passage de la gestion des stocks « à flux tendus » à la gestion des stocks « juste au cas » pour atténuer les risques de perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, d’autres facteurs, comme une inflation élevée récente, peuvent également jouer un rôle dans la décision des entreprises de détenir davantage de stocks. Il est également difficile de faire la distinction entre un passage à la gestion des stocks « juste au cas » et des accumulations involontaires de stocks comme celles causées par de mauvaises prévisions de la demande. Aux États-Unis, l’accumulation des stocks de matières premières ainsi que de produits transformés a été plus importante que celle des produits finis. Une accumulation de produits finis peut toutefois être indésirable et refléter une mauvaise prévision de la demande.
La décision d’augmenter ou de réduire les stocks constitue un travail de juste équilibre délicat, car la détention de stocks est coûteuse. Pour une entreprise, utiliser la gestion des stocks « juste au cas » revient à souscrire une assurance contre les perturbations. Les entreprises le feront si le coût est abordable et si la probabilité d’avoir besoin de l’assurance est élevée, mais elles reviendront au système de la gestion des stocks « à flux tendus » ou à un système intermédiaire entre les deux systèmes de gestion des stocks si le coût est trop élevé et si la probabilité de perturbations est trop faible.
Figure 2.13 : Accumulation des stocks manufacturiers au Canada et aux États-Unis
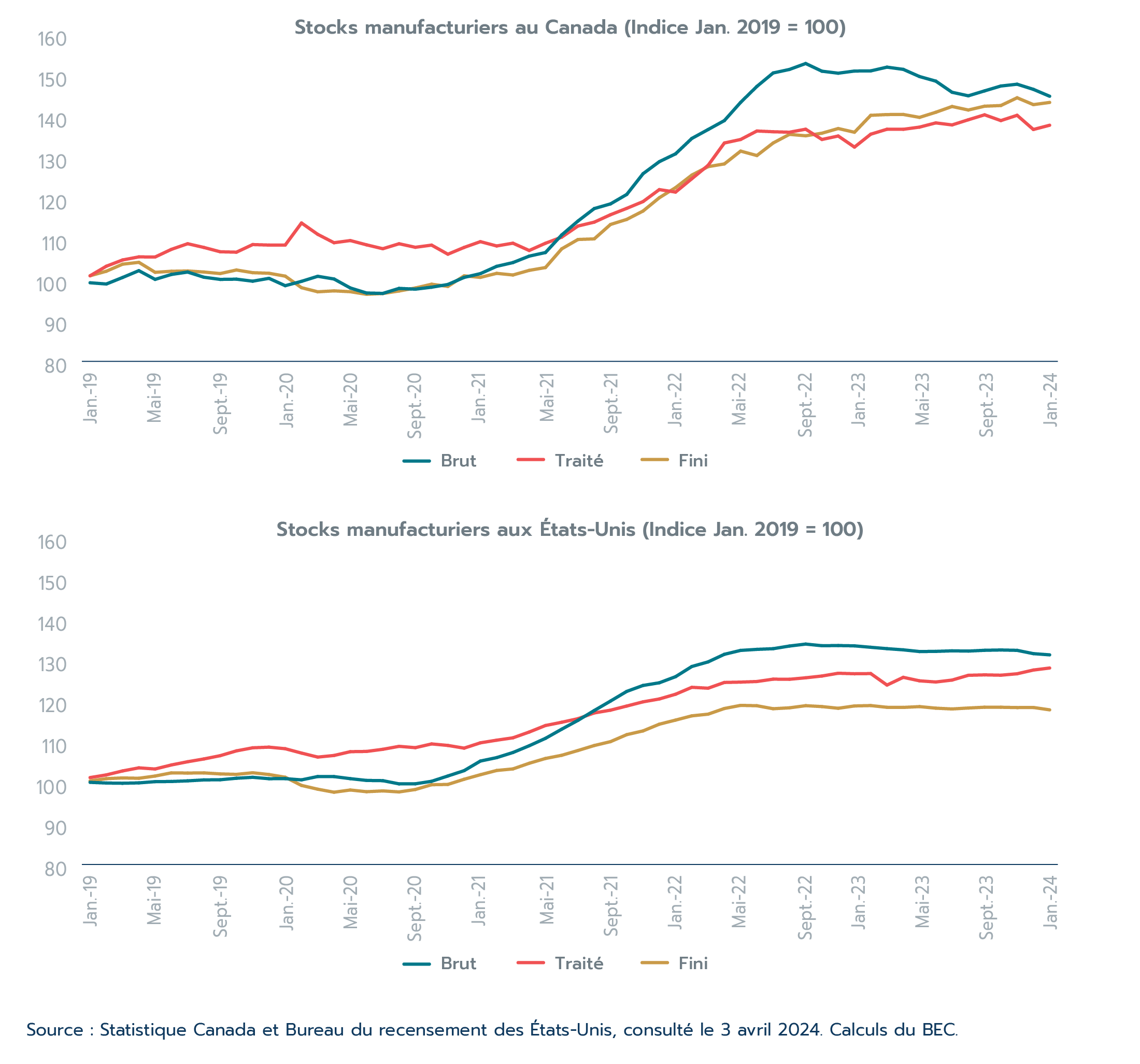
Version texte - Figure 2.13
| Mensuel | Stocks manufacturiers au Canada | Stocks manufacturiers aux États-Unis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brut | Traité | Fini | Brut | Traité | Fini | |
| Source : Statistique Canada et Bureau du recensement des États-Unis, consulté le 3 avril 2024. Calculs du BEC. | ||||||
| Janv. 2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Févr. 2019 | 99,2 | 100,9 | 100,9 | 100,1 | 101,2 | 100,4 |
| Mars 2019 | 98,9 | 103,2 | 102,0 | 99,9 | 101,9 | 101,0 |
| Avril 2019 | 100,5 | 104,8 | 103,7 | 99,8 | 102,9 | 101,1 |
| Mai 2019 | 102,2 | 105,5 | 104,2 | 99,9 | 103,6 | 101,1 |
| Juin 2019 | 100,0 | 105,5 | 101,8 | 100,2 | 103,3 | 101,6 |
| Juill. 2019 | 101,2 | 107,4 | 102,0 | 100,3 | 104,3 | 102,4 |
| Août 2019 | 101,8 | 108,7 | 102,1 | 100,4 | 105,1 | 102,3 |
| Sept. 2019 | 100,6 | 107,8 | 101,8 | 100,7 | 105,8 | 102,4 |
| Oct. 2019 | 100,0 | 106,8 | 101,5 | 100,7 | 106,6 | 102,1 |
| Nov. 2019 | 100,1 | 106,7 | 102,3 | 101,1 | 107,8 | 102,0 |
| Déc. 2019 | 99,6 | 108,5 | 101,7 | 101,3 | 108,5 | 102,4 |
| Janv. 2020 | 100,3 | 108,4 | 101,5 | 101,0 | 108,7 | 102,0 |
| Févr. 2020 | 98,5 | 108,4 | 100,8 | 101,0 | 108,3 | 101,3 |
| Mars 2020 | 99,6 | 113,8 | 98,0 | 100,7 | 107,2 | 99,3 |
| Avril 2020 | 100,8 | 111,0 | 97,0 | 101,5 | 106,2 | 98,4 |
| Mai 2020 | 100,1 | 109,0 | 97,2 | 101,5 | 106,6 | 97,7 |
| Juin 2020 | 97,9 | 109,5 | 97,0 | 101,0 | 107,6 | 98,2 |
| Juill. 2020 | 96,7 | 108,5 | 96,4 | 100,5 | 107,6 | 97,8 |
| Août 2020 | 96,6 | 107,5 | 96,6 | 100,5 | 108,1 | 98,0 |
| Sept. 2020 | 97,8 | 108,7 | 97,2 | 99,7 | 108,9 | 97,7 |
| Oct. 2020 | 97,6 | 107,9 | 97,9 | 99,7 | 108,5 | 98,3 |
| Nov. 2020 | 98,1 | 108,4 | 98,9 | 100,3 | 109,5 | 99,5 |
| Déc. 2020 | 98,8 | 106,2 | 98,3 | 101,6 | 109,1 | 99,6 |
| Janv. 2021 | 100,5 | 107,8 | 100,9 | 102,9 | 108,4 | 100,8 |
| Févr. 2021 | 101,4 | 109,3 | 100,5 | 105,3 | 109,7 | 101,9 |
| Mars 2021 | 103,2 | 108,2 | 101,5 | 106,1 | 110,4 | 103,0 |
| Avril 2021 | 104,1 | 108,9 | 101,1 | 107,4 | 110,9 | 103,4 |
| Mai 2021 | 105,7 | 107,1 | 102,2 | 109,0 | 112,4 | 104,7 |
| Juin 2021 | 106,6 | 108,9 | 102,9 | 110,8 | 114,0 | 105,9 |
| Juill. 2021 | 110,9 | 110,4 | 107,5 | 113,1 | 114,8 | 106,7 |
| Août 2021 | 114,3 | 113,1 | 109,8 | 115,2 | 115,6 | 107,9 |
| Sept. 2021 | 117,3 | 114,0 | 109,9 | 117,6 | 117,0 | 109,1 |
| Oct. 2021 | 118,5 | 115,8 | 113,5 | 119,9 | 117,7 | 110,0 |
| Nov. 2021 | 120,8 | 117,4 | 114,7 | 122,3 | 118,7 | 111,7 |
| Déc. 2021 | 125,9 | 119,0 | 116,7 | 123,8 | 119,7 | 112,6 |
| Janv. 2022 | 128,8 | 122,0 | 120,0 | 124,4 | 120,4 | 114,3 |
| Févr. 2022 | 130,7 | 121,4 | 122,5 | 125,9 | 121,6 | 115,3 |
| Mars 2022 | 134,5 | 124,6 | 125,5 | 128,4 | 123,3 | 116,3 |
| Avril 2022 | 136,7 | 127,9 | 127,6 | 129,5 | 123,1 | 116,7 |
| Mai 2022 | 138,8 | 133,4 | 128,3 | 131,4 | 124,5 | 118,1 |
| Juin 2022 | 143,3 | 134,2 | 131,4 | 132,3 | 124,6 | 118,9 |
| Juill. 2022 | 147,2 | 136,3 | 130,3 | 132,6 | 124,7 | 118,8 |
| Août 2022 | 150,5 | 136,1 | 133,4 | 132,7 | 125,3 | 118,1 |
| Sept. 2022 | 151,3 | 136,0 | 135,5 | 133,4 | 125,3 | 118,3 |
| Oct. 2022 | 152,8 | 136,7 | 135,1 | 133,9 | 125,6 | 118,8 |
| Nov. 2022 | 150,9 | 134,2 | 135,8 | 133,5 | 126,1 | 118,6 |
| Déc. 2022 | 150,4 | 135,1 | 136,9 | 133,5 | 126,7 | 118,2 |
| Janv. 2023 | 151,0 | 132,4 | 136,0 | 133,4 | 126,6 | 118,7 |
| Févr. 2023 | 151,0 | 135,5 | 140,1 | 133,1 | 126,7 | 118,8 |
| Mars 2023 | 151,9 | 136,7 | 140,3 | 132,7 | 123,8 | 118,4 |
| Avril 2023 | 151,4 | 136,7 | 140,3 | 132,5 | 125,7 | 118,4 |
| Mai 2023 | 149,6 | 137,2 | 139,6 | 132,0 | 124,9 | 118,6 |
| Juin 2023 | 148,5 | 138,3 | 140,9 | 132,1 | 124,6 | 118,2 |
| Juill. 2023 | 145,8 | 137,8 | 142,3 | 132,2 | 125,1 | 118,0 |
| Août 2023 | 144,9 | 139,0 | 141,4 | 132,2 | 126,2 | 118,2 |
| Sept. 2023 | 146,1 | 140,3 | 142,4 | 132,3 | 126,3 | 118,4 |
| Oct. 2023 | 147,3 | 138,8 | 142,5 | 132,4 | 126,3 | 118,4 |
| Nov. 2023 | 147,7 | 140,1 | 144,4 | 132,3 | 126,6 | 118,3 |
| Déc. 2023 | 146,5 | 136,7 | 142,7 | 131,5 | 127,5 | 118,4 |
| Janv. 2024 | 144,8 | 137,7 | 143,3 | 131,2 | 128,0 | 117,8 |
Diversifier les fournisseurs
Une autre possibilité de se prémunir contre les ruptures de la chaîne d’approvisionnement consiste pour une entreprise à diversifier ses fournisseurs ou à disposer de fournisseurs de secours en cas de rupture. La diversification peut revêtir deux aspects : l’un consiste à disposer d’un plus grand choix d’entreprises, ce qui permet d’avoir d’autres fournisseurs en cas de problème ou d’arrêt à l’échelle de l’entreprise. L’autre type est de nature géographique et consiste à répartir les fournisseurs entre les pays ou les régions, ce qui permet de se prémunir contre les risques de catastrophes naturelles, les risques humains et organisationnels, ainsi que les risques géopolitiques. Comme indiqué précédemment, Tokui, Kawasaki et Miyagawa (2017) ont estimé que dans le cas du grand tremblement de terre de l’est du Japon, l’ajout de redondance aux chaînes d’approvisionnement aurait pu grandement atténuer les répercussions.
L’ajout de fournisseurs (diversification des entreprises) ou la diversification des lieux (diversification géographique) où une entreprise s’approvisionne en intrants peut toutefois s’avérer plus difficile en réalité qu’en théorie. La possibilité d’ajouter d’autres fournisseurs pour un intrant nécessaire dépendra entre autres de la nature de l’intrant en question ainsi que de la relation entre le fournisseur et l’entreprise cliente. Les intrants génériques ou homogènes peuvent faire l’objet d’un large choix de fournisseurs, tandis que les intrants hétérogènes, et plus uniques, peuvent faire l’objet d’un choix plus restreint de fournisseurs. En outre, des intrants plus spécialisés sont susceptibles de nécessiter des relations plus étroites entre les fournisseurs et les clients. Par exemple, ils peuvent nécessiter des schémas clients complexes, des normes changeantes, voire une collaboration quotidienne entre le fournisseur et le client, ce qui rend la mise en place de solutions de rechange plus coûteuse. En outre, les dotations naturelles peuvent signifier que certains intrants bruts ne se trouvent que dans un petit nombre de pays clés, ce qui rend la diversification géographique des fournisseurs difficile, voire parfois impossible. Par exemple, à la suite de l’invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine par la Russie, il s’est avéré que la Russie était le principal mondial fournisseur d’urée, un additif nutritif essentiel dans les engrais. Il s’agissait d’un intrant particulièrement important pour les producteurs de pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, qui ne pouvait pas être facilement remplacé par des engrais nationaux, comme ceux composés de potasse. Dans le même ordre d’idées, l’importance des coûts irrécupérables relatifs à la création d’usines ou d’autres caractéristiques des monopoles naturels peuvent concentrer certains intrants à l’égard d’une sélection limitée de pays sources, comme c’est le cas pour les micropuces (se reporter à l’encadré 2.1).
Même si une entreprise est en mesure de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, les résultats ne sont pas aussi simples qu’on pourrait le penser. La diversification des fournisseurs peut notamment aller à l’encontre de la création de relations plus étroites entre le fournisseur et le client. Une relation de travail étroite entre le fournisseur et le client peut potentiellement aider les entreprises à travailler ensemble en vue de résoudre les problèmes et surmonter les obstacles. C’est ce que montrent Jain, Girotra et Netessine (2022), où les auteurs écrivent que la diversification des fournisseurs est associée à une reprise plus lente après des interruptions d’approvisionnement, tandis que l’utilisation de relations à long terme est associée à une reprise qui est plus rapide. Une diminution d’un écart-type de la première est associée à une récupération plus rapide de 16 %, et une augmentation semblable de la seconde est associée à une récupération plus rapide de 20 %. Les mêmes auteurs font référence à d’autres études (Sheffi 2005, Yang et al. 2012) soulignant que si la diversification peut réduire les risques de perturbation, elle peut augmenter la période de récupération après une perturbation. En d’autres termes, si le fait d’avoir de nombreux fournisseurs réduit les risques en matière de perturbations, le fait d’avoir un ou deux fournisseurs de confiance entretenant des relations étroites peut aider une entreprise à résister à une crise ou à se remettre plus rapidement d’une perturbation, car les deux entreprises seront en mesure de mieux collaborer pour surmonter les obstacles. Comme pour la constitution de stocks, il semble que la diversification des fournisseurs puisse constituer une couverture dont les coûts doivent être équilibrés avec la probabilité des risques de perturbation de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise.
Figure 2.14 : Diversification des sources d’importation
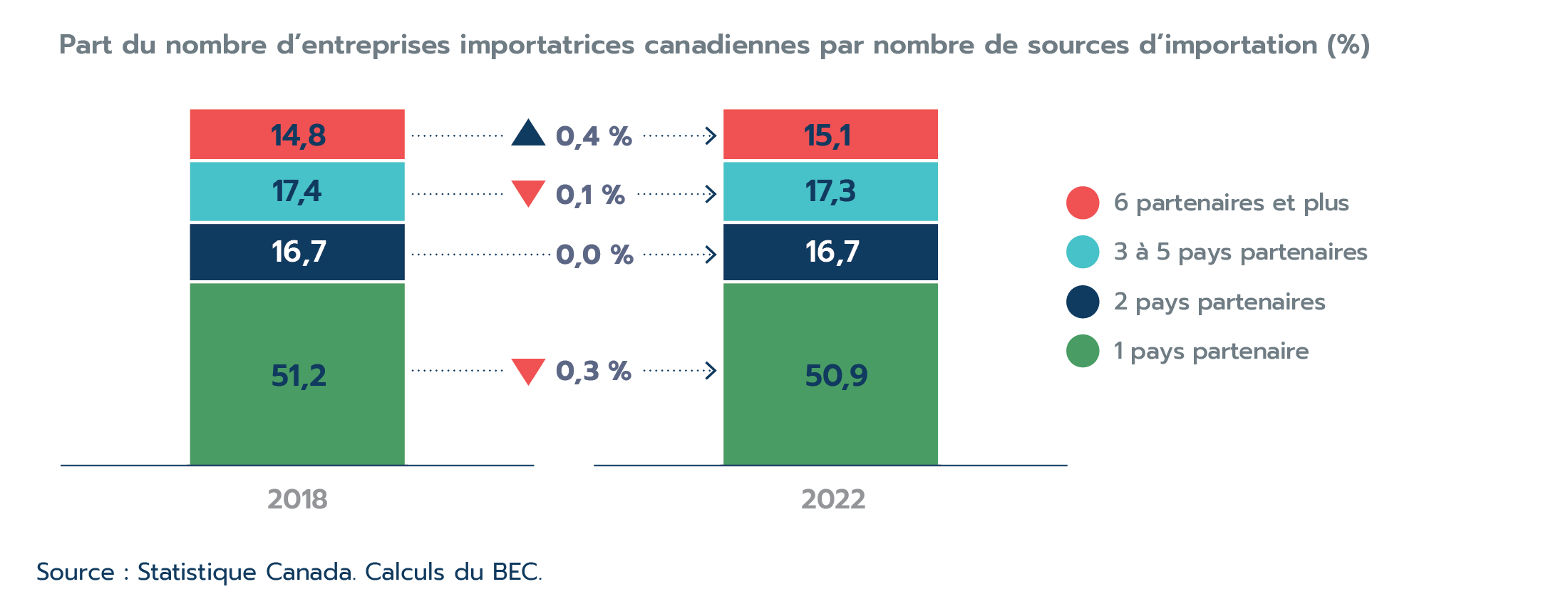
Version texte - Figure 2.14
| Nombre de sources d’importation | 2018 (%) | 2022 (%) | Variation en points de pourcentage |
|---|---|---|---|
| Source : Statistique Canada. Calculs du BEC. | |||
| 1 pays partenaire | 51,2 | 50,9 | -0,3 |
| 2 pays partenaires | 16,7 | 16,7 | 0,0 |
| 3 à 5 pays partenaires | 17,4 | 17,3 | -0,1 |
| 6 partenaires et plus | 14,8 | 15,1 | 0,4 |
La capacité et les gains ambigus de la diversification des chaînes d’approvisionnement peuvent aussi être observés à l’échelle des données. Dans le cas du Canada, comme l’illustre la figure 2.14, les entreprises importatrices canadiennes ont légèrement amélioré la diversification géographique de leurs fournisseurs depuis la pandémie de COVID-19. En 2018 (avant la pandémie), 51 % des entreprises importatrices au Canada ne s’approvisionnaient qu’auprès d’un seul pays partenaire. En 2022, cette part avait toutefois légèrement diminué. De même, 15,1 % les importateurs se sont approvisionnés auprès de six sources géographiques ou plus, contre 14,8 % en 2018. Si l’on examine les données de plus près, ce sont les entreprises de taille moyenne qui ont connu la plus forte augmentation sur le plan de la diversification géographique de leurs fournisseurs. Il est trop tôt pour dire s’il s’agit de simples fluctuations à l’échelle des données ou du début d’une tendance.
Innover dans la production et internaliser l’offre
Une autre façon pour une entreprise de réagir au risque de perturbation de ses chaînes d’approvisionnement constitue à modifier la façon dont elle fabrique son produit. Il peut s’agir de modifier le mode de fabrication du produit afin de limiter ou encore d’éviter l’utilisation d’un intrant vulnérable ou, dans certains cas, d’internaliser l’approvisionnement en fabriquant l’intrant en question dans le pays ou en acquérant la propriété du fournisseur. Bien qu’il s’agisse d’une solution possible afin de faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, il est probable qu’elle soit beaucoup plus coûteuse que la constitution de stocks ou la diversification de l’offre.
Il semble qu’il y ait quelques exemples d’entreprises qui modifient ou innovent en matière de production afin d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement. Un exemple cité est celui de l’entreprise Honda, un constructeur automobile japonais, qui a innové en fabriquant un moteur de véhicule hybride sans utiliser certains métaux des terres rares habituellement utilisés dans les moteurs hybrides. Il s’agirait d’une réponse aux mesures de contrôle des exportations chinoises imposées au Japon en 2010. Selon Forbes (2016), à l’époque, la Chine était responsable d’environ 95 % de la production mondiale de métaux des terres rares et détenait la moitié des réserves mondiales de ces métaux. En raison d’un différend territorial, la Chine a réduit son quota d’exportation et a également bloqué les exportations vers le Japon pendant deux mois. Pour faire face à cela, Honda a conçu un nouveau moteur hybride qui ne nécessite pas l’utilisation des métaux des terres rares bloqués en 2010. Il convient toutefois de noter que ce nouveau moteur n’a été annoncé qu’en 2016, soit six ans après le différend de 2010, et qu’il peut y avoir de nombreuses motivations ainsi que de nombreux facteurs à l’origine de la nouvelle conception, au-delà du risque lié à la chaîne d’approvisionnement mis en évidence. Un autre exemple passé, mais plus célèbre en matière d’un changement de production associé à des problèmes d’approvisionnement est celui de l’industrie des boissons non alcoolisées. La hausse des prix du sucre de canne au début des années 1980 aurait conduit Coca-Cola, un producteur populaire de boissons non alcoolisées, et d’autres compagnies nord-américaines de boissons non alcoolisées, à utiliser du sirop de maïs dans leurs boissons vers le milieu des années 1980. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’une réaction aux risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement, mais plutôt à la tarification des fournitures, cela indique que les entreprises peuvent innover et le feront à la lumière des pressions exercées à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
La prise de contrôle d’un fournisseur ou la production en interne d’un intrant nécessaire constitue une autre réponse possible aux risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement. La prise de contrôle d’un fournisseur ou la combinaison au sein d’une même entreprise de deux ou plusieurs étapes de production habituellement gérées par des entreprises distinctes est appelée intégration verticale. Mesurer l’intégration verticale et déterminer les motivations qui la sous-tendent représente toutefois une entreprise difficile. Il n’est pas simple de savoir si le renforcement de l’intégration verticale est attribuable aux risques perçus pour les chaînes d’approvisionnement dans le sillage de la pandémie de COVID-19 ou aux nouveaux défis mis en évidence dans le présent chapitre. Une tentative unique en vue de déterminer si les entreprises utilisent l’intégration verticale comme solution de rechange aux défis de la chaîne d’approvisionnement se trouve dans un document de travail du National Bureau of Economic Research (NBER), où Ersahin, Giannetti et Huang (2023) utilisent l’analyse textuelle des conférences téléphoniques portant sur les bénéfices des entreprises américaines cotées en bourse pour déterminer les entreprises qui sont confrontées à des risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement et pour voir comment ces entreprises réagissent à ces risques. Les auteurs ont constaté que si les entreprises confrontées à des risques plus importants en matière de chaîne d’approvisionnement avaient tendance à renforcer leurs relations avec des fournisseurs plus proches ou nationaux, celles qui n’étaient pas confrontées à des contraintes financières étaient plus susceptibles de se mobiliser dans le cadre de fusions et d’acquisitions verticales. Il s’agit d’une indication que, du moins aux États-Unis, les entreprises peuvent avoir internalisé les fournisseurs afin de limiter les risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement.
La constitution de stocks, la diversification de l’offre, l’innovation ainsi que l’intégration verticale sont autant de moyens pour les entreprises d’atténuer les risques dans les chaînes d’approvisionnement, mais il en existe probablement d’autres. Plus important encore, il convient de noter que les chaînes d’approvisionnement présentent des avantages considérables qui l’emportent souvent largement sur les risques. On pourrait croire que seules les grandes entreprises actives à l’échelle mondiale doivent penser à s’adapter à ces risques, mais en fait, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) au Canada sont également impliquées dans des chaînes d’approvisionnement internationales et sont ainsi tout aussi vulnérables aux perturbations que les grandes entreprises. Toutefois, les PME peuvent aussi être confrontées à d’autres défis particuliers, notamment en ce qui concerne la connaissance de leurs fournisseurs en amont et de leurs lieux d’implantation respectifs. L’encadré 2.2 résume une étude réalisée par Bazile, Toumi, Mohiuddin et Su (2024), qui ont entrepris une enquête pancanadienne auprès de 465 PME manufacturières canadiennes afin de mieux comprendre les défis uniques auxquels ces petites entreprises canadiennes sont confrontées concernant la chaîne d’approvisionnement. Enfin, la dernière section de ce chapitre examine une réponse plus radicale aux risques relatifs à la chaîne d’approvisionnement : le rapatriement, ce qu’il est et s’il est en train de se produire au Canada.
Encadré 2.2 : Défis rencontrés par les PME canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement internationales
Une étude récente menée par une équipe de chercheurs,Note de bas de page 18 dirigée par le professeur Zhan Su de l’Université Laval, tente de faire la lumière sur la manière dont les PME canadiennes se mobilisent dans les chaînes d’approvisionnement internationales et sur les défis auxquels elles sont confrontées. En interrogeant 465 PME manufacturières à travers le Canada entre le 28 septembre et le 23 octobre 2023, l’équipe de recherche de l’Université Laval a été en mesure de mieux comprendre plusieurs éléments : le niveau de dépendance des PME canadiennes à l’égard des intrants étrangers; la capacité des PME canadiennes à déterminer leurs fournisseurs directs et indirects et l’endroit où ils sont situés; et les stratégies que les PME canadiennes ont mises en place pour atténuer les vulnérabilités attribuables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En outre, l’enquête a également montré comment les caractéristiques des entreprises, comme son chiffre d’affaires, sa taille et les niveaux de connaissance de la chaîne d’approvisionnement, jouent un rôle dans la vulnérabilité d’une entreprise face aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement. Voici un résumé des principaux résultats de l’enquête. Le rapport complet (PDF en anglais seulement, 1.66MB) peut également être consulté.
Tableau 2.2 : Dépendance des PME à l’égard des intrants étrangers
| Pourcentage d’intrants intermédiaires provenant de l’étranger | Nombre de PME ayant participé à l’enquête | Pourcentage de répondants |
|---|---|---|
| Source : Bazile, J., Toumi, S., Mohiuddin, M., Su, Z. (2024). Les défis des PME canadiennes face à la turbulence de la chaîne d’approvisionnement mondiale : résultats d’une enquête pancanadienne. Québec : Université Laval. | ||
| Moins de 5 % | 79 | 17,0 % |
| 5 % à 15 % | 117 | 25,2 % |
| 16 % à 25 % | 148 | 31,8 % |
| Plus de 25 % | 121 | 26,0 % |
Les PME canadiennes dépendent fortement des intrants étrangers
Les chaînes d’approvisionnement internationales ne constituent pas l’apanage des grandes entreprises. L’enquête réalisée par l’équipe de l’Université Laval montre que la plupart des PME manufacturières sont également profondément intégrées dans les chaînes d’approvisionnement internationales, 95 % des répondants à l’enquête indiquant qu’ils s’approvisionnent directement sur les marchés internationaux. Plus de la moitié (58 %) des PME ayant participé à l’enquête ont indiqué qu’elles se procuraient plus de 15 % de leurs intrants intermédiaires auprès de sources étrangères (se reporter au tableau 2.2). Dans de nombreux cas, ces intrants provenant de l’étranger peuvent représenter des intrants essentiels pour les PME manufacturières canadiennes, et il se peut qu’elles ne puissent pas trouver d’autres solutions ailleurs. L’enquête a révélé qu’une grande partie des PME dépendent d’intrants étrangers qui sont difficiles à remplacer, ce qui les expose davantage à des pertes de production en cas de perturbations.
Les PME canadiennes qui dépendent fortement des intrants étrangers (plus de 25 % de leurs intrants proviennent de l’étranger) ont tendance à être plus grandes et mieux établies, et mènent leurs activités principalement dans les secteurs de la fabrication d’ordinateurs et d’appareils électroniques, de la fabrication de produits alimentaires et de la fabrication de produits métalliques. Toutefois, les PME de plus grande taille – par exemple les PME dont le chiffre d’affaires est plus important, en particulier celles qui dépassent les 10 millions de dollars – sont plus susceptibles de se mobiliser auprès de fournisseurs internationaux. Il s’agit d’un point important, car on constate que des relations plus solides entre les clients et les fournisseurs peuvent aider les entreprises à surmonter plus rapidement les perturbations ou encore les chocs subis par leurs chaînes d’approvisionnement.
Les PME canadiennes ne dépendent pas seulement des marchés étrangers pour leurs intrants, elles vendent aussi sur les marchés étrangers. Près de la moitié des PME ayant participé à l’enquête ont des revenus substantiels basés sur l’exportation, principalement vers les États-Unis, ce qui signifie que les PME canadiennes sont confrontées à des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement au moyen des importations et des exportations.
Les PME canadiennes s’approvisionnent dans un grand nombre de pays, mais la visibilité de la chaîne d’approvisionnement fait souvent défaut.
Les PME canadiennes s’approvisionnent en intrants auprès d’un vaste éventail de pays. Lors de l’enquête, 47 pays différents ont été répertoriés comme sources d’intrants intermédiaires. Toutefois, les États-Unis et la Chine semblent être devenus les principaux fournisseurs. Ce ne sont pas toutes les PME canadiennes qui savent exactement d’où proviennent leurs intrants. Parmi les PME qui dépendent de fournisseurs étrangers, une part importante (70 %) a indiqué avoir une connaissance partielle ou encore précise de la source de leurs intrants. Toutefois, cela signifie que près d’un tiers (30 %) des PME ayant participé à l’enquête présentent des lacunes importantes en matière de connaissance et de visibilité de leurs sources d’intrants. La visibilité dans les chaînes d’approvisionnement en amont représente également une préoccupation. Bien que 75,7 % des PME puissent déterminer au moins un pays client étranger, le fait de dépendre d’intermédiaires pour les exportations limite leur visibilité sur les marchés définitifs. L’étude a révélé que les entreprises qui ont une meilleure visibilité de leur chaîne d’approvisionnement, tant en amont qu’en aval, ont tendance à se mobiliser dans des pratiques telles qu’une collaboration accrue avec les fournisseurs et un contact direct avec ces derniers, réduisant ainsi le besoin d’intermédiaires.
Les PME canadiennes mettent en œuvre diverses stratégies afin d’atténuer leur vulnérabilité face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Si l’enquête a révélé que les PME canadiennes sont vulnérables face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales en raison de leur dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers ainsi que de leurs ventes sur les marchés étrangers, elle a également montré que de nombreuses PME canadiennes mettent en œuvre des stratégies pour surmonter les risques de perturbation de leurs chaînes d’approvisionnement. Premièrement, les PME cherchent à diversifier leurs fournisseurs. Les résultats de l’enquête révèlent que de nombreuses PME ont indiqué qu’elles recherchaient de nouveaux fournisseurs, avec un pourcentage notable de 78,5 % de PME ayant activement recherché de nouveaux fournisseurs, ce qui démontre une évolution stratégique vers la diversification des sources d’approvisionnement. Deuxièmement, les PME canadiennes s’efforcent aussi de diversifier leur clientèle, 63,9 % des PME ayant participé à l’enquête indiquent avoir trouvé de nouveaux clients étrangers et 73,5 % de nouveaux clients nationaux. Troisièmement, de nombreuses PME canadiennes constituent des stocks afin de parer à d’éventuelles pénuries. L’enquête révèle que 70 % des PME ont augmenté leurs capacités de stockage, les grandes entreprises et celles dont les intrants sont difficilement substituables étant plus enclines à augmenter considérablement leurs stocks. Enfin, plus de 68 % des PME ont modifié leurs processus de fabrication ou encore leurs produits afin de réduire leur dépendance à l’égard de certains intrants étrangers ou pour s’adapter à l’évolution du marché.
Conclusion
Ces conclusions de la recherche menée par l’équipe de l’Université Laval révèlent l’intégration profonde des PME canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Plus de la moitié des entreprises ayant participé à l’enquête dans le cadre de cette étude font état d’une dépendance marquée à l’égard des intrants internationaux et nombre d’entre elles indiquent que ces intrants seraient difficiles à remplacer. En bref, les PME canadiennes sont très dépendantes des chaînes d’approvisionnement internationales, et les PME canadiennes joueront un rôle important dans la manière dont le Canada fera face aux défis et aux risques futurs relatifs aux chaînes d’approvisionnement internationales.
2.4 Rapatriement et autres stratégies de localisation
Comme il est indiqué dans la section précédente, les entreprises peuvent atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement de plusieurs manières. Le rapatriement, ou la relocalisation des activités de production dans leur pays d’origine, et les autres stratégies de localisation sont des façons pour les entreprises peuvent choisir de reconfigurer des portions de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales en réponse à des risques nouveaux ou élevés, ou à l’évolution des priorités. Bien que les différentes options de localisation aient fait l’objet d’une attention accrue ces dernières années en raison des défis posés à la chaîne d’approvisionnement par la pandémie, le changement climatique, ainsi que les tensions et les conflits géopolitiques, il ne s’agit pas de nouvelles stratégies du point de vue de l’entreprise. La décision de s’établir ou de s’approvisionner, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale, fait partie de la stratégie de choix de l’emplacement d’une entreprise, qui peut être réexaminée et révisée en cas de besoin.
Lorsque les entreprises ont besoin d’intrants pour leur production (c’est-à-dire de biens et de services intermédiaires), elles peuvent choisir de se les procurer auprès d’une autre entreprise, c’est-à-dire de les externaliser, ou de les produire à l’interne (figure 2.15). Les entreprises qui externalisent leurs intrants peuvent choisir des fournisseurs nationaux, des fournisseurs étrangers ou une combinaison des deux. De même, la production interne peut être réalisée au pays par l’entreprise, ou à l’étranger, par la création ou l’acquisition de filiales étrangères, c’est-à-dire la délocalisation de la production. Étant donné que les entreprises peuvent délocaliser l’externalisation ou la production, ou les deux, il convient de faire la distinction entre le rapatriement de l’externalisation – le passage de l’approvisionnement de produits ou de services à l’étranger à l’approvisionnement national – et le rapatriement de la production – la relocalisation des filiales situées à l’étranger dans le pays d’origine de l’entreprise.
Le rapatriement de la production et le rapatriement de l’externalisation auront tous deux une incidence sur le commerce. Si les entreprises canadiennes choisissent de s’approvisionner ou d’effectuer leur production au pays, les importations de biens et de services intermédiaires des entreprises canadiennes diminueront. De même, si des entreprises étrangères ayant des filiales ou des fournisseurs au Canada décident de s’approvisionner ou d’effectuer leur production sur place, les exportations canadiennes seront touchées.
Le rapatriement de la production aura également une incidence sur l’investissement direct étranger (IDE). Une modification des stratégies des multinationales étrangères pourrait avoir une incidence négative sur l’IDE du Canada si les multinationales étrangères décident de rapatrier leurs filiales du Canada à leur pays d’origine. De même, les entreprises multinationales canadiennes (EMNC) pourraient décider de rapatrier une partie de leurs activités délocalisées, ce qui aurait une incidence sur l’investissement direct canadien à l’étranger (IDCE).
Figure 2.15 : Rapatrier quoi? Déménager des filiales ou changer de fournisseurs
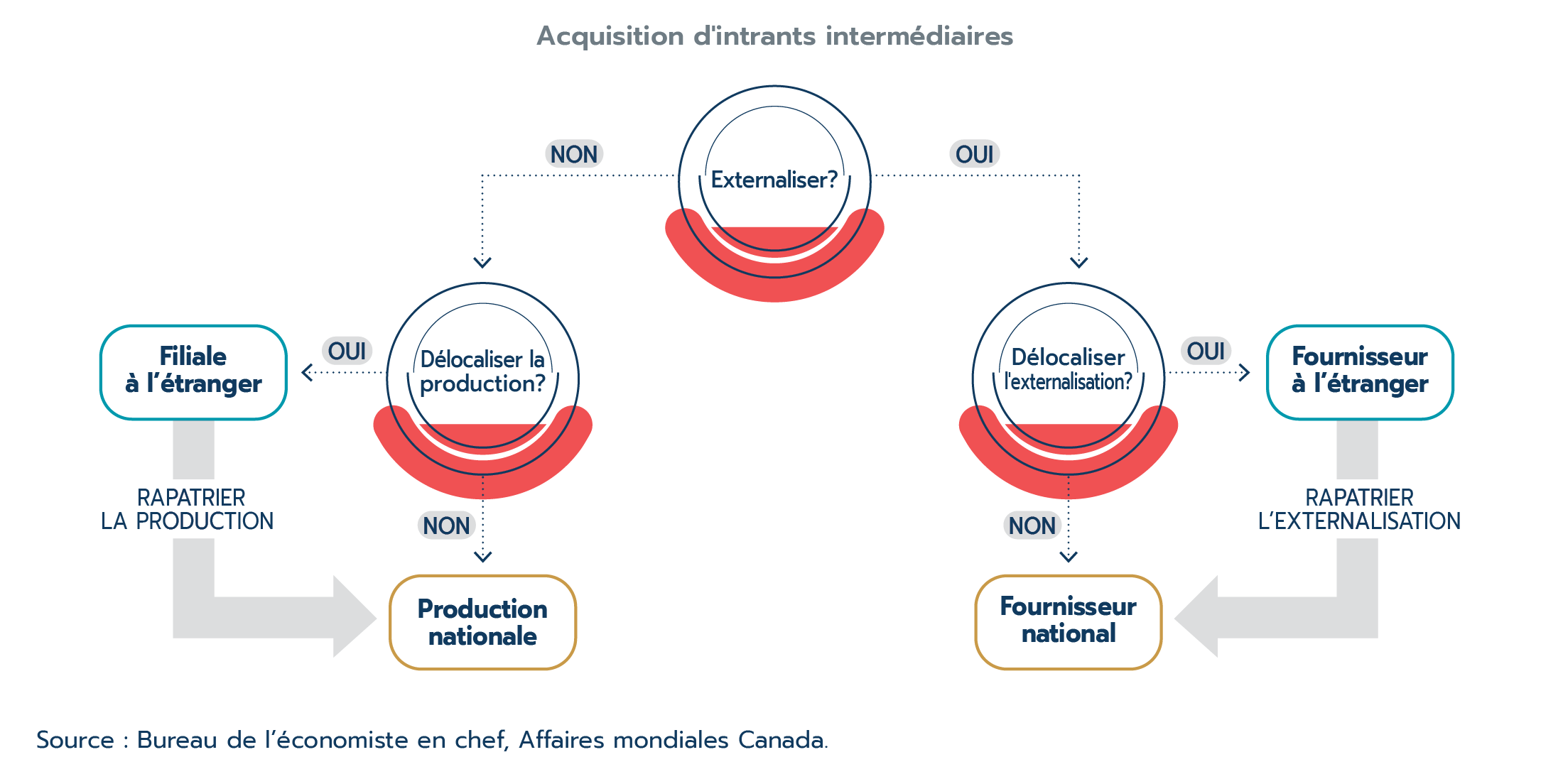
Version texte - Figure 2.15
Rapatrier quoi? Déménager des filiales ou changer de fournisseurs
Cette figure illustre les choix que font les entreprises lorsqu’elles acquièrent des intrants intermédiaires pour la production. Les choix de l’entreprise sont représentés par des losanges qui présentent chacune des principales questions auxquelles l’entreprise doit répondre, avec des flèches indiquant le résultat selon que la réponse à la question donnée est « oui » ou « non ». La première question figurant dans un losange en haut à gauche est : « Externaliser? » Si la décision est « non », la question suivante est de savoir s’il faut délocaliser la production. Cela est représenté par une flèche pointant vers le bas et menant à un autre losange comportant le texte « Délocaliser la production? ». Si la réponse à la première question est « oui », la question suivante est de savoir s’il faut délocaliser l’externalisation. Cela est indiqué par une flèche pointant vers la droite vers un autre losange avec le texte « Délocaliser l’externalisation? ». Le losange « Délocaliser la production? » comporte une flèche pointant vers la gauche et un « non » au-dessus. La flèche pointe vers une case avec le texte « Production nationale ». Ce losange comporte également une flèche pointant vers le bas et un « oui » à côté. Cette flèche pointe vers une case située sous le losange et comportant le texte « Filiale à l’étranger ». Une flèche part de la case « Filiale à l’étranger » et aboutit à la case « Production nationale », avec le texte « Rapatrier la production » en dessous. Le losange « Délocaliser l’externalisation » est précédé d’une flèche et d’un « non » qui pointe vers une case contenant le texte « Fournisseur national ». Ce losange comporte également une flèche vers la droite qui pointe vers une case avec le texte « Fournisseur à l’étranger ». Une flèche part de la case « Fournisseur à l’étranger » et aboutit à la case « Fournisseur national », avec le texte « Rapatrier l’externalisation » en dessous.
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada.
Il convient de noter que selon cette définition du rapatriement – qu’il s’agisse du rapatriement de la production ou du rapatriement de l’externalisation – il existe un processus antérieur de délocalisation qui est inversé (De Backer, 2016). Il existe d’autres définitions du rapatriement qui englobent d’autres types de décisions de relocalisation, y compris la délocalisation. Le rapatriement et la relocalisation d’un pays étranger à un autre sont même parfois utilisés comme synonymes, sans distinction de l’endroit où l’activité de l’entreprise est finalement déplacée (c’est-à-dire sur le territoire national ou ailleurs à l’étranger). Dans ce rapport, le rapatriement est considéré comme le mouvement des activités délocalisées vers le pays d’origine de l’entreprise.
Comprendre la décision de la relocalisation
Étant donné que le rapatriement fait suite à une décision antérieure de délocalisation, il est utile de comprendre les raisons de la délocalisation et les moteurs possibles du rapatriement. Les raisons qui poussent les entreprises à délocaliser leurs activités sont l’accès aux ressources, l’accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles technologies, l’amélioration de l’efficacité et d’autres avantages comparatifs qu’offrent les différents emplacements. Selon le cadre « propriété », « localisation » et « internalisation » (PLI) (Dunning, 1979), une entreprise choisira d’investir à l’étranger si elle possède des actifs qui lui donnent un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux; si une localisation étrangère offre des avantages comme une main-d’œuvre qualifiée, une législation favorable et l’accès à des ressources et à des marchés clés; et si une entreprise possède les compétences et les ressources clés pour réaliser et gérer les activités – l’avantage de l’internalisation. Si une entreprise ne dispose pas de cet avantage en matière d’internalisation, elle préférera conclure un contrat avec des fournisseurs étrangers, c’est-à-dire délocaliser l’externalisation.
Le cadre PLI indique les raisons pour lesquelles les entreprises décident de délocaliser leurs activités en décrivant les motifs sous-jacents suivants. Premièrement, l’établissement d’une filiale à l’étranger peut aider une entreprise à accéder à un nouveau marché étranger (IDE axé sur la recherche de marchés). Deuxièmement, la délocalisation peut être utilisée pour accéder à des ressources précises, comme des matières premières (IDE axé sur la recherche de ressources). Par la délocalisation, les entreprises peuvent également réduire leurs coûts de production en tirant parti des avantages concurrentiels offerts par un autre emplacement (IDE axé sur la recherche de l’efficacité). Enfin, les entreprises peuvent être en mesure d’accéder à des actifs stratégiques, notamment à l’aide d’acquisitions à l’étranger (IDE axé sur la recherche d’actifs stratégiques). Ces quatre motifs de délocalisation ne s’excluent pas mutuellement. Les entreprises s’engagent souvent dans l’IDE pour une combinaison de raisons (Affaires mondiales Canada, 2021).
La raison initiale de la délocalisation influe sur la décision de l’entreprise de rapatrier ses activités ou de les relocaliser dans un autre pays (Barbieri et al., 2019). Les IDE principalement axés sur la recherche de marchés ont moins de chances d’être rapatriés (Fel et al., 2020) que les IDE axés sur la recherche de ressources. Dans les deux cas, l’emplacement à l’étranger offre des avantages clés, comme l’accès à un marché ou à des ressources stratégiques qui ne sont pas accessibles ailleurs. Les IDE axés sur la recherche d’actifs peuvent être rapatriés si les avantages associés à l’emplacement d’une filiale et à ses actifs ont été pleinement utilisés ou épuisés (par exemple, des connaissances ou des technologies avancées) ou si un autre emplacement offre des actifs supérieurs. Les IDE axés sur la recherche d’efficacité peuvent être réorientés si les économies associées à un emplacement sont moins importantes que prévu ou si des problèmes de qualité ou autres se posent (Barbieri et al., 2019).
Les moteurs du rapatriement des filiales peuvent être classés en trois grandes catégories : la reconnaissance d’une décision de délocalisation incorrecte, le changement de l’environnement externe et le changement stratégique (Barbieri et al., 2018). Le rapatriement peut être le renversement d’une décision incorrecte de délocalisation si la direction n’a pas pleinement pris en compte les coûts ou les problèmes de rendement ou de qualité. Un changement dans l’environnement externe englobe de nombreux scénarios, de l’incertitude accrue due à de nouveaux risques perçus (par exemple, environnementaux, géopolitiques, monétaires, etc.) à des conditions de plus en plus défavorables dans le pays d’accueil, comme une augmentation des coûts (par exemple, des salaires plus élevés, des coûts énergétiques plus élevés) ou une détérioration de la qualité ou des délais de livraison. Enfin, le rapatriement peut être dû à un changement de stratégie ou de priorités de l’entreprise, comme la décision de poursuivre le développement de nouveaux produits ou d’automatiser la production.
Les mêmes facteurs qui sous-tendent le rapatriement des filiales s’appliquent également au rapatriement des fournisseurs. Les entreprises peuvent décider de se tourner vers des fournisseurs nationaux pour corriger une erreur initiale dans le choix d’un fournisseur étranger, en raison de changements dans l’environnement externe, comme des fluctuations monétaires, ou en raison de changements dans les stratégies ou les priorités.
Les raisons souvent évoquées pour justifier la décision des entreprises multinationales (EMN) de rapatrier des activités et des fournisseurs (Blais-Morisset et Rao, 2024) comprennent :
- Coûts : Des modifications aux coûts relatifs des emplacements à l’étranger et dans le pays d’origine de l’entreprise, et des connaissances acquises en lien avec les hypothèses en matière de coûts initiales.
- Qualité : Des problèmes liés à la qualité des produits ou des services reçus de l’étranger, résultant d’activités externalisées ou délocalisées.
- Risques : Une modification des risques associés à l’approvisionnement sur le marché international et aux activités délocalisées (par exemple, phénomènes météorologiques extrêmes, conflits géopolitiques, variation des taux de change, menaces pour la propriété intellectuelle, difficulté à sécuriser des intrants, goulots d’étranglement de l’offre, etc.).
- Changements de la structure : Un changement structurel des intrants nécessaires pour la production, notamment en lien avec la numérisation et l’automatisation des processus.
- Valeurs/image de marque : Des valeurs de l’entreprise en lien avec le nationalisme économique (c.-à-d. production locale), à la durabilité et à la réduction de l’empreinte carbone, ainsi qu’à l’approvisionnement inclusif au sein de l’économie nationale.
En fin de compte, le rapatriement est une entreprise coûteuse pour les entreprises et une société qui choisit la délocalisation ne le fera pas, de manière réaliste, à court terme. Le transfert d’activités à un autre emplacement, que ce soit dans le pays ou à l’étranger, prend beaucoup de temps. La construction de nouvelles installations, l’embauche et la formation de nouveaux employés et la recherche de nouveaux fournisseurs prennent du temps, tout comme la réduction de la production et la vente de bâtiments ou d’équipements à l’emplacement de la filiale existante. Les entreprises peuvent également être confrontées à des sanctions prohibitives en cas de rupture des contrats de vente existants. En outre, le manque à gagner des activités qui ne sont pas entièrement amorties fait de la relocalisation des activités un choix difficile à court terme. La restructuration d’une chaîne d’approvisionnement intégrée à l’échelle mondiale – que ce soit à l’aide de nouveaux fournisseurs, de la relocalisation de filiales ou des deux – est un processus graduel et il faut du temps pour observer les changements dans les stratégies des entreprises (Barbieri et al., 2020). Compte tenu des coûts irrécupérables associés à la délocalisation, les entreprises ne relocalisent leur production en réponse aux chocs de la demande, aux coûts commerciaux ou aux coûts de production à l’étranger que si les chocs sont importants et persistants (Di Stefano et al., 2022).
Les entreprises peuvent estimer que la relocalisation dans un autre pays est plus avantageuse que le rapatriement, car elles peuvent remédier aux vulnérabilités tout en continuant à profiter des avantages comparatifs d’autres pays. La délocalisation dans un pays proche – le déplacement de filiales ou de fournisseurs éloignés vers des pays plus proches – permet aux entreprises de réduire les coûts de transport, de diminuer les délais et d’améliorer la communication et la coordination, si elles exercent des activités dans le même fuseau horaire (du pays A vers le pays B dans la figure 2.16). Par ailleurs, le déplacement de filiales ou le changement de fournisseurs vers un autre lieu de la même région (du pays A au pays C, par exemple de la Chine au Vietnam) peut permettre aux entreprises de bénéficier de coûts inférieurs, notamment en ce qui concerne les coûts d’exploitation. Bien entendu, la société mère peut également décider de délocaliser dans une région entièrement différente pour accéder aux avantages du nouvel emplacement ou aux priorités stratégiques (du pays A au pays D).
Figure 2.16 : Options de localisation
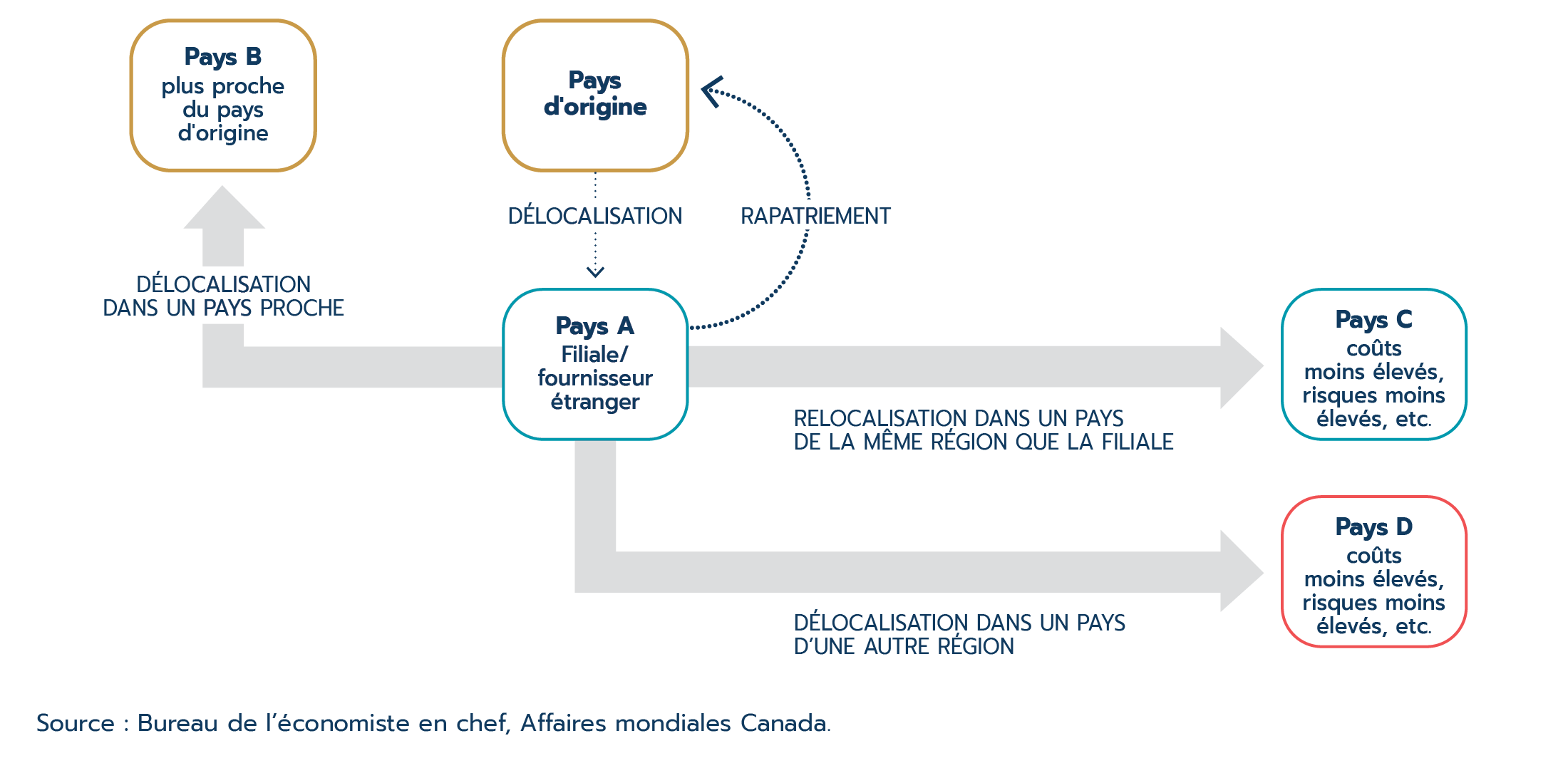
Version texte - Figure 2.16
Options de localisation
Cette figure illustre les différentes options de localisation possibles pour une entreprise. Une case en haut contient le texte « Pays d’origine » et une flèche en dessous pointe vers le texte « Délocalisation » à côté. Cette flèche pointe vers la case « Pays A : Filiale/fournisseur étranger ». Quatre flèches partent de cette boîte. Une flèche pointe vers la case « Pays d’origine » et porte la mention « Rapatriement ». Une autre flèche pointe vers la gauche et vers le haut avec le texte « Délocalisation dans un pays proche » écrit à côté. Cette flèche mène à une case située à gauche de la case « Pays d’origine », qui indique « Pays B : Plus proche du pays d’origine ». La troisième flèche pointe vers la droite et le texte « Relocalisation dans un pays de la même région que la filiale » est écrit en dessous. Cette flèche mène à une case avec le texte « Pays C : Coûts moins élevés, risques moins élevés, etc. ». La dernière flèche se trouve sous la case « Pays A » et pointe vers le bas et la droite, avec le texte « Délocalisation dans un pays d’une autre région » en dessous. Cette flèche pointe vers la case « Pays D : Coûts moins élevés, risques moins élevés, etc. ».
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada.
Les signes de rapatriement sont rares
La croissance des investissements directs étrangers, ou délocalisation, a été forte dans les années 1990 et 2000, comme nous l’avons vu à la section 2.1. Depuis qu’elles ont pris des décisions de délocalisation, les entreprises peuvent disposer de nouveaux renseignements et reconsidérer ces décisions. La question est de savoir si de nombreuses entreprises ont reconsidéré leur position et, plus important encore, si elles ont pris des mesures. La difficulté en lien avec le repérage du rapatriement et son évolution dans le temps consiste à trouver les bonnes données. Idéalement, une base de données permettant de suivre les filiales commerciales et les fournisseurs au fil du temps aiderait à suivre les tendances en matière de rapatriement. En l’absence de telles données, d’autres méthodes sont utilisées pour tenter de déterminer si les entreprises ramènent des activités sur le territoire national ou passent de fournisseurs étrangers à des fournisseurs nationaux.
Les données sur les importations sont souvent examinées pour rechercher des signes de rapatriement au niveau de l’économie. Une diminution globale des importations peut indiquer un transfert de la production à l’étranger (c’est-à-dire une diminution des importations de biens intermédiaires en provenance des filiales étrangères) vers une augmentation de la production nationale. Une diminution des importations pourrait également refléter un transfert des fournisseurs étrangers vers les fournisseurs nationaux. Une étude de 2016 (De Backer et al.) a examiné la croissance des importations par rapport à la demande nationale dans les principales économies entre 2005 et 2014 et n’a constaté aucune diminution du ratio qui suggérerait un rapatriement. Si une diminution de ce ratio peut être le signe d’un rapatriement des filiales ou d’un passage à des fournisseurs nationaux, elle peut également refléter une augmentation de la production nationale sans relocalisation des filiales étrangères ni changement de fournisseur.
Les données sur les importations peuvent également être utilisées pour examiner les changements dans le ratio des intrants nationaux par rapport aux intrants étrangers. Une autre étude (Krenz et Strulik, 2021) montre une augmentation de ce ratio à l’échelle mondiale entre 2000 et 2014 et interprète cette augmentation comme un signe de rapatriement. Toutefois, une augmentation du ratio des intrants nationaux par rapport aux intrants étrangers pourrait être observée sans qu’il y ait rapatriement. Ce serait le cas si, par exemple, une industrie qui n’externalise pas ses intrants à l’étranger se développe (augmentant ainsi la demande d’intrants nationaux) tandis que d’autres industries maintiennent leur demande d’intrants provenant de l’étranger.
Le rapatriement peut également être mesuré en examinant les importations de produits de fabrication en tant que part de la production nationale, également connu sous le nom de ratio importations/production manufacturière (RIPM). Une augmentation de la production nationale accompagnée d’une diminution des importations peut être le signe d’un rapatriement, car cela pourrait indiquer que les intrants sont de plus en plus produits ou approvisionnés à l’échelle nationale plutôt qu’importés de filiales ou de fournisseurs étrangers. Kearney publie son indice de relocalisation annuel pour les États-Unis; cet indice représente la variation du RIPM d’une année à l’autre au niveau agrégé pour l’ensemble de l’économie. Leur plus récente publication (2023) fait état d’une diminution de 0,39 du RIPM, qui est passé de 14,49 en 2021 à 14,10 en 2022, l’interprétant comme un signal de rapatriement. Toutefois, une diminution du RIPM pourrait également découler de tendances autres que le rapatriement. Par exemple, les progrès technologiques, comme l’automatisation, pourraient également entraîner une augmentation de la production nationale, sans délocalisation correspondante des filiales ou des fournisseurs étrangers, ni diminution des importations. De plus, cette baisse sur un an fait suite à une forte augmentation du RIPM entre 2020 et 2021 (+1,54). Par conséquent, la dernière baisse est beaucoup moins importante que la hausse précédente. En outre, le RIPM américain suit une tendance à la hausse depuis dix ans et le RIPM de 2022 demeure supérieur à la moyenne décennale (12,61).
Le RIPM ajusté pour tenir compte de l’inflation constitue une meilleure mesure, car il permet d’isoler les variations du ratio qui peuvent simplement refléter des effets de prix. Les RIPM ajustés pour tenir compte de l’inflation n’indiquent pas de rapatriement à l’échelle macroéconomique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, les deux pays affichant une tendance générale à la hausse entre 2015 et 2023. On observe une légère baisse du RIPM ajusté pour tenir compte de l’inflation aux États-Unis en 2023, ce qui peut suggérer la possibilité d’un rapatriement, mais il est trop tôt pour déterminer s’il s’agit du début d’une nouvelle tendance. À l’échelle de l’industrie au Canada, il y a également des signes de rapatriement possible pour la fabrication de boissons et de tabac (entre 2018 et 2021) et la fabrication de produits du pétrole et du charbon (entre 2016 et 2022). Toutefois, il semble qu’il s’agisse là de candidats peu probables au rapatriement.
Les tendances en matière de localisation des filiales peuvent également être examinées à l’aide de données sur les activités des multinationales. Si l’emploi des multinationales et leurs actifs augmentent plus rapidement dans le pays qu’à l’étranger, cela pourrait être un signe de rapatriement. Au cours des dix années écoulées entre 2011 et 2021, la part des EMNC dans l’emploi national a diminué dans les industries de biens et de services en raison de la croissance beaucoup plus rapide de l’emploi à l’étranger (Blais-Morisset et Rao, 2024) [1,4 % de croissance de l’emploi national des EMNC par rapport à 5,4 % de croissance de l’emploi des EMNC par les filiales étrangères]. Cette tendance n’est pas suffisante pour exclure le rapatriement. Le ralentissement de la croissance de l’emploi dans les EMNC peut refléter d’autres facteurs, comme l’adoption de nouvelles technologies ou la restructuration des industries nationales. En ce qui concerne les actifs des EMNC, la croissance à l’étranger a été plus rapide que la croissance nationale au cours de la dernière décennie, ce qui a entraîné une diminution de la part nationale des EMNC dans les industries de biens et de services. Cela montre également que les entreprises canadiennes continuent d’étendre leurs activités à l’étranger.
Les données sur les actifs des EMNC par secteur montrent que pour les secteurs à forte présence étrangère (Finance et assurances; Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz), il n’y a eu aucun signe de rapatriement, la part des actifs nationaux ayant diminué. Le secteur du transport et de l’entreposage a également une forte présence étrangère et a montré des signes possibles de rapatriement ces dernières années avec une diminution de la part des actifs étrangers. Dans le même temps, l’industrie de la fabrication, le secteur le plus souvent associé au rapatriement, n’a montré aucun signe de relocalisation des activités des entreprises sur le territoire national, les actifs étrangers continuant de croître. Le secteur qui a connu une augmentation notable de sa part dans les actifs nationaux est celui de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse. Dans l’ensemble, toutefois, la présence étrangère dans ce secteur est très faible (14 % des actifs des EMNC et 1,2 % de la part totale du Canada dans les actifs du secteur des entreprises).
Statistique Canada recueille des données sur les importations de biens par des entreprises au Canada en provenance de parties « apparentées » et « non apparentées » qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur l’activité de rapatriement. Une partie « apparentée » est définie comme une société dans laquelle l’entreprise importatrice détient une participation de 5 % ou plus. Il s’agit donc d’une mesure plus large que l’investissement direct pour lequel une participation d’au moins 10 % est requise. Néanmoins, les importations des EMNC en provenance de parties apparentées sont une bonne approximation des importations des EMNC en provenance de filiales, tandis que les importations de parties non apparentées sont une mesure des importations de l’entreprise ne provenant pas de filiales, c’est-à-dire provenant de fournisseurs étrangers.
L’examen des importations des EMNC révèle que depuis 2016, première année pour laquelle des données sont disponibles, les importations en provenance de parties apparentées ont augmenté à un taux annuel moyen plus élevé (11 %) que les importations en provenance de parties non apparentées (7,4 %). La croissance des deux importations indique que le rapatriement ne semble pas être une tendance généralisée parmi les EMNC.Note de bas de page 19 Toutefois, par rapport aux ventes, les importations des parties apparentées sont demeurées stagnantes, tandis que les importations des parties non apparentées ont diminué (figure 2.17). Par conséquent, les ventes des EMNC ont augmenté plus rapidement que les importations ne provenant pas de filiales. Cela peut indiquer un approvisionnement plus important auprès des fournisseurs nationaux ou une augmentation de la production nationale, par rapport aux fournisseurs étrangers, mais pas une diminution des intrants provenant des filiales étrangères.
Figure 2.17 : La part des importations des EMNC en provenance des filiales par rapport aux ventes est demeurée constante
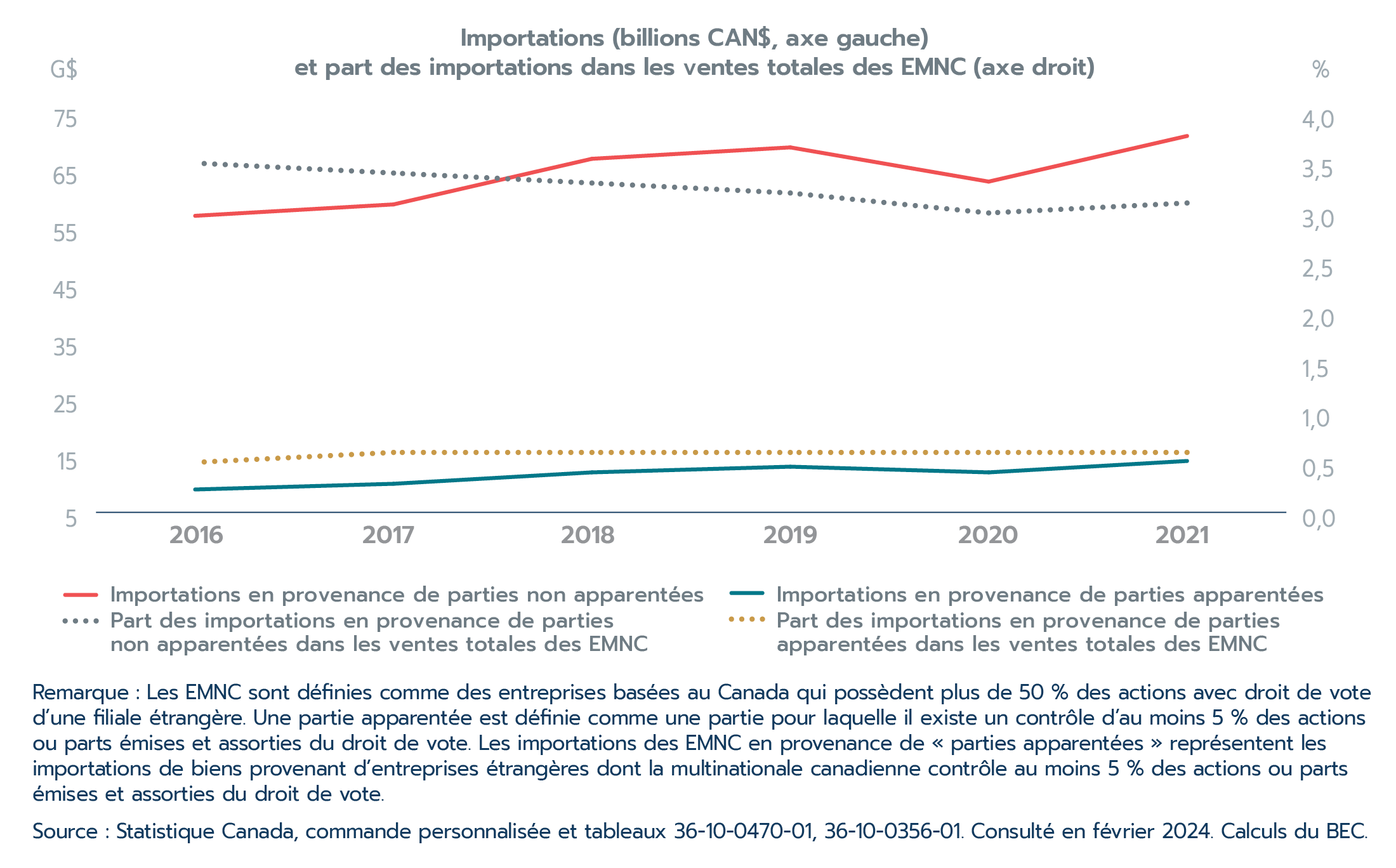
Version texte - Figure 2.17
| Année | Importations en provenance de parties non apparentées (milliards de $ CA) | Importations en provenance de parties apparentées (milliards de $ CA) | Part des importations en provenance de parties non apparentées dans les ventes totales des EMNC (%) | Part des importations en provenance de parties apparentées dans les ventes totales des EMNC (%) |
|---|---|---|---|---|
| * Remarque : Les EMNC sont définies comme des entreprises basées au Canada qui possèdent plus de 50 % des actions avec droit de vote d’une filiale étrangère. Une partie apparentée est définie comme une partie pour laquelle il existe un contrôle d’au moins 5 % des actions ou parts émises et assorties du droit de vote. Les importations des EMNC en provenance de « parties apparentées » représentent les importations de biens provenant d’entreprises étrangères dont la multinationale canadienne contrôle au moins 5 % des actions ou parts émises et assorties du droit de vote. Source : Statistique Canada, commande personnalisée et tableaux 36-10-0470-01, 36-10-0356-01. Consulté en février 2024. Calculs du BEC. | ||||
| 2016 | 57 | 9 | 3,5 | 0,5 |
| 2017 | 59 | 10 | 3,4 | 0,6 |
| 2018 | 67 | 12 | 3,3 | 0,6 |
| 2019 | 69 | 13 | 3,2 | 0,6 |
| 2020 | 63 | 12 | 3 | 0,6 |
| 2021 | 71 | 14 | 3,1 | 0,6 |
L’Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise de Statistique Canada fournit des renseignements supplémentaires sur les activités de rapatriement. Cette enquête recueille des renseignements sur les décisions stratégiques et les activités de la chaîne de valeur mondiale des entreprises au Canada. Les résultats de la version de 2021 montrent qu’entre 2017 et 2019, seulement 1,2 % des entreprises interrogées ont transféré des activités de l’étranger vers un emplacement canadien, une part encore plus faible qu’entre 2015 et 2017 (1,5 %). En outre, une part plus importante d’entreprises a déclaré avoir des filiales à l’étranger en 2019 (8,9 %) par rapport à 2017 (5,3 %).
Les données américaines ne fournissent pas non plus de preuves claires des tendances en matière de rapatriement. Les données relatives aux activités des multinationales américaines sont contrastées. L’emploi national des multinationales américaines est demeuré relativement constant, tandis que les actifs des multinationales américaines ont augmenté. Cette dernière tendance pourrait être attribuée à un certain rapatriement de la part des multinationales américaines. Toutefois, l’augmentation des actifs nationaux pourrait également illustrer la croissance du marché national sans activité de rapatriement significative (Blais-Morisset et Rao 2024). Les données sur les importations en provenance des filiales et ne provenant pas de filiales révèlent que les multinationales américaines semblent diminuer leur approvisionnement à l’étranger, et peut-être rapatrier l’externalisation, mais l’activité des filiales à l’étranger ne semble pas avoir diminué. Toutefois, par rapport aux ventes totales des multinationales américaines, les importations ne provenant pas de filiales et les importations provenant de filiales en tant que part des ventes ont diminué entre 2011 et 2021. En d’autres termes, les ventes globales des multinationales américaines ont augmenté plus rapidement que les intrants des multinationales américaines en provenance de l’étranger. Cela pourrait être le signe d’un approvisionnement plus important auprès des fournisseurs nationaux ou d’une augmentation de la production nationale.
Pendant la première moitié de 2024, les données disponibles ne confirment pas l’existence de tendances générales de rapatriement au Canada ou aux États-Unis. Il se peut que les entreprises envisagent de rapatrier leurs activités pour accroître la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement, tant en ce qui concerne l’approvisionnement que la production, mais qu’elles n’aient pas encore achevé et mis en place leurs plans (encadré 2.3).
Encadré 2.3 : Intentions des entreprises – différentes stratégies pour accroître la résilience future
Les décisions concernant le rapatriement font partie de la stratégie à long terme d’une entreprise. À court terme, il est moins probable qu’une entreprise procède à un rapatriement, compte tenu des coûts associés et du temps nécessaire à la transition des activités vers le pays d’origine ou des coûts liés à la rupture des contrats existants avec les fournisseurs et à la recherche de nouveaux fournisseurs nationaux. Ainsi, les décisions des entreprises de relocaliser des filiales ou de changer de fournisseurs depuis le début de la pandémie ou à la suite de conflits géopolitiques récents ne sont peut-être pas encore prises en compte dans les données. Des enquêtes récentes sur les intentions des entreprises peuvent fournir des indications sur les tendances futures.
Les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises canadiennes montrent un intérêt modeste pour le rapatriement. En 2023, seuls 4,4 % des répondants à l’Enquête sur la situation des entreprises de Statistique Canada (T2 de 2023) ont déclaré avoir l’intention de relocaliser des activités de la chaîne d’approvisionnement au Canada. Les intentions sont légèrement plus élevées pour les entreprises de l’industrie de la fabrication (7,5 %) et de l’industrie de l’information et de la culture (8,5 %). Les entreprises semblent avoir d’autres idées pour accroître la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Il semble qu’il y ait une légère tendance à la relocalisation vers d’autres pays. La part des entreprises qui ont l’intention de relocaliser les activités de la chaîne d’approvisionnement à l’extérieur du Canada était légèrement plus élevée dans l’ensemble (5,6 %), une fois de plus avec une part plus élevée parmi les entreprises des industries de fabrication (23 %). Outre la modification des stratégies de localisation, les entreprises envisagent d’adapter les chaînes d’approvisionnement en travaillant avec les fournisseurs pour améliorer les délais (36 %), en établissant des partenariats avec de nouveaux fournisseurs (31 %) ou en substituant des intrants (27 % des répondants). Ces deux dernières stratégies n’excluent pas le changement de l’emplacement des filiales ou des fournisseurs.
Au sud de la frontière, les chefs d’entreprise américains semblent envisager de relocaliser les activités de la chaîne d’approvisionnement plus que leurs homologues canadiens. Une récente enquête menée auprès de cadres américains (ABB 2022) a révélé que 37 % des répondants envisageaient de rapatrier la production dans leur pays d’origine. La délocalisation dans un pays proche est également une option populaire envisagée, 33 % d’entre eux envisageant de relocaliser leurs activités plus près. Parallèlement, une autre enquête menée auprès de PDG et de chefs d’entreprise américains (Kearney 2023) révèle que les entreprises sont de plus en plus enclines à vouloir rapatrier des activités manufacturières, la majorité des personnes interrogées (96 %) indiquant avoir rapatrié certaines de leurs activités, ou prévoyant de le faire ou en évaluant la possibilité. La définition de rapatriement utilisée pour cette enquête comprend à la fois une relocalisation dans le pays d’origine de la filiale et le passage à des fournisseurs nationaux.
Pas de retour au pays, mais peut-être une relocalisation
Comme nous l’avons indiqué, il peut être préférable de relocaliser les activités vers d’autres emplacements plutôt que de rapatrier la production et l’approvisionnement dans le pays d’origine. Les entreprises peuvent choisir de délocaliser leurs activités dans un pays proche (figure 2.16). Cette stratégie peut être choisie pour plusieurs raisons, notamment la réduction des délais d’expédition, la diminution des coûts de transport et l’amélioration des communications (en exerçant des activités dans le même fuseau horaire, par exemple). La délocalisation dans un pays proche permet aux entreprises de continuer à bénéficier de l’efficacité de la production dont elles disposent. Les données sur les actifs des EMNC à l’étranger ne montrent pas de signes clairs de délocalisation dans un pays proche en ce qui concerne les filiales. Si la part des actifs des EMNC a augmenté aux États-Unis, il en va de même dans les pays asiatiques. En outre, la croissance des actifs dans le reste de l’Asie (hors Chine) (17,6 %) a dépassé la croissance des actifs des EMNC aux États-Unis (11,7 %) au cours des cinq dernières années. De même, les données sur les activités des multinationales américaines ne confirment pas la thèse de la délocalisation dans un pays proche. Au cours de la dernière décennie, la part des actifs dans les pays voisins, le Canada et le Mexique, a diminué (Blais-Morisset et Rao, 2024), tandis que les pays d’Europe et d’Asie ont connu une croissance des actifs américains.
Si une proportion notable d’entreprises canadiennes sont des filiales de délocalisation dans un pays proche, la part du stock d’IDE dans les pays les plus proches devrait augmenter par rapport aux parts dans les pays les plus éloignés. Par conséquent, une autre façon de vérifier la présence du phénomène de délocalisation dans un pays proche est d’examiner comment les parts du stock d’IDE à l’étranger évoluent par rapport aux distances avec le pays d’accueil. Pour ce faire, on calcule une « distance moyenne », qui représente la somme des distances de la destination de chaque IDE pondérée par leurs parts respectives du stock d’IDE. La distance moyenne du stock d’investissements directs canadiens à l’étranger (IDCE) a suivi une tendance à la hausse jusqu’en 2012, en étant multipliée par 1,3 par rapport aux deux décennies précédentes (figure 2.18). À partir de 2012, la distance a commencé à se réduire (baisse de 17 % entre 2012 et 2022), ce qui peut être le signe d’une délocalisation dans un pays proche. En revanche, la distance moyenne des investissements directs américains à l’étranger n’a pas évolué de manière aussi marquée, avec une diminution de 3,1 % entre 1996 et 2003 et de 2,4 % entre 2006 et 2011, suivie d’une tendance à la hausse jusqu’en 2019 (croissance de 3,7 % entre 2011 et 2019). Il est possible que ce soit produit la délocalisation de filiales américaines dans des pays proches ces dernières années, la distance des investissements à l’étranger diminuant progressivement. Il est intéressant de noter que la distance moyenne des investissements à l’étranger est plus élevée pour les États-Unis que pour le Canada. En d’autres termes, dans l’ensemble, les États-Unis ont un stock d’IDE plus important dans des emplacements plus éloignés que dans des pays plus proches. La distance moyenne beaucoup plus faible du Canada s’explique par le fait que la moitié de son stock d’IDCE se trouve dans le pays le plus proche : les États-Unis.
Il est important de garder à l’esprit que les données sur les stocks d’IDE sortants ne représentent pas nécessairement la destination finale de l’investissement. Parfois, les entreprises font transiter les fonds par une filiale ou un centre financier extraterritorial, de sorte que le pays de destination inscrit peut ne pas être le pays d’accueil final. Par conséquent, les investissements dans certains pays sont surévalués alors que ceux dans d’autres pays peuvent être sous-évalués (Le point sur le commerce, 2021). L’exclusion des données pour les pays qui sont largement reconnus comme étant des centres financiers extraterritoriaux (Torslov et al., 2021) explique en partie le manque de données définitives sur les pays d’accueil. Pour le Canada et les États-Unis, les distances moyennes du stock d’IDE à l’exclusion des centres financiers extraterritoriaux suivent un schéma semblable à celui des données originales.
Figure 2.18 : Une plus grande partie des investissements directs étrangers du Canada se fait dans des pays plus proches, à savoir les États-Unis
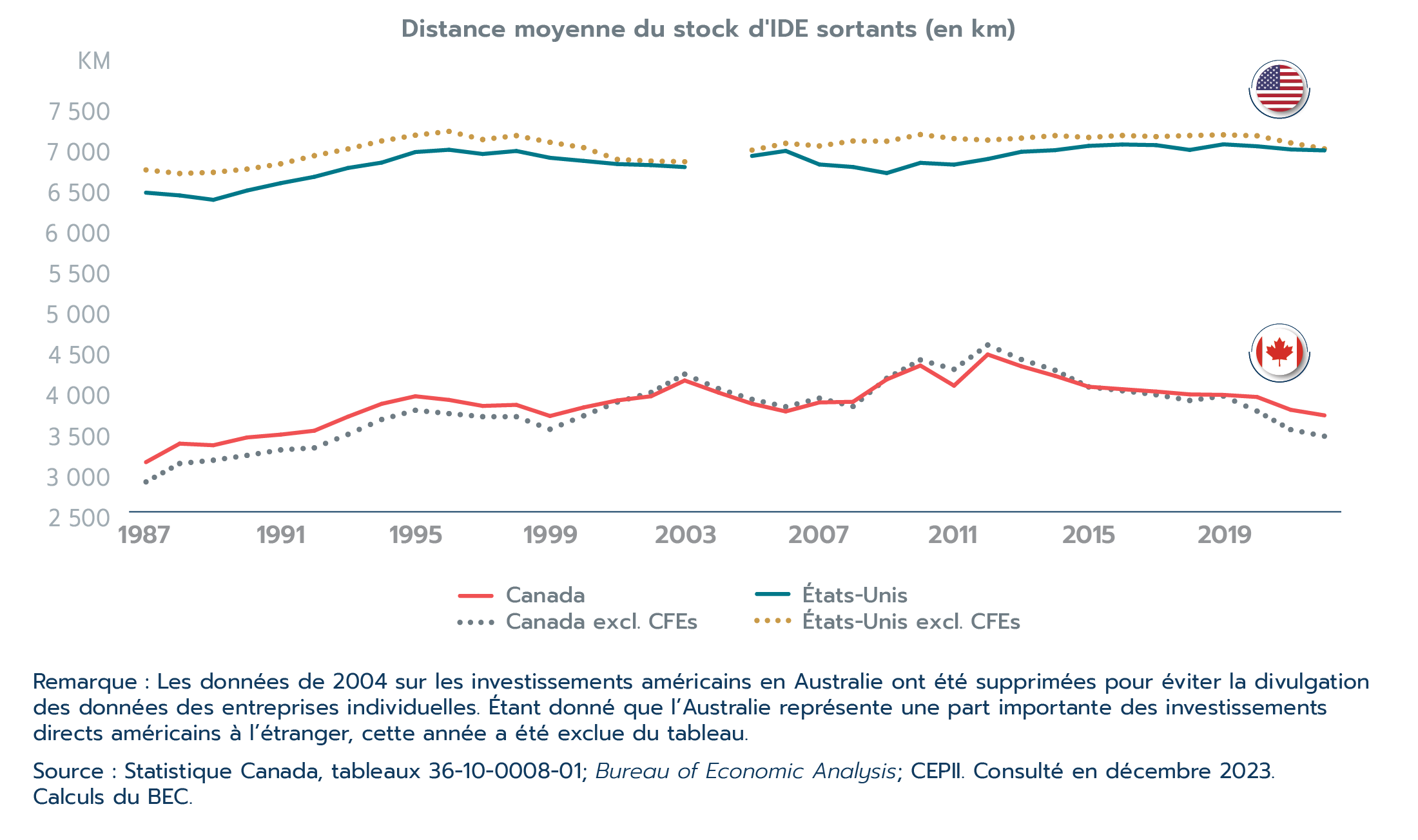
Version texte - Figure 2.18
| Année | Canada | Canada, à l’exclusion des centres financiers extraterritoriaux | États-Unis | États-Unis, à l’exclusion des centres financiers extraterritoriaux |
|---|---|---|---|---|
| Remarque : Les données de 2004 sur les investissements américains en Australie ont été supprimées pour éviter la divulgation des données des entreprises individuelles. Étant donné que l’Australie représente une part importante des investissements directs américains à l’étranger, cette année a été exclue du tableau. Source : Statistique Canada, tableaux 36-10-0008-01; Bureau of Economic Analysis; CEPII. Consulté en décembre 2023. Calculs du BEC. | ||||
| 1987 | 3 111 | 2 868 | 6 428 | 6 708 |
| 1988 | 3 339 | 3 094 | 6 394 | 6 664 |
| 1989 | 3 319 | 3 135 | 6 340 | 6 678 |
| 1990 | 3 415 | 3 194 | 6 454 | 6 718 |
| 1991 | 3 450 | 3 262 | 6 545 | 6 783 |
| 1992 | 3 498 | 3 287 | 6 623 | 6 883 |
| 1993 | 3 671 | 3 453 | 6 732 | 6 966 |
| 1994 | 3 829 | 3 636 | 6 798 | 7 065 |
| 1995 | 3 922 | 3 749 | 6 928 | 7 135 |
| 1996 | 3 877 | 3 709 | 6 956 | 7 182 |
| 1997 | 3 803 | 3 671 | 6 904 | 7 082 |
| 1998 | 3 816 | 3 670 | 6 941 | 7 130 |
| 1999 | 3 679 | 3 516 | 6 857 | 7 048 |
| 2000 | 3 785 | 3 682 | 6 819 | 6 982 |
| 2001 | 3 871 | 3 851 | 6 780 | 6 837 |
| 2002 | 3 922 | 3 969 | 6 767 | 6 817 |
| 2003 | 4 116 | 4 194 | 6 743 | 6 809 |
| 2004 | 3 968 | 4 016 | ||
| 2005 | 3 830 | 3 884 | 6 880 | 6 952 |
| 2006 | 3 735 | 3 793 | 6 942 | 7 035 |
| 2007 | 3 846 | 3 898 | 6 775 | 7 003 |
| 2008 | 3 854 | 3 797 | 6 744 | 7 064 |
| 2009 | 4 129 | 4 142 | 6 669 | 7 061 |
| 2010 | 4 300 | 4 369 | 6 795 | 7 143 |
| 2011 | 4 052 | 4 254 | 6 773 | 7 094 |
| 2012 | 4 436 | 4 553 | 6 842 | 7 075 |
| 2013 | 4 291 | 4 375 | 6 931 | 7 099 |
| 2014 | 4 173 | 4 242 | 6 951 | 7 130 |
| 2015 | 4 039 | 4 037 | 7 004 | 7 108 |
| 2016 | 4 009 | 3 990 | 7 021 | 7 132 |
| 2017 | 3 980 | 3 941 | 7 013 | 7 118 |
| 2018 | 3 945 | 3 870 | 6 954 | 7 131 |
| 2019 | 3 939 | 3 924 | 7 023 | 7 140 |
| 2020 | 3 913 | 3 739 | 6 999 | 7 128 |
| 2021 | 3 755 | 3 511 | 6 960 | 7 041 |
| 2022 | 3 687 | 3 430 | 6 948 | 6 968 |
Au lieu de relocaliser leurs activités dans leur pays d’origine ou dans un pays plus proche, les entreprises peuvent choisir de relocaliser leurs activités dans un autre pays de la région où se trouve la filiale ou à un autre emplacement éloigné. Ce serait le cas si l’on essayait de tirer parti de coûts inférieurs (comme les salaires) ou de gains d’efficacité. Les entreprises peuvent également choisir de relocaliser ses activités en réponse à l’évolution des stratégies mondiales ou régionales. L’augmentation des actifs des EMNC et des multinationales américaines dans les pays asiatiques peut être le signe d’une relocalisation des filiales nord-américaines en Asie. Toutefois, cela pourrait aussi simplement exprimer l’augmentation de la délocalisation. Néanmoins, certains signes indiquent que les multinationales modifient leurs stratégies de délocalisation en Asie. Alors qu’il n’y a pas eu de tendances notables dans les dessaisissements d’actifs existants en Chine, les annonces de nouveaux projets d’IDE par des entreprises américaines et d’Europe occidentale sont en baisse depuis plus d’une décennie (figure 2.19). En parallèle, les annonces de projets dans d’autres économies asiatiques ont augmenté. Cela suggère que les entreprises occidentales modifient leurs stratégies de délocalisation et se tournent vers des emplacements où les bénéfices nets sont plus élevés, peut-être en raison d’une combinaison de coûts et de risques moindres.
Figure 2.19 : Les annonces de projets en Chine sont en baisse alors que les autres pays asiatiques voient leurs investissements augmenter
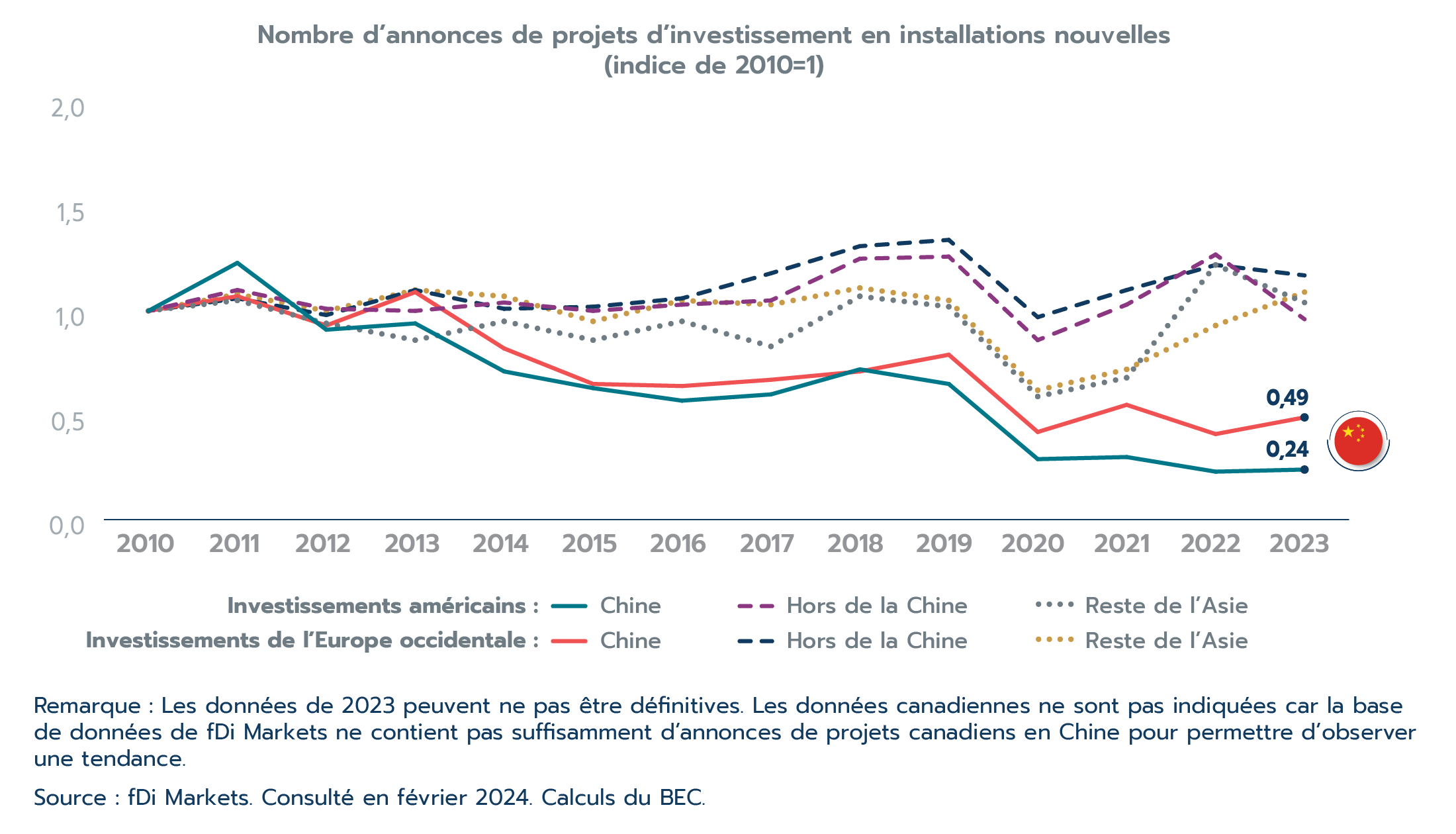
Version texte - Figure 2.19
| Année | Investissements américains | Investissements de l’Europe occidentale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine | Hors de la Chine | Reste de l’Asie | Chine | Hors de la Chine | Reste de l’Asie | |
| Remarque : Les données de 2023 peuvent ne pas être définitives. Les données canadiennes ne sont pas indiquées car la base de données de fDi Markets ne contient pas suffisamment d’annonces de projets canadiens en Chine pour permettre d’observer une tendance. Source : fDi Markets. Consulté en février 2024. Calculs du BEC. | ||||||
| 2010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2011 | 1,23 | 1,10 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 1,08 |
| 2012 | 0,91 | 1,01 | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| 2013 | 0,94 | 1,00 | 0,86 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| 2014 | 0,71 | 1,04 | 0,95 | 0,82 | 1,01 | 1,07 |
| 2015 | 0,63 | 1,00 | 0,86 | 0,65 | 1,02 | 0,95 |
| 2016 | 0,57 | 1,03 | 0,95 | 0,64 | 1,06 | 1,05 |
| 2017 | 0,60 | 1,05 | 0,83 | 0,67 | 1,18 | 1,03 |
| 2018 | 0,72 | 1,25 | 1,07 | 0,71 | 1,31 | 1,11 |
| 2019 | 0,65 | 1,26 | 1,02 | 0,79 | 1,34 | 1,05 |
| 2020 | 0,29 | 0,86 | 0,59 | 0,42 | 0,97 | 0,62 |
| 2021 | 0,30 | 1,03 | 0,68 | 0,55 | 1,10 | 0,72 |
| 2022 | 0,23 | 1,27 | 1,22 | 0,41 | 1,22 | 0,93 |
| 2023 | 0,24 | 0,96 | 1,04 | 0,49 | 1,17 | 1,09 |
2.5 Conclusion
Les chaînes d’approvisionnement internationales jouent un rôle important dans l’économie canadienne. Si le Canada est impliqué dans les chaînes d’approvisionnement internationales depuis bien avant la Confédération, les chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui sont davantage complexes et sophistiquées, et consistent souvent en un réseau complexe de fournisseurs, de producteurs ainsi que de points d’assemblage et de distribution. Si les chaînes d’approvisionnement présentent des défis, car elles peuvent aussi transmettre des chocs externes à l’économie canadienne, le Canada tire également d’importants avantages des chaînes d’approvisionnement internationales.
La littérature citée dans le cadre de ce dossier révèle comment les chaînes d’approvisionnement internationales améliorent la productivité des entreprises canadiennes en leur permettant d’accéder à des intrants étrangers ainsi qu’en leur offrant un plus grand choix en termes de variété et de personnalisation des intrants. En outre, les chaînes d’approvisionnement internationales permettent aux entreprises de bénéficier de la diffusion des connaissances et contribuent aussi à accroître leur productivité en les exposant davantage à la concurrence étrangère et en permettant ainsi aux entreprises nationales de se concentrer sur leurs tâches essentielles. En raison des gains de productivité réalisés par les entreprises, les consommateurs du Canada bénéficient des chaînes d’approvisionnement internationales grâce à une plus grande variété de choix de produits ainsi qu’à des prix plus bas et plus stables.
Au début de la pandémie de COVID-19, la population canadienne craignait que les fermetures d’usines dans le monde entier n’entraînent des pénuries dans les magasins de leur quartier. Bon nombre des enjeux rencontrés pendant la pandémie étaient attribuables à un déplacement important de la demande des services vers les biens de consommation durables, ce qui a exercé une pression sur les infrastructures de transport, entraînant des retards dans les ports ainsi qu’une augmentation des coûts du transport maritime. Néanmoins, la pandémie a montré à quel point les chaînes d’approvisionnement étaient robustes, compte tenu de l’ampleur du choc; la population canadienne a pu continuer à accéder à la plupart des biens et services dont elle avait besoin.
Si les chaînes d’approvisionnement internationales se sont rapidement remises des perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, elles sont aujourd’hui confrontées à des défis et à des risques qui sont nouveaux. Ces risques peuvent être regroupés en quatre grandes catégories : les changements climatiques et les catastrophes naturelles, les risques humains et organisationnels, les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et l’évolution du paysage géopolitique. Bien que ces nouveaux risques soient considérables et, dans certains cas, augmentent (comme dans le cas des changements climatiques), les entreprises peuvent s’y préparer et tenter de les atténuer de nombreuses façons. La constitution de stocks, la diversification des fournisseurs ainsi que l’innovation dans les processus de production constituent quelques-unes des stratégies adoptées par les entreprises pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et ainsi renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement internationales.
Les entreprises peuvent également choisir de reconfigurer certaines parties de leurs chaînes d’approvisionnement en relocalisant des activités de production dans l’économie nationale, ou encore le rapatriement. Si le rapatriement représente une réponse possible aux risques actuels auxquels sont confrontées les chaînes d’approvisionnement internationales, il s’agit d’une aventure coûteuse pour les entreprises, car cela implique à renoncer à de nombreux avantages découlant des chaînes d’approvisionnement internationales. Sur la base des données disponibles au moment de la rédaction du présent document, rien n’indique que les entreprises canadiennes pratiquent le rapatriement à grande échelle. Plutôt que de rapatrier des activités, les entreprises peuvent choisir de les délocaliser dans un autre pays, ce qui leur permet ainsi de remédier aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement tout en continuant à profiter des avantages comparatifs d’autres pays. Certains éléments indiquent que les entreprises pourraient délocaliser certaines sources d’intrants vers d’autres pays, bien que les données soient encore limitées. En fin de compte, une entreprise qui choisit de délocaliser ne le fera pas, de manière réaliste, à court terme. Qu’il s’agisse de changer de fournisseurs ou de délocaliser des filiales, la restructuration des chaînes d’approvisionnement intégrées à l’échelle mondiale constitue un processus graduel et les changements dans les stratégies des entreprises prennent généralement du temps à se matérialiser.
On ne sait pas encore comment les chaînes d’approvisionnement internationales évolueront à l’avenir, car les entreprises modifient leurs stratégies en fonction des risques, des défis ainsi que de l’évolution des priorités. Ce que nous savons, c’est que les chaînes d’approvisionnement internationales existent depuis fort longtemps et qu’elles continueront probablement à exister pendant bien des années. Nous savons également que l’utilisation de ce système de production représente de nombreux avantages. Les entreprises continueront à se restructurer et à modifier leur processus de production pour être à la fois concurrentielles et se développer. Les chaînes d’approvisionnement internationales deviendront probablement plus complexes et davantage sophistiquées à mesure que les entreprises continueront d’innover et d’adopter de nouvelles technologies, comme la numérisation et l’intelligence artificielle. Pour rester concurrentielles, les entreprises canadiennes doivent apprendre à s’adapter, à établir des chaînes d’approvisionnement résilientes et à mettre en place des stratégies en cas de perturbations. Le rôle des chaînes d’approvisionnement internationales dans l’économie canadienne ne fera vraisemblablement que s’accroître à l’avenir, et les entreprises canadiennes continueront à s’approvisionner en intrants nécessaires à l’étranger et, à leur tour, à exporter leurs biens et services dans le monde entier.
Bibliographie
ABB Robotics and Discrete Automation. (2022). ABB supply chain survey. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/28/2470499/0/en/ABB-survey-finds-70-of-US-businesses-looking-to-bring-production-closer-to-home-robotic-automation-and-workforce-upskilling-essential-to-return-of-operations.html.
Acemoglu, D. et Tahbaz-Salehi, A. (2020). Firms, failures, and fluctuations: The macroeconomics of supply chain disruptions. NBER Working Paper no 27565, National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA), États-Unis.
Aiyar, M. S., Chen, M. J., Ebeke, C., Ebeke, M. C. H., Garcia-Saltos, M. R., Gudmundsson, T.,… Trevino, M. J. P. (2023). Geo-economic fragmentation and the future of multilateralism. Washington (D.C.), FMI.
Andrews, D., Gal, P. et Witheridge, W. (2018). Un génie dans sa lampe? Mondialisation, concurrence et inflation. Documents de travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, no 1462, Éditions OCDE, Paris. https://doi.org/10.1787/deda7e54-en.
Autorité du canal de Panama. (2024). Advisory to shipping no. A-07-2024. https://pancanal.com/wp-content/uploads/2024/01/ADV07-2024-MONTHLY-FEB.pdf.pdf.
Baldwin, J. et Yan, B. (2014). Les chaînes de valeur mondiales et la productivité des entreprises manufacturières au Canada. Série de documents de recherche sur l’analyse économique (AE) 1703-0412, no 359. https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/statcan/11f0027m/11f0027m2014090-fra.pdf.
Baldwin, R. (2013). Global supply chains: Why they emerged, why they matter, and where they are going. CTEI Working Papers, The Graduate Institute Geneva, Centre for Trade and Economic Integration.
Baluch, A. et Bottorf, C. (2023). What is just in time inventory (jit)? Forbes Advisor. https://www.forbes.com/advisor/business/just-in-time-inventory/#:~:text=Reduce%20waste.,Increase%20productivity.
Banque du Canada. (2021). La politique monétaire expliquée. Ottawa (Ontatio). https://www.banqueducanada.ca/2021/04/politique-monetaire-expliquee/?theme_mode=light&_gl=1*1pf5vh2*_ga*MTMyNTQ0MzMzMi4xNzE3MDk5Mzg3*_ga_D0WRRH3RZH*MTcxNzA5OTM4Ni4xLjAuMTcxNzA5OTM4Ni42MC4wLjA.
Barbieri, P., Ciabuschi, F., Fratocchi, L. et Vignoli, M. (2018). What do we know about manufacturing reshoring? Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 11(1), 79-122. DOI : 10.11108/JGOSS-02-2017-0004.
Barbieri, P., Elia, S., Fratocchi, L. et Golini, R. (2019). Relocation of Second Degree: Moving Towards a New Place or Returning Home? Journal of Purchasing and Supply Management, 25(3). DOI : 10.1016/j.pursup.2018.12.003.
Barbieri, P., Boffelli, A., Elia, S., Fratocchi, L., Kalchschmidt, M. et Samson, D. (2020). What can we learn about reshoring after Covid-19? Operations Management Research, 13(3-4), 131-136. DOI : 10.1007/s12063-020-00160-1.
Bazile, J., Toumi, S., Mohiuddin, M., Su, Z. (2024). The challenges of Canadian SMEs in the face of global supply chain turbulence: Results from a Pan-Canadian survey. Université Laval. https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/recherche/chaire-gestion-affaires-internationales/Final-report-team-ZhanSu.pdf.
Blais-Morisset, P. et Rao, S. (2024). Une tendance au rapatriement? Ce que montrent les données probantes. Ottawa : Affaires mondiales Canada. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/reshoring_trend-tendance_rapatriement.aspx?lang=fra.
Boileau, D. et Sydor, A. (2020). Vulnérabilité des industries canadiennes aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ottawa : Affaires mondiales Canada. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/supply-chain-vulnerability.aspx?lang=fra.
Bureau de l’économiste en chef. (2011). Le commerce international du Canada : L’évolution des chaînes de valeur mondiales. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/state_of_trade-commerce_international/special_feature-2011-article_special.aspx?lang=fra.
Bureau de l’économiste en chef. (2021). Le point sur le commerce 2021 – Les investissements directs étrangers sous la loupe. Ottawa : Affaires mondiales Canada. /docs/state-trade-commerce-international/2021.aspx?lang=fra.
Bureau de l’économiste en chef. (2024). Faits saillants sur le rendement du commerce de marchandises du Canada – Mise à jour de 2023. https://www.international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/merchandise_trade-commerce_marchandises-2023.aspx?lang=fra.
Bureau international du Travail. (2016). Rapport IV : Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_468095.pdf.
Carrière-Swallow, Y., Deb, P., Furceri, D., Jiménez, D. et Ostry, J. D. (2022). How soaring shipping costs raise prices around the world. Washington (D.C.) : FMI.
Carvalho, V. M., Nirei, M., Saito, Y. U. et Tahbaz-Salehi, A. (2021). Supply chain disruptions: Evidence from the great east Japan earthquake. The Quarterly Journal of Economics, 136(2), 1255-1321.
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. (2024). Global investment trends monitor, no 46. Genève : CNUCED. https://unctad.org/publication/global-investment-trends-monitor-no-46.
Criscuolo, C. et Timmis, J. (2017). The relationship between global value chains and productivity. International Productivity Monitor, 32, 61-83. https://EconPapers.repec.org/RePEc:sls:ipmsls:v:32:y:2017:4.
De Backer, K., Menon, C., Desnoyers-James, I. et Moussiegt, L. (2016). La Relocalisation : Mythe ou réalité? OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27, Éditions OCDE, Paris. DOI : 10.1787/5jm3tqx59bhd-fr.
De Soyres, F. et Franco, S. (2019). Inflation dynamics and global value chains. Document de travail de recherche sur les politiques, Banque mondiale (9090).
Degain, C., Meng, B. et Wang, Z. (2017). Recent trends in global trade and global value chains. Dans Global Value Chain Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, Groupe de la Banque mondiale, 37-68.
Di Stefano, E., Giovannetti, G., Mancini, M., Marvasi, E. et Vannelli, G. (2022). Reshoring and plant closures in Covid-19 times: Evidence from Italian MNEs. International Economics, 172, 255-277. DOI : 10.1016/j.inteco.2022.09.009.
DRex. (2023). How many semiconductor chips in a modern car? https://www.icdrex.com/how-many-semiconductor-chips-in-a-modern-car/.
Dun and Bradstreet. (2022). Russia-Ukraine crisis implications for the global economy and businesses. https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/dnb-data-insight/DNB_Russia_Ukraine_Crisis_UK.pdf.
Dunning, J. (1979). Explaining Changing Patterns of International Production: In Defence of the Eclectic Theory. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
Ersahin, N., Giannetti, M. et Huang, R. (2023). Supply chain risk: Changes in supplier composition and vertical integration (no w31134). National Bureau of Economic Research.
Evenett, S., Jakubik, A., Martín, F. et Ruta, M. (2024). IMF working paper: The return of industrial policy in data. Washington (D.C.) : FMI.
Fel, F., Cayla, J. et Carbonne, V. (2020). L’industrie 4.0 peut-elle favoriser une relocation de la production en France? Logistique & Management, 28(1), 18-28. DOI : 10.1080/12507970.2019.1683477.
Fonds monétaire international. (2023). World economic outlook: Navigating global divergences (October 2023). Washington (D.C.) : FMI. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023.
Fonds monétaire international. (2024). World economic outlook: Steady but slow: Resilience amid divergence (April 2024). Washington (D.C.) : FMI. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023.
Forbes. (2016). How Honda’s new innovation gives it a huge edge. https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/07/13/how-hondas-new-innovation-gives-it-a-huge-edge/?sh=4a7ff3247a00.
Foster, J. et Eccles, W. (2019). Traite des fourrures au Canada. Dans L’Encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-des-fourrures.
Georgieva, K. (2023). The price of fragmentation: Why the global economy isn’t ready for the shocks ahead. Affaires étrangères, 102, 131.
Global Trade Alert. (2024). Global Dynamics Database. https://www.globaltradealert.org/global_dynamics [consulté en mars 2024].
Globerman, S. (2011). Global value chains: economic and policy issues. Dans A. Sydor (éd.), Global Value Chains: Impacts and Implications, 17-42. Ottawa : ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Greer, J. (2022). The biggest ESG risks in your supply chain. Moddy’s Analytics. https://www.moodysanalytics.com/articles/2022/top-esg-risks-in-supply-chain.
Groupe de la Banque mondiale. (2024). Pink sheet data. Washington (D.C.) : Banque mondiale. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets [consulté en mai 2024].
Jain, N., Girotra, K. et Netessine, S. (2022). Recovering global supply chains from sourcing interruptions: The role of sourcing strategy. Manufacturing & Service Operations Management, 24(2), 846-863.
Kearney. (2023). America is ready for reshoring. Are you? 2022 Reshoring Index. https://www.kearney.com/service/operations-performance/us-reshoring-index/2022.
Kennedy, S. et Mazzocco, I. (2022). Has trade with China really cost the U.S. jobs? Harvard Business Review. https://hbr.org/2022/11/has-trade-with-china-really-cost-the-u-s-jobs.
Kim, M. (2018). Rising Import Competition in Canada and its Employment Effect by Skill Group: Evidence from the ‘China Shock’. Centre d’étude des niveaux de vie.
Kim, M. (2020). The Price Effect of Trade: Evidence of the China Shock and Canadian Consumer Prices (no. 2020-02). Centre d’étude des niveaux de vie.
Komaromi, A., Cerdeiro, D. A., Cerdeiro, M. D. A. et Liu, Y. (2022). Supply chains and port congestion around the world. FMI.
Krenz, A. et Strulik, H. (2021). Quantifying reshoring at the macro-level—Measurement and applications. Growth and Change, 52(3), 1230-1250. DOI : 10.1111/grow.12513.
Lee, H., Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P.,… Park, Y. (2023). IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report, Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [sous la direction de l’équipe de rédaction principale, H. Lee et J. Romero (éd.)]. Genève (Suisse) : GIEC.
Leslie, J. (2022). How climate change is disrupting the global supply chain. Yale Environment 360. https://e360.yale.edu/features/how-climate-change-is-disrupting-the-global-supply-chain.
Makin, A. J. et Layton, A. (2021). The global fiscal response to COVID-19: Risks and repercussions. Economic Analysis and Policy, 69, 340-349.
MIT Sloan School of Management. (2022). How auto companies are adapting to the global chip shortage. https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-auto-companies-are-adapting-to-global-chip-shortage#:~:text=The%20response%3A%20retrofitting%2C%20reworking%2C,arise%20from%20this%20indiscriminate%20approach.
Organisation de coopération et de développement économiques. (2023). Échanges en valeur ajoutée (TiVA) – édition 2023 : Indicateurs principaux. https://www.oecd.org/fr/sti/ind/mesurerlecommerceenvaleurajoutee.htm.
Organisation mondiale du commerce. (2024). Commerce des services commerciaux. https://stats.wto.org/.
Schiller, C. (2018). Global supply-chain networks and corporate social responsibility. Dans 13th Annual Mid-Atlantic Research Conference in Finance (MARC) Paper.
Sécurité publique Canada. (2024). Travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes. https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/frcd-lbr-cndn-spply-chns/index-fr.aspx.
Semiconductor Industry Association. (2022). Congress Passes Investments in Domestic Semiconductor Manufacturing, Research & Design. https://www.semiconductors.org/chips/#:~:text=The%20share%20of%20modern%20semiconductor,the%20U.S.%20government%20has%20not.
Sheffi, Y. (2005). The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. Pearson Education India.
Sprinkle, G. B. et Maines, L. A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons, 53(5), 445.
Sweet, S. (2024). US: The inflation risks from global shipping disruptions. Oxford Economics.
S&P Global. (2023). The semiconductor shortage is – mostly – over for the auto industry. https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/the-semiconductor-shortage-is-mostly-over-for-the-auto-industry.html.
Tokui, J., Kawasaki, K. et Miyagawa, T. (2017). The economic impact of supply chain disruptions from the Great East-Japan earthquake. Japan and the World Economy, 41, 59-70.
Torslov, T., Wier, L. et Zucman, G. (2022). The Missing Profits of Nations. Review of Economic Studies. DOI : 10.1093/restud/rdac049.
Tran, T. (à paraître). The export survival of young Canadian firms. Ottawa : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada.
Yang, Z., Aydın, G., Babich, V. et Beil, D. R. (2012). Using a dual-sourcing option in the presence of asymmetric information about supplier reliability: Competition vs. Diversification. Manufacturing & Service Operations Management, 14(2), 202-217.
- Date de modification: