Une carrière qui a contribué à tracer la voie du Canada sur la scène mondiale

Isabelle Bérard revient sur sa carrière en développement international ponctuée d’événements marquants, notamment le séisme de 2010 en Haïti.
Lorsqu’on lui a demandé d’écrire sur sa carrière en coopération internationale dans le cadre d’un programme de formation de cadres supérieurs, il y a quelques années, Isabelle Bérard a qualifié sa carrière de « randonnée ».
« J’aime l’endurance, pas les sprints; les choses qui se passent quand on fait un effort et qu’on se fixe un objectif », a-t-elle expliqué, détaillant les étapes qui ont mené à son poste et qui comprenaient une exploration profonde, des tâches exigeantes et de nouveaux horizons.
Ayant récemment pris sa retraite en tant que sous-ministre adjointe pour le Secteur de l’Afrique subsaharienne à Affaires mondiales Canada (AMC), Mme Bérard, âgée de 55 ans, revient sur les étapes de son parcours ainsi que sur le rôle qu’elle a joué pour tracer la voie du Canada sur la scène mondiale au cours des 33 dernières années.
Au début de sa carrière, son objectif n’était pas de s’aventurer au-delà de sa ville natale de Montréal. En effet, Mme Bérard se sentait si attachée à sa ville qu’elle a décidé d’étudier l’urbanisme à l’Université du Québec à Montréal dans l’espoir de travailler pour la municipalité ou dans un cabinet d’architectes.
Mais un jour son parcours a changé du tout au tout.
« Quand je faisais mes études, je me suis soudainement rendu compte qu’il y avait un monde à découvrir », se souvient-elle. L’étape suivante a été d’obtenir un diplôme d’études supérieures d’un an à l’Université d’Ottawa en coopération internationale. « C’était tout juste les débuts de ce concept qui permettait aux étudiants de se familiariser avec ce qui se passe ailleurs dans le monde dans le domaine de la coopération », explique Mme Bérard, qui a trouvé beaucoup de points communs entre ce programme d’études et l’urbanisme. « Il s’agissait de traiter des mêmes enjeux : les communautés, l’environnement, l’évolution des sociétés, la façon de s’assurer que les gens ont des moyens de subsistance durables. »

Isabelle Bérard, en République démocratique du Congo, anciennement la république du Zaïre, en 1989.
Le fait d’être à Ottawa lui a permis d’approfondir cette expérience. « Cela m’a ouvert les yeux sur plusieurs autres choses qui se déroulent à l’échelle internationale, non seulement dans le domaine de la coopération, mais également dans celui des relations internationales et, bien sûr, de la politique. » Grâce à ses études, Mme Bérard a également acquis une « bien meilleure perception des inégalités dans le monde », affirme-t-elle. « Je savais qu’il y avait des inégalités à Montréal, et je me suis dit qu’il y en avait aussi ailleurs. »
Prendre conscience du fait « qu’il y a des gens qui essaient de travailler à l’échelle mondiale pour s’attaquer à des problèmes très importants » l’a amenée à se détourner complètement des questions purement nationales. « J’ai soudainement senti que je pouvais, d’une certaine manière, faire partie de la solution. »
Maintenant, il fallait trouver un emploi. Mme Bérard avait appris l’importance de l’autonomie financière de sa mère qui, issue d’une famille de 16 enfants, avait quitté l’école primaire pour aider à la maison et avait été frustrée de ne pas pouvoir poursuivre une carrière et être financièrement indépendante.
Lorsque Mme Bérard a obtenu son diplôme en 1988, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) était l’endroit idéal où se chercher un emploi. Alors que le recrutement dans la fonction publique était au point mort, elle a obtenu un stage d’été où elle a pu mettre à profit une compétence importante : ses connaissances en informatique. En effet, elle avait utilisé les ordinateurs lorsqu’elle était étudiante. « Bien que je ne me sois jamais considérée comme une “geek”, j’avais un peu d’avance sur le plan technologique. »
À l’ACDI, « ils avaient encore un service de dactylographie », mais les ordinateurs étaient en cours d’installation. « C’est donc comme ça que j’ai commencé, en tant que technicienne », affirme-t-elle. Elle aidait le personnel à se familiariser avec la technologie. « Je passais d’un agent à l’autre, expliquant comment fonctionne un ordinateur, comment sauvegarder son travail... L’idée d’avoir différentes versions d’un document était si lointaine pour les gens qu’il fallait des heures pour qu’ils comprennent le concept. »
Une étude approfondie

Isabelle Bérard, lors d’un voyage d’affaires en Mozambique, en 2020.
Chaque leçon a été l’occasion de promouvoir ses autres capacités. Elle leur disait : « Vous savez, je n’ai pas étudié l’informatique; je ne suis pas une spécialiste de l’informatique. J’ai étudié l’urbanisme et j’ai fait mon diplôme d’études supérieures en coopération internationale. » L’histoire de Mme Bérard a suscité l’intérêt de Raymond Drouin, un responsable de programme à la Direction générale du partenariat, qui a voulu en savoir plus « une fois l’ordinateur installé ». Il souhaitait se servir des ordinateurs afin d’appliquer les leçons apprises dans une série de projets mis en place pour fournir une aide financière aux femmes qui démarrent de petites entreprises dans 5 pays africains. Mme Bérard a été sollicitée afin de participer à la mise en place d’un système utilisant des feuilles de calcul Excel pour recueillir, contrôler et comparer les données des projets.
Elle a travaillé comme consultante à l’ACDI pendant 5 ans, avant d’être engagée et d’occuper une série de postes d’agente de développement. Elle a préféré travailler sur des questions telles que la santé, l’éducation, l’environnement, la croissance économique et la gouvernance de différents pays et communautés, « des thèmes qui sont loin d’être étrangers à quelqu’un qui travaille en urbanisme ». Ce travail l’a amenée à occuper des postes plus importants au sein du Secteur de l’Afrique de 2000 à 2008. Selon elle, ce fut une période formidable en raison du soutien que le Canada accordait au plan d’action pour l’Afrique présenté lors du sommet du G7 à Kananaskis en 2002 et de l’engagement du Canada à doubler son aide en Afrique.
En même temps, la « communauté internationale se regroupait » autour des objectifs du Millénaire pour le développement, « et nous avions élaboré une feuille de route pour mieux travailler ensemble » par l’entremise de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement de 2005, explique Mme Bérard. « Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et c’était très, très excitant. »
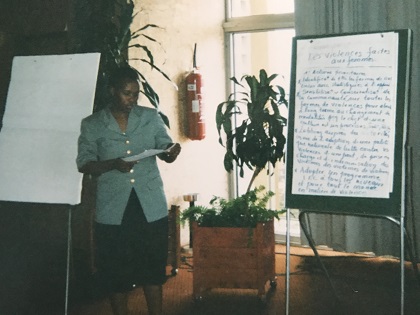
Photo prise par Isabelle Bérard, au Rwanda, en 1998, alors que le pays se relevait du génocide de 1994.
L’une de ses tâches préférées était « d’être sur le terrain et de rencontrer principalement des femmes africaines ». Par exemple, en 1997, alors qu’elle travaillait dans le cadre du programme pour le Rwanda juste après le génocide dans ce pays, « un certain nombre de choses devaient se produire pour que les femmes puissent avoir accès à un compte bancaire, posséder une maison et être en mesure de fonctionner », se souvient Mme Bérard. « Il n’y avait pratiquement plus d’hommes, donc toutes les lois devaient être ajustées pour que les femmes puissent survivre. C’était fascinant de voir ce que les femmes, qu’elles soient Tutsies ou Hutues, pouvaient accomplir ensemble pour se sortir de la pauvreté. »
Bien qu’elle ait beaucoup voyagé, visitant quelque 70 pays au cours de sa carrière, Mme Bérard n’a jamais été affectée à l’étranger, malgré les mises en garde que ce manque pourrait l’empêcher de gravir les échelons. Elle avait fondé une famille entre des postes de consultante, et son mari, Bruno Cadieux, ne pouvait pas travailler à distance. « Il était le pilier de notre couple du point de vue financier. »
On a également averti Mme Bérard qu’elle avait trop de plaisir au travail. « J’aime bien rire... On m’a souvent dit au cours de ma carrière d’arrêter de rire parce que je n’avais pas l’air sérieux, que faire des blagues n’était pas bien et que je n’irais nulle part. » Tout au long de sa carrière, il y a quand même eu des costumes élaborés à l’Halloween, des apparitions dans des vidéos loufoques et des interventions drôles lors de réunions. « Même dans les réunions très sérieuses, je m’assurais toujours qu’au début ou à la fin, nous trouvions un moyen d’alléger un peu les choses. »
Des tâches exigeantes
Mme Bérard organisait des fêtes après le travail un vendredi sur 2, même dans les moments les plus difficiles, comme lorsqu’elle était directrice générale du Secteur d’Haïti et de la République dominicaine. Elle se souvient qu’un collègue était venu lui annoncer qu’un violent tremblement de terre avait frappé la capitale haïtienne, Port-au-Prince, à 16 h 53 le 12 janvier 2010.
« En quelques minutes, nous avons su que quelque chose de très grave était arrivé », raconte-t-elle. « Nous faisions face à une énorme catastrophe. » Pendant 3 ans, Mme Bérard a dirigé une équipe de collaborateurs à l’administration centrale et sur le terrain qui accomplissait un travail incessant. « Les premières journées et les premiers mois ont été vraiment éprouvants pour moi, pour l’équipe et pour les Haïtiens. Du point de vue du leadership, ce fut certainement l’expérience la plus difficile que j’ai vécue. »

Isabelle Bérard en visite à Haïti alors qu’elle était directrice générale du Secteur d’Haïti et de la République dominicaine.
Il y avait des réunions « stand-up » 2 fois par jour, dans le cadre d’un système gouvernemental de gestion de crise très efficace. « Si on veut être fier d’être fonctionnaire, il suffit d’observer ce qui se passe dans la cellule de crise qui est mise en place lorsqu’il y a une crise à gérer », dit-elle.
Le personnel n’était pas autorisé à utiliser Facebook à l’époque, mais une exception avait été faite afin qu’il puisse le parcourir « pour savoir qui était encore en vie et qui ne l’était plus ». L’une des principales préoccupations de l’ACDI était ses partenaires œuvrant dans quelque 80 projets sur le terrain, qui avaient été tués ou qui avaient perdu leur conjoint ou leurs enfants, raconte-t-elle. « Chaque jour apportait une nouvelle tournure à toute l’histoire. » Mme Bérard, qui se targuait de toujours consulter les autres avant de prendre une décision, devait rapidement décider d’une marche à suivre. « Je devais prendre des décisions toutes les 10 minutes. Je n’avais pas le luxe de me demander si je devais faire quelque chose ou non. »
Lorsqu’elle s’est rendue en Haïti au début du mois de mars 2010, elle a constaté que tout avait été détruit. « C’était d’une telle ampleur », se souvient-elle. « Pourtant, le simple fait d’avoir pu voir les personnes qui avaient géré la crise sur place était très, très rassurant. » L’aide canadienne au redressement, dirigée avec compétence par Gilles Rivard, l’ambassadeur du Canada en Haïti, comprenait l’installation d’énormes abris fortifiés pour permettre au gouvernement du pays de fonctionner. Elle comprenait également le soutien nécessaire pour évacuer des dizaines de milliers de personnes d’un campement tentaculaire sur la place du Champ du Mars, en face du palais présidentiel détruit. « En fin de compte, nous avons aidé chacun des habitants du campement à se reloger, à trouver du travail, etc. »
Une décennie plus tard, elle est satisfaite du travail accompli par son équipe, mais demeure réaliste quant aux obstacles auxquels le pays est confronté. « Les besoins sont si grands en Haïti. C’était un défi avant, c’était un défi à l’époque, et il est clair que cela reste un défi. Mais nous avons assurément fait une différence. »
De nouveaux horizons
Il y a eu beaucoup d’autres moments déterminants pour Mme Bérard et l’ACDI, comme la création d’AMC à la suite de la fusion des affaires étrangères, du commerce et du développement. De 2017 à 2019, Mme Bérard a occupé un poste de sous-ministre adjointe aux affaires internationales à Environnement et changement climatique Canada. Ce fut une période intense, compte tenu de la position militante du Canada en matière d’environnement à la Conférence des parties des Nations Unies, ainsi qu’au sein du G20 et du G7. Il y a eu des négociations sur le chapitre portant sur l’environnement dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que sur la position de chef de file du Canada dans le dossier du plastique. Mme Bérard a été appréciée pour sa familiarité avec AMC et pour sa gestion de l’enveloppe de l’aide internationale, alors que le gouvernement mettait en œuvre son engagement de 2,65 milliards de dollars sur 5 ans pour lutter contre les changements climatiques.
Mme Bérard est revenue à AMC en 2019, bouclant ainsi la boucle du point de vue de sa carrière. Elle y occupait le poste de sous‑ministre adjointe pour le Secteur de l’Afrique subsaharienne. Cette fois, elle supervisait les aspects politiques et commerciaux des relations avec l’Afrique, et gérait les questions liées au développement. Elle a notamment contribué à l’organisation du voyage en Afrique du premier ministre Justin Trudeau et des 4 ministres qui ont visité 11 pays pendant 10 semaines. Elle a également contribué à la campagne du Canada pour l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a coïncidé avec le début de la pandémie de COVID-19 et l’effort massif de rapatriement des Canadiens dispersés dans 48 pays d’Afrique subsaharienne. « Ce fut une période de folie. Nous travaillions nuit et jour. »
En plus d’organiser les évacuations, le personnel a examiné chaque projet du budget annuel de programmation de 700 millions de dollars pour trouver des moyens de résoudre les problèmes liés à COVID-19 dans ces pays, explique-t-elle. « Nous avons retourné chaque pierre et réajusté le portefeuille. » Après la pandémie, elle entrevoit « d’importantes possibilités à venir » pour l’Afrique et le Canada. Ces possibilités s’étendent bien au-delà du développement au commerce; ils touchent notamment des secteurs comme les technologies propres. « Nous devons saisir ces occasions. »
Tout au long de sa carrière, son travail a beaucoup changé, mais pas plus que les progrès réalisés dans le domaine de la technologie. « Quand j’ai commencé, j’aidais avec les ordinateurs. Puis le télécopieur est arrivé, ce qui a constitué une révolution en soi », raconte-t-elle. « Et nous voilà aujourd’hui en train d’utiliser l’application Microsoft Teams et d’autres plateformes pour nous rencontrer virtuellement. C’est incroyable. »
En rétrospective, Mme Bérard est reconnaissante d’avoir eu l’occasion, dès ses débuts, d’observer de grands leaders et d’avoir aspiré à en devenir une elle-même. « Je savais que j’avais une certaine capacité à rassembler les gens pour réaliser quelque chose », explique-t-elle. « Le service public est un endroit formidable lorsque vous avez l’endurance nécessaire pour le faire. »
A-t-elle le sentiment d’avoir fait une différence? « Dans l’ensemble, c’est la combinaison des efforts de chacun qui fait la différence », affirme-t-elle. « Mais j’ai certainement fait de mon mieux pour contribuer à la recherche de solutions... J’ai été témoin de projets où nous avons apporté un changement énorme et durable dans la vie des enfants, des femmes et des communautés. »
À l’avenir, Mme Bérard pourrait envisager de s’engager dans les affaires ou la politique. Pour l’instant, elle apprécie les longues promenades dans la campagne autour de sa maison, près de Wakefield, au Québec. Et elle a hâte de faire des randonnées dans des pays plus lointains, une fois qu’il sera possible de voyager.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: