Examen triennal de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste du Groupe d’action pour le commerce inclusif
Gouvernement du Canada
24 août 2023
Table des matières
- Déclaration de la ministre
- Limites
- Résumé
- Introduction
- Contexte
- Résumé des constatations
- Évaluation de l’efficacité
- Évaluation des retombées économiques
- 1. Aperçu du commerce et de l’investissement dans le cadre du PTPGP
- 2. Création d’échanges commerciaux dans le cadre du PTPGP : commerce en régime de droits de douane et en franchise de droits de douane
- 3. Exportations sous l’angle du commerce inclusif
- 4. Le commerce des biens environnementaux dans le cadre du PTPGP
- 5. Application des tarifs préférentiels dans le cadre du PTPGP
- Conclusion de l’évaluation des retombées économiques
- Lacunes et possibilités
- Recommandations
- Prochaines étapes
- Annexe A : Liste des acronymes
- Annexe B : Résumés des chapitres du PTPGP
- Annexe C : Liste des comités créés en vertu de l’Accord
- Annexe D : Critères d’adhésion à l’AMCG
- Annexe E : Dispositions sur l’égalité des genres dans le PTPGP
- Annexe F : Tableaux infographiques sur le commerce et le genre dans le cadre du PTPGP
Déclaration de la ministre

Il y a un peu plus de cinq ans, en marge de la cérémonie de signature de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l’un des accords commerciaux les plus ambitieux et inclusifs au monde, le Canada s’est fièrement joint à la Nouvelle-Zélande et au Chili pour adopter la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif.
Cette déclaration commune a amené le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande à mettre en place le Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI) afin de s’assurer que le PTPGP procure non seulement des avantages pour tous en matière de commerce inclusif et de développement durable, mais permet également de mieux faire connaître l’importance du commerce inclusif dans le monde entier.
La Déclaration commune appelait les gouvernements à examiner l’efficacité du PTPGP en ce qui concerne 6 enjeux mondiaux : l’égalité des genres; les peuples autochtones; le développement économique régional; les PME; les droits des travailleurs; l’environnement et les changements climatiques.
J’ai le plaisir de présenter à nos partenaires commerciaux du PTPGP et à la population canadienne le Rapport sur l’examen triennal du PTPGP par le GACI.
En adhérant au PTPGP, le Canada a fait un choix judicieux qui favorise une forte croissance économique pour les entreprises canadiennes. Nous pouvons en faire plus pour maximiser les avantages de cet accord commercial et les faire connaître plus largement.
Le GACI est essentiel pour faire croître le commerce inclusif dans le monde entier et s’assurer que chacun peut bénéficier des échanges commerciaux. C’est pourquoi le Mexique, le Costa Rica et l’Équateur ont également décidé d’en faire partie.
Le GACI a élargi son champ d’action pour promouvoir des politiques en matière de commerce et de genre qui ont des objectifs complémentaires, augmentent la participation des femmes au commerce et renforcent le pouvoir économique des femmes grâce à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG). Le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou ont déjà signé l’Arrangement, et l’Argentine fera de même bientôt. Ce résultat témoigne du rôle de chef de file joué par le Canada pour promouvoir le commerce inclusif. L’augmentation du nombre de pays adhérant à cet Arrangement fait partie des priorités dominantes du Canada, qui orienteront son action au cours de sa présidence du PTPGP, en 2024.
En effet, les récents événements survenus sur la scène mondiale ont forcé des pays du monde entier à trouver de nouvelles manières de se regrouper pour protéger leur population, leur économie et la planète.
Ils ont également incité des pays comme le nôtre à réévaluer les acteurs, nos échanges et nos méthodes en matière de commerce, dans le but d’élargir les débouchés commerciaux pour les entrepreneurs de l’ensemble du Canada actifs dans un large éventail d’industries.
Cette démarche commerciale inclusive, qui complète notre politique étrangère féministe, est devenue un pilier de notre politique commerciale moderne et nous aide à réaliser les priorités du Canada comme la croissance inclusive, l’égalité des genres, la création de bons emplois et la réconciliation avec les peuples autochtones.
Toutefois, nous savons qu’il nous reste du pain sur la planche, et nous avons appris lors de consultations avec la population canadienne que nos politiques commerciales devraient être non seulement plus inclusives, mais aussi durables et transparentes.
Pour que le Canada et les autres partenaires du PTPGP réussissent, nous devons poursuivre nos efforts afin de nous assurer qu’un plus grand nombre d’entrepreneurs – notamment les femmes, les jeunes, les Autochtones, les propriétaires de PME et d’autres personnes généralement sous-représentées dans le commerce – peut participer aux échanges mondiaux et à notre résilience économique collective, et en bénéficier.
Par conséquent, j’espère que vous en conviendrez avec moi, la réalisation d’évaluations précises comme celle qui fait l’objet du présent rapport constitue l’un des moyens pour garantir que nous continuons de rendre des comptes à nos entrepreneurs en ce qui concerne les objectifs que nous nous sommes fixés.
L’honorable Mary Ng
Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique
Limites
L’examen triennal du PTPGP (l’examen) du Canada, réalisé par le GACI, comporte certaines limites puisqu’il se rapporte à une période particulière pendant laquelle de multiples enjeux ont engendré des difficultés à l’échelle mondiale. Sur les trois années évaluées, deux ont été particulièrement difficiles en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.
Pendant la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier ont uni leurs forces pour protéger la santé et la sécurité de leurs populations tout en cherchant à atténuer les répercussions économiques de la pandémie. En réponse à la pandémie, on a vu au Canada les entrepreneurs, les travailleurs et tous les Canadiens s’unir pour se soutenir mutuellement. Les entreprises ont fait preuve d’une souplesse et d’une créativité incroyables pour s’adapter et trouver des solutions novatrices aux défis auxquels elles faisaient face.
La pandémie a entraîné des retards dans la collecte et l’analyse des données. Elle a aussi fait dérailler ou retardé certaines initiatives du GACI. Le présent examen s’appuie sur des renseignements à jour dans la mesure du possible; toutefois, pour terminer l’examen, certaines sections comprennent des données qui se limitent à la période se terminant au mois de septembre 2022.
Résumé
L’examen du Canada découle d’un engagement pris lors de la cérémonie de signature du PTPGP, lorsque le Canada a approuvé la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif, aux côtés du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Le Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI) a été créé en novembre 2018 par les membres fondateurs, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande, en marge du sommet des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Les membres du GACI se sont engagés à évaluer l’efficacité du PTPGP trois ans après son entrée en vigueur en ce qui concerne six questions d’envergure mondiale liées au commerce inclusif, soit : les petites et moyennes entreprises (PME); l’égalité des genres; les peuples autochtones; le développement économique régional au sein de chaque pays; les droits des travailleurs; l’environnement et les changements climatiques.
L e Canada a effectué un examen exhaustif, fondé à la fois sur des données qualitatives et quantitatives, afin d'évaluer l'efficacité avec laquelle le PTPGP a contribué à faire progresser ces six questions d'envergure mondiale et l'impact sur le Canada au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de l' Accord. Ce rapport présente les résultats de l'évaluation, cerne les lacunes et les possibilités et propose des recommandations.
Par le truchement d'une évaluation qualitative, le présent examen vise à déterminer si les objectifs du PTPGP touchant les six questions ont été atteints et à mettre en évidence les impacts pour le Canada . L'examen s'accompagne d'une évaluation quantitative des éléments prévus dans le PTPGP pour favoriser l'inclusion, notamment en ce qui concerne les PME, l'ensemble des travailleurs, ainsi que les femmes sur le marché du travail, et de la manière dont ils ont pu bénéficier du PTPGP. Le présent examen ne remplace ni ne duplique l'examen général exigé en vertu du chapitre 27 du PTPGP, qui est beaucoup plus vaste; il lui sert plutôt de complément.
Voici ce que l’évaluation qualitative a permis de déterminer :
- Le PTPGP présente des avantages pour le Canada en matière de commerce et d’investissement, et des efforts sont déployés pour intégrer le développement inclusif et durable dans certains aspects de la mise en œuvre de l’Accord.
- Les ambassades, les hauts-commissariats et les consulats du Canada dans les régions visées par le PTPGP ont un rôle à jouer dans la promotion des activités et le renforcement des capacités afin de soutenir l’inclusion, la durabilité et la capacité des groupes sous-représentés à tirer parti de l’Accord.
- La mise en œuvre du PTPGP présente plusieurs lacunes, y compris sur le plan du développement économique régional et de la mesure des résultats.
- Il existe des possibilités de collaboration accrue entre les Parties au PTPGP afin de combler les lacunes et d’assurer que les dispositions et les activités du PTPGP en matière de commerce inclusif et de développement durable produisent l’effet escompté.
Voici les observations découlant de l’évaluation quantitative :
- Le PTPGP a procuré des avantages tangibles au Canada en matière de commerce, y compris pour les PME et les travailleuses.
- Au cours de la première année de mise en œuvre de l’Accord, les exportations passibles de droits de douane effectuées par des PME canadiennes vers les marchés du PTPGP ont augmenté de 241millions de dollars (12,3 %).
- Au cours de la première année de mise en œuvre, le nombre d’emplois total s’est accru de 135 000 (23,8 %), et le nombre d’emplois occupés par des femmes de 23 000 (11,4 %), au sein des entreprises canadiennes qui ont augmenté de manière importante leurs exportations vers les nouveaux marchés du PTPGP.
En réalisant les évaluations qualitatives et quantitatives aux fins du présent examen, le Canada a constaté certaines lacunes et des possibilités futures à examiner et à prendre en compte. La section du présent rapport consacrée aux lacunes et aux possibilités en recense un grand nombre, y compris : accroître l'égalité des genres et l'inclusion dans la mise en œuvre du PTPGP; inviter les membres du PTPGP à adhérer à l'Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones (ACECPA); renforcer les mesures relatives au développement économique régional; mesurer les résultats des activités de coopération; faire participer régulièrement les intervenants aux activités de mise en œuvre; et la promotion accrue de la conduite responsable des entreprises (CRE) canadiennes sur les marchés du PTPGP.
Afin que le PTPGP puisse favoriser plus efficacement l’inclusion et la durabilité, le Canada recommande aux membres du GACI les mesures suivantes : effectuer régulièrement des examens de l’efficacité, au besoin; inviter les membres du PTPGP à adhérer au GACI, à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG) et à l’ACECPA; inviter les comités du PTPGP à promouvoir l’inclusion dans le contexte de la mise en œuvre du PTPGP, à mesurer les résultats, à mobiliser les intervenants et à intégrer, dans leurs activités, les facteurs relatifs au développement économique régional au sein de chaque pays. Il est également recommandé que le Canada demande aux intervenants d’examiner le présent rapport afin d’en tenir compte dans sa présidence du PTPGP en 2024.
Comme suite à la publication du présent rapport d’examen, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :
- Solliciter l’avis des parties prenantes sur le présent examen.
- Continuer à promouvoir l’adhésion au GACI, à l’AMCG et à l’ACECPA auprès des membres potentiels à l’échelle mondiale.
- Collaborer avec des experts sur la manière d’élaborer une méthode pour mesurer les résultats des activités de coopération dans le cadre du PTPGP.
Introduction
L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange (ALE) régional entre 12 pays de la région de l’Asie-Pacifique, à savoir l’Australie, Brunéi Darussalam, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Royaume-Uni et le Vietnam. Il s’agit d’un accord commercial ambitieux, comportant des dispositions évoluées dans toute une série de domaines. Plus précisément, le PTPGP comprend 30 chapitres distincts (voir l’annexe B) et 20 comités (voir l’annexe C), qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l’Accord. Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018, lorsque le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont devenus les six premiers pays à ratifier l’Accord. Le Vietnam a par la suite adhéré à l’Accord le 14 janvier 2019, suivi du Pérou le 19 septembre 2021, de la Malaisie le 29 novembre 2022 et du Chili le 21 février 2023. Plus récemment, soit le 13 mai 2023, Brunéi a déposé son instrument de ratification, et le PTPGP est entré en vigueur dans ce pays le 12 juillet 2023. Plusieurs pays ont depuis demandé à adhérer à l’Accord, à savoir le Royaume-Uni, la Chine, le Taïpei chinois, l’Équateur, le Costa Rica, l’Uruguay et l’Ukraine, et le Royaume-Uni a signé l’Accord le 16 juillet 2023.
Le présent examen évalue l’efficacité avec laquelle le PTPGP contribue à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de développement durable et de commerce inclusif, en particulier dans le contexte des relations économiques nouées avec les nouveaux pays partenaires du PTPGP qui l’ont ratifié mais qui n’avaient pas d’ALE antérieur avec le Canada, c’est-à-dire l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.
Parallèlement à la signature du PTPGP, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont également endossé la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif (ci-après appelée « la Déclaration commune ») en mars 2018. La Déclaration commune a mené à la création du Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI), en marge du Sommet des dirigeants de l’APEC de novembre 2018. Les partenaires du GACI ont convenu d’unir leurs efforts pour faire progresser le commerce durable et inclusif, pour veiller à ce que les avantages du commerce soient plus largement répartis et pour mieux répondre aux préoccupations croissantes concernant les questions environnementales et les normes du travail dans le commerce international. Ces instruments soutiennent l’approche inclusive du Canada à l’égard du commerce, un aspect essentiel de la Stratégie de diversification du commerce du gouvernement du Canada. La Stratégie vise à ce que les avantages du commerce soient mieux répartis dans la société dans son ensemble, et que ceux et celles qui sont traditionnellement sous-représentés dans le commerce, comme les femmes, les petites et moyennes entreprises (PMENote de bas de page 1), de même que les peuples autochtones, puissent en profiter.
Comme le souligne la Déclaration commune, le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande ont convenu de travailler ensemble pour montrer que le commerce peut contribuer au développement durable et aider à trouver des solutions à l’égard de six questions d’envergure mondiale : les PME, l’égalité des genres, les peuples autochtones, le développement économique régional au sein de chaque pays, les droits des travailleurs, ainsi que l’environnement et les changements climatiques. À ce titre, les trois pays cofondateurs du GACI se sont engagés à effectuer une évaluation de l’efficacité du PTPGP relativement à ces 6 questions, et ce, trois ans après son entrée en vigueur. Le présent examen vise à évaluer les résultats obtenus, à cerner les lacunes et les domaines dans lesquels la collaboration doit se poursuivre, à mettre en évidence les possibilités actuelles ainsi qu’à formuler des recommandations. L’examen triennal du GACI évalue les six questions d’envergure mondiale au moyen d’une évaluation qualitative. De plus, comme l’exige l’alinéa 27.2b) de l’Accord, la Commission du PTPGP s’est penchée sur les relations économiques entre les Parties au PTPGP dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de l’AccordNote de bas de page 2. Le Canada a réalisé une évaluation des retombées économiques (ERE) afin d’évaluer les effets quantitatifs du PTPGP sur le commerce canadienNote de bas de page 3. Bien que les conclusions de l’ERE soient publiées séparément, un résumé de ces résultats est inclus dans le présent rapport d’examen. Plus précisément, l’ERE du Canada évalue l’état d’avancement des éléments inclusifs prévus dans les obligations découlant du PTPGP. Elle examine si les PME, les travailleurs et les travailleuses bénéficient des obligations du PTPGP.
Le présent examen servira de point de référence pour toute analyse ultérieure, ce qui permettra d’obtenir des conclusions plus solides sur des périodes plus longues que les trois premières années du PTPGP. Enfin, le présent examen vise à mieux comprendre le commerce inclusif dans le contexte de l’Accord et à inciter d’autres signataires du PTPGP à se joindre au GACI.
L’examen débute par une vue d’ensemble du PTPGP et des initiatives du GACI, suivie d’un résumé des engagements tarifaires énoncés dans l’Accord et des dispositions pertinentes relatives au commerce inclusif et au développement durable. La deuxième section décrit le cadre d’évaluation et la méthodologie utilisés pour réaliser l’examen, tandis que la troisième section présente les résultats de l’évaluation qualitative et de l’ERE quantitative. La dernière section cerne les principales lacunes et possibilités, formule des recommandations et décrit les prochaines étapes.
Contexte
Qu’est-ce que le PTPGP?
Le PTPGP est un accord commercial conclu entre 12 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni, Singapour et Vietnam). Il forme un bloc commercial régional qui représente 13,5 % du PIB mondial et 15 % du commerce mondial. Ensemble, les pays membres représentent un bassin de consommateurs important, puisque leurs populations combinées dépassaient les 511 millions d'habitants en 2021, ce qui représente 6,5 % de la population mondialeNote de bas de page 4.
L’Accord offre aux exportateurs canadiens un avantage concurrentiel dans la région de l’Asie-Pacifique. Une fois qu’il aura été mis en œuvre dans son intégralité, le PTPGP éliminera les droits de douane sur la quasi-totalité des exportations canadiennes vers les marchés du PTPGP et créera de meilleures conditions d’exportation, y compris en réduisant les obstacles au commerce, en améliorant l’accès aux marchés publics (MP) et en instaurant un environnement commercial à la fois cohérent, transparent et prévisible. De plus, l’Accord représente un nouveau jalon dans les traités commerciaux internationaux contemporains, car il établit de nouvelles normes et règles commerciales, et engage les pays membres à réaffirmer l’importance de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, du commerce inclusif et du développement durable.
Le PTPGP offre des avantages considérables aux exportateurs canadiens de marchandises dans tous les secteurs de l’économie. Une fois qu’il aura été mis en œuvre dans son intégralité, 99 % de toutes les lignes tarifaires entre les Parties au PTPGP seront en franchise de droits, et le Canada bénéficiera d’un accès en franchise de droits pour :
- 94 % des exportations de produits agricoles et agroalimentaires canadiens;
- 99 % des exportations de produits industriels canadiens;
- 100 % des exportations de poissons et de fruits de mer canadiens;
- 100 % des exportations de produits forestiers canadiens.
De plus, le PTPGP contribue à lever les obstacles non tarifaires au commerce en venant réduire le temps d’attente des exportateurs pour le dédouanement des marchandises; en faisant diminuer les coûts de mise en conformité; en accroissant la prévisibilité des processus en vigueur dans d’autres pays; en soutenant les secteurs des services et du numérique en pleine croissance; en élargissant les possibilités de soumissionner pour des contrats de MP dans les pays parties à l’Accord.
De plus, le PTPGP contribuera à relever les normes en matière de travail et d’environnement dans la région de l’Asie-Pacifique, à réduire les effets négatifs de certaines pratiques et à favoriser le développement durable. Les résultats du PTPGP en matière de travail et d’environnement sont parmi les plus complets que le Canada ait obtenus dans un accord de libre-échange. Le PTPGP rend les normes du travail et de l’environnement juridiquement contraignantes pour la première fois dans l’histoire.
Qu’est-ce que le GACI?
Le Groupe d’action pour le commerce inclusif (GACI) est issu de la Déclaration commune et a officiellement été établi en marge du Sommet de 2018 des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Le Canada, le Chili et la Nouvelle-Zélande sont les partenaires fondateurs du GACI, groupe qui vise à prendre appui sur les aspirations de la Déclaration commune pour aller plus loin. En octobre 2021, le Mexique, aussi partie au PTPGP, a été accueilli comme premier nouveau membre du GACI. Le Costa Rica et l’Équateur l’ont rejoint en mai 2023. L’adhésion au GACI est ouverte à tous les pays, même ceux qui ne font pas partie du PTPGP.
Les membres du GACI travaillent ensemble en faveur d’un commerce inclusif, pour assurer que les avantages du commerce sont plus largement répartis dans la société dans son ensemble et pour mieux répondre aux préoccupations croissantes concernant les questions environnementales et les normes du travail dans le commerce international. Ces travaux font progresser l’approche inclusive du Canada en matière de commerce, qui vise à créer une politique commerciale favorisant le développement économique durable et inclusif, et à aborder des questions d’intérêt mondial et régional.
Les membres du GACI ont élaboré un programme de travail évolutif qui englobe des priorités du Canada telles que la promotion du renforcement du pouvoir économique des femmes, le renforcement de la participation des femmes, des PME et des peuples autochtones au commerce, ainsi que la promotion de la CRE et des pratiques exemplaires en matière de consultation des intervenants.
Voici quelques-unes des initiatives du GACI à ce jour :
- Faire progresser les principes du commerce inclusif tels que la durabilité et l’égalité des genres à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et défendre les intérêts liés aux pêches et aux PME.
- Coparrainer un atelier de renforcement des capacités sur les femmes et le commerce, organisé par l’APEC au Chili, en mars 2019.
- Participer collectivement à un atelier de l’OMC, sur le travail dans les accords commerciaux en mars 2019, au cours duquel les membres du GACI ont fait part de leurs expériences sur la façon dont des dispositions détaillées relatives au travail, dans les accords commerciaux, peuvent contribuer à obtenir des résultats inclusifs.
- Organiser un webinaire sur la façon de favoriser la participation du public au commerce et aux accords commerciaux. Le webinaire de septembre 2019 a mis en évidence les avantages d’une participation ouverte à tous dans l’élaboration des politiques commerciales.
- Organiser un webinaire sur l’importance du commerce numérique pour favoriser la participation des femmes et des autres groupes sous-représentés dans le commerce, pendant la Semaine du commerce de Genève à l’OMC, tenue en octobre 2020.
- Organiser une discussion entre experts réunissant des économistes en chef du GACI pendant le Forum public de l’OMC en septembre 2022. La discussion a porté sur les données commerciales inclusives et la recherche qui appuie la concrétisation du commerce inclusif.
Qu’est-ce que l’AMCG?
À ce jour, la réalisation la plus importante du GACI a été la négociation et l’entrée en vigueur de l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG). Le 4 août 2020, les ministres responsables du commerce du Canada, du Chili et de la Nouvelle-Zélande ont tenu une réunion virtuelle pour signer l’AMCG. Le Mexique s’est joint à l’AMCG en octobre 2021, suivi de la Colombie et du Pérou en juin 2022, et du Costa Rica et de l’Équateur en mai 2023. L’AMCG s’inspire du chapitre sur le commerce et le genre que le Canada cherche à inclure dans les ALE depuis que le premier chapitre de ce type a été négocié avec le Chili en 2017. L’AMCG cadre avec l’approche inclusive du Canada en matière de commerce et la fait progresser; cette approche vise à garantir que les groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce, tels que les femmes, puissent bénéficier davantage du commerce et y participer davantage. L’adhésion à l’AMCG est ouverte aux non-membres du PTPGP (la liste des critères d’adhésion figure à l’annexe D).
En particulier, l’AMCG vise à réaffirmer des principes importants liés au commerce, tels que la reconnaissance du fait que la protection offerte par les lois nationales qui font la promotion de l’égalité des genres ne devrait pas être affaiblie dans le but d’encourager le commerce et l’investissement. L’AMCG confirme également l’importance de promouvoir l’égalité des genres sur le lieu de travail et engage les participants à l’AMCG à collaborer et à échanger les pratiques exemplaires afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi, y compris en fonction du sexe, de la grossesse, de la possibilité de grossesse, de la maternité, du genre et de l’identité de genre, sans oublier l’orientation sexuelle. L’AMCG accorde une grande importance à la mise en œuvre commune d’activités de coopération visant à supprimer les obstacles à la participation des femmes au commerce international et prévoit une disposition permettant aux participants à l’AMCG de collaborer au sein de tribunes internationales pour faire avancer ces questions. L’AMCG a de plus mis sur pied un groupe de travail chargé de mener à bien ces activités et d’en rendre compte.
Les activités réalisées jusqu’ici dans le cadre de l’AMCG comprennent ce qui suit :
- Partage d’information sur les politiques et les programmes nationaux qui favorisent le renforcement du pouvoir économique des femmes et l’égalité des genres en décembre 2020.
- Présentation et promotion de l’AMCG au cours d’une activité réunissant un groupe d’experts à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juin 2021. Plus de 300 personnes du monde entier ont assisté à cette activité.
- Table ronde destinée à aider les femmes qui exportent, qui sont prêtes à exporter ou qui envisagent des opportunités futures sur les marchés du l'AMCG à en savoir plus sur les opportunités commerciales qui existent au Canada, au Chili et en Nouvelle-Zélande en juin 2021. Environ 120 participants ont assisté à l'événement.
- Présentation d’un exposé sur les avantages de l’AMCG aux Parties au PTPGP dans le cadre de la réunion annuelle des comités de coopération en juillet 2021.
- Table ronde virtuelle sur l’AMCG et sur la nécessité de promouvoir la participation des femmes au commerce dans le cadre de la Diplomacy for Sustainability Initiative (initiative Diplomatie pour le développement durable) tenue chaque année par le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne, en septembre 2021.
- Table ronde virtuelle axée sur la participation et le maintien en poste des femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Les participants ont échangé des idées et des conseils sur la façon d’encourager et de soutenir les femmes dans les carrières en STIM qui apportent des avantages au commerce. Au total, 120 participants et participantes de plus de 22 pays ont assisté à l’activité.
Cadre et méthode d’évaluation
L’efficacité du PTPGP a été analysée selon une méthode hybride comprenant une évaluation qualitative et une évaluation des retombées économiques (ERE) quantitative. La première évalue et indique les progrès réalisés à l’égard des six questions d’envergure mondiale, tandis que l’ERE porte plus particulièrement sur les PME et l’égalité des genres.
Figure 1 :

Figure 1 - Version texte :
Cadre de l’examen triennal du GACI
La figure 1 présente un organigramme hiérarchique décrivant les différents apports nécessaires à l’élaboration de l’examen triennal du GACI. La partie gauche explique que la Déclaration commune du GACI de 2018 à guidé l’élaboration de l’évaluation qualitative. La partie droite explique que l’article 27.2(b) du PTPGP a guidé l’élaboration de l’évaluation quantitative des éléments inclusifs GACI dans le cadre du PTPGP.
Évaluation de l’efficacité
L’efficacité s’entend de la capacité à réussir et à produire les résultats escomptés. Une évaluation qualitative de l’efficacité du PTPGP touchant les six questions d’envergure mondiale de la Déclaration commune consiste donc à déterminer si les Parties à l’Accord ont été en mesure d’atteindre les objectifs liés à ces enjeux. Autrement dit, l’évaluation de l’efficacité vise à répondre à la question suivante : Le PTPGP a-t-il réussi à amener les Parties à atteindre l’objectif qu’elles s’étaient fixé?
Voici les six questions d’envergure mondiale qui ont été examinées dans le cadre du présent rapport :
- Petites et moyennes entreprises (PME);
- Égalité des genres;
- Peuples autochtones;
- Développement économique régional au sein de chaque pays;
- Droits des travailleurs;
- Environnement et changements climatiques.
L’évaluation de l’efficacité comportait une démarche en trois étapes : 1) regrouper les dispositions existantes du PTPGP par thème; 2) recenser les travaux des comités ayant une pertinence à l’égard de chaque thème; 3) énoncer les résultats et les constatations. Des études de cas et des exemples de réussite sont mis en évidence dans la mesure du possible. L’évaluation de l’efficacité a fait appel à plusieurs séries de consultations avec des représentants du Comité canadien du PTPGP, ainsi qu’avec des fonctionnaires canadiens en poste dans des missions dans les pays membres du PTPGP.
Évaluation des retombées économiques
Une ERE d’un ALE vise à mesurer de façon quantitative les effets sur les économies des pays concernés en analysant et en comparant les indicateurs clés avant et après la mise en œuvre de l’ALE. La présente ERE est le premier exercice du genre portant sur les résultats commerciaux du Canada dans le cadre du PTPGP et vise à évaluer si l’amélioration des obligations en matière d’accès aux marchés a entraîné une augmentation des échanges entre le Canada et les autres Parties au PTPGP.
Le Canada avait des ALE avec le Chili, le Mexique et le Pérou avant le PTPGP. Pour tenir compte de ce fait, l’ERE fait une distinction entre les marchés déjà visés par des ALE et les nouveaux marchés qui ont été rendus accessibles par le PTPGP. Les marchés existants comprennent le Chili, le Mexique et le Pérou, tandis que les nouveaux marchés comprennent les cinq pays qui avaient ratifié le PTPGP au moment de cette analyse (Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour et Vietnam). Brunéi, le Chili et la Malaisie n’ont pas été inclus dans l’évaluation, car ils ont ratifié le PTPGP après la période initiale de mise en œuvre de trois ans.
L’ERE mesure les gains commerciaux découlant de l’accès préférentiel du Canada aux nouveaux marchés. Pour mieux compléter l’examen de l’efficacité et soutenir les objectifs de la Déclaration commune, l’ERE fait ressortir les avantages dont bénéficient les PME, les travailleurs et les travailleuses.
L’ERE utilise les données commerciales et tarifaires pertinentes, lorsque celles-ci sont disponibles, pour comparer les échanges commerciaux du Canada avec les nouveaux marchés en 2018 (un an avant l’entrée en vigueur du PTPGP), en 2019 (l’année précédant la pandémie de COVID-19) et en 2021. Les statistiques commerciales pour 2020, première année de la pandémie, sont aussi présentées. Outre les comparaisons historiques, l’ERE compare aussi la tenue des échanges entre les secteurs libéralisés et non libéralisés, ou entre les secteurs assujettis à différents niveaux de réduction tarifaire dans le cadre du PTPGP. De plus, l’ERE observe l’évolution de l’utilisation des ALE au fil du temps après la mise en œuvre des accords commerciaux et compare l’utilisation entre les différents ALE.
Résumé des constatations
Évaluation de l’efficacité
Les résultats de l’évaluation de l’efficacité sont présentés par question d’intérêt mondial. Pour chaque question, l’évaluation décrit les dispositions du PTPGP, les efforts et les résultats pertinents, et fait état d’une étude de cas lorsque cela est possible.
1. Petites et moyennes entreprises
Le PTPGP est le premier ALE du Canada à inclure un chapitre consacré aux PME afin de les aider à tirer pleinement parti des nouveaux débouchés offerts par l’Accord. Cette première témoigne de la volonté du gouvernement du Canada d’accroître sensiblement le nombre de PME canadiennes qui exportent vers des marchés nouveaux et émergents. Les PME constituent la majorité des entreprises canadiennes et emploient plus de 7,5 millions de Canadiens et Canadiennes, soit environ 70 % de la main-d’œuvre du secteur privé.
L’une des principales caractéristiques du chapitre consacré aux PME réside dans l’obligation faite aux Parties de créer des sites Web conviviaux présentant de l’information sur la manière dont les PME peuvent tirer parti du PTPGP. Ces sites Web doivent comprendre des descriptions des dispositions du PTPGP pertinentes pour les PME. Le Canada a créé son site Web sur le PTPGP destiné aux PME en janvier 2019; les données révèlent qu’entre décembre 2020 et décembre 2022, le site Web a donné lieu à 3 414 visites, 44 % des visiteurs étant situés au Canada.
Le chapitre a en outre prévu l’établissement du Comité sur les PME qui se réunit régulièrement pour examiner dans quelle mesure le PTPGP répond aux besoins des PME, étudier les façons d’améliorer encore ses avantages et superviser les activités de coopération et de renforcement des capacités visant à soutenir les PME par le truchement de conseils à l’exportation, de programmes de formation, d’échange de renseignements, de financement du commerce et d’autres activités.
En 2019, les membres du Comité ont échangé de l’information sur les sites Web et sur l’élaboration de renseignements destinés expressément aux PME. Le Canada a présenté son expérience en matière de renforcement des compétences des fonctionnaires et de création de ressources et d’outils pour les PME, ainsi que les enseignements tirés de la promotion de l’utilisation du PTPGP par les PME. Les membres du Comité ont aussi échangé de l’information sur les pratiques actuelles d’échange de renseignements et de renforcement des capacités. Le Comité était d’avis que ces échanges, la mise en commun de renseignements sur les initiatives des membres et la consultation de l’industrie, du milieu universitaire et des PME sont un apport utile à l’avancement de ses travaux.
En 2020, le Comité s’est réuni pour discuter des façons dont les stratégies et les politiques visant à remédier aux répercussions de la COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement étaient mises en œuvre pour appuyer les PME, en s’attardant particulièrement aux mesures prises par les pays pour renforcer les capacités liées au commerce numérique. La même année, le Canada a présenté une proposition en vue d’organiser un atelier consacré à la mise en commun des pratiques exemplaires pour évaluer les effets des ALE, en mettant l’accent sur les PME et les chaînes d’approvisionnement. Cette réunion avait pour objectif de faire connaître différentes méthodes d’évaluation empirique de l’incidence des accords commerciaux et d’évaluation de la participation des PME au commerce et aux chaînes d’approvisionnement internationales, et ce, dans le but de tracer la voie à suivre afin d’évaluer l’effet du PTPGP sur les chaînes d’approvisionnement, comme l’exige l’Accord. La proposition a reçu un vaste soutien de la part des membres du Comité, et le Canada a pu tenir l’atelier en septembre 2020.
De plus, les missions du Canada dans les pays membres du PTPGP ont contribué à procurer des avantages aux PME. Depuis 2019, ces missions ont réalisé 20 activités ciblant les PME; plusieurs activités visaient des PME détenues ou dirigées par des femmes et des Autochtones, ainsi que des PME du secteur de l’environnement et des technologies propres. Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada aide également à promouvoir et à faire mieux connaître le PTPGP d’une manière adaptée aux entreprises et aux entrepreneurs canadiens. Depuis l’exercice 2018-2019, le SDC a organisé, soutenu ou présenté plus de 25 activités liées au PTPGP qui ont réuni plus de 1 975 participants, dont la plupart étaient des représentants de PME canadiennes. Outre le chapitre consacré aux PME, le PTPGP soutient aussi les PME canadiennes en venant simplifier les procédures douanières et les règles d’origine, et rendre plus transparente la réglementation rattachée au PTPGP.
À propos du SDC
Le Service des délégués commerciaux (SDC) aide les entreprises et les organisations canadiennes de toutes les tailles à croître et à exercer des activités à l’échelle internationale. Le réseau de délégués commerciaux présents dans plus de 160 villes du monde permet aux exportateurs d’avoir accès à des personnes de confiance dans le marché local, à des programmes de financement et de soutien, ainsi qu’à de précieux renseignements pour les aider à saisir des possibilités et à prospérer sur les marchés du monde entier.
Le SDC aide les entreprises admissibles à se préparer au commerce international, à trouver des débouchés et des contacts qualifiés à l’échelle mondiale et à résoudre les problèmes de nature commerciale qui se présentent à l’étranger.
Au chapitre sur les PME s’ajoutent aussi d’autres dispositions de l’Accord portant sur les PME et les travaux de différents comités du PTPGP qui sont liés à de nombreux autres chapitres du PTPGP, y compris le commerce transfrontières des services, le commerce électronique, la propriété intellectuelle (PI), la cohérence en matière de réglementation, la politique en matière de concurrence, la compétitivité et la facilitation des échanges commerciaux.
Commerce transfrontières des services
Les obligations et les engagements dans le chapitre sur le commerce transfrontières des services renforcent la transparence et la prévisibilité pour les fournisseurs de services, y compris dans le cas des services offerts en ligne. Les principales dispositions permettent d’assurer des règles du jeu équitables en veillant à ce que les Parties au PTPGP accordent le même traitement aux fournisseurs de services canadiens qu’à tout autre tiers et à leurs fournisseurs de services nationaux. D’autres dispositions du chapitre favorisent des pratiques exemplaires dans l’application des mesures et les processus d’octroi de licences dans les secteurs réglementés, y compris pour les services professionnels, tels que l’ingénierie, l’architecture et les services juridiques, dans lesquels les PME canadiennes sont concurrentielles à l’échelle mondiale. En outre, les femmes représentent en moyenne 43 % des professionnels dans ces secteurs.
Commerce électronique
Le Comité sur le commerce électronique établi en vertu du PTPGP a tenu sa première réunion en avril 2022. Le Comité offre un cadre pour discuter des questions liées au commerce inclusif, telles que la collaboration pour faciliter la participation des PME au commerce numérique ou la promotion de l’inclusion numérique. À titre de membres de ce comité, les Parties ont monté un atelier virtuel sur les dispositions nouvelles et novatrices pouvant faire partie des accords dans l’économie numérique et sur l’avancement de l’infrastructure numérique. L’atelier de juin 2022 a comporté des exposés présentés par les Parties au PTPGP, dont un du Canada sur les dispositions relatives au transfert de données de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). En outre, les Parties ont commandé une étude sur la mise en œuvre des engagements pris dans le chapitre sur le commerce électronique.
Propriété intellectuelle
Le Canada collabore avec l’Australie, le Chili, le Japon et le Mexique au sein du groupe des Amis de la propriété intellectuelle et de l’innovation (APII) dans les discussions du Conseil des accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’OMC, sur les expériences et les pratiques nationales dans de nouveaux domaines touchant la PI et l’innovation. En prévision de la réunion de février 2020 du Conseil des ADPIC, le Canada a rédigé le document de travail intitulé Rendre les MPME compétitives à l’aide des marques de commerce, afin de faciliter une discussion du Conseil des ADPIC sur la sensibilisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au rôle que jouent les marques de commerce dans le commerce international. Dans le cadre de la discussion du Conseil des ADPIC de février 2020 à ce sujet, le Canada, ainsi que l’Australie, le Chili, le Japon, le Pérou et Singapour, pays Parties au PTPGP, ont fait part de leurs expériences nationales pour faire mieux connaître aux MPME les marques de commerce et favoriser l’enregistrement et l’utilisation de celles-ci par ces types d’entreprises.
Politique en matière de concurrence
Le chapitre portant sur la politique en matière de concurrence reconnaît que la concurrence est avantageuse pour les entreprises, y compris les PME. La concurrence renforce la capacité des entreprises à réussir sur les marchés mondiaux en veillant à ce que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas annulés par des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Ce chapitre contribue à l’objectif des Parties de créer un environnement commercial équitable, transparent, prévisible et concurrentiel qui, au bout du compte, profite aux consommateurs et aux entreprises. Au Canada, l’un des objectifs de la Loi sur la concurrence est de veiller à ce que les PME aient une chance équitable de participer à l’économie canadienne. Le fonctionnement du Bureau de la concurrence du Canada s’appuie sur le principe général selon lequel des marchés ouverts et concurrentiels et des politiques favorables à la concurrence facilitent la participation des PME à l’économie. Les PME sont un moteur essentiel de la compétitivité de l’économie, car elles mettent sur le marché des produits novateurs et exercent une pression sur les grandes entreprises pour qu’elles restent concurrentielles.
Cohérence en matière de réglementation
Le chapitre portant sur la cohérence en matière de réglementation peut procurer des avantages aux PME. Il vise à remédier au problème croissant posé par les obstacles non tarifaires en améliorant la transparence, la coordination à l’échelon national des pays et la prévisibilité des cadres réglementaires étrangers et de leur application. Une discussion au cours de la réunion du Comité sur la cohérence en matière de réglementation de juillet 2020 a porté sur la participation des PME et des groupes intéressés aux processus d’amélioration de la réglementation.
Exemple de réussite
Le bureau du Service des délégués commerciaux du Canada à Tokyo a collaboré avec un studio d’illustration vancouvérois dirigé par des femmes pour concevoir une carte du Canada mettant en évidence les principales exportations agricoles de chaque province canadienne vers le Japon bénéficiant des réductions tarifaires prévues par le PTPGP. Le projet comprenait également des illustrations des 14 principales exportations agricoles du Canada vers le Japon, qui faisaient ressortir les résultats obtenus sur le plan tarifaire, grâce aux dispositions du PTPGP. Dans sa déclaration de travail, l’illustratrice a indiqué qu’elle tenait beaucoup à collaborer avec des organisations (dirigées par des femmes) qui accordent de l’importance à l’égalité, à la communauté et à la durabilité. Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec les provinces canadiennes, qui comptent un nombre important d’entreprises exportant vers le Japon (p. ex. la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec), afin de déterminer les principaux produits présentant un intérêt à l’exportation vers le marché japonais. Les illustrations sont utilisées pour promouvoir le PTPGP dans l’ensemble du réseau commercial au Japon, du bureau de Sapporo jusqu’au nouveau bureau de Fukuoka, dans le sud du Japon.
2. Égalité des genres
Grâce à son approche inclusive du commerce, le Canada a fait de l’égalité et du renforcement du pouvoir économique des femmes une priorité centrale de sa politique commerciale et de ses activités de promotion du commerce. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l’égalité des genres et à renforcer le pouvoir des femmes et des filles, tant au pays qu’à l’étranger. La réalisation de ces objectifs est un moyen efficace de faire rayonner les valeurs du Canada et son approche fondée sur les droits, ainsi que de favoriser la prospérité, une paix durable et un développement durable.
La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada et le SDC soutiennent et promeuvent les entreprises canadiennes dirigées par des femmes afin de faire progresser l’égalité des genres et de renforcer le pouvoir économique des femmes. Entre autres éléments, le Canada a notamment cherché à intégrer l’égalité des genres et la prévention de la discrimination fondée sur le genre dans ses ALE antérieurs, souvent en négociant des dispositions visant à éliminer la discrimination en matière d’emploi dans les chapitres sur le travail. Désormais, le Canada cherche aussi à inclure d’autres facteurs liés à l’égalité des genres. Pour ce faire, il réalise une analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) des différents chapitres de l’ALE en vue d’intégrer des dispositions relatives aux femmes dans l’ensemble des ALE, et il cherche à inclure un chapitre distinct sur la participation des femmes au commerce (communément appelé « chapitre sur le commerce et le genre »).
Bien que le PTPGP ne contienne pas de chapitre sur le commerce et le genre, plusieurs dispositions relatives à l’égalité des genres figurent dans les chapitres respectifs sur le travail, le développement, la coopération et le renforcement des capacités, ainsi que dans le préambule de l’Accord (voir l’annexe E). Ces dispositions contribuent à faire en sorte que les femmes et les entreprises dirigées par des femmes bénéficient du PTPGP (voir les tableaux infographiques sur la participation des femmes au commerce dans le cadre du PTPGP à l’annexe F). En outre, des travaux sont en cours à l’égard de cinq chapitres en vue de renforcer l’égalité et le pouvoir économique des femmes : commerce transfrontières des services; propriété intellectuelle; politique en matière de concurrence; développement; coopération et renforcement des capacités. Au-delà des activités entreprises, ces chapitres peuvent aussi bénéficier indirectement aux femmes et aux PME qui participent aux échanges commerciaux sous le régime du PTPGP et en tirent profit.
Commerce transfrontières des services
Le chapitre sur le commerce transfrontières des services a prévu la création par les membres du PTPGP d’un groupe de travail sur les services professionnels. Ce groupe de travail a mis au point des lignes directrices non contraignantes visant à faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) entre les organismes de réglementation ou les autorités chargées de reconnaître les qualifications et les services professionnels. Une disposition précise des lignes directrices vise expressément à favoriser l’inclusion, en indiquant que les exigences et les procédures énoncées dans les ARM ne doivent pas entraîner de discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou la race. Les lignes directrices non contraignantes sur les ARM ont été adoptées à l’échelon ministériel en octobre 2022 et sont actuellement accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
Propriété intellectuelle
En ce qui concerne la propriété intellectuelle (PI), le Canada a échangé avec les Parties au PTPGP sur leurs expériences respectives des stratégies nationales visant à réduire l’écart dans la participation des femmes et d’autres groupes sous-représentés aux systèmes d’innovation. Le Canada continue de mettre à profit sa vaste expérience dans le domaine de la PI pour participer à des échanges de connaissances avec ses partenaires commerciaux afin de favoriser la participation des femmes et d’autres groupes sous-représentés aux systèmes de PI et de leur permettre de mieux tirer parti de l’Accord.
L’expérience du Canada qui est mise à profit à cet égard comprend :
- La collaboration du Canada avec le Mexique et d’autres membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) aux réunions du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) de l’OMPI pour faire avancer les travaux sur la participation des femmes aux systèmes de PI. Le Canada et le Mexique ont notamment proposé au CDIP un projet visant à renforcer le rôle des femmes dans l’innovation et l’entrepreneuriat en encourageant les femmes des pays en développement à utiliser le système de la propriété intellectuelle, qui a été adopté à l’unanimité par le CDIP et lancé en janvier 2019. Le projet vise à mieux faire comprendre les problèmes que les inventrices et les innovatrices affrontent et à recenser des mécanismes de soutien ciblés susceptibles de faire mieux connaître aux femmes le système de la PI afin qu’elles y recourent davantage. En avril 2022, l’OMPI a publié un sur le programme international de mentorat en matière de PI pour les investisseuses.
- La Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada, lancée en 2018, vise à assurer que le régime de PI du Canada est moderne et solide, et que les entrepreneurs canadiens comprennent et protègent mieux leur PI. En 2019, pour mieux comprendre comment les Canadiens comprennent et utilisent la PI, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Statistique Canada ont mené une Enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété intellectuelle. Les répondants à l’enquête comprenaient des groupes traditionnellement sous-représentés et moins enclins à utiliser le système de la propriété intellectuelle, comme les femmes. Les résultats de cette étude seront communiqués aux Parties au PTPGP en tant qu’outil d’apprentissage seront communiqués aux Parties au PTPGP en tant qu’outil d’apprentissage.
Politique en matière de concurrence
Les Parties au PTPGP échangent des renseignements et collaborent à mesure que la recherche sur la prise en compte de l’égalité des genres dans les politiques de concurrence progresse à l’OCDE. Outre le Canada, les autres membres du PTPGP qui adhèrent ou participent au Comité de la concurrence de l’OCDE sont l’Australie, le Chili, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Pérou.
Le Canada finance des recherches pertinentes et a élaboré des outils de prise en compte de la dimension de genre à l’intention des autorités en matière de concurrence. Afin d’aider ces dernières à aborder leur travail sous l’angle de l’égalité des genres, l’OCDE termine l’élaboration d’une trousse d’outils pour une politique de concurrence tenant compte de la dimension de genre. Le Canada diffusera cette information auprès des Parties au PTPGP lorsqu’elle sera publiée en septembre 2023. Le Bureau de la concurrence du Canada continuera d’aider l’OCDE et ses membres (y compris les partenaires commerciaux du PTPGP) à comprendre les avantages de cette approche inclusive et fondée sur l’égalité des genres et à l’appliquer à la politique en matière de concurrence.
Le Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’efficacité de ses politiques et de ses programmes en matière de concurrence à l’échelle nationale et de faire part de son expérience aux Parties au PTPGP afin d’obtenir des résultats qui favorisent l’égalité des genres et l’inclusion.
Développement, ainsi que sur la coopération et le renforcement des capacités
L’article 23.4 (Femmes et croissance économique) du chapitre sur le développement et l’article 21.2 (Domaines visés par la coopération et le renforcement des capacités) du chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités visent à renforcer l’égalité et le pouvoir économique des femmes. Ces articles proposent la réalisation d’activités de coopération à l’appui du développement pour favoriser la croissance économique et le commerce en venant aider les femmes à renforcer leurs capacités et leurs compétences, pour accroître l’accès des femmes aux marchés, à la technologie et au financement, pour créer des réseaux de femmes dirigeantes et définir des pratiques exemplaires visant à favoriser la souplesse du milieu de travail.
À la réunion de 2019 du Comité sur le développement, les membres du Comité ont convenu d’échanger de l’information et de mettre en commun leurs expériences et pratiques exemplaires sur les façons de mesurer les effets du commerce, en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données, en mettant l’accent sur des thèmes (y compris les femmes dans l’économie) pertinents en ce qui a trait au chapitre du PTPGP sur le développement. En 2020, dans le cadre d’une réunion conjointe du Comité sur le développement et du Comité sur la coopération et le renforcement des capacités, le Canada a communiqué aux membres des renseignements actualisés sur le GACI et sur la conclusion de l’AMCG. Le Canada a aussi proposé d’organiser une séance d’information plus approfondie sur ces deux questions afin d’amener davantage de pays Parties au PTPGP à participer à l’Arrangement.
En juillet 2021, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont présenté, au Comité sur le développement ainsi qu’au Comité sur la coopération et le renforcement des capacités du PTPGP, un exposé sur les avantages de l’AMCG, et ont encouragé d’autres pays à y adhérer. En particulier, l’exposé a mis en évidence la vaste collaboration dans le cadre du GACI, l’importance du lien entre le commerce et l’égalité des genres et les avantages du GACI pour les économies et les femmes exportatrices. Le Mexique a adhéré à l’AMCG en octobre 2021.
Les missions du Canada dans les pays du PTPGP ont également œuvré en faveur de l’égalité et du renforcement du pouvoir économique des femmes dans leur pays d’accueil. Depuis 2019, le réseau des missions du Canada dans les pays du PTPGP a réalisé 33 activités liées à l’égalité des genres dans le contexte du commerce, en mettant l’accent sur diverses questions, telles que le développement, le renforcement du pouvoir économique des femmes, les femmes autochtones, l’innovation et la durabilité.
Exemple de réussite
Née et ayant grandi dans le Nord canadien, Amy Maund s’est passionnée dès son plus jeune âge pour les plantes et la faune. Lorsqu’elle était enfant, sa famille se rendait chaque été au Grand lac des Esclaves pour y récolter des produits de la forêt. Aujourd’hui, on peut la trouver avec sa jeune fille dans les régions sauvages des Territoires du Nord-Ouest ou du nord de la Colombie-Britannique en train de récolter des herbes, des baies, du lichen et des champignons pour fabriquer des produits artisanaux.
En 2011, Mme Maund a fondé Laughing Lichen pour créer et commercialiser d’une manière écologique des produits artisanaux à base de plantes sauvages tels que des savons, des pommades, des tisanes et des assaisonnements. Tous les aspects des activités de l’entreprise sont durables, de la récolte conforme à l’éthique à la fabrication des produits hors du réseau électrique au moyen de l’énergie solaire. Laughing Lichen récolte plus de 50 espèces différentes d’herbes sauvages, de baies, de lichens et de champignons pour ses produits.
« C’est ma passion, a indiqué Mme Maund. Les plantes sont sauvages et indigènes; elles ne sont pas cultivées ni situées à proximité des autoroutes, vaporisées ou génétiquement modifiées. Dans le Nord, la fabrication d’articles artisanaux faits à partir de produits de la nature est un beau mode de vie qui consiste à récolter et à chercher des plantes avec sa famille et ses amis, à profiter de la nature de manière durable et responsable, puis à revenir et à fabriquer des produits à partir de la récolte de plantes sauvages. »
Les produits de l’entreprise comprennent le thé du Labrador, tiré d’un petit arbuste aromatique poussant dans les zones marécageuses et humides, et qui contient aussi de la résine d’épinette, reconnue pour ses qualités antifongiques, analgésiques et antimicrobiennes. Son entreprise produit également un savon qui imite la forme des crottes d’ours, infusé avec des champignons chaga sauvages et des canneberges.
Pour soutenir l’expansion de son entreprise, elle construit une nouvelle installation alimentée par l’énergie solaire sur un terrain de 12 acres situé à 40 minutes au nord-est de Yellowknife, et elle compte employer plus de personnes et récolter de plus grandes quantités.
Laughing Lichen est un exemple d’entreprise prospère située dans l’une des régions isolées du Canada et qui est devenue exportatrice dans le monde entier. Mme Maund explique qu’elle souhaite soutenir un mode de vie dans le Nord où l’on peut gagner convenablement sa vie tout en continuant à vivre à distance des grands centres.
Les produits en gros de Laughing Lichen se vendent bien en Asie. Les ventes en ligne atteignent aussi les marchés du PTPGP au Japon et en Australie.
3. Peuples autochtones
Le PTPGP vise à faire progresser le développement économique et la participation des peuples autochtones au commerce au moyen de dispositions énoncées dans quatre chapitres du PTPGP : propriété intellectuelle; développement; coopération et renforcement des capacités; environnement. La Fondation Asie-Pacifique (article en anglais seulement) estime que plus de 50 millions d’Autochtones vivent dans les pays du PTPGP. Compte tenu de ces réalités, il est important de veiller à ce que les groupes sous-représentés, y compris les peuples autochtones, profitent des avantages et des possibilités qu’offre l’intensification des échanges commerciaux. Les dispositions relatives aux peuples autochtones énoncées dans les précédents accords de libre-échange du Canada figurent également dans le PTPGP, mais elles sont conçues pour protéger les droits des Autochtones et le traitement préférentiel qui leur est accordé au Canada. Par exemple, le Canada maintient des réserves pour les « affaires autochtones » dans sa liste d’engagements concernant le commerce des services et l’investissement, ainsi que des marchés réservés aux entreprises autochtones dans sa liste d’engagements portant sur les marchés publics (MP). Dans le même ordre d’idées, la Nouvelle-Zélande a inclus dans le PTPGP une exception générale pour le traité de Waitangi afin de protéger les droits et les intérêts des Maoris. Le Canada s’est inspiré de l’approche adoptée par la Nouvelle-Zélande et a ensuite élaboré sa propre exception générale en faveur des Autochtones au Canada, qu’il a défendue avec succès pendant les négociations de l’ACEUM.
Propriété intellectuelle
Les Parties au PTPGP se sont engagées à collaborer par l’intermédiaire de leurs organismes respectifs responsables de la propriété intellectuelle (PI) (ou d’autres organismes pertinents), afin d’améliorer la compréhension des questions liées aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (article 18.16 du PTPGP), ce qui présente un intérêt particulier pour les peuples autochtones. À ce titre, le Canada collabore avec les Parties au PTPGP, au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, de l’OMPI, qui réunit des spécialistes techniques pour mettre en commun les expériences nationales sur ces questions. Le Canada a communiqué aux Parties au PTPGP sa Stratégie en matière de propriété intellectuelle, qui vise à garantir un régime de PI moderne et solide et à informer les entrepreneurs canadiens sur la manière de protéger leur PI. Pour mieux comprendre comment les Canadiens comprennent et utilisent la PI, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Statistique Canada ont mené une Enquête sur la connaissance et l’utilisation de la propriété intellectuelle en 2021. Les répondants à l’enquête comprenaient des groupes traditionnellement sous-représentés et moins susceptibles d’utiliser la PI, tels que les peuples autochtones. L’enquête a montré que 10,1 % des entreprises dont le principal décideur est autochtone possédaient une forme quelconque de PI., qui vise à garantir un régime de PI moderne et solide et à informer les entrepreneurs canadiens sur la manière de protéger leur PI.
Dans le cadre de la Stratégie en matière de PI, ISDE a lancé en 2019 la subvention du Programme de propriété intellectuelle autochtone, qui aide les organisations autochtones à accroître leur capacité à gérer stratégiquement la PI. Cinq organisations ont reçu au total 116 665 $ pour étudier les moyens de rendre le système de PI plus accessible et élaborer leurs propres politiques, ressources éducatives et projets pilotes en matière de PI.
Développement, Coopération et renforcement des capacités
Le Comité sur le développement et le Comité sur la coopération et le renforcement des capacités, établis en vertu des chapitres respectifs du PTPGP, se sont réunis en 2019 et ont convenu d’échanger des renseignements et de mettre en commun leurs expériences et pratiques exemplaires sur les moyens de mesurer les effets du commerce, en particulier en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données. Ils ont mis l’accent sur des thèmes pertinents en ce qui a trait au chapitre du PTPGP sur le développement, y compris les groupes sous-représentés tels que les peuples autochtones. Depuis 2019, le réseau des missions du Canada dans les pays du PTPGP a mené 11 activités liées à la participation des Autochtones au commerce.
Environnement
Dans le chapitre sur l’environnement, les Parties se sont engagées à maintenir une gouvernance environnementale solide en appliquant des normes élevées de protection de l’environnement et en faisant respecter efficacement les lois environnementales dans le contexte de la libéralisation des échanges. À l’article 20.13 du PTPGP, les Parties au PTPGP ont en outre convenu de promouvoir et d’encourager la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et de reconnaître l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales qui concernent la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Les Parties ont aussi convenu de l’importance de la participation et de la consultation du public sur des questions afférentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.
Exemple de réussite
En décembre 2020, la mission du Canada à Sydney, en Australie, s’est associée au Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA) pour lancer le premier Dialogue Canada-Australie sur l’exportation par les entreprises autochtones, en collaboration avec six entreprises autochtones canadiennes et australiennes et les partenaires suivants : CCEA, Supply Nation, Business Council of Australia, Austrade, Ignite. La mission du Canada a présenté le SDC du Canada, en faisant ressortir le PTPGP et l’importance accordée par le Canada aux exportateurs autochtones, ainsi que le degré élevé de collaboration entre Austrade et le SDC, qui améliore les services fournis aux entreprises. Les entreprises canadiennes participantes étaient désireuses d’en savoir plus sur l’aide que le SDC pouvait leur apporter en Australie, sur le programme CanExport, ainsi que sur l’incidence possible des accords commerciaux sur leurs activités. Comme presque toutes les entreprises étaient actives dans le secteur de la nutrition, de la santé et du mieux-être, une synergie naturelle est apparue, ce qui les a amenées à s’engager à examiner la possibilité de collaborer. Le CCEA a présenté une demande à CanExport Associations pour, entre autres initiatives, mener une mission commerciale virtuelle autochtone en Australie en 2021.
4. Développement économique régional
Le Canada apporte son soutien aux entreprises canadiennes qui cherchent à tirer parti des possibilités offertes par les marchés du PTPGP de diverses façons : en élaborant et en distribuant du matériel de promotion tel que des vidéos d’exemples de réussite, en publiant des renseignements en ligne sur les programmes de soutien et en fournissant des outils avantageux tels qu’Info-Tarif Canada pour chercher les taux de droits de douane qui s’appliquent. Le Canada donne aussi de la formation à ses délégués commerciaux et aux fonctionnaires qui travaillent directement avec les entreprises canadiennes pour qu’ils puissent les conseiller sur les possibilités liées au PTPGP. Les partenaires du secteur public englobent les gouvernements provinciaux et territoriaux, les sociétés d’État et les autres ministères fédéraux. En 2023, le Canada a amorcé, en collaboration avec ces partenaires, l’élaboration d’un portail numérique sur les ALE afin d’aider les entreprises canadiennes à tirer pleinement parti de ces accords, y compris du PTPGP. Le lancement du portail numérique des accords de libre-échange est prévu en 2024.
Ces initiatives appuient les efforts déployés par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour promouvoir le PTPGP. On peut prendre connaissance des avantages du PTPGP pour les provinces et les territoires en consultant le site Web du gouvernement du Canada.
Exemple de réussite
En juillet 2020, le ministère du Développement social du Chili a coordonné une série d’ateliers sur la participation des femmes autochtones dans les économies locales : discussions sur la participation des institutions à la promotion du renforcement des capacités [en anglais seulement] dans le cadre de la présidence chilienne de l’APEC en 2019. La série d’ateliers, parrainée par le Canada, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, comptait quatre séances auxquelles ont assisté des représentants des institutions publiques des économies membres de l’APEC qui se spécialisent dans le renforcement du pouvoir économique des femmes autochtones. Les économies de l’APEC qui ont participé à cet événement comprenaient de nombreux pays parties au PTPGP, soit l’Australie, le Canada, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et le Vietnam. Le Chili était représenté par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Chili, la Corporación de Fomento de la Producción, le sous-secrétaire du Tourisme et Organisation des Nations Unies (ONU) Femmes au Chili. Mme Dawn Madahbee Leach, vice-présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones, représentait le Canada en tant que conférencière à l’événement.
La série d’ateliers a porté sur les défis et les bonnes pratiques liés à la conception et à la mise en application de politiques publiques qui favorisent la participation des femmes autochtones aux économies locales. Elle a permis d’effectuer une analyse comparative des pratiques exemplaires qui devraient être reproduites à l’échelle de l’APEC pour faire progresser les politiques et les programmes visant à renforcer le pouvoir des femmes autochtones dans la région de l’APEC. Les Autochtones qui se trouvent dans la région de l’APEC représentent 70 % de la population autochtone mondiale.
5. Droits des travailleurs
Le chapitre du PTPGP portant sur le travail renferme des obligations contraignantes sur les droits des travailleurs et confirme l’engagement pris par les Parties de respecter les droits et les principes internationalement reconnus dans le domaine du travail et d’appliquer de manière effective leurs lois nationales sur le travail. Les dispositions du PTPGP en matière de travail encouragent la participation des membres du public et leur permettent de faire part de leurs préoccupations.
Toutes les Parties au PTPGP sont membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et reconnaissent le lien qui existe entre les droits des travailleurs et le commerce. Dans le PTPGP, les Parties conviennent d’adopter et de maintenir dans leurs lois et pratiques les droits fondamentaux des travailleurs énoncés dans la Déclaration de 1998 de l’OIT, à savoir la liberté d’association et le droit à la négociation collective, l’élimination du travail forcé, l’abolition du travail des enfants, l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi. Elles conviennent également d’adopter et d’appliquer des lois régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail, ainsi que la santé et la sécurité au travail.
Le Canada collabore avec les Parties au PTPGP pour soutenir l’application des normes du travail dans leurs pays. En plus des consultations techniques tenues avec les pays partenaires, le Canada fournit une assistance technique, au moyen de programmes de subventions et de contributions, pour soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement partenaires. Ce soutien a permis aux pays qui ont ratifié le PTPGP, l’ACEUM et l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou, de renforcer leur capacité à réformer ou à appliquer efficacement les régimes du travail et à respecter les normes du travail reconnues à l’échelle internationale.
Ce soutien comprend une série de projets de coopération bilatérale auxquels participent le Canada et les partenaires du PTPGP, que ce soit dans le cadre du PTPGP ou d’autres ALE. Bien que tous les exemples ne soient pas propres au PTPGP, il est important de tenir compte des travaux en cours dans d’autres cadres afin d’éviter de répéter inutilement les efforts, et de reconnaître les avantages qu’ils peuvent offrir dans le contexte du PTPGP. En mettant l’accent sur le renforcement d’un système commercial fondé sur des règles harmonisées avec les normes internationales du travail, ce soutien devrait contribuer, directement ou indirectement, à faire avancer les objectifs du chapitre sur le travail du PTPGP et trois des priorités de coopération adoptées à la réunion de 2021 du Conseil du travail du PTPGP, pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement éthiques et durables, la santé et la sécurité au travail et l’égalité des genres.
En tant que partenaire pour le développement, le Canada soutient financièrement la mise en œuvre par l’OIT d’un projet quinquennal sur les systèmes nationaux de relations de travail au Vietnam, doté d’une enveloppe de 1,5 million de dollars à partir de l’exercice 2020-2021, qui vise ce qui suit : faciliter la réforme de la loi nationale sur les relations de travail; appuyer les nouveaux modes de négociation collective et de dialogue social au niveau local; renforcer la fonction de service du gouvernement vietnamien dans les relations de travail. En outre, le projet vise à renforcer le rôle du gouvernement vietnamien en tant que médiateur et promoteur des négociations collectives et du dialogue social. Le projet devrait aider le Vietnam à respecter les normes internationales du travail et les obligations découlant du chapitre du PTPGP portant sur le travail. Le projet soutient la mise en application du Code du travail du Vietnam de 2019, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et établit, pour la première fois, le droit des employés à établir des syndicats indépendants et à y adhérer, rendant ainsi la loi vietnamienne conforme à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 de l’OIT.
Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour le Vietnam, le Canada a reçu une communication publique en mars 2023 selon laquelle les lois sur le travail du Vietnam ne seraient pas conformes aux obligations du chapitre du PTPGP sur le travail, portant sur la liberté d’association et la négociation collective. Le point de contact canadien désigné pour le chapitre sur le travail a accepté d’examiner la communication publique et se penchera sur les questions soulevées. Tout au long de ce processus et au-delà, le Canada continuera à apporter son soutien, dans toute la mesure du possible, afin que le Vietnam puisse poursuivre la mise en œuvre de ces réformes et respecter ses obligations.
À la suite de la ratification du PTPGP par la Malaisie, le Canada a lancé en mars 2023 un projet de l’OIT d’une valeur de 800 000 $. Ce projet a pour but de renforcer les mesures nationales et sectorielles afin que les normes internationales du travail soient adoptées et appliquées en Malaisie. Il vise avant tout à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le secteur des appareils électriques et électroniques, et à renforcer la liberté d’association et le droit à la négociation collective, à titre de moyens efficaces d’améliorer la protection des travailleurs. Le projet devrait prendre fin en septembre 2025.
Au Mexique, le Canada a soutenu le réseau de solidarité Maquila Solidarity Network (en anglais et en espagnol seulement), une organisation établie au Canada, dans la réalisation d’un projet de deux ans d’une valeur de 250 000$ qui vise à soutenir le droit des travailleurs de l’industrie du vêtement et d’autres secteurs d’exportation du Mexique à adhérer aux syndicats de leur choix ou à former des syndicats, ainsi qu’à négocier collectivement. À cette fin, les activités du projet comprenaient l’élaboration et la diffusion d’un large éventail de ressources sur la réforme du travail, ainsi que la promotion d’un dialogue constructif sur la liberté d’association et la négociation collective entre les entreprises, les fabricants, les gouvernements et les défenseurs des droits des travailleurs. Les activités du projet ont pris fin en juin 2021.
En outre, le Canada s’est engagé à verser 20 millions de dollars sur quatre ans, à compter de l’exercice 2021-2022, pour soutenir la mise en œuvre par le Mexique de ses réformes du travail et de ses obligations découlant des dispositions relatives au travail de l’ACEUM. En septembre 2021, le Canada a approuvé deux projets quadriennaux axés sur les travailleurs, dont un d’une valeur de 4,4 millions de dollars mis en œuvre par le Fonds humanitaire des Métallos, pour améliorer la protection des droits des travailleurs, les salaires et les conditions de travail des travailleurs syndiqués et non syndiqués dans des États et des secteurs économiques ciblés, et un autre d’une valeur de 5 millions de dollars mis en œuvre par Unifor, pour améliorer l’exercice des droits des travailleurs mexicains tels qu’ils sont énoncés dans le droit du travail mexicain et dans l’ACEUM. En outre, en 2022, une initiative triennale de 2,4 millions de dollars réalisée par Vision mondiale Canada a été lancée pour améliorer les conditions de travail et l’exercice effectif des droits des travailleurs mexicains, en particulier des femmes et des jeunes migrants et autochtones, en s’attaquant au travail forcé et au travail des enfants dans des sous-secteurs agricoles clés axés sur l’exportation (tomates, concombres et aubergines) dans les États mexicains du Sinaloa et de Jalisco.
Le Canada a aussi aidé le Pérou dans divers domaines liés au travail. En particulier, depuis l’entrée en vigueur, en 2009, de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou, le Canada a fourni au Pérou une assistance technique dans les domaines du travail des enfants, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que du respect et de l’application des droits des travailleurs. Par exemple, le Canada a aidé le Programa Laboral de Desarrollo, une organisation non gouvernementale péruvienne, à mener à bien un projet triennal d’une valeur de 600 000 $. Ce projet a renforcé la capacité d’acteurs du monde du travail au Pérou à respecter et à faire appliquer les lois du travail, en particulier celles qui garantissent le droit de s’associer librement et de négocier collectivement. Le projet visait également à garantir un accès rapide à la justice pour les griefs liés au travail. Les activités du projet comprenaient la formation des fonctionnaires de justice et des représentants syndicaux, ainsi que la mise en place d’outils pour faciliter la négociation collective. Les activités du projet ont pris fin en novembre 2021.
En outre, comme il s’y est engagé dans le chapitre de l’ACEUM sur le travail, le Canada a adopté une loi interdisant l’importation de biens qui sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par le travail forcé. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Le Canada continuera d’informer les membres du Conseil du travail du PTPGP des mesures qu’il prend pour lutter contre le travail forcé et cherchera à échanger des renseignements sur les pratiques exemplaires pertinentes.
6. Environnement et changements climatiques
Le chapitre du PTPGP portant sur l’environnement est très ambitieux, car il engage les Parties à maintenir une gouvernance environnementale solide en défendant des normes de protection élevées et en appliquant efficacement les lois pertinentes tout en libéralisant le commerce. Il interdit en outre aux Parties d’affaiblir les normes ou les lois environnementales dans le but de promouvoir le commerce ou d’attirer des investissements. Fait à souligner, le respect des obligations du chapitre peut être assuré au moyen du mécanisme de règlement des différends du PTPGP, une première dans un ALE signé par le Canada. Composé de hauts représentants gouvernementaux de chaque pays Partie, le Comité sur l’environnement du PTPGP supervise la mise en œuvre des dispositions. Le PTPGP reconnaît le droit des Parties à établir leurs propres priorités environnementales et les niveaux de protection correspondants. Dans cette optique, les Parties s’engagent à s’efforcer d’atteindre des niveaux élevés de protection dans leurs lois et leurs politiques nationales. Les Parties conviennent également de collaborer sur des questions d’intérêt mutuel liées aux changements climatiques (transition vers des économies carboneutres), comprenant les énergies propres et renouvelables, les technologies à faibles émissions, les transports durables et l’infrastructure urbaine durable, la prévention du déboisement, ainsi que les mécanismes de marché et les mécanismes non marchands.
Le Comité sur l’environnement du PTPGP a été actif et s’est réuni cinq fois, y compris au moyen de réunions intersessions, et a aussi mis en œuvre diverses activités de collaboration dans le but d’échanger des renseignements, d’accroître la sensibilisation et d’échanger les pratiques exemplaires et les leçons retenues, en vue de promouvoir de meilleures pratiques environnementales dans l’ensemble de la région du PTPGP.
En 2019, les membres du Comité ont échangé des renseignements liés aux dispositions figurant dans le chapitre sur l’environnement, y compris sur les programmes environnementaux nationaux, les stratégies visant à faire mieux connaître au public les lois et les politiques environnementales, les divers mécanismes consultatifs utilisés par les Parties à l’égard des questions environnementales, ainsi que les mécanismes volontaires mis en place par les Parties pour améliorer la performance environnementaleNote de bas de page 5. Le Comité a également convenu qu’une liste de priorités de coopération serait soumise par chaque Partie afin de constituer une filière de possibilités de coopération pour l’avenir. Le Comité a tenu une séance publique en 2019, qui réunissait des représentants gouvernementaux et des membres de la société civile, y compris d’organisations non gouvernementales et d’entreprises, de chaque pays du PTPGP. La séance s’est concentrée sur la biodiversité, la gestion des pêches et les subventions, la pollution marine et l’économie circulaire.
Au cours d’une réunion du Comité sur l’environnement tenue en octobre 2020, le Canada s’est efforcé de mobiliser les autres pays en proposant un dialogue virtuel sur la reprise verte après la COVID‑19, qui a eu lieu le 2 décembre 2020; un dialogue sur les cadres de coopération, qui a eu lieu en 2021; une discussion sur les séances publiques, qui a eu lieu pendant la réunion du Comité sur l’environnement en juin 2021; deux ateliers sur le commerce illégal d’espèces sauvages, qui ont eu lieu en mars 2021 et en mai 2023.
En août 2020, une séance publique ayant pour thème « Une reprise verte après la COVID-‑19 : renforcer la résilience pour un avenir plus vert, plus sain et prospère » a été organisée, et trois experts y ont présenté des exposés. Le premier exposé a donné un aperçu des mesures internationales de relance verte et a recommandé une série de mesures, telles que des investissements dans les infrastructures d’énergie propre, l’efficacité énergétique et les infrastructures naturelles. Le deuxième exposé a porté sur les mesures visant à accroître la résilience et à prévenir de futures maladies zoonotiques telles que la COVID-19‑. Le dernier exposé a plaidé en faveur de voies environnementales vers la reprise, comprenant des investissements dans des technologies et des infrastructures à faibles émissions.
Au cours d’une réunion intersessions tenue en octobre 2020, le Japon, à titre de président du Comité sur l’environnement, a accepté la suggestion du Canada d’organiser un dialogue sur les expériences des Parties en matière de coopération dans des contextes d’ALE bilatéraux à l’occasion de la prochaine réunion du PTPGP, afin de renforcer l’adhésion en faveur de la coopération au sein du Comité sur l’environnement. Ce dialogue a eu lieu à la réunion suivante du Comité sur l’environnement en juin 2021, au cours de laquelle le Canada a présenté des exemples de ses activités de coopération dans le cadre du PTPGP et d’autres accords de libre-échange afin de lancer une discussion sur le dialogue à venir entre les Parties.
En outre, le Comité sur l’environnement du PTPGP et le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) du PTPGP ont collaboré à l’organisation d’un atelier qui a eu lieu en juin 2020. Celui-ci avait pour but de déterminer les possibilités d’échanger de l’information et à propos d’expériences de gestion liées au mouvement, à la prévention, à la détection, au contrôle et à l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue de renforcer les efforts visant à évaluer et à contrer les risques et les effets négatifs. Il s’agit d’un point important, car le chapitre du PTPGP portant sur les mesures SPS est axé sur la protection de la santé humaine et animale et la protection des végétaux, et les espèces exotiques envahissantes peuvent avoir un effet négatif sur tous ces aspects.
Faisant suite à sa proposition précédente, le Canada a organisé un dialogue sur la reprise verte après la COVID-‑19 en décembre 2020. Des représentants gouvernementaux de neuf des onze pays trois sujets : l’économie circulaire pour la reprise verte; mieux reconstruire pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de 2030 de l’ONU; les mesures de conservation pour prévenir les pandémies. Le dialogue a soulevé des questions importantes, qui peuvent contribuer à une plus grande collaboration dans le contexte du PTPGP, y compris en ce qui concerne le commerce transfrontalier de biens recyclés, l’investissement vert et l’atténuation des obstacles non tarifaires découlant du protectionnisme vert dans le cadre de la reprise après la pandémie.
En mars 2021, le Canada et le Mexique ont organisé ensemble un atelier sur la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages. En présence de 180 délégués de huit des onze pays du PTPGP, l’atelier portait sur le commerce illégal de tortues en voie de disparition. Il a servi à renforcer les capacités d’inspection, d’échantillonnage et de surveillance des envois transfrontaliers d’espèces sauvages protégées. Le Canada et le Mexique ont organisé un deuxième atelier en mai 2023, qui a porté sur les requins et les raies. Plus de 70 personnes ont participé à ce deuxième atelier, qui visait à renforcer la capacité de s’attaquer à l’offre et à la demande du commerce illicite d’espèces sauvages.
De juin à août 2021, le Japon a organisé quatre webinaires, qui ont servi d’activités de coopération et de séances publiques dans le cadre du chapitre du PTPGP sur l’environnement. Les thèmes discutés ont été les suivants :
- Prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
- Conservation et utilisation durable de la biodiversité.
- Économie circulaire et utilisation efficace des ressources.
- Changements climatiques et décarbonation.
Le Canada a participé aux quatre webinaires.
Étant donné que de nombreux pays Parties au PTPGP n’avaient jamais contracté d’obligations environnementales dans un ALE, il y avait au départ des degrés inégaux de compréhension de la mise en œuvre des dispositions environnementales et de motivation pour réaliser des progrès. Ce déséquilibre a constitué un défi et a entraîné des retards dans l’établissement des procédures initiales et dans la mise en œuvre du chapitre. Toutefois, si certaines Parties au PTPGP ne participent pas très activement dans ce domaine, d’autres ont manifesté un grand intérêt et font preuve d’un grand dynamisme au sein du Comité sur l’environnement.
Exemple de réussite
À l’appui de la Stratégie de diversification du commerce du Canada, des représentants du SDC du Canada à Singapour et de MaRS Discovery District (en anglais seulement) ont collaboré pour mettre en valeur 15 entreprises canadiennes et deux accélérateurs canadiens de technologies propres (MaRS et Alacrity) au 2e forum de l’Asie sur les technologies propres [Clean Tech Asia], en octobre 2019. La délégation canadienne était la 2e en importance à la conférence, et la plupart des participants canadiens étaient des conférenciers officiels à l’événement qui comprenait des séances de présentation éclair de projets et des tables rondes. En plus de présenter des technologies propres canadiennes novatrices, la délégation canadienne s’est distinguée par la diversité des genres, puisque les entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes représentaient le tiers de la délégation. Le 7 octobre, le haut-commissariat du Canada à Singapour a organisé un programme d’une journée pour les entreprises canadiennes participant au forum. Le programme comprenait une visite d’installations, une séance d’information et une séance de réseautage à l’Agence nationale de l’eau de Singapour, ainsi que des exposés sur les débouchés et les tendances du marché. Une séance de réseautage organisée en collaboration avec Enterprise Singapore (un organisme du gouvernement de Singapour relevant du ministère du Commerce et de l’Industrie) comprenait des présentations éclair faites par cinq entreprises canadiennes et une entreprise singapourienne de technologies propres appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes, ainsi que des rencontres interentreprises préorganisées.
En outre, le SDC a activement facilité les rencontres avec des entreprises locales pendant le forum et en marge de celui-ci. L’espace réservé au Canada au cours de l’événement a permis aux entreprises canadiennes de disposer d’un lieu de rencontre et de réseautage de premier ordre. Ce service de mise en relation offert à tous les participants canadiens leur a permis d’avoir accès à des réseaux locaux, régionaux (Asie du Sud-Est) et mondiaux d’entreprises, à des investisseurs et à des sociétés axés sur les activités liées à l’avenir de l’énergie, de l’électricité, de la mobilité, de la gestion des déchets, et bien plus encore.
Le Canada a également organisé un déjeuner ayant pour thème « Les femmes dans les technologies propres » afin de présenter le Canada comme chef de file en matière d’inclusion et de diversité, deux éléments qui ont contribué à distinguer la délégation canadienne. Deux représentantes des entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes, RWI Synthetics et Eco Waste Solutions, ont pris la parole pendant la table ronde dont l’animation était assurée par MaRS Discovery District. La discussion a porté sur la manière d’ouvrir aux femmes plus de possibilités de devenir entrepreneures, en particulier dans les secteurs liés à la technologie. Les entreprises et les organisations canadiennes dirigées par des femmes et mises en valeur au cours du déjeuner étaient les suivantes : Eco Waste Solutions, xpertSea, RWI Synthetics, Genecis Bioindustries, Open Ocean Robotics et MaRS Discovery District.
Conclusion de l’évaluation de l’efficacité
L’évaluation de l’efficacité met en évidence certains résultats importants du PTPGP susceptibles de faire progresser les questions liées au commerce inclusif pour les Parties au PTPGP. Le chapitre du PTPGP consacré aux PME ressort comme un résultat important, car il reconnaît le rôle et la contribution des PME et facilite leur participation au commerce international et à l’investissement parmi les Parties au PTPGP. Comme le montre le présent examen, plusieurs comités du PTPGP s’efforcent d’améliorer l’accès des PME aux débouchés commerciaux et leur capacité à tirer parti de l’Accord. Bien que le PTPGP ne comprenne pas de chapitre sur le commerce et l’égalité des genres, plusieurs dispositions de l’Accord reconnaissent l’importance de la participation des femmes à l’économie et au commerce. En outre, à ce jour, plusieurs comités ou Points de contact du PTPGP (le Comité sur le commerce transfrontières des services, les Points de contact pour la propriété intellectuelle, le Comité sur le développement, le Comité sur la coopération et le renforcement des capacités) se sont efforcés d’intégrer dans leurs travaux des éléments visant à favoriser l’égalité des genres et l’inclusion. Dans le même ordre d’idées, plusieurs comités ou Points de contact (les Points de contact pour la propriété intellectuelle, le Comité sur le développement, le Comité sur la coopération et le renforcement des capacités, le Comité sur l’environnement) collaborent sur des questions liées aux peuples autochtones. Les dispositions exécutoires obtenues dans le PTPGP dans les domaines du travail et de l’environnement font partie intégrante des engagements de l’Accord en matière d’inclusion, d’équité, de durabilité et de droits de la personne. Ils complètent les engagements pris par les Parties au PTPGP dans d’autres cadres, comme l’Organisation internationale du Travail. La mise en œuvre des chapitres du PTPGP sur le travail et l’environnement a fait l’objet d’une collaboration considérable entre le Canada et les Parties au PTPGP, y compris au sein des comités et de façon bilatérale.
L’évaluation démontre que, parallèlement à la collaboration au sein des comités, les missions du Canada ont joué un rôle important pour faire progresser l’inclusion et veiller à ce que les groupes sous-représentés, dont les PME, les femmes et les peuples autochtones, tirent profit du PTPGP. Les missions du Canada dans les pays du PTPGP ont réalisé des dizaines d’activités pour soutenir ces groupes.
Bien que du bon travail ait été accompli dans ces domaines, il est possible de mettre l’accent de manière plus marquée sur d’autres aspects de la mise en œuvre du PTPGP à l’égard de l’inclusion, en particulier en ce qui concerne la collaboration en matière de développement économique régional. De toute évidence, il s’agit d’un domaine dans lequel les Parties au PTPGP, dont le Canada, compte tenu de sa grande superficie et de sa population diversifiée, pourraient mieux collaborer afin de faire progresser un développement économique régional dont personne n’est exclu.
En tout état de cause, la mise en œuvre du PTPGP bénéficierait d’une plus grande prise en compte des groupes sous-représentés, que ce soit dans le cadre des travaux des comités ou de la coopération bilatérale. Cela pourrait nécessiter une collaboration plus étroite, au moyen de consultations ciblées, avec les groupes sous-représentés, afin de mieux comprendre les défis et les obstacles qu’ils rencontrent pour accéder aux débouchés commerciaux internationaux. Les partenaires du GACI pourraient apporter un soutien en mettant en commun leurs expériences et leurs pratiques exemplaires et en favorisant un dialogue inclusif et transparent, y compris avec les PME, les femmes et les Autochtones. Pour en savoir plus sur cette idée, consultez les sections « Lacunes et possibilités », « Recommandations » et « Prochaines étapes » du présent rapport.
Évaluation des retombées économiques
L’objectif du Groupe d’action pour un commerce inclusif (GACI) est de faire progresser le commerce durable et inclusif, de veiller à ce que les avantages du commerce soient plus largement répartis et de mieux répondre aux préoccupations croissantes concernant les questions environnementales et les normes du travail dans le commerce international. À cette fin, l’évaluation des retombées économiques du Canada évalue l’état des éléments inclusifs dans le cadre des obligations de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Elle examine si les PME canadiennes et les travailleurs et travailleuses canadiens bénéficient des obligations du PTPGP.
Cette évaluation des retombées économiques commence par un aperçu du commerce et de l’investissement du Canada avec les pays partenaires du PTPGP à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord. La deuxième partie évalue l’ampleur du commerce créé dans le cadre du PTPGP, en comparant les résultats commerciaux du Canada dans les nouveaux marchés du PTPGP avant et après l’entrée en vigueur de l’accord, pour tous les produits visés par le PTPGP. Elle est suivie d’un examen plus approfondi des éléments du commerce inclusif dans le cadre des obligations du PTPGP, en mettant l’accent sur les résultats commerciaux des PME exportatrices canadiennes (pour les produits visés par l’accord) et sur les résultats du Canada en matière d’emploi des travailleuses dans les entreprises exportant vers les nouveaux marchés, à l’aide des données de Statistique Canada sur les entreprises. Pour compléter le thème central du GACI,« l’environnement et les changements climatiques », la quatrième partie se penche sur les échanges de biens environnementaux du Canada avec les nouveaux marchés, et la dernière partie examine l’utilisation du régime tarifaire préférentiel du PTPGP par pays.
1. Aperçu du commerce et de l’investissement dans le cadre du PTPGP
1.1 Commerce de marchandises
Trois ans après l’entrée en vigueur du PTPGP, on constate une augmentation de 10 % du commerce total de marchandises entre le Canada et les nouveaux marchés du PTPGP (à savoir l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam, mais à l’exclusion du Mexique et du Pérou, avec lesquels le Canada avait déjà conclu des accords commerciaux). La valeur de ces échanges est passée de 47,3 milliards de dollars en 2018 à 52,1 milliards de dollars en 2021.
Les exportations de marchandises canadiennes vers les nouveaux marchés du PTPGP ont augmenté de 7,1 %, passant de 21 milliards de dollars en 2018, un an avant l’entrée en vigueur du PTPGP, à 22,5 milliards de dollars en 2019, première année d’application du PTPGP (figure 2). La majeure partie de la croissance entre 2018 et 2019 est attribuable à l’augmentation des exportations vers Singapour et le Japon. Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en 2020 a ébranlé l’économie mondiale et a considérablement perturbé la croissance du commerce bilatéral entre les membres du PTPGP. Toutefois, en 2021, les exportations du Canada vers les nouveaux marchés ont augmenté suffisamment pour récupérer toutes les pertes causées par la pandémie, atteignant un sommet historique de 22,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2018, dépassant ainsi la croissance des exportations de marchandises du Canada dans le monde de 8,1 % au cours de la même période. La croissance des exportations canadiennes entre 2018 et 2021 s’explique principalement par les exportations vers le Japon et l’Australie.
Figure 2Note de bas de page 6 :
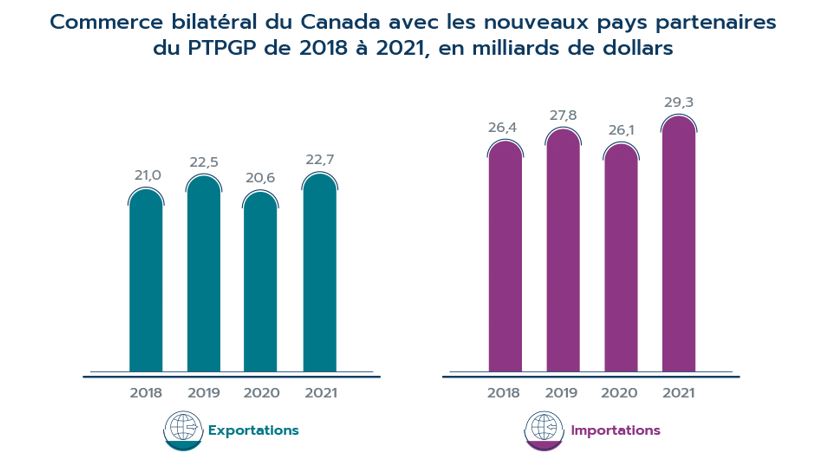
Données : Atlas du commerce mondial
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 2 - Version texte :
Commerce bilatéral du Canada avec les nouveaux pays partenaires du PTPGP de 2018 à 2021, en milliards de dollars
| Année | Exportations (milliards de dollars) | Importations (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 2018 | 21.0 | 26.4 |
| 2019 | 22.5 | 27.8 |
| 2020 | 20.6 | 26.1 |
| 2021 | 22.7 | 29.3 |
Données : Atlas du commerce mondial
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
À l’échelle sectorielle, l’essentiel de la hausse des exportations du Canada vers les nouveaux marchés du PTPGP au cours de la première année de l’accord provient de la vente de machines mécaniques, de produits pharmaceutiques, de viande, de combustibles minéraux, de minerais, de scories et de cendres. Du côté des importations, les machines électriques ont été le principal secteur à l’origine de cette croissance, constituant plus de 80 % de la hausse des importations du Canada en provenance des nouveaux marchés du PTPGP entre 2018 et 2019.
1.2 Commerce de services
Les exportations canadiennes de services vers les nouveaux marchés ont augmenté de 576 millions de dollars pour atteindre 5,9 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 10,7 % par rapport à leur niveau de 5,4 milliards de dollars en 2018. La croissance des exportations a été stimulée par le Japon, qui a représenté plus de la moitié de la croissance. Le Vietnam a également joué un rôle majeur, contribuant à plus du tiers de la hausse. Les importations canadiennes de services en provenance des nouveaux marchés ont atteint un sommet de 7,6 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à 2018. Là encore, le Japon a dominé la croissance des importations, représentant plus de la moitié de cette hausse.
Figure 3 :
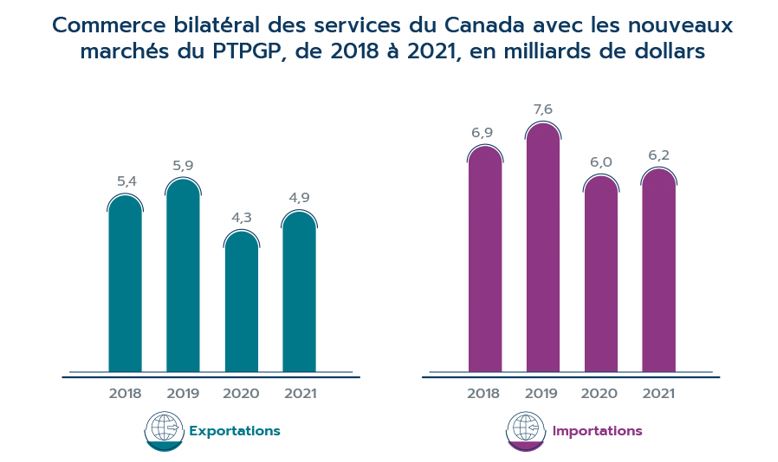
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 3 - Version texte :
Commerce bilatéral du Canada avec les pays partenaires existants du PTPGP de 2018 à 2021, en milliards de dollars
| Année | Exportations (milliards de dollars) | Importations (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 2018 | 14.8 | 38.2 |
| 2019 | 13.9 | 40.6 |
| 2020 | 12.2 | 33.6 |
| 2021 | 15.3 | 37.5 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
En ce qui concerne le commerce par catégorie de services, les services commerciaux ont constitué la majorité des exportations du Canada vers les nouveaux marchés du PTPGP en 2019, tandis que la majorité de ses importations provenaient du secteur des transports. De 2018 à 2019, les exportations de services du Canada ont été stimulées par le secteur des voyages, tandis que les importations l’ont été par le secteur des services commerciaux.
Le secteur des voyages a enregistré certains des gains les plus importants de 2018 à 2019, mais aussi les plus grandes pertes pendant la pandémie de COVID-19 à cause des restrictions imposées sur les voyages dans le monde. Les exportations et les importations canadiennes de services de voyage ont chuté de 53,5 % et 63,8 %, respectivement, entre 2018 et 2021. Les services de transport ont également reculé par rapport à 2018 : les exportations ont chuté de près de 30 %, tandis que les importations ont connu une légère contraction de 2,8 %. Malgré le ralentissement économique provoqué par la pandémie, les exportations et les importations de services commerciaux du Canada ont augmenté de 41,9 % et de 13,7 %, respectivement, entre 2018 et 2021.
1.3 Investissement direct étranger
En ce qui concerne l’investissement direct étranger (IDE), l’investissement direct du Canada dans les nouveaux marchés du PTPGP totalisait 63,3 milliards de dollars en 2019 (figure 4), une croissance modérée de 5,4 % par rapport à l’année précédente. L’essentiel de cette croissance est attribuable à une hausse de l’investissement en Australie et au Japon, tandis que l’investissement du Canada à Singapour a diminué de 33,5 %.
En ce qui concerne les investissements entrants, la valeur des IDE des nouveaux partenaires de libre-échange du PTPGP au Canada a atteint 53,5 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 15,2 % au cours de la première année suivant la ratification du PTPGP. Cette croissance est largement attribuable à l’augmentation de l’investissement en provenance de l’Australie, qui a bondi de 52,1 % ou 6,1 milliards de dollars.
Contrairement à la contraction qui s’est produite dans le commerce des services au cours de la première année de la pandémie, la valeur des investissements entrants et sortants du Canada s’est révélée résiliente et a poursuivi sa hausse en 2021. L’IDE sortant du Canada dans les nouveaux marchés du PTPGP a atteint un sommet de 69,8 milliards de dollars cette année-là, soit une augmentation de 16,1 % par rapport à 2018. L’IDE entrant au Canada a connu une croissance encore plus forte, augmentant de 28,9 % pour atteindre 59,9 milliards de dollars en 2021.
Figure 4 :
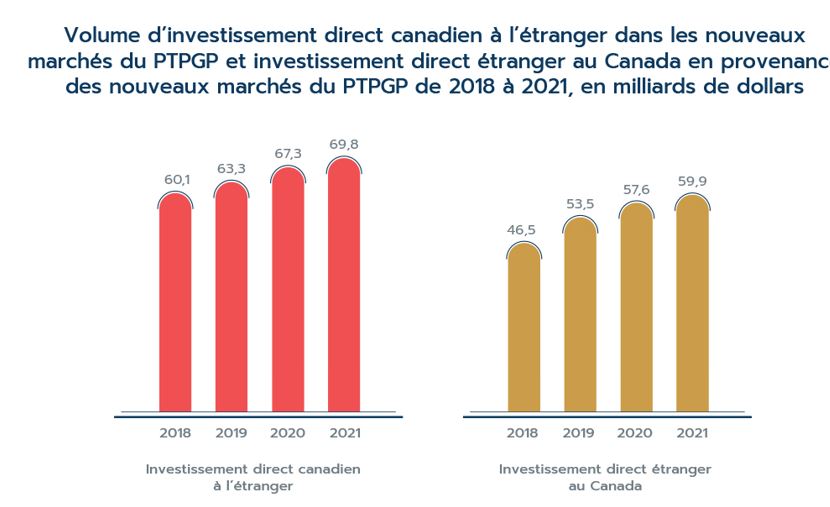
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 4 - Version texte :
Volume d’investissement direct canadien à l’étranger dans les nouveaux marchés du PTPGP et investissement direct étranger au Canada en provenance des nouveaux marchés du PTPGP de 2018 à 2021, en milliards de dollars
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Investissement direct canadien à l’étranger (milliards de dollars) | 60.1 | 63.3 | 67.3 | 69.8 |
| Investissement direct étranger au Canada (milliards de dollars) | 46.5 | 53.5 | 57.6 | 59.9 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
2. Création d’échanges commerciaux dans le cadre du PTPGP : commerce en régime de droits de douane et en franchise de droits de douane
Alors que la partie précédente a montré que les échanges commerciaux du Canada avec les nouveaux marchés du PTPGP ont augmenté dans l’ensemble, la présente partie vise à déterminer dans quelle mesure cette croissance est vraisemblablement attribuable au PTPGP. Pour ce faire, nous divisons la croissance du commerce en deux catégories : le commerce en régime de droits de douane et le commerce en franchise de droits. Cette ventilation est utile, car le PTPGP offre un accès tarifaire préférentiel à presque tous les produits, mais seuls les produits ayant un taux tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) positif (non nul) bénéficieraient de ces droits de douane réduits. Les produits déjà en franchise de droits aux termes de la NPF ne bénéficieraient pas davantage de réductions tarifaires. Ainsi, la croissance du commerce en régime de droits de douane après la mise en œuvre du PTPGP pourrait fournir une première indication des avantages de la libéralisation tarifaire.
Si ces comparaisons permettent d’illustrer les gains obtenus sur le plan commercial dans le cadre du PTPGP, elles n’indiquent pas l’existence d’un lien de causalité entre le PTPGP et le commerce. Bien que les réductions tarifaires exercent une forte influence sur le commerce bilatéral, de nombreux autres facteurs peuvent également influer sur les flux commerciaux, comme la variation du prix des produits de base et du taux de change et les conditions générales du marché dans les pays partenaires. En particulier, dans les flux commerciaux des années 2018 à 2021, les données sont affectées par les deux premières années de la pandémie de COVID-19 et la récente tendance à la hausse du prix des produits de base. D’avril 2020 à décembre 2021, l’indice des produits de base du FMI est passé de 84,79 à 186,18, soit un bond de 120 %.
De plus, comme le montre la figure 5 ci-dessous, la majorité des produits échangés entre le Canada et les nouveaux marchés du PTPGP sont déjà en franchise de droits. En fait, seulement 26,5 % des exportations canadiennes vers les nouveaux marchés du PTPGP, et 39,9 % des importations canadiennes en provenance de ces marchés, étaient considérées comme étant passibles de droits de douane en 2019. La part des exportations canadiennes soumises à des droits de douane dans les nouveaux marchés du PTPGP varie grandement d’un partenaire à l’autre, allant de près de 0 % dans le marché à zone franche de Singapour à 40,5 % en Australie. Du côté des importations, plus de 85 % des produits que le Canada a importés de Singapour et d’Australie étaient en franchise de droits, tandis que les importations en régime de droits en provenance du Japon et du Vietnam constituaient plus de 40 % des importations du Canada en provenance de chaque pays.
Figure 5Note de bas de page 7 :
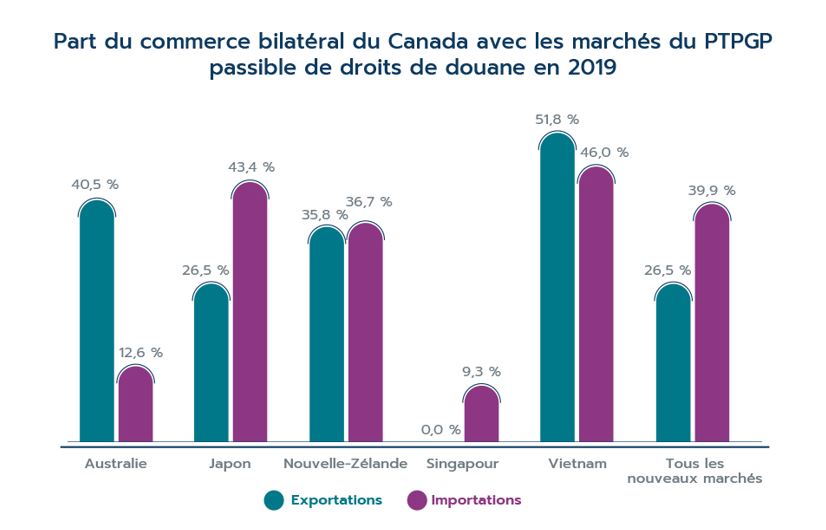
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP, données échangées
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 5 - Version texte :
Part du commerce bilatéral du Canada avec les marchés du PTPGP passible de droits de douane en 2019
| Marché | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| Australie | 40.5% | 12.6% |
| Japon | 26.5% | 43.4% |
| Nouvelle-Zélande | 35.8% | 36.7% |
| Singapour | 0.0% | 9.3% |
| Vietnam | 51.8% | 46.0% |
| Tous les nouveaux marchés | 26.5% | 39.9% |
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP, données échangées
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Par conséquent, la hausse du prix des produits de base pourrait avoir gonflé la hausse du commerce en franchise de droits, ce qui complique l’évaluation de l’effet du PTPGP sur la croissance du commerce en comparant les résultats commerciaux des produits en régime de droits et en franchise de droits. Toutefois, en accédant à d’autres données, on pourrait réaliser une analyse économétrique plus poussée dans un avenir proche pour isoler l’effet de création de commerce du PTPGP.
Comme le montre la figure 6, les exportations canadiennes soumises à des droits de douane vers les nouveaux marchés du PTPGP s’élevaient à 4,9 milliards de dollars en 2018, et les exportations en franchise de droits ont totalisé 14,9 milliards de dollars. Les exportations canadiennes soumises à des droits de douane ont connu une forte croissance au cours de la première année du PTPGP, augmentant de 9 % pour atteindre 5,3 milliards de dollars en 2019, tandis que les exportations en franchise n’ont augmenté que de 6,8 % au cours de cette période. La croissance nette des exportations en régime de droits a été stimulée par les exportations vers le Japon et l’Australie.
Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, la croissance des exportations en régime de droits du Canada vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande est devenue négative entre 2018 et 2021. Toutefois, malgré la contraction du commerce mondial, les exportations passibles de droits de douane vers le Japon n’ont cessé d’augmenter. Dans l’ensemble, les exportations soumises à des droits ont augmenté de 6,9 % de 2018 à 2021, soit légèrement moins que l’année suivant l’entrée en vigueur du PTPGP. Parallèlement, les exportations en franchise de droits du Canada ont connu de meilleurs résultats pendant la pandémie, augmentant de 10,5 % de 2018 à 2021, contre 6,8 % de 2018 à 2019. Cette hausse est en grande partie attribuable à une flambée des prix des produits de base cette année-là, qui a poursuivi sa tendance à la hausse en 2022.
Figure 6Note de bas de page 8 :
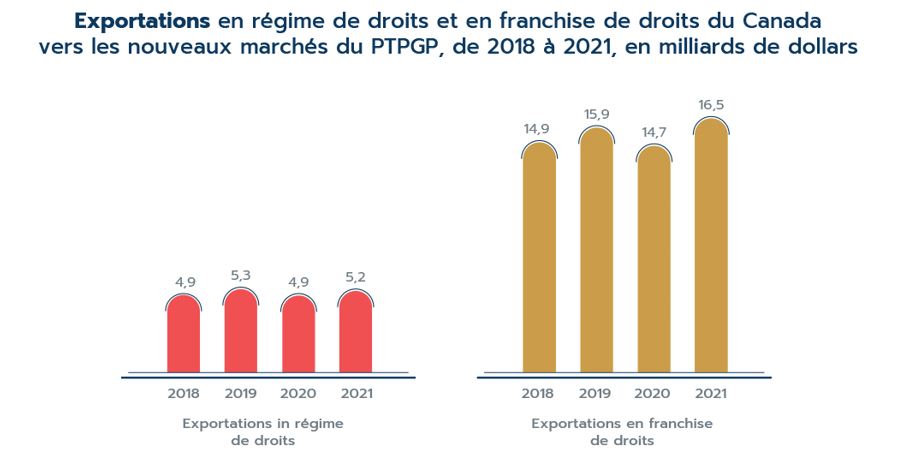
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 6 - Version texte :
Exportations en régime de droits et en franchise de droits du Canada vers les nouveaux marchés du PTPGP, de 2018 à 2021, en milliards de dollars
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Exportations en régime de droits (milliards de dollars) | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.2 |
| Exportations en franchise de droits (milliards de dollars) | 14.9 | 15.9 | 14.7 | 16.5 |
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
En ce qui concerne les importations, le Canada a fait entrer 10 milliards de dollars de produits en régime de droits de douane et 16,3 milliards de dollars de produits en franchise de droits en provenance des nouveaux marchés du PTPGP en 2018 (figure 7). Les importations canadiennes de produits en régime de droits de douane ont enregistré une croissance impressionnante au cours de la première année du PTPGP, soit une hausse de 10,4 %, tandis que les importations en franchise de droits n’ont progressé que de 2,4 %. Parmi les nouveaux marchés, le Vietnam et le Japon sont ceux qui ont le plus bénéficié des réductions tarifaires dans le cadre du PTPGP. Les importations en régime de droits de douane en provenance du Vietnam ont continué à augmenter pendant la pandémie et ont totalisé 3,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 41 % par rapport à leur valeur en 2018.
Figure 7 :
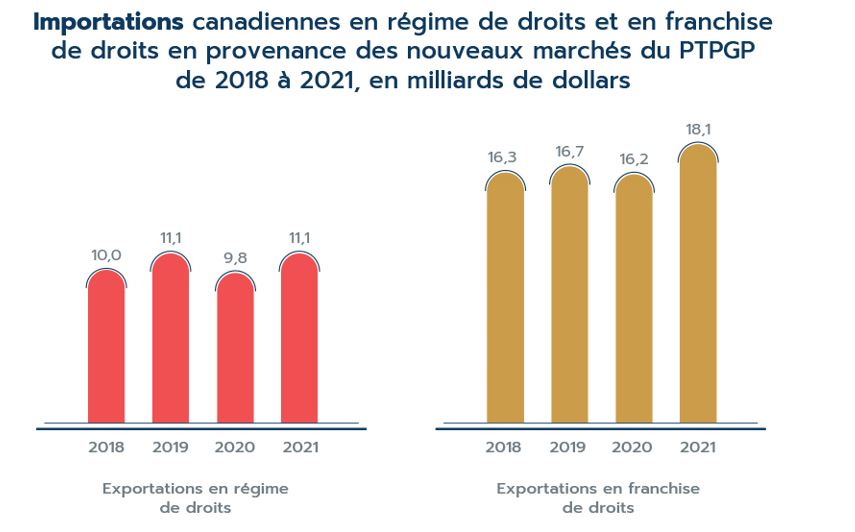
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 7 - Version texte :
Importations canadiennes en régime de droits et en franchise de droits en provenance des nouveaux marchés du PTPGP de 2018 à 2021, en milliards de dollars
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Importations en régime de droits (milliards de dollars) | 10.0 | 11.1 | 9.8 | 11.1 |
| Importations en franchise de droits (milliards de dollars) | 16.3 | 16.7 | 16.2 | 18.1 |
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Dans l’ensemble, les exportations canadiennes de produits carnés ont enregistré la plus forte augmentation des exportations en régime de droits de douane vers les nouveaux marchés du PTPGP de 2018 à 2021, augmentant de 286 millions de dollars, soit 17,2 % (voir figure 8). Cette croissance a été propulsée par les exportations de produits carnés vers le Japon, qui ont bondi de 307 millions de dollars. En outre, les exportations canadiennes de produits céréaliers ont augmenté de plus de 500 % tandis que celles de produits laitiers ont presque doublé pendant la même période.
La croissance des importations en régime de droits de douane du Canada en provenance des nouveaux marchés du PTPGP entre 2018 et 2021 a été stimulée par l’augmentation des importations de produits vestimentaires (bonneterie et autres) du Vietnam. Les importations de meubles et de caoutchouc en provenance du Vietnam ont également connu de fortes augmentations.
Figure 8 :

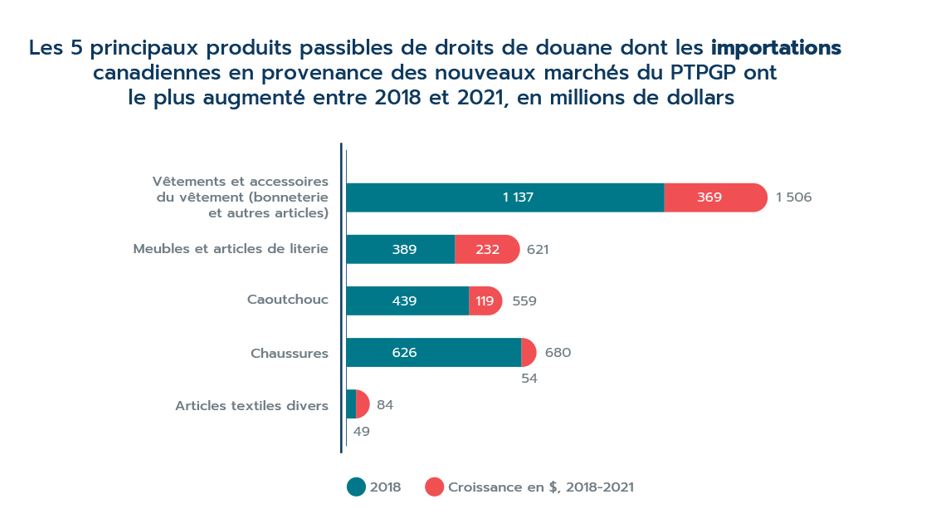
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Nota : Les chiffres au-dessus des barres superposées représentent les données pour 2021.
Figure 8 - Version texte :
Les 5 principaux produits passibles de droits de douane dont les exportations canadiennes vers les nouveaux marchés du PTPGP ont le plus augmenté entre 2018 et 2021, en millions de dollars
| Produit | Exportations en 2018 (millions de dollars) | Croissance entre 2018 et 2021 (millions de dollars) | Exportations en 2021 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Viande | 1,662 | 286 | 1,947 |
| Bois et autres produits connexes | 816 | 95 | 911 |
| Légumes | 42 | 20 | 63 |
| Céréales | 3 | 19 | 22 |
| Produits laitiers et produits connexes | 19 | 16 | 36 |
Les 5 principaux produits passibles de droits de douane dont les importations canadiennes en provenance des nouveaux marchés du PTPGP ont le plus augmenté entre 2018 et 2021, en millions de dollars
| Produit | importations en 2018 (millions de dollars) | Croissance entre 2018 et 2021 (millions de dollars) | Importations en 2021 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Vêtements et accessoires du vêtement (bonneterie et autres articles) | 1,137 | 369 | 1,506 |
| Meubles et articles de literie | 389 | 232 | 621 |
| Caoutchouc | 439 | 119 | 559 |
| Chaussures | 626 | 54 | 680 |
| Articles textiles divers | 35 | 49 | 84 |
Données : Statistique Canada, World Integrated Trade Solutions, Agence des services frontaliers du Canada, sites Web des douanes des différents membres du PTPGP
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Nota : Les chiffres au-dessus des barres superposées représentent les données pour 2021.
3. Exportations sous l’angle du commerce inclusif
La présente partie du rapport examine les aspects inclusifs des résultats commerciaux du Canada dans le cadre du PTPGP, en particulier pour savoir si le PTPGP a offert de meilleures possibilités aux PME et aux femmes. Les PME, les femmes et d’autres groupes traditionnellement sous-représentés ont souvent moins accès aux ressources et plus de mal à accéder aux débouchés commerciaux par rapport aux grandes entreprises. Ainsi, ces groupes sous-représentés peuvent être touchés par le PTPGP de manière différente et présenteraient donc des comportements distincts dans le cadre de cet accord.
L’analyse suivante puise dans les données de Statistique Canada sur le commerce par caractéristiques des exportateurs pour faire la lumière sur les résultats commerciaux des PME exportatrices canadiennes dans le cadre du PTPGP. En outre, elle évalue la mesure dans laquelle les PME canadiennes exportatrices, les travailleurs et les employées ont bénéficié des dispositions de réduction tarifaire du PTPGP. Un examen complet des résultats commerciaux des groupes sous-représentés dans le marché plus vaste défini par le PTPGP permettrait de mettre en lumière la dynamique commerciale des obligations de l’ALE et de démontrer les avantages de l’accord sur le plan de la durabilité et de l’inclusion.
3.1 Croissance des exportations des PME
En facilitant l’intégration économique, les accords commerciaux ouvrent aux PME des marchés plus vastes, qui leur permettent de se développer. Parmi les autres avantages de la libéralisation des échanges, citons la réduction des coûts de production grâce au renforcement des économies d’échelle et à l’accès direct aux intrants intermédiaires et aux ressources naturelles nécessaires à la production.
Les exportateurs canadiens sont principalement des PME de moins de 500 employés, mais celles-ci ont représenté moins de la moitié (41,1 %) du total des exportations mondiales du Canada en 2018. En revanche, les grandes entreprises étaient responsables de 58,9 % des exportations totales, alors qu’elles ne représentaient que 2,7 % de l’ensemble des entreprises exportatrices. Cette tendance se maintient depuis plusieurs décennies.
Dans le contexte du PTPGP, environ 5 397 PME canadiennes ont exporté vers les nouveaux marchés du PTPGP en 2018. Les petites entreprises constituaient plus des trois quarts de tous les exportateurs, et leurs exportations allaient principalement en Australie, au Japon et à Singapour. Les entreprises de taille petite à moyenne étaient la deuxième catégorie d’entreprises en importance, constituant 11,3 % des exportateurs, suivies des grandes entreprises (6,4 %) et des entreprises de taille moyenne à grande (4,7 %). Ensemble, les PME constituaient 93,6 % de toutes les entreprises canadiennes exportant vers les nouveaux marchés du PTPGP en 2018.
En ce qui concerne la valeur, les entreprises canadiennes ont exporté pour 16,7 milliards de dollars de produits vers les nouveaux marchés du PTPGP en 2018. Environ les deux tiers de ces exportations provenaient de grandes entreprises, et les PME comptaient pour 37,1 % des exportations totales vers cette région. La plupart des exportations des PME provenaient de petites entreprises, tandis que les entreprises de taille moyenne à grande représentaient la plus petite part des exportations.
Le nombre total de PME canadiennes exportant vers les nouveaux marchés du PTPGP est resté relativement stable au cours de la première année du PTPGP, et leurs exportations ont légèrement augmenté pour atteindre 6,4 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2018. L’essentiel de la hausse des exportations a été réalisé par les entreprises de taille moyenne à grande, qui ont vu leurs exportations bondir de 1,5 milliard de dollars en 2018 à 2,1 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 45,7 %. Bien que le nombre de grandes entreprises exportant vers les nouveaux marchés du PTPGP ait légèrement augmenté de 2018 à 2019, la valeur de leurs exportations a diminué de 4,4 %.
3.2 Croissance des exportations des PME en régime de droits de douane
Après l’examen de la trajectoire commerciale globale des PME et des grandes entreprises, la partie suivante discute des exportations canadiennes de produits soumis à des droits de douane qui ont obtenu des réductions tarifaires dans le cadre du PTPGP, selon la taille de l’entreprise.
Les exportateurs canadiens ont effectivement bénéficié de l’accord, leurs exportations passibles de droits vers les nouveaux marchés du PTPGP ayant augmenté de 18,3 %, soit 740 millions de dollars, au cours de l’année qui a suivi l’entrée en vigueur du PTPGP (voir figure 9)Note de bas de page 9. Alors que les grandes entreprises ont vu leurs exportations augmenter de 499 millions de dollars, soit 24 %, les PME ont également réussi à augmenter leurs exportations passibles de droits de douane de 241 millions de dollars de 2018 à 2019.
Figure 9 :
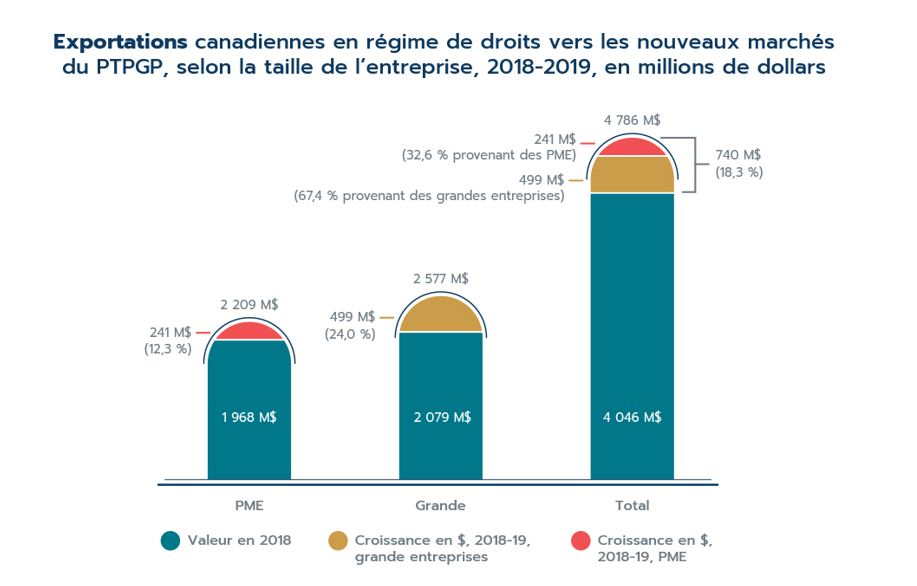
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 9 - Version texte :
Exportations canadiennes en régime de droits vers les nouveaux marchés du PTPGP, selon la taille de l’entreprise, 2018-2019, en millions de dollars
| Taille d'entreprise | Valeur en 2018 (millions de dollars) | Croissance entre 2018-19, grande entreprises (millions de dollars) | Croissance entre 2018-19, PME (millions de dollars) | Valeur en 2019 (millions de dollars) | Croissance entre 2018-2019, en % | Part de la croissance totale, en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PME | 1,968 | 241 | 2,209 | 12.3 | 32.6 | |
| Grande | 2,079 | 499 | - | 2,577 | 24.0 | 67.4 |
| Total | 4,046 | 499 | 241 | 4,786 | 18.3 | 100.0 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
En ce qui concerne la destination, le Japon a été le principal destinataire des exportations canadiennes passibles de droits de douane, tant pour les PME que pour les grandes entreprises (voir figure 10). Le Japon a également connu la plus forte augmentation des exportations soumises à des droits de douane provenant des grandes entreprises, qui ont bondi de 500 millions de dollars de 2018 à 2019. En ce qui concerne les PME, l’Australie est à l’origine de la majorité de la croissance, ses exportations passibles de droits ayant augmenté de 211 millions de dollars.
Figure 10 :
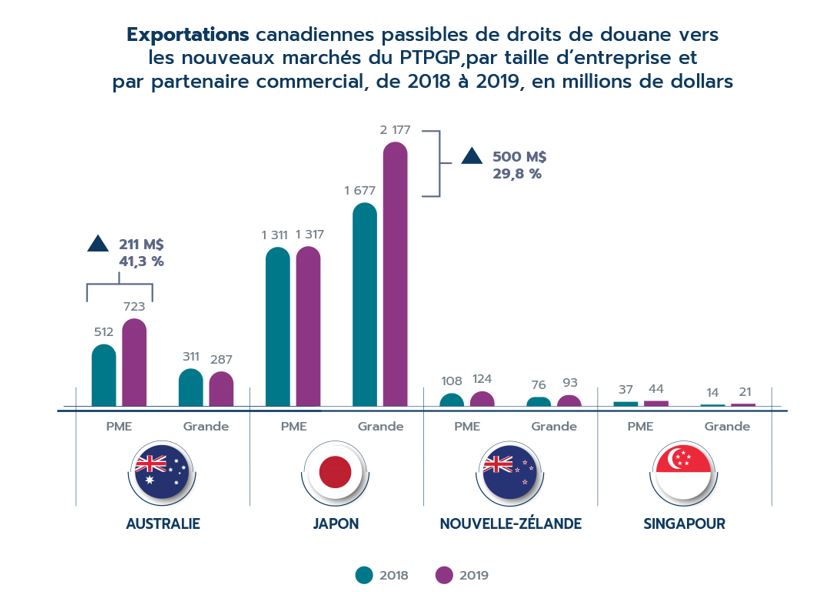
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 10 - Version texte :
Exportations canadiennes passibles de droits de douane vers les nouveaux marchés du PTPGP, par taille d’entreprise et par partenaire commercial, de 2018 à 2019, en millions de dollars
| Partnenaire commercial | Taille d'entreprise | Valeur en 2018 (millions de dollars) | Valeur en 2019 (millions de dollars) | Croissance entre 2018-19, en $ (millions de dollars) | Croissance entre 2018-2019, en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | PME | 512 | 723 | 211 | 41.3 |
| Grande | 311 | 287 | -24 | -7.7 | |
| Japon | PME | 1,311 | 1,317 | 6 | 0.5 |
| Grande | 1,677 | 2,177 | 500 | 29.8 | |
| Nouvelle-Zélande | PME | 108 | 124 | 17 | 15.5 |
| Grande | 76 | 93 | 16 | 21.3 | |
| Singapour | PME | 37 | 44 | 7 | 18.4 |
| Grande | 14 | 21 | 7 | 46.5 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
La figure 11 classe les exportations passibles de droits de douane du Canada par pays de destination et par type de PME. Fait à noter, la plupart des gains de l’Australie dans les produits passibles de droits exportés par les PME peuvent être attribués aux entreprises de taille moyenne à grande. Leurs exportations ont plus que triplé de 2018 à 2019, passant de 89 millions de dollars à 308 millions de dollars. Cette hausse est la deuxième en importance, en valeur pour toutes les tailles d’entreprises et tous les pays, après seulement celle des grandes entreprises exportant vers le Japon.
Figure 11 :
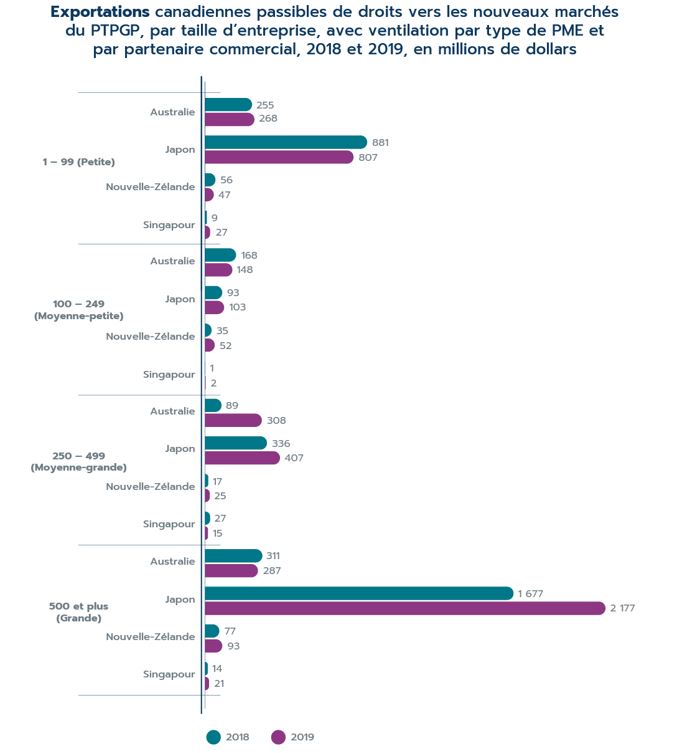
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 11 - Version texte :
Exportations canadiennes passibles de droits vers les nouveaux marchés du PTPGP, par taille d’entreprise, avec ventilation par type de PME et par partenaire commercial, 2018 et 2019, en millions de dollars
| Taille d'entreprise | Partnenaire commercial | Valeur en 2018 (millions de dollars) | Valeur en 2019 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| 1 – 99 (Petite) | Australie | 255 | 268 |
| Japon | 881 | 807 | |
| Nouvelle-Zélande | 56 | 47 | |
| Singapour | 9 | 27 | |
| 100 – 249 (Moyenne-petite) | Australie | 168 | 148 |
| Japon | 93 | 103 | |
| Nouvelle-Zélande | 35 | 52 | |
| Singapour | 1 | 2 | |
| 250 – 499 (Moyenne-grande) | Australie | 89 | 308 |
| Japon | 336 | 407 | |
| Nouvelle-Zélande | 17 | 25 | |
| Singapour | 27 | 15 | |
| 500 et plus (Grande) | Australie | 311 | 287 |
| Japon | 1677 | 2177 | |
| Nouvelle-Zélande | 77 | 93 | |
| Singapour | 14 | 21 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Une ventilation plus détaillée des entreprises par type de PME (figure 12) révèle que les entreprises de taille moyenne à grande sont la seule catégorie de PME qui a enregistré des gains importants dans le cadre du PTPGP. Les exportations soumises à des droits de douane de ce groupe ont augmenté de 61,1 %, soit 287 millions de dollars, tandis que les exportations passibles de droits ont légèrement diminué pour les petites entreprises et sont restées stables pour les entreprises de taille petite à moyenne.
Figure 12 :
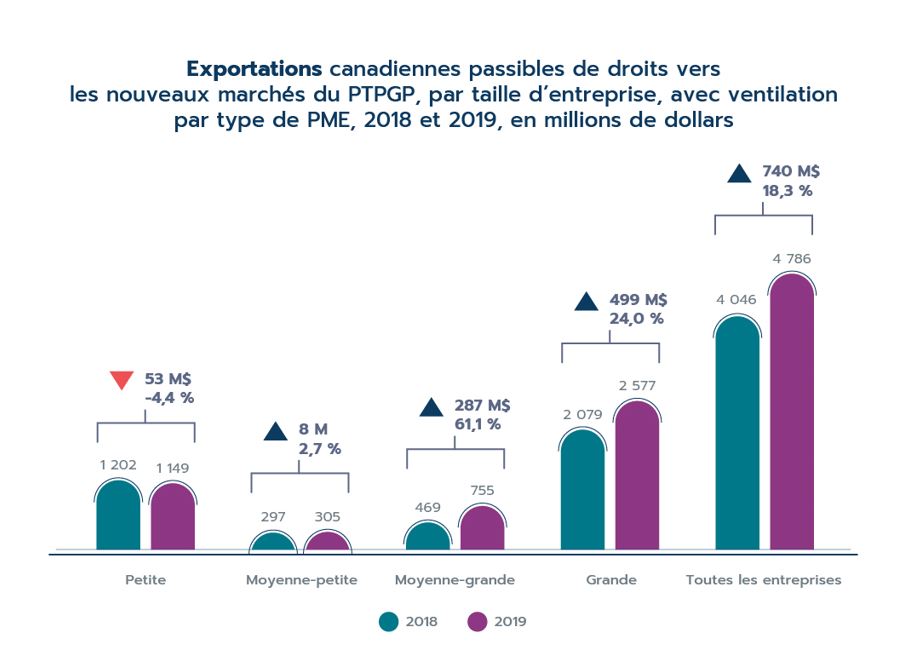
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 12 - Version texte :
Exportations canadiennes passibles de droits vers les nouveaux marchés du PTPGP, par taille d’entreprise, avec ventilation par type de PME, 2018 et 2019, en millions de dollars
| Taille d'entreprise | Valeur en 2018 (millions de dollars) | Valeur en 2019 (millions de dollars) | Part du total en 2018 | Part du total en 2019 | Croissance entre 2018-2019, en millions de dollars | Croissance entre 2018-2019, en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petite | 1,202 | 1,149 | 29.7% | 24.0% | -53 | -4.4 |
Moyenne-petite | 297 | 305 | 7.3% | 6.4% | 8 | 2.7 |
Moyenne-grande | 469 | 755 | 11.6% | 15.8% | 287 | 61.1 |
Grande | 2,079 | 2,577 | 51.4% | 53.8% | 499 | 24.0 |
Toutes les entreprises | 4,046 | 4,786 | 100.0% | 100.0% | 740 | 18.3 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Pour compléter l’analyse ci-dessus des exportations canadiennes soumises à des droits de douane au niveau global, une ventilation des exportations passibles de droits en fonction de l’importance de la réduction tarifaire de la NPF, ou marge de préférence, permet de mieux comprendre l’efficacité de l’accord.
La figure 13 montre la valeur des exportations canadiennes assujetties à des droits de douane vers les nouveaux marchés du PTPGP par marge de préférenceNote de bas de page 10. La croissance des exportations en régime de droits a été stimulée par les produits dont les marges de préférence sont supérieures à 10 points de pourcentage, ce qui démontre l’efficacité du PTPGP. Ces exportations ont grimpé en flèche, de 329 % ou 618 millions de dollars, au cours de la première année de l’accord, un bond qui représente plus de 80 % de la hausse totale des exportations en régime de droits. En revanche, les exportations bénéficiant des réductions tarifaires les plus faibles ont enregistré des gains mineurs entre 2018 et 2019, bien qu’elles représentaient plus de 85 % du total des exportations passibles de droits en 2019, et les exportations bénéficiant de réductions tarifaires comprises entre 5 et 10 points de pourcentage ont légèrement diminuéNote de bas de page 11.
Figure 13 :
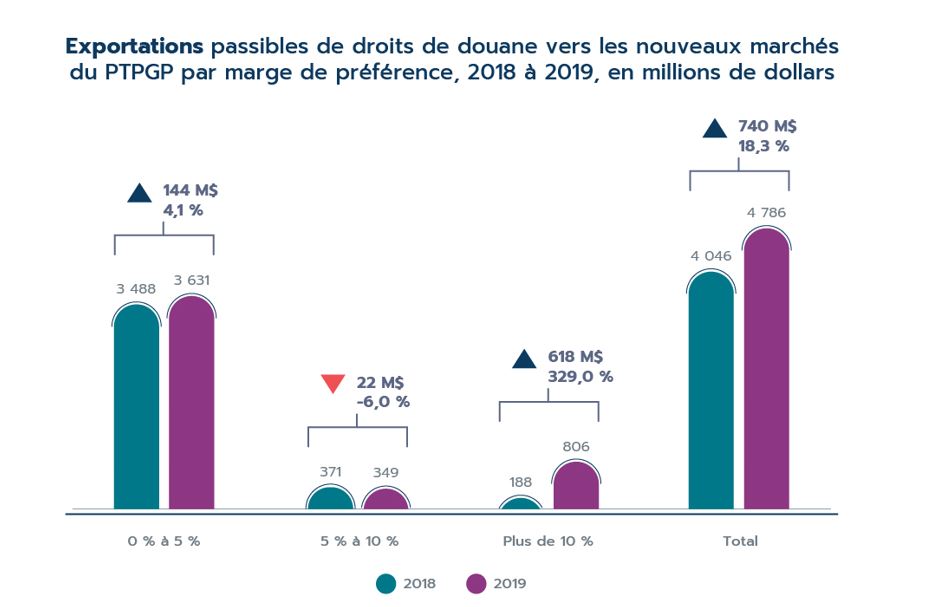
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 13 - Version texte :
Exportations passibles de droits de douane vers les nouveaux marchés du PTPGP par marge de préférence, 2018 à 2019, en millions de dollars
| Marge de préférence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0% à 5% | 5% à 10% | Plus de 10% | Total | |
| Exportations en 2018 (millions de dollars) | 3,488 | 371 | 188 | 4,046 |
| Exportations en 2019 (millions de dollars) | 3,631 | 349 | 806 | 4,786 |
| Croissance en $ entre 2018-19 (millions de dollars) | 144 | -22 | 618 | 740 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Une analyse plus approfondie des exportations en régime de droits par marge de préférence et par pays de destination révèle que le Japon était la principale destination des exportations passibles de droits du Canada dans toutes les gammes de marges de préférence. Sur le plan de la croissance, le Japon a mené la hausse des exportations, avec des marges de préférence supérieures à 10 %, exportations qui ont bondi de 330,4 %, ou 618 millions de dollars, de 2018 à 2019, et l’Australie a été le principal moteur des gains dans les marges de préférence de 0 % à 5 %. En revanche, les exportations ayant fait l’objet de réductions tarifaires comprises entre 5 % et 10 % ont baissé de 5,9 % dans le cas du Japon et de 33,9 % dans le cas de la Nouvelle-Zélande.
En ce qui concerne la taille des entreprises, la croissance des exportations passibles de droits de douane avec des marges préférentielles inférieures à 5 % a été propulsée par les entreprises de taille moyenne à grande (figure 14). Les grandes entreprises ont également connu une augmentation importante, tandis que les exportations des petites entreprises ont subi une baisse considérable. En revanche, on observe le contraire pour les marges de préférence comprises entre 5 et 10 %; les petites entreprises ont connu la plus forte hausse en valeur tandis que les grandes entreprises ont enregistré une baisse des exportations. Enfin, les exportations soumises à des droits de douane qui ont bénéficié d’une réduction tarifaire supérieure à 10 % ont augmenté pour les entreprises de toutes tailles. Les grandes entreprises ont enregistré la plus forte augmentation en valeur monétaire, leurs exportations ayant bondi de près de 400 millions de dollars, soit 238,8 %. Les entreprises de taille moyenne à grande et les petites entreprises ont également vu leurs exportations exploser entre 2018 et 2019.
Figure 14Note de bas de page 12 :
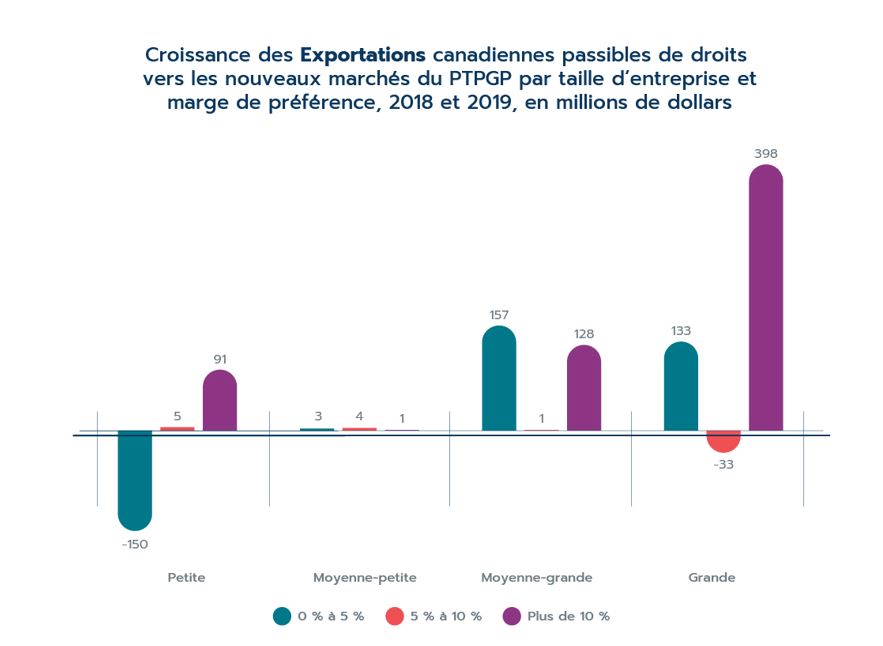
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 14 - Version texte :
Croissance des exportations canadiennes passibles de droits vers les nouveaux marchés du PTPGP par taille d’entreprise et marge de préférence, 2018 et 2019, en millions de dollars
| Croissance en M$, 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|
| 0% à 5% | 5% à 10% | Plus de 10% | |
| Petite | -150 | 5 | 91 |
| Moyenne-petite | 3 | 4 | 1 |
| Moyenne-grande | 157 | 1 | 128 |
| Grande | 133 | -33 | 398 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
3.3. Croissance de l’emploi dans les entreprises
La partie suivante donne un aperçu de l’emploi dans le cadre du PTPGP. Étant donné que la plupart de ces entreprises exportatrices exportent également vers d’autres destinations de premier plan, telles que les États-Unis et l’Europe, il serait difficile de lier l’évolution de l’emploi aux exportations vers les pays du PTPGP.
Le nombre total d’employés des entreprises qui ont exporté vers les nouveaux marchés du PTPGP s’élevait à 1,3 million en 2018, ce qui représentait 7,1 % du total des emplois canadiens cette année-là. Les hommes représentaient 68,2 % de la main-d’œuvre, et les femmes, 31,8 %.
Lorsque l’emploi est ventilé en fonction du montant de la croissance des exportations déclarée par les entreprises entre 2018 et 2019, comme le montre la figure 15, les entreprises dont les exportations ont augmenté de plus de 25 %, ou entreprises à forte croissance, ont connu une croissance de l’emploi, révélant ainsi une corrélation entre la croissance de l’emploi et les échanges commerciaux dans le cadre du PTPGP. Plus précisément, leur effectif a augmenté de 23,8 %, soit 135 000 employés, dans l’année qui a suivi l’entrée en vigueur du PTPGP.
Figure 15 :
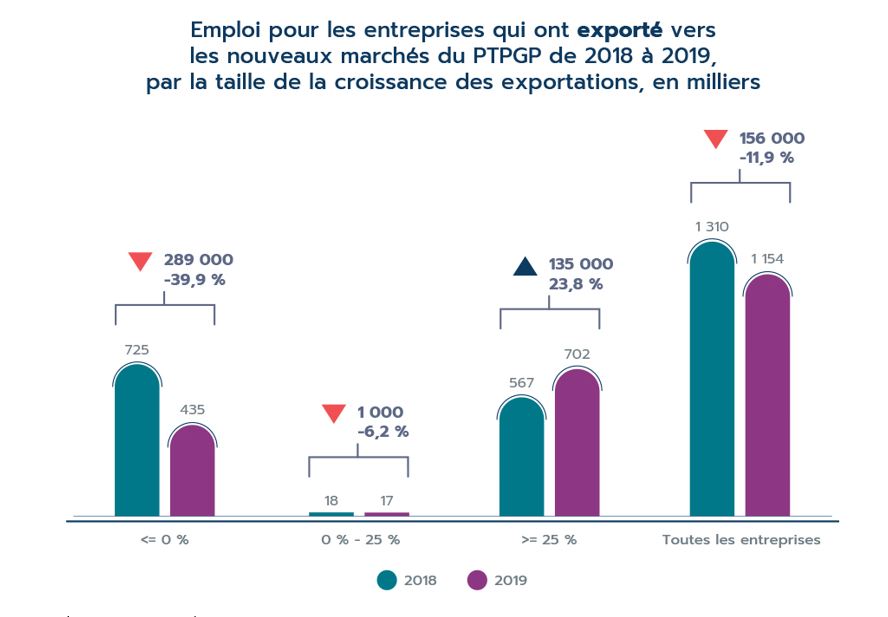
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 15 - Version texte :
Emploi pour les entreprises qui ont exporté vers les nouveaux marchés du PTPGP de 2018 à 2019, par la taille de la croissance des exportations, en milliers
| Croissance des exportations des entreprises de 2018 à 2019 | Emploi en 2018 (en milliers) | Emploi en 2019 (en milliers) | Croissance en $, 2018-2019 | Croissance en $, 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|
| <= 0% | 725 | 435 | - 289 | - 39.9 |
| 0% - 25% | 18 | 17 | - 1 | - 6.2 |
| >= 25% | 567 | 702 | 135 | 23.8 |
| Toutes les entreprises | 1,310 | 1,154 | - 156 | - 11.9 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
3.4 Croissance de l’emploi féminin
Il est communément admis que le commerce crée de meilleurs environnements pour les femmes, que ce soit en créant de meilleurs emplois ou en augmentant les revenus. En offrant un meilleur accès aux marchés étrangers, les ALE permettent aux entreprises commerçantes de produire davantage, de gagner davantage et d’embaucher davantage. Les femmes employées dans ces entreprises peuvent à leur tour bénéficier de l’amélioration de l’accès au marché par des voies directes et indirectes.
Dans le cas du PTPGP, l’emploi féminin dans les entreprises à forte croissance a augmenté de 11,4 % dans l’année qui a suivi l’entrée en vigueur de l’accord (figure 16). En revanche, les entreprises à faible croissance ont vu leur personnel féminin diminuer de 21 %, et le nombre de travailleuses a chuté de 33,2 % dans les entreprises qui ont déclaré une baisse des exportations de 2018 à 2019.
Figure 16 :

Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 16 - Version texte :
Emploi féminin dans les entreprises qui ont exporté vers les nouveaux marchés du PTPGP de 2018 à 2019, par taille de la croissance des exportations, en milliers
| Croissance des exportations des entreprises de 2018 à 2019 | Emploi en 2018 (en milliers) | Emploi en 2019 (en milliers) | Croissance en $, 2018-2019 | Croissance en $, 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|
| <= 0% | 211.4 | 141.2 | -70.2 | -33.2 |
| 0% - 25% | 6.1 | 4.8 | -1.3 | -21.0 |
| >= 25% | 198.9 | 221.5 | 22.6 | 11.4 |
| Toutes les entreprises | 416.4 | 367.5 | -48.9 | -11.7 |
Données : Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Sans surprise, les tendances de l’emploi féminin suivent les tendances générales de l’emploi décrites dans la partie précédente. Cette analyse permet de tirer deux conclusions. Premièrement, la forte croissance des exportations vers de nouveaux marchés est liée à la croissance de l’emploi total et de l’emploi féminin. Deuxièmement, il semble que les femmes soient quelque peu protégées des pertes d’emploi résultant d’une croissance négative des exportations, mais par contre, elles ne bénéficient pas de la forte croissance des exportations au même rythme que les hommes. Par exemple, bien qu’elles représentent 31,8 % de l’effectif, les femmes ne sont à l’origine que de 24,2 % des pertes d’emploi. Toutefois, les femmes n’ont représenté que 17 % de la croissance de l’emploi dans les entreprises à forte croissance. Ainsi, la situation de l’emploi féminin est quelque peu épineuse : si les femmes semblent moins susceptibles de perdre leur emploi que leurs collègues masculins, elles sont également moins susceptibles de bénéficier des nouvelles embauches associées à la croissance rapide des exportations. La raison de cette constatation n’est toutefois pas claire.
4. Le commerce des biens environnementaux dans le cadre du PTPGP
En 2014, un groupe de membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a entamé des négociations en vue d’établir l’Accord sur les biens environnementaux (ABE). Cet accord vise à éliminer les droits de douane sur certains produits susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de protection de l’environnement et du climat, dits « biens environnementaux »Note de bas de page 13.
En 2019, le Canada a exporté pour 1,5 milliard de dollars de biens environnementaux vers les nouveaux marchés du PTPGP, soit une hausse de 14,6 % par rapport à sa valeur de 1,3 milliard de dollars en 2018. Le Japon a été la principale destination de ces exportations, recevant près de 40 % du total des exportations canadiennes vers cette région, suivi de l’Australie et Singapour. Sur le plan de la croissance, Singapour a connu la plus forte augmentation en valeur et en pourcentage, ses exportations depuis le Canada ayant augmenté de 35,2 %, soit 102 millions de dollars, de 2018 à 2019.
Les importations canadiennes de biens environnementaux en provenance de ces nouveaux marchés ont totalisé 3,2 milliards de dollars en 2019, soit une baisse de 1,4 % par rapport à leur valeur de 3,3 milliards de dollars en 2018. La croissance de 2018 à 2019 a fortement varié selon les partenaires; alors que les importations en provenance du Japon ont diminué de 10,7 %, celles en provenance du Vietnam ont augmenté de 83,2 %.
De 2018 à 2021, les importations canadiennes de biens environnementaux ont augmenté de 16,9 %, pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 2021. La composition de la croissance au cours de cette période reflète le schéma observé de 2018 à 2019, alors que les importations en provenance du Vietnam avaient connu une hausse spectaculaire de 327,2 %, sous l’effet de la hausse des ventes de machines et de matériel électriques, tandis que les importations en provenance du Japon ont chuté de 11,5 %.
Figure 17 :
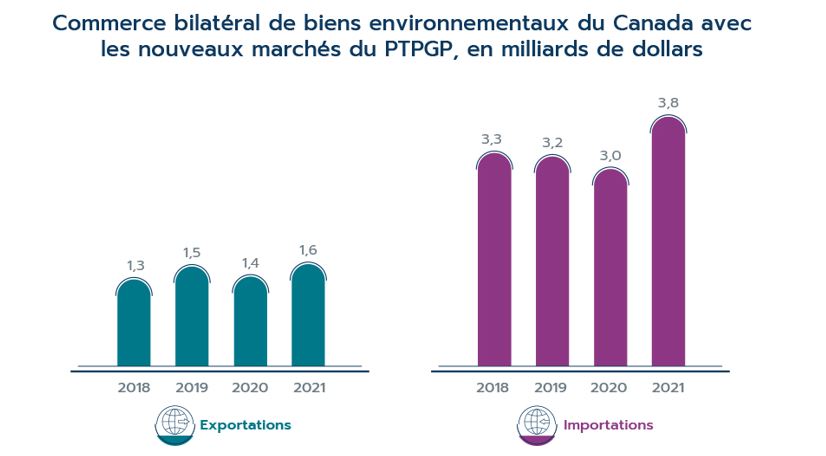
Données : Global Trade Atlas, Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 17 - Version texte :
Commerce bilatéral de biens environnementaux du Canada avec les nouveaux marchés du PTPGP, en milliards de dollars
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Exportations (milliards de dollars) | 1,342 | 1,538 | 1,378 | 1,568 |
| Importations (milliards de dollars) | 3,257 | 3,210 | 3,018 | 3,809 |
Données : Global Trade Atlas, Statistique Canada
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Au cours de la première année du PTPGP, la croissance en valeur des exportations canadiennes des biens environnementaux les plus échangés a été dominée par les machines écoénergétiques, qui ont augmenté de 178 millions de dollars. Toutefois, de 2018 à 2021, les exportations d’équipement de mesure de la pollution ont enregistré la plus forte augmentation en valeur, soit 67 millions de dollars, tandis que les exportations de machines écoénergétiques ont diminué de 3 millions de dollars. En revanche, cette tendance est inversée pour les importations canadiennes des biens environnementaux les plus échangés. De 2018 à 2019, la croissance des importations canadiennes a été menée par les produits d’équipement de mesure, et de 2018 à 2021, par les importations de machines écoénergétiques.
5. Application des tarifs préférentiels dans le cadre du PTPGP
Le taux d’utilisation des préférences tarifaires (TUPT) est un indicateur clé qui permet de déterminer si les partenaires d’un ALE profitent des avantages d’un accord commercial. Le TUPT mesure à quel point les préférences tarifaires prévues par un accord commercial sont appliquées lorsque les produits traversent les frontières. Pour qu’une économie bénéficie d’un ALE, ses entreprises doivent tirer parti des préférences obtenues dans le cadre de cet ALE. À cette fin, elles doivent revendiquer ces préférences et prouver qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des tarifs préférentiels. Par conséquent, les taux d’utilisation des préférences tarifaires constituent un indicateur important, car il démontre la mesure dans laquelle les accords commerciaux sont utilisés.
5.1 Taux d’utilisation des préférences tarifaires par pays
Comme le montre la figure 18, les TUPT des importations canadiennes en provenance des marchés du PTPGP sont plus élevés que ceux des exportations canadiennes, à l’exception du Japon. Ces dernières années, les TUPT des membres du PTPGP se sont améliorés de manière constante, tant pour les exportations que pour les importations. En outre, il convient de mentionner que les TUPT, tant pour les exportations que pour les importations ont augmenté pendant la pandémie.
Bien que les TPUT dans le cadre du PTPGP se soient améliorés dans l’ensemble, il existe de grandes variations dans les taux d’utilisation entre les pays membres. Les exportations canadiennes vers le Japon ont atteint assez rapidement des taux élevés dans l’utilisation des dispositions préférentielles du PTPGP, les entreprises profitant pleinement de ces dispositions dès l’entrée en vigueur du PTPGP. Néanmoins, les taux d’utilisation peuvent être très faibles pour les pays dont les ALE se chevauchent. Par exemple, en 2020, le Mexique a déclaré des TUPT de seulement 0,2 % pour ses importations en provenance du Canada dans le cadre du PTPGP. Cette faible utilisation peut s’expliquer par le fait que 64,2 % des importations mexicaines qui pouvaient prétendre aux dispositions préférentielles du PTPGP ont demandé d’autres traitements préférentiels. Bien que les données fournies par le gouvernement mexicain ne précisent pas les autres dispositions préférentielles utilisées, il serait raisonnable de penser qu’il a appliqué celles de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) ou celles de l’accord de l’OMC sur le commerce des aéronefs civilsNote de bas de page 14.
Dans le même ordre d’idées, les TUPT pour les exportations du Canada vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie en 2020 étaient également faibles par rapport aux taux d’importation du Canada en provenance de ces deux pays. Encore une fois, nombre de ces exportateurs n’ont pas profité des dispositions préférentielles du PTPGP, puisqu’ils réclamaient déjà des traitements préférentiels en vertu des accords commerciaux existants du Canada avec ces paysNote de bas de page 15.
Figure 18 :
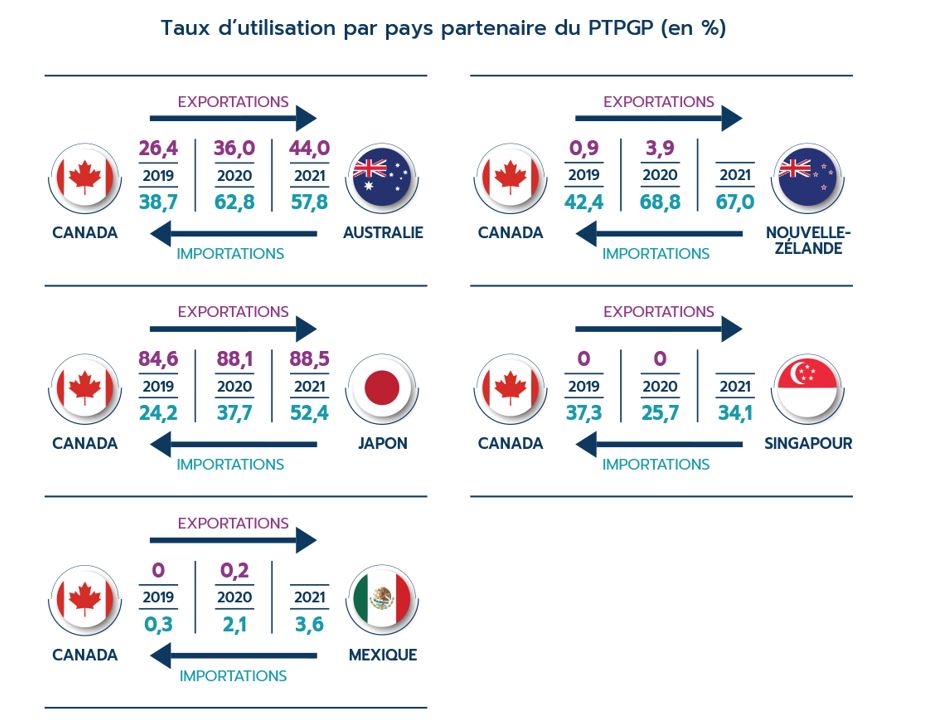
Sources : Compilation spéciale de données de Statistique Canada; échanges de données avec l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour.
Nota : Les échanges de données ont tendance à prendre du temps à se mettre en place; par conséquent, les calculs ne peuvent être effectués que pour 2021, pour certains pays membres seulement. Les cellules vides indiquent les années pour lesquelles les données n’étaient pas disponibles.
Figure 18 - Version texte :
Taux d’utilisation par pays partenaire du PTPGP (en %)
| Taux d'utilisation (en %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Australie | Exportations | 26.4 | 36.0 | 44.0 |
| Importations | 38.7 | 62.8 | 57.8 | |
| Nouvelle-Zélande | Exportations | 0.9 | 3.9 | |
| Importations | 42.4 | 68.8 | 67.0 | |
| Japon | Exportations | 84.6 | 88.1 | 88.5 |
| Importations | 24.2 | 37.7 | 52.4 | |
| Singapour | Exportations | 0 | 0 | |
| Importations | 37.3 | 25.7 | 34.1 | |
| Mexique | Exportations | 0 | 0.2 | |
| Importations | 0.3 | 2.1 | 3.6 | |
Sources : Compilation spéciale de données de Statistique Canada; échanges de données avec l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour.
Nota : Les échanges de données ont tendance à prendre du temps à se mettre en place; par conséquent, les calculs ne peuvent être effectués que pour 2021, pour certains pays membres seulement. Les cellules vides indiquent les années pour lesquelles les données n’étaient pas disponibles.
5.2 Économies tarifaires non utilisées par pays
L’une des raisons pour lesquelles les pays se concentrent sur le taux d’utilisation des préférences tarifaires des accords après leur signature est que les préférences permettent de réaliser des économies tarifaires dans les échanges commerciaux. Si ces dispositions ne sont pas entièrement utilisées, le montant des droits payés qui auraient pu être évités est appelé économies tarifaires non utilisées, et les droits qui ont été évités grâce aux demandes de traitement préférentiel constituent le montant des économies tarifaires utilisées. Ce sont les pays dont les TUPT sont les plus élevés qui économisent le plus de droits de douane.
En 2020, les exportations canadiennes vers les nouveaux marchés ont pu économiser environ 580 millions de dollars en droits de douane grâce à l’application du traitement préférentiel du PTPGP. Ces économies tarifaires peuvent encourager les entreprises à accroître leur compétitivité et à réduire les prix pour les consommateurs. Néanmoins, si les dispositions préférentielles du PTPGP avaient été pleinement utilisées, des économies supplémentaires de 52 millions de dollars auraient pu être réalisées.
Le Japon a enregistré la plus grande part des économies tarifaires utilisées pour les exportations canadiennes vers les nouveaux marchés en 2020 (figure 19). Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le Japon a également déclaré le plus haut taux d’utilisation dans le cadre du PTPGP (88,1 %). D’autre part, les économies tarifaires déclarées par la Nouvelle-Zélande et l’Australie représentent des parts considérablement plus faibles de leurs économies totales possibles dans le cadre du PTPGP, ce qui correspond aux TUPT plus faibles déclarés par les deux partenaires. En ce qui concerne les importations, les pays ayant les parts les plus élevées d’économies de droits de douane utilisés en 2020 étaient l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, le Vietnam, le Japon et Singapour ont épargné des parts plus faibles de leur épargne maximale possible. Ces pays ont également déclaré des taux d’utilisation nettement inférieurs à ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Figure 19Note de bas de page 16 :
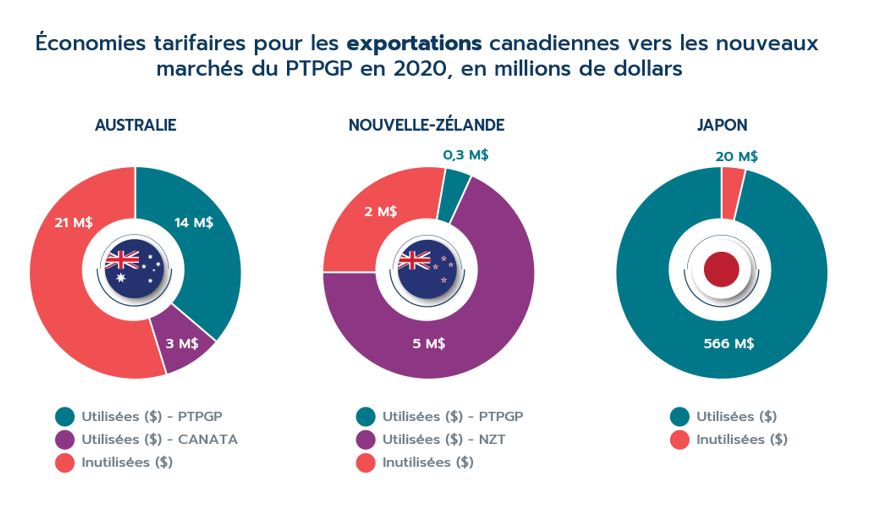
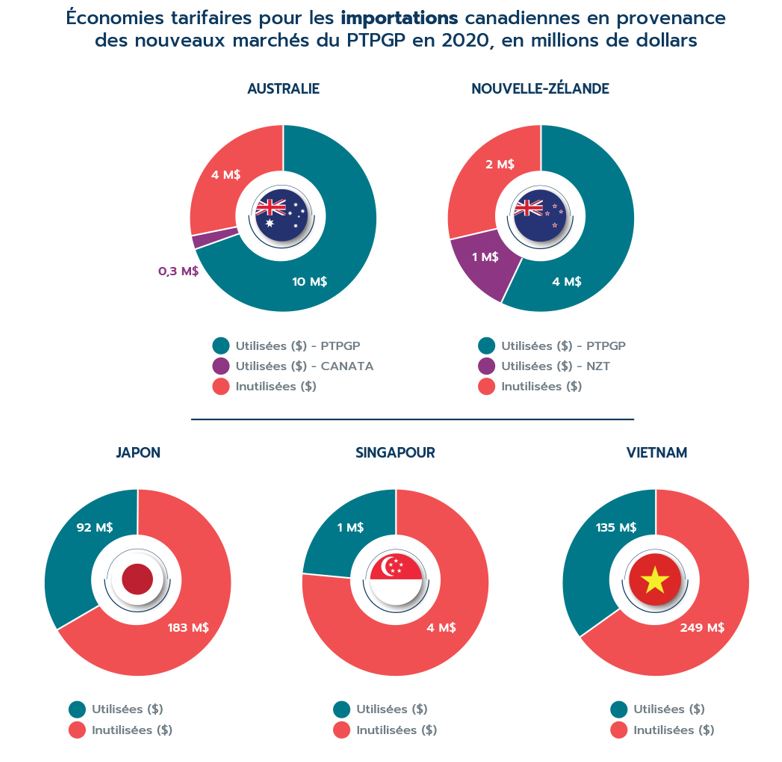
Données : Compilation spéciale de données de Statistique Canada; échanges de données avec l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Figure 19 - Version texte :
Économies tarifaires pour les exportations canadiennes vers les nouveaux marchés du PTPGP en 2020, en millions de dollars
| Australie | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) - PTPGP | 13.6 |
| Utilisées ($) - CANATA | 3.4 |
| Inutilisées ($) | 20.5 |
| Nouvelle-Zélande | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) - PTPGP | 0.3 |
| Utilisées ($) - NZT | 5 |
| Inutilisées ($) | 2.0 |
| Japon | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) | 566.23 |
| Inutilisées ($) | 20.36 |
Économies tarifaires pour les importations canadiennes en provenance des nouveaux marchés du PTPGP en 2020, en millions de dollars
| Australie | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) - PTPGP | 10 |
| Utilisées ($) - CANATA | 0.3 |
| Inutilisées ($) | 4 |
| Nouvelle-Zélande | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) - PTPGP | 4 |
| Utilisées ($) - NZT | 1 |
| Inutilisées ($) | 2 |
| Japon | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) | 92.1 |
| Inutilisées ($) | 183.1 |
| Singapour | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) | 1.1 |
| Inutilisées ($) | 3.6 |
| Vietnam | Économies tarifaires (millions de dollars) |
| Utilisées ($) | 134.9 |
| Inutilisées ($) | 249.4 |
Données : Compilation spéciale de données de Statistique Canada; échanges de données avec l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam.
Source : Bureau de l’économiste en chef, Affaires mondiales Canada
Conclusion de l’évaluation des retombées économiques
L’évaluation des retombées économiques (ERE) menée par le Canada s’est appuyée sur des données à l’échelon des entreprises pour évaluer l’état d’avancement à l’égard des éléments inclusifs prévus dans les obligations découlant du PTPGP. Cette évaluation quantitative vise à faire en sorte que chacun de ces éléments progresse de façon soutenue et que les PME, les travailleurs, les femmes et les autres groupes traditionnellement sous-représentés au Canada bénéficient de l’accord commercial.
L’analyse montre que les éléments inclusifs de l’Accord connaissent une solide progression. L’analyse révèle que, au cours de la première année d’application de l’Accord, les exportations passibles de droits de douane effectuées par des PME canadiennes vers les nouveaux marchés du PTPGP ont augmenté de 241 millions de dollars (12,3 %). L’analyse révèle aussi que le nombre d’emplois total s’est accru de 135 000 (23,8 %), et que le nombre d’emplois occupés par des femmes s’est accru de 23 000 (11,4 %), au sein des entreprises canadiennes qui ont augmenté considérablement leurs exportations vers les nouveaux marchés du PTPGP au cours de la première année de sa mise en œuvre. Les exportations de biens environnementaux des entreprises canadiennes ont également progressé de 14,6 % au cours de la première année et ont continué à augmenter en 2021.
Dans l’ensemble, ces résultats signalent une progression soutenue des éléments inclusifs prévus dans le PTPGP. Les analyses futures continueront d’évaluer ces éléments afin d’assurer que les avantages de l’Accord sont largement répartis dans l’ensemble des groupes et des régions au Canada.
Lacunes et possibilités
Le présent examen met en évidence la somme importante de travail et d’efforts déployés pour faire progresser l’inclusion dans le cadre du PTPGP, ainsi que plusieurs lacunes et possibilités. En venant combler ces lacunes et saisir ces occasions, le Canada et ses partenaires du PTPGP profiteraient d’avantages supplémentaires sur le plan de la durabilité et de l’inclusion.
Le PTPGP comprend de précieux chapitres mettant l’accent sur l’inclusion dans le commerce, notamment les chapitres respectifs sur les PME, l’environnement et le travail, et on trouve dans l’ensemble de l’Accord certaines dispositions sur le renforcement du pouvoir économique des femmes et l’égalité des genres, ainsi que sur les droits des peuples autochtones. Mais le PTPGP ne comporte pas certains éléments faisant maintenant partie intégrante de la politique commerciale inclusive du Canada et qui s’inscrivent dans une démarche d’ensemble pour intégrer des dispositions visant à favoriser l’égalité des genres et l’inclusion dans l’ensemble des ALE. À cet égard, le Canada dispose d’une marge de manœuvre pour tenter d’apporter des améliorations au PTPGP afin de combler ces lacunes. Il existe des possibilités d’agir pour combler les lacunes suivantes :
- Accroître l’égalité des genres et l’inclusion dans la mise en œuvre du PTPGP.
- Encourager les membres du PTPGP à adhérer à l’ACECPA.
- Renforcer les mesures à l’appui du développement économique régional au sein de chaque pays.
- Mesurer les résultats des activités de coopération.
- Assurer une participation régulière et inclusive des parties intéressées aux activités de mise en œuvre.
- Promouvoir la conduite responsable des entreprises (CRE) auprès des membres du PTPGP.
1. Intégration de l’égalité des genres et de l’inclusion
Certains comités du PTPGP ont intégré des facteurs liés à l’égalité des genres et à l’inclusion dans la mise en œuvre de leurs plans de travail, comme le fait remarquer le présent rapport. Le Canada a joué un rôle de premier plan en s’efforçant de faciliter l’intégration de ces questions dans les plans de travail des comités. Toutefois, il est possible d’en faire davantage pour assurer que le PTPGP procure des avantages à ces égards. Pour y parvenir, les activités menées par les comités doivent être plus délibérées et stratégiques, en tenant compte des questions liées à l’égalité des genres et à l’inclusion tout au long de leur mise en œuvre. Les parties au PTPGP devraient chercher à repérer et à supprimer les obstacles au renforcement du pouvoir économique des femmes et à faciliter la participation des femmes aux échanges commerciaux dans le cadre du PTPGP. Grâce à l’élaboration de nouvelles politiques, de nouveaux programmes et de nouveaux outils au sein des économies nationales, et à la collecte de données ventilées selon le genre, les Parties au PTPGP pourraient être mieux en mesure de savoir si ces efforts atteignent les résultats escomptés. Le Canada, par exemple, pourrait promouvoir l’ACS Plus au sein des comités et contribuer à la conception et à la réalisation d’activités visant davantage à favoriser l’égalité des genres et l’inclusion.
L’approche inclusive du Canada en matière de commerce s’appuie sur l’ACS Plus, un processus qui évalue la manière dont les activités, les politiques et les programmes nationaux et internationaux peuvent avoir une incidence sur divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires. Le « plus » de l’ACS Plus fait référence à la prise en compte de facteurs d’identité qui se recoupent, tels que le statut d’Autochtone, l’ethnie, le statut d’immigrant, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et la région de résidence (urbaine, rurale, éloignée, côtière ou nordique). L’ACS Plus vise à placer les personnes au cœur du processus décisionnel et à assurer que les politiques ne causent pas, ne perpétuent pas ou n’aggravent pas les inégalités actuelles.
L'ACS Plus peut également aider à mettre en évidence les inégalités actuelles. Voir la synthèse de l'analyse comparative entre les sexes plus finale du PTPGP.
L’application de l’ACS Plus à la politique et aux accords commerciaux permet d’assurer qu’ils visent à favoriser l’égalité des genres et l’inclusion. L’ACS Plus modifie la manière dont le Canada élabore et met en œuvre la politique commerciale.
2. Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones
Le PTPGP protège effectivement les droits des peuples autochtones, conformément à la ligne de conduite que le Canada suit habituellement dans ses accords commerciaux, mais il pourrait faciliter plus efficacement le développement économique et les débouchés commerciaux pour les peuples autochtones au Canada et dans d’autres pays du PTPGP. L’approche actuelle du Canada consiste à négocier un chapitre sur la participation des peuples autochtones au commerce. Ce chapitre comprend des dispositions qui visent à cerner et à éliminer les obstacles au commerce par l’échange de renseignements et de pratiques exemplaires.
Comme il est peu probable qu’un tel chapitre soit ajouté au PTPGP, il est possible de promouvoir l’ (ACECPA) auprès des Parties au PTPGP afin de faire progresser le renforcement du pouvoir économique et la participation des Autochtones au commerce international et dans la région du PTPGP. Le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Taïpei chinois ont approuvé l’ACECPA en marge du sommet de l’APEC de 2021. Les négociations sur l’ACECPA ont été inspirées par le Groupe d'action pour un commerce inclusif (GACI), étant donné que le groupe a négocié et signé avec succès l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG) en août 2020 et a désigné les droits des peuples autochtones comme une question d’intérêt mondial dans la Déclaration commune sur la promotion d’un commerce progressiste et inclusif.
L’ACECPA concorde avec l’approche inclusive du Canada en matière de commerce et la fait progresser. L’ACECPA s’inspire du chapitre sur la participation des peuples autochtones au commerce que le Canada cherche à intégrer dans les accords de libre-échange depuis 2017. L’ACECPA est un instrument commercial autonome fondé sur la collaboration, dirigé par les Autochtones et soutenu par le gouvernement. Il établit un cadre pour faciliter la collaboration entre les économies afin de cerner et d’éliminer les obstacles au renforcement du pouvoir économique des peuples autochtones et à leur participation au commerce. Il sert de complément à la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, en plus de contribuer à la réconciliation, au développement durable, à une prospérité économique inclusive et à la reprise économique après la pandémie de COVID‑19. D’autres pays, y compris l’ensemble des Parties au PTPGP, peuvent adhérer à l’ACECPA.
3. Développement économique régional
Le développement économique régional au sein des pays progresse grâce au commerce, et il s’agit là de l’un des enjeux mondiaux désignés dans la Déclaration commune en raison de ses liens importants avec la croissance économique inclusive. Le développement économique régional est particulièrement important pour le Canada en raison de sa taille et de la diversité de ses provinces, de ses territoires et de ses régions. En outre, l’expérience a montré que certaines régions pouvaient bénéficier davantage des accords commerciaux, tandis que d’autres pouvaient être affectées de manière disproportionnée par ceux-ci. Le Canada entend tenir compte de ces facteurs en appliquant l’ACS Plus aux ALE. Le Canada analyse les effets du commerce sur les habitants de divers milieux (urbain, rural, éloigné, nordique, côtier) afin de mieux comprendre les possibilités, les obstacles et les défis que les habitants de ces régions doivent relever. Pendant la négociation d’accords commerciaux, le Canada consulte régulièrement les provinces et les territoires, les peuples autochtones et les parties intéressées afin de mieux comprendre ce qu’ils considèrent comme important.
En rédigeant le présent rapport et en essayant d’effectuer une évaluation de l’efficacité du PTPGP, nous avons eu de la difficulté à trouver de l’information sur les efforts ou les activités déployés par les différents comités pour faire progresser le développement économique régional. Comme il est important que toutes les régions bénéficient des échanges commerciaux, y compris entre les Parties au PTPGP, il y a là une occasion d’examiner les moyens de concevoir et de mettre en œuvre efficacement des activités dans le cadre du PTPGP afin d’assurer que les avantages sont largement répartis entre les différentes régions, y compris au Canada.
4. Mesure des résultats
Le Canada a dirigé la mise en œuvre de nombreuses activités liées au commerce inclusif par les comités et par les partenaires du GACI, y compris des séminaires, des projets de recherche conjoints et des conférences, afin de sensibiliser, ainsi que d’échanger de l’information, des pratiques exemplaires et des leçons retenues. Toutefois, le Canada, les partenaires du GACI et les Parties au PTPGP n’ont pas encore défini ou élaboré de méthode pour évaluer et mesurer les résultats de ces activités. À l’heure actuelle, le Canada ne sait pas si ces activités ont les effets escomptés.
Étant donné que de nombreuses activités réalisées par les comités du PTPGP présentent une dimension liée à l’égalité des genres ou à l’inclusion ou des avantages sur le plan du développement durable, il est important de montrer que ces avantages sont obtenus. Ainsi, la mesure des résultats devrait faire partie de la conception et de la mise en œuvre des activités de coopération des comités du PTPGP. Il pourrait s’agir d’un domaine de travail du GACI pour l’avenir, en vue d’élaborer un processus, y compris des indicateurs qui pourraient être éclairés par les cibles et les indicateurs des Objectifs de développement durable de l’ONU, afin de mesurer les résultats des activités de coopération menées par les comités du PTPGP.
Le Bureau de l’économiste en chef d’Affaires mondiales Canada a élaboré une méthode empirique qui fait appel à des données à l’échelon des entreprises pour suivre l’état d’avancement de chaque élément inclusif lié au commerce dans le PTPGP et les résultats obtenus à cet égard. L’objectif consiste à disposer de données et de faits probants pour chaque élément clé afin de mieux suivre les avantages découlant de l’accord commercial. Cette méthode peut aussi aider à détecter les premiers signes d’effets négatifs possibles sur les groupes désignés. Toutefois, peu de données pertinentes sont actuellement disponibles. Il faudra déployer plus d’efforts pour obtenir des données autres que celles relatives aux PME, aux travailleurs et aux femmes sur le marché du travail. Le Canada a communiqué cette méthode aux partenaires du GACI afin de soutenir les futurs examens du GACI.
5. Consultation inclusive des intervenants
Un pilier important de l’approche inclusive du Canada en matière de commerce consiste à ouvrir les consultations à tous. Le gouvernement du Canada recherche et valorise un large éventail de points de vue de diverses parties intéressées, y compris ceux de groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce, tels que les femmes (par l’intermédiaire du Groupe consultatif sur l’égalité des genres et le commerce) et les peuples autochtones (par l’intermédiaire du Groupe de travail autochtone sur le commerce).
Bien qu’un certain dialogue multipartite ait eu lieu aux fins de la mise en œuvre de certains chapitres du PTPGP et des travaux des comités, en particulier du Comité sur l’environnement, un dialogue plus soutenu avec les parties intéressées pourrait renforcer les avantages des activités réalisées en matière de durabilité et d’inclusion.
La consultation et la mobilisation de groupes diversifiés facilitent la collecte de données qualitatives à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique commerciale. En outre, le dialogue multipartite favorise la transparence, la responsabilité et le soutien au commerce et aux accords commerciaux tels que le PTPGP.
Des représentants du Canada et des partenaires du GACI (Chili et Nouvelle-Zélande) ont fait part de leurs expériences respectives en matière de mobilisation multipartite en 2019. Depuis, tous ont renforcé leurs modèles de consultation et obtenu des avantages qu’ils peuvent faire connaître aux nouveaux membres du GACI et aux autres Parties au PTPGP afin de soutenir davantage la mise en œuvre du PTPGP.
6. Conduite responsable des entreprises
La promotion de la conduite responsable des entreprises (CRE) constitue une autre lacune à combler dans la mise en œuvre du PTPGP pour obtenir plus d’avantages en matière de durabilité et d’inclusion. Bien que le PTPGP comporte des dispositions relatives à la CRE dans les chapitres sur l’environnement, le travail, le développement, la coopération et le renforcement des capacités, ainsi que celui sur la transparence et la lutte contre la corruption, il est possible d’en faire davantage pour garantir leur application par les entreprises canadiennes dans les pays Parties au PTPGP. Par exemple, les membres du GACI devraient faciliter les discussions pertinentes entre les Parties au PTPGP pour faire progresser la CRE dans la mise en œuvre de l’Accord et promouvoir les pratiques de CRE en tant qu’aspect important du commerce inclusif et durable.
La CRE est au cœur de l’approche inclusive du Canada en matière de commerce. Il s’agit pour les entreprises d’intégrer la gestion des risques pour l’environnement, les personnes et la société dans leurs activités et de collaborer avec les parties intéressées à cette fin. La CRE comprend un large éventail de priorités qui se recoupent, telles que le respect des droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques, l’égalité des genres, la défense des droits des peuples autochtones, les droits de l’enfant, le renforcement de notre politique étrangère féministe, y compris la Politique d’aide internationale féministe du Canada, et l’élimination du travail forcé.
En avril 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur la conduite responsable des entreprises à l’étranger actuelle. Cette stratégie quinquennale s’applique à toutes les entreprises canadiennes actives à l’étranger, peu importe leur taille, leur secteur ou leur envergure, et réaffirme que le gouvernement du Canada s’attend à ce que les entreprises canadiennes contribuent au développement durable et soutiennent les engagements du Canada en matière de droits de la personne, en intégrant des pratiques commerciales responsables dans toutes leurs activités, y compris dans les chaînes d’approvisionnement internationales.
Depuis 2009, le Canada fait progresser les dispositions relatives à la CRE dans ses accords de libre-échange et ses accords sur la protection et la promotion des investissements étrangers (APIE). Les dispositions liées à la CRE comprennent des dispositions sur le développement durable, la protection de l’environnement, les droits des Autochtones, les droits des travailleurs, les droits de la personne, l’égalité des genres, la lutte contre la corruption, la transparence et la gouvernance.
Recommandations
Compte tenu des lacunes et des possibilités décrites précédemment, ainsi que des limites et autres défis relevés dans le présent examen, les recommandations sont claires quant aux mesures à prendre afin de tirer du PTPGP des avantages accrus en matière de durabilité et d'inclusion. Il est recommandé que :
- Les partenaires du GACI envisagent de mener des examens de l'efficacité de façon périodique et selon les besoins.
- Les Parties au PTPGP se joignent aux initiatives suivantes :
- le GACI, aux côtés du Canada, du Chili, du Costa Rica, de l'Équateur, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande;
- l'AMCG, aux côtés du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et du Pérou;
- l'ACECPA, aux côtés du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Taïpei chinois.
- Le Canada continue d'encourager les comités du PTPGP à :
- intégrer les considérations relatives à l'égalité des genres et à l'inclusion dans la conception et la mise en œuvre des activités de coopération;
- mettre en commun leurs expériences de l'application d'outils d'évaluation des retombées, notamment sous l'optique du genre (par exemple l'ACS Plus), dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale;
- intégrer dans la conception et la mise en œuvre des activités de coopération des moyens de mesurer et d'évaluer leur efficacité;
- intégrer régulièrement des consultations inclusives dans les travaux des comités du PTPGP;
- examiner les moyens de renforcer la prise en compte du développement économique régional au sein de chaque pays dans la mise en œuvre des activités du PTPGP, conformément à la Déclaration commune sur la promotion d'un commerce progressiste et inclusif.
- Le Canada demande aux parties intéressées d'examiner le présent rapport et tienne compte des résultats dans la planification de la présidence canadienne du PTPGP en 2024.
Prochaines étapes
À la suite de la publication du présent rapport, le Canada prendra les mesures suivantes :
- Solliciter l’avis des parties prenantes sur le présent rapport.
- Continuer à promouvoir l’adhésion au GACI, à l’AMCG et à l’ACECPA auprès des membres potentiels à l’échelle mondiale.
- Collaborer avec des experts sur la manière d’élaborer une méthode pour mesurer les résultats des activités de coopération.
Donnez votre avis
Affaires mondiales Canada aimerait recevoir des commentaires sur cet examen triennal du GACI d'ici le 20 octobre 2023. Nous invitons les lecteurs à soumettre leurs commentaires sur l'examen ou toute question s'y rapportant par courriel à consultations@international.gc.ca.
Questions pour guider les commentaires :
- En vous appuyant sur l'examen triennal du GACI, quelles sont, selon vous, les lacunes de l'analyse et quels en sont les risques?
- Comment le Canada et les autres membres du GACI peuvent-ils soutenir et renforcer la participation des groupes sous-représentés dans le commerce et dans la région du PTPGP?
- Quelles sont les questions commerciales inclusives les plus importantes sur lesquelles le Canada et les partenaires du PTPGP devraient se concentrer à l'avenir, y compris pendant l'année où le Canada présidera la Commission du PTPGP en 2024?
Annexe A : Liste des acronymes
- ACECPA
- Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones
- ACEUM
- Accord Canada–États-Unis–Mexique
- ACS Plus
- Analyse comparative entre les sexes Plus
- ADPIC
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
- ALE
- Accord de libre-échange
- AMCG
- Arrangement mondial sur le commerce et le genre
- APEC
- Forum de coopération économique Asie-Pacifique
- APII
- Amis de la propriété intellectuelle et de l’innovation
- ARM
- Accord de reconnaissance mutuelle
- CCEA
- Conseil canadien pour l’entreprise autochtone
- CDIP
- Comité du développement et de la propriété intellectuelle
- CRE
- Conduite responsable des entreprises
- ERE
- Évaluation des retombées économiques
- GACI
- Groupe d’action pour un commerce inclusif
- IDE
- Investissement direct étranger
- ISDE
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada
- MP
- Marché public
- MPME
- Microentreprises et petites et moyennes entreprises
- NPF
- Nation la plus favorisée
- OCDE
- Organisation de coopération et de développement économiques
- ODD
- Objectifs de développement durable
- OIT
- Organisation internationale du Travail
- OMC
- Organisation mondiale du commerce
- OMPI
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
- ONU
- Organisation des Nations Unies
- PI
- Propriété intellectuelle
- PME
- Petites et moyennes entreprises
- PTP
- Partenariat transpacifique
- PTPGP
- Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
- SDC
- Service des délégués commerciaux
- SPS
- Sanitaires et phytosanitaires
- STIM
- Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques
- TUPT
- Taux d’utilisation des préférences tarifaires
Annexe B : Résumés des chapitres du PTPGP
Chapitre 1 : Dispositions initiales et définitions générales — Ce chapitre comprend deux parties, la partie A – Dispositions initiales, et la partie B – Définitions générales. La partie A comprend les dispositions initiales affirmant le lien entre l’Accord de PTPGP et d’autres accords internationaux auxquels les parties au PTPGP ont adhéré. La partie B comprend les définitions générales qui définissent les termes employés dans l’Accord.
Chapitre 2 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits — L’objectif des obligations liées au traitement national et à l’accès aux marchés pour les produits est d’accroître et d’améliorer l’accès au marché pour les exportations de marchandises canadiennes vers les pays partenaires de l’ALE, de libéraliser le commerce et de créer un environnement commercial stable et prévisible, à l’avantage de l’économie.
Chapitre 3 : Règles d’origine et procédures d’origine — Les dispositions relatives aux règles d’origine définissent les conditions générales en vertu desquelles une marchandise peut être considérée comme provenant des marchés du PTPGP, et d’autres dispositions permettent de déterminer l’origine d’une marchandise. Les dispositions relatives aux procédures d’origine établissent les procédures qui régissent les règles d’origine et précisent les processus et obligations à respecter pour que les importateurs et les exportateurs bénéficient de taux de droits réduits ou libres. Elles fournissent aux autorités douanières une méthode pratique pour vérifier que seuls les produits admissibles bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALE.
Chapitre 4 : Produits textiles et vêtements — Chapitre distinct consacré aux règles d’origine pour les textiles et les vêtements. Ce chapitre contient des dispositions relatives aux règles d’origine et aux procédures d’origine ainsi qu’une annexe sur les règles d’origine propres aux produits et une courte liste qui permet l’usage de certains fils et tissus ne provenant pas de la région du PTPGP, car rares dans cette région.
Chapitre 5 : Procédures douanières et facilitation des échanges — Les objectifs de ce chapitre sont de promouvoir un environnement frontalier transparent et prévisible et d’accroître l’efficacité des procédures douanières.
Chapitre 6 : Recours commerciaux — À l’instar des derniers ALE conclus par le Canada, le PTPGP réaffirme les droits et obligations de l’OMC en matière de mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde globale dans le cadre des accords pertinents de l’OMC. Le PTPGP renforce également certaines pratiques exemplaires internationales en matière de transparence et d’équité procédurale dans la conduite des enquêtes sur les recours commerciaux.
Chapitre 7 : Mesures sanitaires et phytosanitaires — Ce chapitre s’appuie sur l’Accord relatif à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, lequel maintient le droit de chaque pays membre de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires pour protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, tout en facilitant les échanges commerciaux.
Chapitre 8 : Obstacles techniques au commerce — S’appuyant sur l’Accord sur obstacles techniques au commerce de l’OMC, les dispositions du PTPGP sur ces obstacles empêchent les exigences réglementaires inutiles ou discriminatoires d’éroder les gains en accès au marché négociés ailleurs dans l’Accord.
Chapitre 9 : Investissement — Ce chapitre offre aux investisseurs canadiens davantage de protection, de prévisibilité et de transparence pour leurs investissements dans les marchés à croissance rapide du PTPGP.
Chapitre 10 : Commerce transfrontières des services — Ce chapitre promeut le commerce des services à valeur ajoutée entre les parties au PTPGP et soutient la transformation du Canada en une économie du savoir qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes des emplois de haute qualité et bien rémunérés.
Chapitre 11 : Services financiers — Ce chapitre comprend des engagements en matière d’accès aux marchés pour les échanges et les investissements transfrontières dans le domaine des services financiers ainsi qu’une clause d’exemption prudentielle robuste qui donne aux organismes de réglementation la latitude nécessaire pour prendre des mesures prudentielles.
Chapitre 12 : Admission temporaire des hommes et femmes d’affaires — Ce chapitre renforce les débouchés des entreprises canadiennes en améliorant la circulation transfrontalière des personnes, accroissant ainsi l’investissement, l’innovation, l’efficacité économique, la création d’emplois et la prospérité.
Chapitre 13 : Télécommunications — Ce chapitre renforce la certitude des fournisseurs de services en matière de réglementation des télécommunications, puisqu’il contient des disciplines incitant les autorités de réglementation des télécommunications à agir de manière impartiale, objective et transparente.
Chapitre 14 : Commerce électronique — Ce chapitre vise à faciliter l’utilisation du commerce électronique comme moyen d’échange et s’appuie sur les engagements pris par le Canada dans les ALE qu’il a conclus précédemment.
Chapitre 15 : Marchés publics — Ce chapitre contient deux parties : les règles procédurales et les engagements en matière d’accès aux marchés de chaque partie. Les règles procédurales établissent la manière dont les marchés publics sont conduits et régis par quatre obligations fondamentales : la non‑discrimination, la transparence, l’équité et la responsabilité. L’accès aux marchés renforce les engagements pris par le Canada dans ses ALE et dans l’accord de l’OMC sur les marchés publics, y compris les engagements pris relativement aux marchés publics auprès de gouvernements sous‑centraux du Chili et du Pérou. La Malaisie et le Vietnam ont pris des engagements en matière de marchés publics pour la première fois dans le cadre d’un ALE international.
Chapitre 16 : Politique en matière de concurrence — Ce chapitre favorise les marchés ouverts et concurrentiels et veille à ce que les avantages de la libéralisation des échanges ne soient pas neutralisés par des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
Chapitre 17 : Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés — Ce chapitre couvre les entités qui exercent principalement des activités commerciales. Afin de garantir une concurrence équitable aux entreprises privées qui rivalisent avec les entreprises publiques, ce chapitre engage les entités visées à respecter des obligations de non‑discrimination. Il exige aussi des entités concernées qu’elles agissent conformément aux considérations commerciales, sauf lorsqu’une entité remplit son mandat public. Enfin, il interdit aux parties de fournir une aide non commerciale aux entreprises étatiques qui produisent et vendent des biens sur le territoire d’une autre partie.
Chapitre 18 : Droits de propriété intellectuelle — Le PTPGP contient un chapitre complet sur la protection et la mise en application des droits de propriété intellectuelle. Ce chapitre conserve les gains obtenus dans le PTP en matière de propriété intellectuelle dans la plupart des domaines, gains qui s’appuient eux‑mêmes sur les traités de propriété intellectuelle existants, tels que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC et un certain nombre de traités administrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. À la suite du retrait des États‑Unis du PTP, les parties au PTPGP ont accepté de suspendre certaines dispositions du nouvel accord afin de prendre en considération les intérêts et les priorités des parties dans le rééquilibrage des gains en matière de propriété intellectuelle et la création d’une norme sur la propriété intellectuelle dans la région de l’Asie‑Pacifique.
Chapitre 19 : Travail — Les engagements du PTPGP en matière de travail protègent et autonomisent les travailleurs, y compris les Canadiens, en exigeant des pays partenaires qu’ils respectent des normes communes sur le travail, adoptées à l’échelle internationale. Toutefois, l’accent est mis sur les marchés du PTPGP, car les inégalités persistent sur les marchés du travail mondiaux, sur le plan des possibilités, du traitement et des résultats.
Chapitre 20 : Environnement — Ce chapitre vise à maintenir et à promouvoir une forte protection de l’environnement et veille à ce que les parties ne relâchent pas leur protection de l’environnement pour promouvoir le commerce ou l’investissement, estimant que la promotion du commerce et la protection de l’environnement devraient se soutenir mutuellement.
Chapitre 21 : Coopération et renforcement des capacités — Ce chapitre promeut l’accélération de la croissance économique et du développement en encourageant les activités qui renforcent la capacité des parties à tirer parti de l’ALE.
Chapitre 22 : Compétitivité et facilitation des affaires — Ce chapitre crée des mécanismes officiels qui évaluent l’incidence de l’Accord sur la compétitivité régionale, l’intégration économique et le développement de la zone de libre‑échange.
Chapitre 23 : Développement — Ce chapitre porte sur la promotion du commerce libre et des possibilités d’investissement en soutien au développement des parties.
Chapitre 24 : Petites et moyennes entreprises — Ce chapitre comporte deux grands volets : 1) la diffusion de l’information relative au PTPGP, y compris la création par chaque partie d’un site Web lié au PTPGP et consacré aux PME; 2) la création d’un comité des PME chargé d’examiner les questions commerciales qui concernent les PME.
Chapitre 25 : Cohérence en matière de réglementation — Ce chapitre promeut une plus grande transparence et de bonnes pratiques réglementaires, en vue d’améliorer la gouvernance tout en tenant compte des objectifs légitimes de chaque partie à l’ALE en matière de politiques.
Chapitre 26 : Transparence et lutte contre la corruption — Le PTPGP contient un chapitre en deux parties sur la transparence et la lutte contre la corruption. L’objectif premier des dispositions de ce chapitre sur la lutte contre la corruption est d’exiger des parties qu’elles considèrent les actes de corruption comme étant des infractions pénales, y compris le versement de pots‑de‑vin à des agents publics nationaux ou étrangers, la sollicitation de pots‑de‑vin par des agents publics et leur acceptation. Les dispositions du PTPGP relatives à la transparence stipulent que les lois, les règlements, les procédures et les décisions administratives qui portent sur les questions abordées par l’Accord doivent être rapidement publiés ou mis à disposition d’une autre manière.
Chapitre 27 : Dispositions administratives et institutionnelles — Les dispositions administratives et institutionnelles définissent les modalités de gestion et de mise en œuvre de l’Accord par les parties. Elles établissent la structure, la fonction, les processus et les procédures de la Commission de l’Accord, qui supervise la mise en œuvre et le fonctionnement de l’Accord.
Chapitre 28 : Règlement des différends — Le mécanisme de règlement des différends du PTPGP prévoit le recours à un groupe d’experts impartial, permettant aux États de régler efficacement les questions commerciales qui les opposent. Cela garantit la prévisibilité et l’équité dans la résolution des différends.
Chapitre 29 : Exceptions et dispositions générales — Les dispositions relatives aux exceptions donnent à toutes les parties au PTPGP la pleine capacité de légiférer dans l’intérêt public, y compris dans l’intérêt sécuritaire des parties et pour d’autres motifs de bien‑être public.
Chapitre 30 : Dispositions finales — Les dispositions finales définissent les procédures relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, à l’adhésion à l’Accord et à la sortie de l’Accord.
Annexe C : Liste des comités créés en vertu de l’Accord
| Accès au marché des marchandises | Admission temporaire |
| Agriculture | Services financiers |
| Règles d’origine et procédures d’origine | Télécommunications |
| Questions commerciales relatives aux textiles et aux vêtements | Groupe de travail sur les services professionnels |
| Mesures sanitaires et phytosanitaires | Cohérence en matière de réglementation |
| Obstacles techniques au commerce | Marchés publics |
| Environnement | Compétitivité et facilitation des affaires |
| Travail | Petites et moyennes entreprises |
| Entreprises appartenant à l’État | Coopération et renforcement des capacités |
| Développement | Commerce électronique |
Annexe D : Critères d’adhésion à l’AMCG
Les économies qui souhaitent adhérer à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG) doivent :
- Avoir ratifié la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ou y avoir adhéré.
- Avoir souscrit à la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisationéconomique des femmes.
- Démontrer un intérêt réel pour la promotion de l’égalité des genres au niveau national (au moyen de politiques, de lois ou de programmes).
- Promouvoir la paix et la sécurité à l’échelle nationale et mondiale.
- Être membres de l’OMC ou participer activement à des négociations en vue de leur adhésion à cette organisation.
Le ministre du Commerce du pays (ou son représentant désigné) doit signer l’Arrangement et faire participer les ministères nationaux concernés, le cas échéant.
Annexe E : Dispositions sur l’égalité des genres dans le PTPGP
Le PTPGP intègre plusieurs dispositions relatives à l’égalité des genres.
- Le préambule réaffirme, entre autres, l’importance de promouvoir l’égalité des genres, les droits des travailleurs, le commerce inclusif et le développement durable.
- Le chapitre sur le travail comporte des dispositions sur la promotion de l’égalité, l’élimination de la discrimination et les intérêts des femmes en matière d’emploi.
- Le chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités comprend l’égalité des genres comme domaine de coopération proposé.
- Le chapitre sur le développement comprend l’article intitulé « Femmes et croissance économique » et prévoit des activités de coopération possibles visant à renforcer la capacité des femmes, y compris les travailleuses et les propriétaires d’entreprises, à accéder pleinement aux possibilités créées par le PTPGP et à en tirer profit.
Annexe F : Tableaux infographiques sur le commerce et le genre dans le cadre du PTPGP
- Tableau infographique général – Région du PTPGP
- Australie
- Japon
- Malaisie
- Mexique
- Nouvelle-Zélande
- Pérou
- Singapour
- Vietnam
- Date de modification: